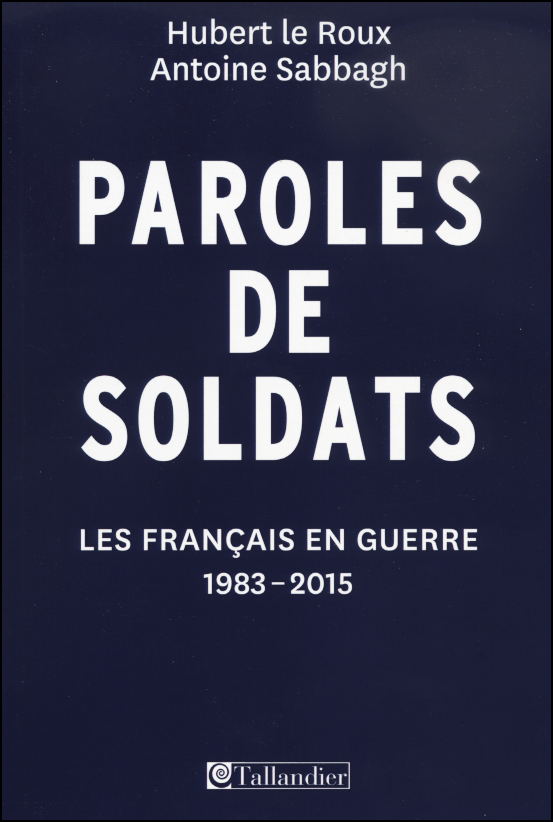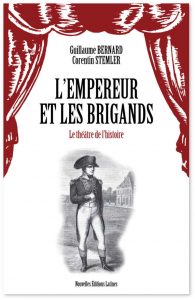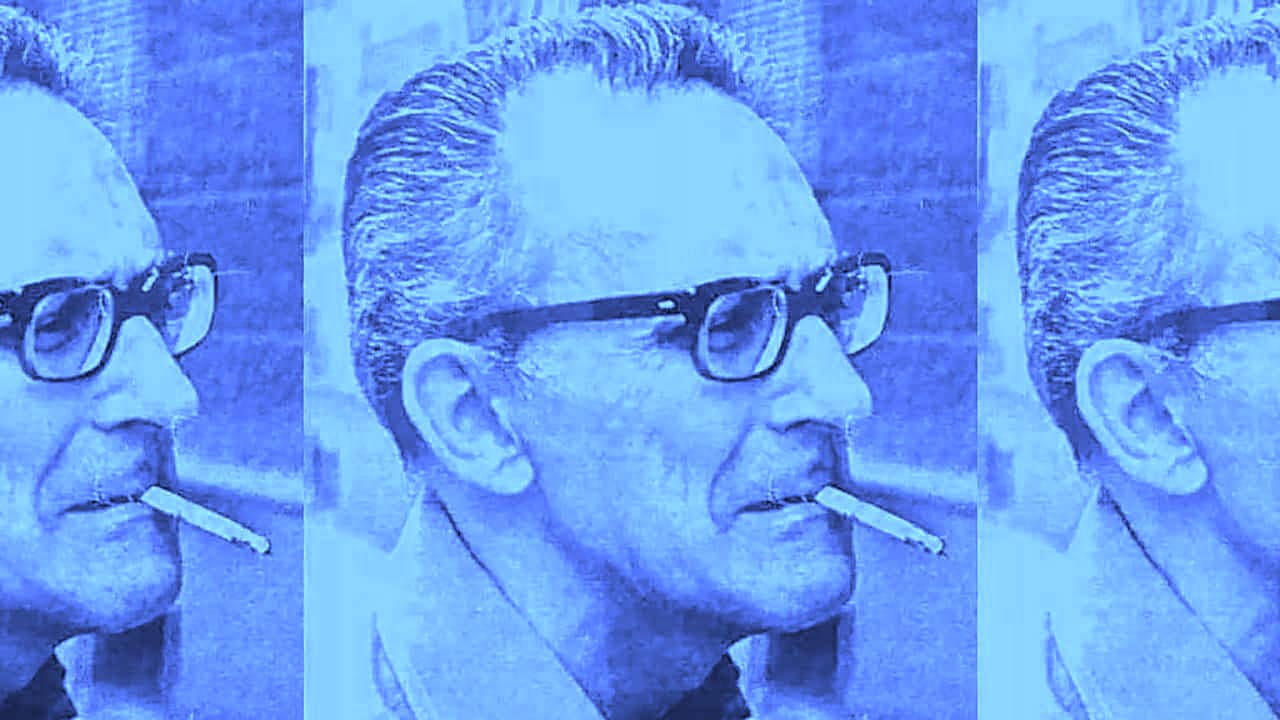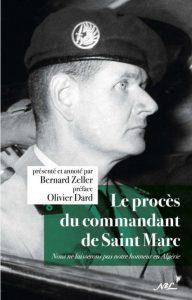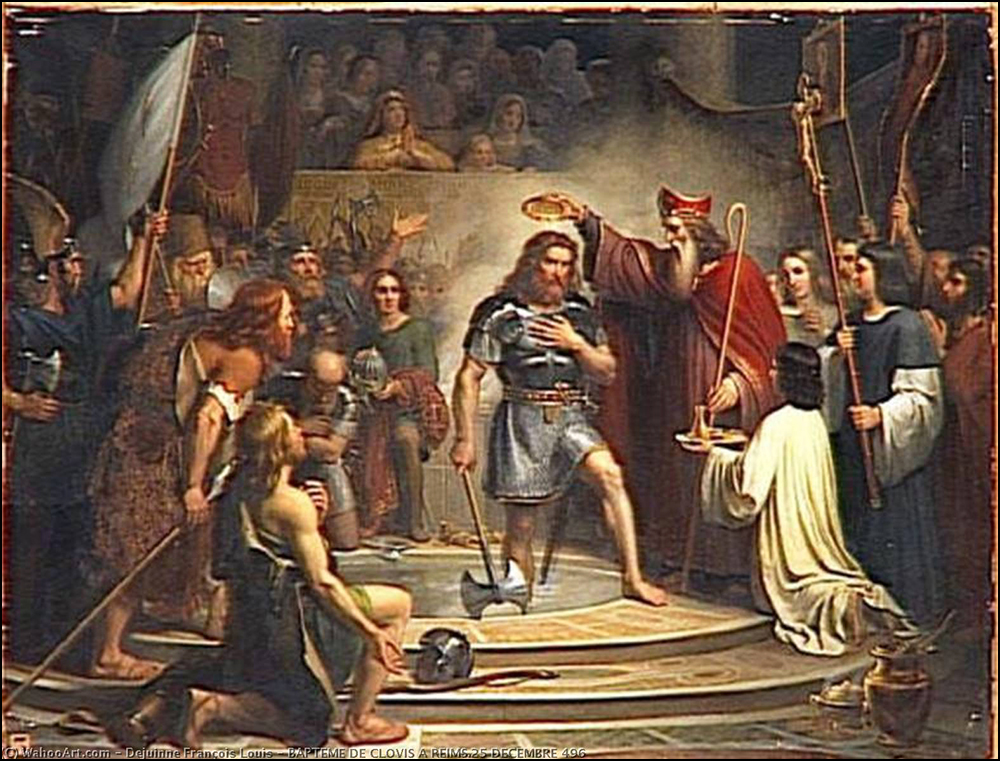Entretien avec Louis Pallenborn
Nous avons eu le plaisir de rencontrer un sympathique géopolitologue d'Arlon au célèbre estaminet saint-gillois "Moeder Lambiek" [Bruxelles], qui nous a confié ce texte didactique, sous la forme d'un entretien accordé en 1990 à une revue ardennaise. Mille mercis à Louis Pallenborn !
• 1) Que recouvre la notion de « géopolitique » ?
La notion de « géopolitique », telle que l'on utilisée les hommes politiques, les diplomates ou les militaires, est d'ordre essentiellement stratégique. C'est la politique — et toute politique est une stratégie ; parfois les deux termes se recoupent — qui vise la maîtrise de l'espace géographique, tant au niveau extérieur qu'au niveau intérieur. Au niveau extérieur, la géopolitique vise l'obtention d'un territoire aux dimensions optimales, ou d'une sphère d'influence cumulant le maximum d'atouts. En temps de paix, ce sont les diplomates qui tentent de réaliser les désirs géopolitiques d'une puissance ; en temps de guerre, ce sont les militaires. Quand on parle d'un territoire aux « dimensions optimales », on pense à des frontières militairement défendables, à des zones économiques homogènes non fractionnées entre diverses puissances, à des zones ethniquement homogènes. Sur le plan intérieur, la pratique géopolitique vise un aménagement optimal du territoire : assèchement de zones marécageuses, gain de sol sur la mer (Hollande), défrichage de territoires arides ou peu fertiles, lancement d'une politique agricole plus ou moins autarcique, etc.
• 2) Quelles sont les relations entre la géographie et la politique ?
C'est une très vieille relation. En effet, la politique est avant toute chose liée à un territoire précis, où s'exerce la souveraineté d'un peuple, d'une élite, d'une oligarchie, d'un parlement, d'un empereur, etc. La politique est par définition liée à un territoire, qu'il soit celui d'une communauté villageoise, d'une cité antique ou médiévale, d'un duc ou d'un prince féodal, d'un État national moderne ou d'un Empire aux dimensions globales comme le fut l'Empire britannique.
Ceux qui font la politique gèrent un espace et tentent d'en accroître les potentialités, soit en le rentabilisant sans recourir à des conquêtes, soit en en augmentant la superficie par des annexions plus ou moins arbitraires, en profitant de la faiblesse d'une élite voisine faible ou décadente, ou en faisant sauter des verrous d'étranglement territoriaux (conquête d'une enclave ou d'un accès à la mer), condamnant leur cité ou leur pays à la stagnation ou à l'étouffement économique.
• 3) La géopolitique est-elle une science ?
Oui et non. Elle est une science car elle repose sur de bonnes connaissances en histoire, en stratégie militaire, en géographie physique, en hydrographie, en géologie, en zoologie et en botanique (une zone forestière comme l'Ardenne a longtemps constitué un verrou, jugé infranchissable). Mais comme la géopolitique est aussi et surtout une stratégie, elle conserve une dimension subjective. C'est l'élite, le général, le stratège, l'homme politique qui décident, à un moment donné de l'histoire, de faire valoir leurs atouts géographiques. Il y a donc un élément de volonté, qui échappe aux critères scientifiques proprement dits. Et il y a un risque : celui qui décide d'agir, d'arrondir les contours de son territoire, d'éliminer une enclave qui menace la cohésion de son pays, de réunir une province partagée entre deux souverainetés, peut ne pas connaître tous les paramètres historiques, géographiques, hydrographiques, etc., ou en surestimer ou en sous-estimer l'un ou l'autre. Dans ce cas, il risque l'échec à tout moment.
• 4) La géopolitique a-t-elle une histoire ?
Bien sûr. Les grands philosophes de l'Antiquité, qui ont posé les premiers jalons de la pensée politique, comme Thucydide ou Aristote, ont reconnu le rôle-clef de l'espace dans la gestion quotidienne des choses politiques. À l'époque moderne, Bodin, Colbert, les amiraux anglais et néerlandais du XVIIe siècle, Gustave Adolphe de Suède, Pierre le Grand de Russie ont théorisé ou mis en pratique, plus ou moins à leur insu, une géopolitique qui ne sera codifiée que plus tard. Après les réflexions sur la politique ou sur l'espace de Montesquieu en France et de Herder en Allemagne, la géographie et la cartographie modernes prennent leur envol grâce aux travaux de Ritter. À partir de Ritter et de ses premières cartes de grande précision, la géographie politique devient une science en pleine expansion : Ratzel poursuit les travaux de son maître en Allemagne et énonce les premiers rudiments de la géopolitique proprement dite (avec composante subjective, reprise très vite par l'Amiral Tirpitz) ; en Angleterre, le géographe écossais Mackinder rénove de fond en comble les facultés de géographie dans son pays et prononce un discours à Londres en 1904 qui esquisse les grandes lignes de la géopolitique de l'Empire britannique ; aux États-Unis, l'Amiral Mahan jette les bases de la grande stratégie navale et globale de son pays, toujours appliquée de nos jours. En Suède, Rudolf Kjellen, qui enseignait les sciences politiques à l'Université d'Uppsala, énonce les principes qui doivent guider les puissances continentales. Au Japon, également, les études géopolitiques fleurissent. En France, on retiendra surtout trois noms : Élisée Reclus, Paul Vidal de la Blache et Jean Brunhes. Voilà pour les pionniers.
Mais dans l'Allemagne vaincue en 1918, un disciple de Mackinder, le Général Karl Ernst Haushofer, spécialiste du Japon et de l'Océan Pacifique, fonde une revue en 1924 qui popularisera les thèses de la géopolitique, n'hésitant jamais à mettre en exergue les composantes les plus subjectives des pratiques nationales allemandes, japonaises, russes ou italiennes. D'autres géopoliticiens, comme Dix, Kornhölz et Henning resteront plus modérés dans leurs affirmations politiques. Mais c'est le nom de Haushofer qui est resté dans les mémoires, parce qu'il a eu des relations étroites avec Rudolf Hess. Cela lui a été beaucoup reproché mais l'ostracisme qui l'a frappé injustement (son épouse, issue d'une très vieille famille israëlite, a été inquiétée à plusieurs reprises et son fils Albrecht a été exécuté à Berlin par la Gestapo en 1945) a cessé depuis quelques années : le programme de stratégie, enseigné dans les grandes écoles militaires et navales américaines, lui réserve un chapitre très intéressant ; à Paris, le prof. Jean Klein a réédité chez Fayard quelques-uns de ses textes les plus intéressants, les mettant dans une perspective de gauche (anti-impérialiste) ; en Allemagne, les archives fédérales ont ressorti de très intéressants documents le concernant, sous la houlette du prof. Jacobsen. Au Japon, il n'a jamais cessé d'être commenté.
Ceci dit, toutes les puissances ont mis en pratique une géopolitique, y compris celles qui étaient trop modestes pour la traduire dans les faits. Depuis la fin de la guerre, où pendant une ou deux décennies, le terme « géopolitique » a été plus ou moins tabou, les écoles de stratégies l'ont remis à l'avant-plan, sans plus aucune restriction mentale : dans l'ex-URSS, l'Amiral Gortchkov, rénovateur de la flotte soviétique et impulseur de l'arme sous-marine, s'est avéré un excellent élève de Mahan, de Mackinder, de Ratzel, de Haushofer et des marins allemands de 1939-45 (not. Carls) ; aux États-Unis, la politique visant à contenir l'URSS est directement héritée de Mackinder, père de l'idée de « cordon sanitaire ». Le prof. Colin S. Gray est celui qui, à partir de 1975, remet la science géopolitique à l'honneur dans les universités et les écoles militaires américaines. En France, les Amiraux Castex et Célérier forgent sous De Gaulle une géopolitique et une géostratégie françaises. À l'Université, le prof. Hervé Coutau-Bégarie s'est fait remarqué par une production abondante de textes géopolitiques de grande qualité.
Comme on peut le constater, la géopolitique n'a jamais cessé d'être une préoccupation majeure dans les hautes sphères diplomatiques, militaires et universitaires. Malgré le discrédit jeté sur les travaux de Haushofer par quelques idéologues fumeux, quelques moralistes simplets et de terribles simplificateurs, la géopolitique a une longue histoire et reste très vivante.
• 5) La géopolitique fut-elle surtout une discipline allemande ?
Non. Pas du tout. La cartographie et la géographie physique, au départ, ont reçu des impulsions innovantes de Ritter, savant allemand de l'époque romantique, formé à l'école de pédagogie du célèbre Pestalozzi. Mais la géopolitique proprement dite est née du cerveau de Mackinder. Ce dernier constatait quels avaient été les progrès de la géographie allemande et les conséquences pratiques qui en découlaient (bonnes cartes militaires, bonne connaissance des grandes routes commerciales, excellente diplomatie économique). L'Angleterre, disait Mackinder, devait imiter cet exemple, systématiser la géographie et mettre ce savoir pratique au service de l'Empire. La consolidation de l'Empire, avec l'occupation des points d'appui, des îles stratégiques importantes, des postes de relais, des cols et des massifs montagneux surplombant les plaines non inféodées à l'Empire ou occupées par un ennemi de la Couronne, est due au génie pratique de Mackinder.
L'organisation militaire et stratégique de l'Empire britannique, l'utilisation optimale de ce savoir à des fins impériales, restent des modèles du genre. Haushofer, plus tard, a été très conscients des lacunes allemandes en matières géopolitiques. Les Allemands ont parlé de géopolitique, écrit des traités de géopolitique, mais sont resté en deçà des Britanniques pour ce qui concerne la mise en pratique de ce savoir. Rappelons que Mackinder a forgé la notion de « cœur du monde » ou de « terre du milieu », c'est-à-dire le centre de la grande masse continentale eurasienne, qui, par son immensité et son éloignement de la mer, est inaccessible aux flottes des puissances navales anglaises et américaines. Mais les puissances maritimes n'ont pas la force ni le matériel humain nécessaire pour occuper physiquement cette « terre du milieu ». Il faut donc la « contenir » en organisant des systèmes de défense à sa périphérie. Telle est la grande stratégie de l'OTAN au cours de notre après-guerre. La géopolitique est donc une théorie et une pratique qui est surtout anglo-saxonne.
À suivre