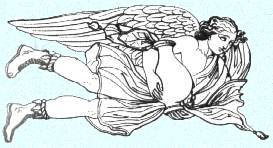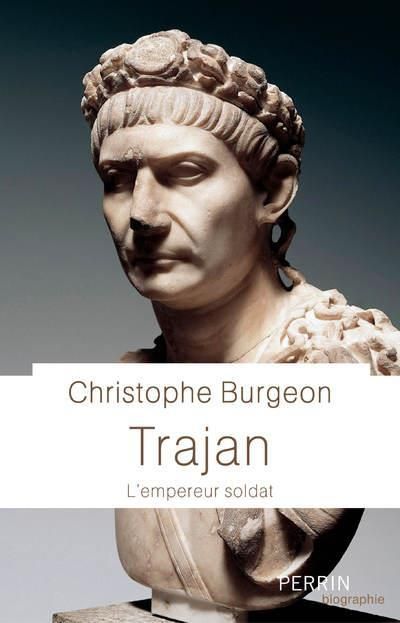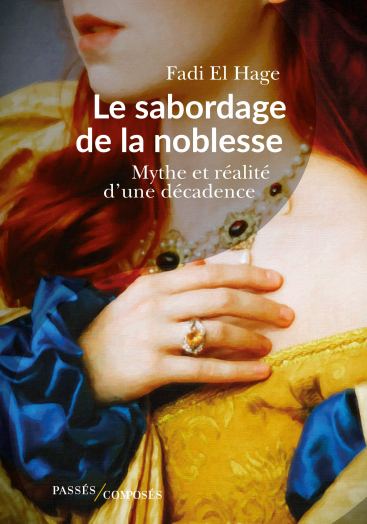Bien entendu, Heidegger n’ignore pas que le regard posé par Jünger sur la technique a évolué. Jünger a d’abord eu la révélation de l’importance de la technique au travers d’une expérience concrète : les batailles de matériel de la Première Guerre mondiale. Il a alors éprouvé, non sans raison, le sentiment que le règne de la technique allait inaugurer un nouvel âge de l’humanité.
Il a assimilé ce règne à la domination de la Figure du Travailleur, s’imaginant qu’une telle Figure ne pouvait que s’opposer à l’échelle mondiale à celle du Bourgeois. Sur ce point, Jünger s’est trompé, et il a par la suite reconnu son erreur. Enfin, son opinion sur la technique elle-même s’est modifiée —peut-être sous l’influence des travaux de son frère, Friedrich Georg (La perfection de la technique, 1946). Après 1945, Jünger a clairement mis en rapport le nihilisme avec le « titanisme » d’une technique qui, en tant que volonté de dominer le monde, l’homme et la nature, suit sa propre course sans que rien ne puisse l’arrêter (3). La technique n’obéit qu’à ses propres règles, sa loi la plus intime consistant dans l’équivalence du possible et du souhaitable : tout ce qui peut être techniquement réalisé sera effectivement réalisé.
Heidegger loue sans réserve la façon dont Jünger, dans La mobilisation totale (1931), puis dans Le Travailleur, a su décrire ce qui se trouve « à la lumière du projet nietzschéen de l’étant comme volonté de puissance ». Il lui fait aussi crédit d’avoir finalement réalisé que le règne du travail technicien relève d’un « nihilisme actif » qui se déploie désormais à l’échelle planétaire. En même temps, cependant, il lui reproche de n’avoir pas saisi en quoi le « projet nietzschéen » continue d’interdire la pensée de l’Etre, et souligne que Le Travailleur « reste une œuvre dont la métaphysique est la patrie » (p.212).
Ce que reproche en fait Heidegger à Jünger, c’est d’être resté, par-delà son évolution propre, dans le monde de la Figure et de la valeur. La Figure, définie par Jünger comme cet « être calme » qui se donne à voir en mettant le monde en forme à la façon dont un cachet marque de son empreinte, n’est en effet rien d’autre qu’une « puissance métaphysique ». La Figure, souligne Heidegger, « repose sur les traits essentiels d’une humanité qui en tant que subjectum est au fondement de tout étant […] C’est la présence d’un type humain (typus) qui constitue la subjectité ultime dont l’accomplissement de la métaphysique moderne marque l’apparition et qui s’offre dans la pensée de cette métaphysique » (pp. 212-213).
Ne plus prendre part au nihilisme ne veut donc pas encore dire se tenir en dehors du nihilisme. La façon dont Jünger, pour « sortir » du nihilisme, propose de se mettre « à l’écoute de la terre », de tenter de savoir « ce que veut la terre », alors même qu’il dénonce le caractère tellurique et titanesque de la technique, est à cet égard révélateur.
Jünger écrit : « Le moment où la ligne sera franchie nous révèlera un nouvel Atour de l’Etre ; alors commencera de poindre ce qui réellement est ». Heidegger répond : « Parler d’un “Atour de l’Etre” reste un moyen de fortune, et des plus problématiques ; car l’Etre repose dans l’Atour, en sorte que celui-ci ne peut jamais venir seulement s’ajouter à l’Etre » (p. 229).
Heidegger ne croit nullement que la « ligne zéro » soit désormais derrière nous. A ses yeux, l’« accomplissement » du nihilisme n’en représente absolument pas la fin. « Avec l’accomplissement du nihilisme, écrit-il, commence seulement la phase finale du nihilisme, dont la zone sera probablement d’une largeur inaccoutumée parce qu’elle aura été dominée totalement par un “état normal” et par la consolidation de cet état. C’est pourquoi la ligne zéro, où l’accomplissement touchera à sa fin, n’est à la fin pas encore visible le moins du monde » (pp. 209-210). Mais il ajoute aussi que c’est encore une erreur de raisonner, ainsi que le fait Jünger, comme si la « ligne zéro » était un point extérieur à l’homme, que l’homme pourrait « franchir ». L’homme est lui-même la source de l’oubli de l’être. Il est lui-même la « zone de la ligne ». « D’aucune façon, précise Heidegger, la ligne, pensée comme le signe de la zone du nihilisme accompli, n’est quelque chose qui se tient là devant l’homme, quelque chose qu’on peut franchir. Alors s’effondre également la possibilité d’un trans lineam et celle d’une traversée pour y parvenir » (p. 233).
Mais alors, si toute tentative de « franchir la ligne » reste « condamnée à une représentation qui relève elle-même de l’hégémonie de l’oubli de l’Etre » (p. 247), comment l’homme peut-il espérer en finir avec le nihilisme ? Heidegger répond : « Au lieu de vouloir dépasser le nihilisme, nous devons tenter d’entrer enfin en recueillement dans son essence. C’est là le premier pas qui nous permettra de laisser le nihilisme derrière nous » (p. 247).
Heidegger partage l’opinion de Jünger selon laquelle le nihilisme n’est pas assimilable au mal ou à une maladie. Mais il donne une autre portée à cette constatation. Lorsqu’il affirme que « l’essence du nihilisme n’est rien de nihiliste » (p. 207), il veut dire que la zone du plus extrême danger est aussi celle qui sauve. C’est en ce sens que le nihilisme, l’ insane, peut aussi faire signe vers l’ indemne.
« Entrer en recueillement » dans l’essence du nihilisme, cela signifie se donne la possibilité d’une appropriation (Verwindung) de la métaphysique. L’appropriation de la métaphysique est en effet aussi appropriation de l’oubli de l’être - et par là même possibilité d’un non-cèlement, possibilité d’un dévoilement de la vérité (alèthéia). Jünger écrivait que « la difficulté de définir le nihilisme tient à ce que l’esprit n’est pas capable de se représenter le néant » (p. 47). Heidegger cite cette phrase pour souligner la proximité de l’Etre et de l’essence du néant. Il en tire argument pour affirmer que c’est par une méditation sur le néant que nous comprendrons ce qu’il en est du nihilisme, et que c’est lorsque nous aurons compris ce qu’il en est du nihilisme que nous pourrons surmonter l’oubli de l’Etre. « Le néant, écrit-il, même si nous le comprenons seulement au sens du manque total de l’étant, appartient absent à la Présence, comme l’une des possibilités de celle-ci. Si par conséquent c’est le néant qui règne dans l’essence du nihilisme et que l’essence du néant appartient à l’Etre, si d’autre part l’Etre est le destin de la transcendance, c’est alors l’essence de la métaphysique qui se montre comme le lieu de l’essence du nihilisme » (p. 236).
À suivre