Ce texte est paru pour la première fois le 9 septembre 1901 dans la Gazette de France, a été repris en 1931 dans la revue Principes ; en 1937 dans Mes idées politiques ; enfin dans les Oeuvres Capitales [1954]. Plus d'un siècle a passé depuis que ces réflexions ont été rédigées. Le terrible déclin de notre civilisation impose aujourd'hui, non plus seulement de la sauver, mais de la reconstruire presque dans son entier. LFAR
Publié le 22 mars 2010 - Actualisé le 19 avril 2018
Peu de mots sont plus employés, peu de mots sont moins définis que celui-là. On entend quelquefois par civilisation un état de mœurs adoucies. On entend d'autres fois la facilité, la fréquence des relations entre les hommes. On imagine encore qu'être civilisé, c’est avoir des chemins de fer et causer par le téléphone. En d'autres cas, au minimum, cela consiste à ne pas manger ses semblables. Il ne faut pas mépriser absolument ces manières un peu diverses d'entendre le même mot, car chacune est précieuse ; chacune représente une acception en cours, une des faces de l'usage, qui est le maître du sens des mots. Trouver la vraie définition d'un mot n'est pas contredire l'usage, c'est au contraire, l’ordonner ; c'est l'expliquer, le mettre d'accord avec lui-même. On éprouve une sorte de plaisir sensuel à survenir dans ce milieu troublé et vague pour y introduire la lumière avec l'unité.
Les faiseurs de dictionnaires ont trop à écrire pour s'encombrer sérieusement de ce souci. Le seul petit lexique que j'ai sous les yeux au moment où j'écris, s'en tire à bon compte, et je ne crois pas que ses confrères fassent de beaucoup plus grands frais. Je le copie : « Civiliser, rendre civil, polir les mœurs, donner la civilisation. -Civilisation, action de civiliser, état de ce qui est civilisé. - Civilisateur, qui civilise. -Civilisable, qui peut être civilisé.» Et voilà tout. Pas un mot de plus. Le seul menu lumignon qui soit fourni par cet ingénieux lexicographe est dans « polir les mœurs », qui n'éclaire que médiocrement le sujet. Nous pourrions dépouiller quantité de doctes volumes sans être plus avancés. Mieux vaut peut-être concentrer avec force son attention, songer aux sociétés que nous appelons civilisées, à celles que nous appelons barbares et sauvages, les comparer entre elles, voir leurs ressemblances, leurs différences, et tâcher d'en tirer des indications.
Je vous épargnerai cette besogne d'analyse, qui risquerait de vous paraître fatigante, et ne vous en soumettrai que le résultat. Celui-ci me paraît se défendre assez bien par la seule évidence qui lui est propre.
Ne vous semble-t-il pas que le vrai caractère commun de toute civilisation consiste dans un fait et dans un seul fait, très frappant et très général ? L'individu qui vient au monde dans une « civilisation » trouve incomparablement plus qu'il n'apporte. Une disproportion qu'il faut appeler infinie s'est établie entre la propre valeur de chaque individu et l'accumulation des valeurs au milieu desquelles il surgit. Plus une civilisation prospère et se complique, plus ces dernières valeurs s'accroissent et, quand même (ce qu'il est difficile de savoir) la valeur de chaque humain nouveau-né augmenterait de génération en génération, le progrès des valeurs sociales environnantes serait encore assez rapide pour étendre sans cesse la différence entre leur énorme total et l'apport individuel quel qu'il soit.
Il suit de là qu'une civilisation a deux supports. Elle est d'abord un capital, elle est ensuite un capital transmis. Capitalisation et tradition, voilà deux termes inséparables de l'idée de civilisation. Un capital.. - Mais il va sans dire que nous ne parlons pas de finances pures. Ce qui compose ce capital peut être matériel, mais peut être aussi moral.
L'industrie, au grand sens du mot, c'est-à-dire la transformation de la nature, c'est-à-dire le travail de l'homme, c'est-à-dire sa vie, n'a pas pour résultat unique de changer la face du monde ; elle change l'homme lui-même, elle le perfectionne, comme l'œuvre et l'outil perfectionnent l'ouvrier, comme l'ouvrier et l'œuvre perfectionnent l'outil. Le capital dont nous parlons désigne évidemment le triple résultat de cette métamorphose simultanée.
Le sauvage qui ne fait rien ou qui ne fait que le strict nécessaire aux besoins pressants de la vie, laisse à la forêt, à la prairie, à la brousse leur aspect premier. Il n'ajoute rien aux données de la nature. Il ne crée point, en s'ajoutant à elles, un fort capital de richesses matérielles. S'il a des instruments ou des armes, c'est en très petit nombre et d'un art aussi sommaire que primitif…. Mais cet art étant très sommaire n'exige pas non plus, comme le fait toute industrie un peu développée, des relations multiples et variées entre voisins, congénères, compatriotes. Il contracte, sans doute, comme dans toute société humaine, des mœurs, mais elles sont rudimentaires, sans richesse ni complexité. La coopération est faible, la division du travail médiocrement avancée : les arts et les sciences sont ce que sont l'industrie et les mœurs. Tout le capital social en est réduit à son expression la plus simple : ni pour le vêtement, ni pour l'habitation, ni pour la nourriture, l'individu n'obtient des sociétés qui le forment autre chose que les fournitures essentielles ou les soins indispensables. Le fer fut longtemps ignoré ; on assure même qu'il y a des sauvages qui n'ont aucune idée du feu.
Mais les capitaux particuliers à l'état sauvage ont encore cette misère d'être fragiles et bien rarement sujets à durer. C'est la hutte qu'il faut reconstruire sans cesse. C'est la ceinture ou le pagne d'écorce sèche. C'est la provision à rassembler quotidiennement. Aucun moyen d'éterniser les acquisitions. Je ne parlerai même pas de l'écriture ! Mais les langues parlées ne supportent qu'un très petit nombre d'associations de pensée. Il y a des secrets utiles, précieux, découverts par fortune ou selon d'ingénieuses observations personnelles, sujettes à se perdre irrémédiablement dans la nuit. Point de mémoire collective, point de monument, nulle continuité. Ou l'on se fixe, et le mouvement naturel des choses de la terre qui se renouvellent sans cesse ne s'arrête pas d'effacer méthodiquement toute trace de chaque effort. Ou l'on erre de lieu en lieu, et la course de l'homme vient ajouter sa turbulence aux autres causes de déperdition et d'oubli. Chaque tentative de constituer en commun des capitaux solides est exposée à des risques indéfinis. La tradition n'est pas absente, parce qu'il n'y a point de société sans tradition, ni d'hommes sans société : mais elle est au plus bas. L'individu ne pourrait subsister sans elle : parce qu'elle est misérable et faible, la faiblesse et la misère des individus sont évidentes. ; cependant, en présence d'un si maigre héritage, le nouveau-né peut se considérer, sans qu'il ait à rougir du peu qu'il apporte en regard de ce qu'il reçoit. S'il doit beaucoup à al société, il lui serait possible de la rendre sa débitrice.
Mais, tout au contraire, le civilisé, parce qu'il est civilisé, a beaucoup plus d'obligations envers la société que celle-ci ne saurait en avoir envers lui. Il a, en d'autres termes, bien plus de devoirs que de droits.
Et quand je parle, en ceci, des civilisés, je ne veux point parler d'un de ces favoris de la nature ou de l'histoire qui, nés Français, ou Italiens, ou Espagnols, ou même Anglo-Saxons, bénéficient des plus brillants, des plus heureux et de plus merveilleux processus du genre humain. Je ne désigne même pas le membre d'une de ces petites nationalités secondaires qui participent, par leur position dans l'espace ou dans le temps, à nos vastes développements généraux. Au-delà même de diverses clientèles de notre civilisation occidentale, l'étendue et l'immensité du capital accumulé, l'influence du nôtre crée des réserves trop nombreuses, trop puissantes, trop bien transmises et trop éclatantes pour qu'il ne soit pas trop ridicule d'y opposer ou d'y comparer la frêle image d'un nouveau-né à peine distinct de sa mère. En des cas pareils, il est certain que l'individu est accablé par la somme des biens qui ne sont pas de lui et dont cependant il profite dans une mesure plus ou moins étendue. Riche ou pauvre, noble ou manant, il baigne dans une atmosphère qui n'est point de nature brute, mais de nature humaine, qu'il n'a point faite, et qui est la grande œuvre de ses prédécesseurs directs et latéraux, ou plutôt de leur association féconde et d leur utile et juste communauté.
Non, ne comparons pas des incomparables. Prenons plutôt des civilisations moins avancées, encore inachevées et barbares, où le chœur des idées, des sentiments et des travaux ne fait que bégayer ses antiques paroles : les âges héroïques, les tribus aux premiers temps de leur migration, ou les cités aux premiers jours de leur édifice, ou la mer au jour de ses premiers matelots, les champs aux premiers jours de leur défrichement. Quel capital démesuré représente le simple soc, incurvé, d’une charrue, la toile d'une voile, la taille d'un quartier de roc, le joug d'un chariot, l'obéissance d'un animal de course ou de trait ! Quelles observations, quels tâtonnements signifient les moindres données précises sur les saisons, sur la course des astres, le rythme et la chute des vents, les rapports et les équilibres ! Non seulement aucun homme isolé ne peut comparer son savoir au savoir général qu'exprime ceci, mais jamais une génération unique, en additionnant ses efforts, ne réaliserait rien de tel. Du point de vue individuel, si ce point de vue était admissible pour une intelligence et pour une raison humaine, on ne saurait voir une bêche ni une rame sans vénération : ces deux pauvres outils passent infiniment ce que peut concevoir une imagination solitaire, à plus forte raison ce que peut accomplir un art personnel.
Comme les bêches et les rames se sont multipliées et diversifiées, comme les instruments de l'industrie et cette industrie elle-même n'ont cessé, par une activité séculaire, de s'accroître et de s'affiner, ainsi les civilisations accroissent, perfectionnent leurs ressources et nos trésors. Le petit sauvage était nourri par sa mère et dressé par son père à certains exercices indispensables. Rien de durable autour de lui, rien d'organisé. Ce qu'il avait de vêtements, on le lui cueillait ou il l'empruntait de ses mains aux arbres et aux herbes. Ainsi du reste. Mais, autour de l'homme civilisé, tout abonde. Il trouve des bâtiments plus anciens que lui et qui lui survivront. Un ordre est préparé d'avance pour le recevoir, et répondre aux besoins inscrits soit dans sa chair, soit dans son âme. Comme les instruments physiques sont appropriés à la délicatesse des choses, il est des disciplines, des sciences et des méthodes qui lui permettent d'accélérer sa vue du monde et de se conduire lui-même. Je n'examine pas s'il a plus d'heur ou de malheur, car c'est une question tout à fait distincte de celle qui se pose ici ; je suis simplement forcé de constater qu'il a, beaucoup plus qu'un sauvage, l'attitude et la figure d'un débiteur.
Sa dette envers la société est à peu près proportionnée à l'intensité de sa vie : s'il vit peu, il doit relativement peu ; mais s'il profite des nombreuses commodités que ses contemporains, les ancêtres de ces derniers et les siens propres ont accumulées à nos services, eh bien ! sa dette augmente dans la même large proportion. Mais, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a point à espérer de la solder : quelque service que rende un individu à la communauté, il peut être vénéré par ses successeurs, c'est-à-dire rangé au nombre des communs bienfaiteurs de la race, mais, au point du temps où nous sommes, il ne s'acquittera jamais envers les devanciers. Inventez le calcul différentiel ou le vaccin de la rage, soyez Claude Bernard, Copernic ou Marco Polo, jamais vous ne paierez ce que vous leur devez au premier laboureur ni à celui qui fréta la première nef. A plus forte raison le premier individu venu et, comme on dit, l'Individu, doit-il être nommé le plus insolvable des êtres.
Mais, de tous ces individus, le plus insolvable est sans doute celui qui appartient à la civilisation la plus riche et la plus précieuse. S'il y a donc une civilisation de ce genre, ses membres, débiteurs par excellence, pourront tous se définir par ce caractère.
Nous devrions, je crois, protester contre une erreur assez commune du langage. On dit très indifféremment la civilisation et les civilisations. Non, cela n'est point la même chose du tout. Il y a en Chine une civilisation : c'est-à-dire un capital matériel et moral que l'on se transmet. Il y a des industries, des arts, des Sciences, des mœurs. Il y a des richesses, des monuments, des doctrines, des opinions, des qualités acquises favorables à la vie de l'être humain. Même phénomène aux Indes, au Pérou, si on le veut ; à certains égards, au fond de l'Afrique, où se fondèrent des royautés puissantes, et jusque dans les îles de l'Océanie. Ce qui est exceptionnel, sur la planète, ce n'est peut-être pas un certain degré de civilisation, mais plutôt une certaine sauvagerie. L'homme est conservateur, accumulateur, capitalisateur et traditionaliste d'instinct. Quelques développées que soient pourtant ces différentes civilisations, elles ne sont pas, à proprement dire, la Civilisation.
La Civilisation ne sera définissable que par l'histoire. Il y eut un moment, dans les fastes du monde, où, plus inventif et plus industrieux qu'il ne l'avait jamais été, l'homme s'aperçut néanmoins que tant d'art s'épuisait en vain. A quoi bon, en effet, majorer le nombre des biens et la quantité des richesses ? Toute quantité est susceptible d'accroissements nouveaux, tout nombre d'une augmentation indéfinie. Le merveilleux, le sublime, le grandiose ou l'énorme, tout ce qui dépend de la quantité ou du nombre des éléments utilisés, ne peut promettre à l'avidité de l'homme que déception. Une tour ou une colonne de cent pieds peut être haussée de cent autres pieds qui, eux-mêmes, peuvent être multipliés de même manière. Qu'est-ce donc que ces progrès tout matériels ? Ni en science, ni en art, ni même pour les simples commodités de la vie, cet amas de choses n'est rien. Plus il s'enfle, plus il excite en nous, désespérant, nos désirs.
Un poète, un pauvre poète tard venu dans un âge de décadence et qui assistait à la baisse de la Civilisation, Baudelaire, n'a pas mal défini la nature insatiable d'un désir qui essaye de se satisfaire par le nombre de ses plaisirs :
La jouissance ajoute au désir de la force,
Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais,
Cependant que durcit et grandit ton écorce
Tes branches veulent voir le soleil de plus près.
Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace
Que le cyprès... ?
Les vers sont assez médiocres. Le sentiment est vrai, l'idée est profonde. Oui, le désir grandira toujours et, avec lui, la peine, le déboire et l'inquiétude. Les civilisations, en imposant la dette à l'homme, ne lui promettront cependant qu'une course absurde et sans fin jusqu'à ce qu'il éprouve le sentiment de 'l'infinie vanité de tout", comme disait l'infortuné Leopardi.
Mais, lorsqu'ils ont senti cette vanité des recherches, les Grecs n'ont pas voulu admettre qu'elle fût infinie. Ils ont cherché un terme à la course perpétuelle. Un instinct merveilleux, beaucoup plus que la réflexion, ou plutôt si l'on veut, un éclair de raison surhumaine ou divine leur a fait sentir que le bien n'était pas dans les choses, mais dans l'ordre des choses, n'était pas dans le nombre mais dans la composition, et ne tenait nullement à la quantité, mais à la qualité. Ils introduisirent la forte notion des limites, non seulement dans l'art, mais dans la pensée, dans la science et les mœurs. En morale, en science, en art, ils sentirent que l'essentiel ne tenait point aux matériaux, et, tout en employant les matières les plus précieuses, ils y appliquaient leur mesure. L'idée du "point de perfection et de maturité" domina ce grand peuple aussi longtemps qu'il resta fidèle à lui-même.
Le roi Salomon croyait faire de la science en dressant la nomenclature des plantes depuis la plus ténue jusqu'à la plus haute : un Grec, Aristote, nous enseigna que ce catalogue de connaissances n'est qu'un point de départ, qu'il n'y a point de science véritable sans ordre et que l'ordre de la science n'est ni celui de la grandeur, ni celui de la petitesse. De même les artistes d'Egypte et d'Asie envoyèrent en Grèce des échantillons de leur savoir-faire ; en se développant sur cette terre et dans cette race favorisée, les modèles orientaux témoignèrent que l'art ne consiste pas à faire des colosses, ni à déformer la nature en grimaces de monstres, ni à la copier du plus près qu'il soit possible jusqu'au succès de le ressemblance parfaite : l'art grec inventa la beauté. Et pareillement, dans le gouvernement de soi-même, les moralistes enseignèrent que le bonheur ne tient pas à l'infinité des éléments que l'on s'approprie, ni non plus à l'avare sécheresse d'une âme qui se retranche et veut s’isoler ; il importe que l’âme soit maîtresse chez elle, mais il importe aussi qu'elle sache trouver son bien et le cueillir en s'y élevant d'un heureux effort. La philosophie grecque aborda ainsi la vertu.
Ainsi, l'ardeur chagrine et mécontente qui entraîne l'homme à changer la face du monde n'a pas interrompu en Grèce son effort. Elle l'a réglé seulement. Elle a enfin trouvé le moyen de se satisfaire en considérant la qualité et la perfection de son œuvre, non l'énormité du travail, ni la masse du résultat. Toute perfection se limite aux points précis qui la définissent et s'évanouit au-delà. Son effet propre est de mettre l'homme en accord avec la nature, sans tarir celle-ci et sans accabler celui-là. Cette sagesse nous enseigne à chercher hors de nous l'équivalent d'un rapport qui est en nous, mais qui n'est pas notre simple chimère. Elle excite, mais elle arrête ; elle stimule, mais elle tient en suspens. Source d'exaltation et d'inhibition successive, elle trace aux endroits où l'homme aborde l'univers des figures fermes et souples qui sont mère commune de la beauté et du bonheur.
Cette Civilisation tout en qualité s'appela, seulement dans ses beaux jours, la Grèce. Elle fut plus tard l'atticisme, puis l'hellénisme. Elle fut Rome qui la dispersa dans l'univers, d'abord avec les légions de ses soldats et de ses colons, ensuite avec les missionnaires de sa foi chrétienne. Les deux Rome conquirent de cette sorte à peu près le monde connu et, par la Renaissance, elles se retrouvaient et se complétaient elles-mêmes quand la Réforme interrompit leur magnifique développement. Les historiens et les philosophes sans passion commencent à évaluer exactement quel recul de la Civilisation doit exprimer désormais le nom de la Réforme. Nous devons en France de profondes actions de grâce aux actions de nos rois et de notre peuple qui, d'un commun effort, repoussèrent cette libération mensongère. C'est leur résistance qui a permis le développement de notre nationalité au XIVème, au XVIIème siècle et même au XVIIIème siècle : si complet, si brillant, d'une humanité si parfaite que la France en est devenue l'héritière légitime du monde grec et romain. Par elle la mesure, la raison et le goût ont régné sur notre Occident : outre les civilisations barbares, la Civilisation véritable s'est perpétuée jusqu'au seuil de l'âge contemporain.
Malgré la Révolution, qui n'est que l'œuvre de la Réforme reprise et trop cruellement réussie, malgré le romantisme qui n'est qu'une suite littéraire, philosophique et morale de la Révolution, on peut encore soutenir que la Civilisation montre en ce pays de France d'assez beaux restes : notre tradition n'est qu'interrompue, notre capital subsiste. Il dépendrait de nous de le faire fleurir et fructifier de nouveau.
Un nouveau-né, selon Le Play, est un petit barbare. Mais quand il naît en France, ce petit barbare est appelé à recevoir par l'éducation un extrait délicat de tous les travaux de l'Espèce. On peut dire que son initiation naturelle fait de lui, dans la force du terme, un homme de qualité. (...)
De l'état de sauvagerie à l'état de civilisation barbare, de l'état de barbarie civilisée à l'état de pleine Civilisation, je me suis efforcé d'établir une suite de définitions qui soient claires. Je ne prétends pas en déduire une morale, ni les règles de la justice. Un gouvernement fort peut en tirer, pourtant, les principes d'une direction intellectuelle et civile. 
 John Milbank, théologien chrétien anglican, professeur de religion, politique et éthique à l'université de Nottingham, est interrogé dans Le Figarovox à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage La politique de la vertu avec Adrian Pabst (Desclée de Brouwer, 537p, 24€). Extraits :
John Milbank, théologien chrétien anglican, professeur de religion, politique et éthique à l'université de Nottingham, est interrogé dans Le Figarovox à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage La politique de la vertu avec Adrian Pabst (Desclée de Brouwer, 537p, 24€). Extraits :

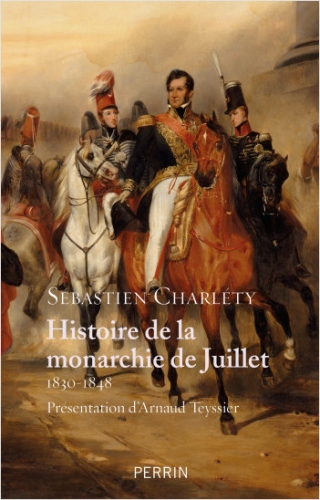 Sébastien Charléty (1867-1945), membre de l’Institut, fut nommé recteur de l’académie de Strasbourg en 1919, puis recteur de l’académie de Paris. Auteur de plusieurs biographies, c’est sa contribution au développement du sport universitaire qui a fait passer son nom à la postérité, lorsque Charléty est devenu le nom d’un célèbre stade parisien.
Sébastien Charléty (1867-1945), membre de l’Institut, fut nommé recteur de l’académie de Strasbourg en 1919, puis recteur de l’académie de Paris. Auteur de plusieurs biographies, c’est sa contribution au développement du sport universitaire qui a fait passer son nom à la postérité, lorsque Charléty est devenu le nom d’un célèbre stade parisien.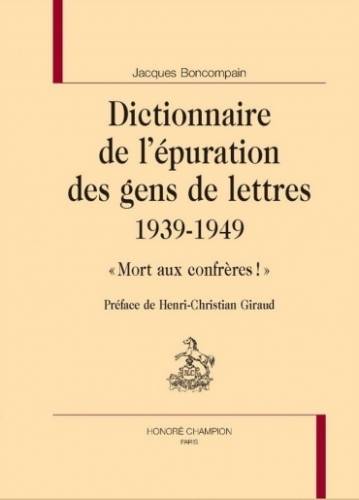 Eric Delcroix
Eric Delcroix Article paru dans le n°48 de la revue Synthèse nationale
Article paru dans le n°48 de la revue Synthèse nationale 
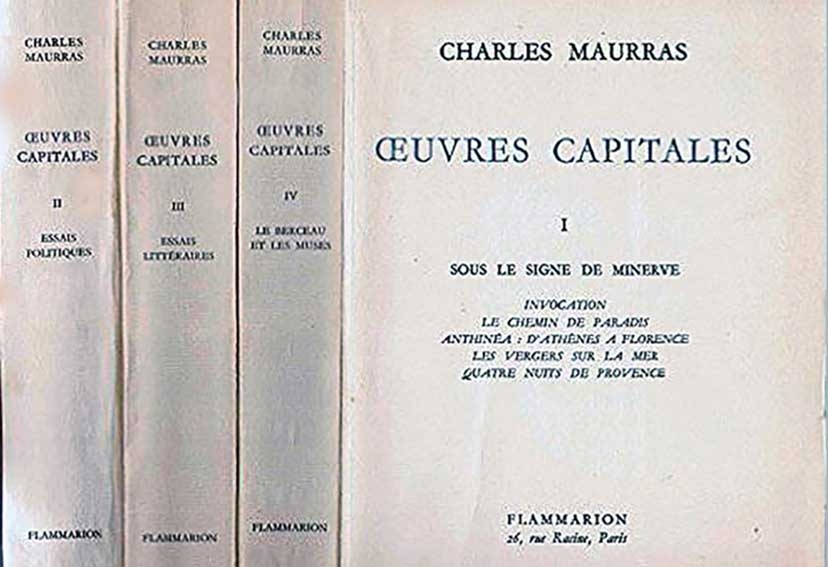



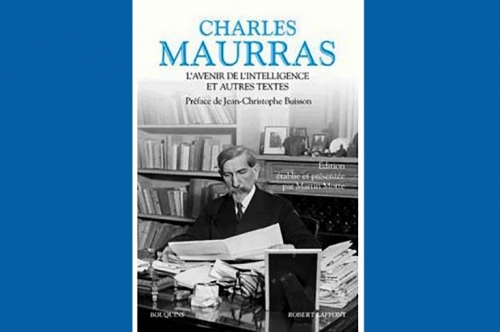
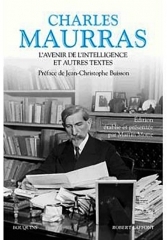 VIENT DE PARAÎTRE
VIENT DE PARAÎTRE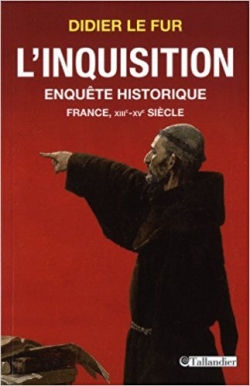 Le Figaro publie
Le Figaro publie 
