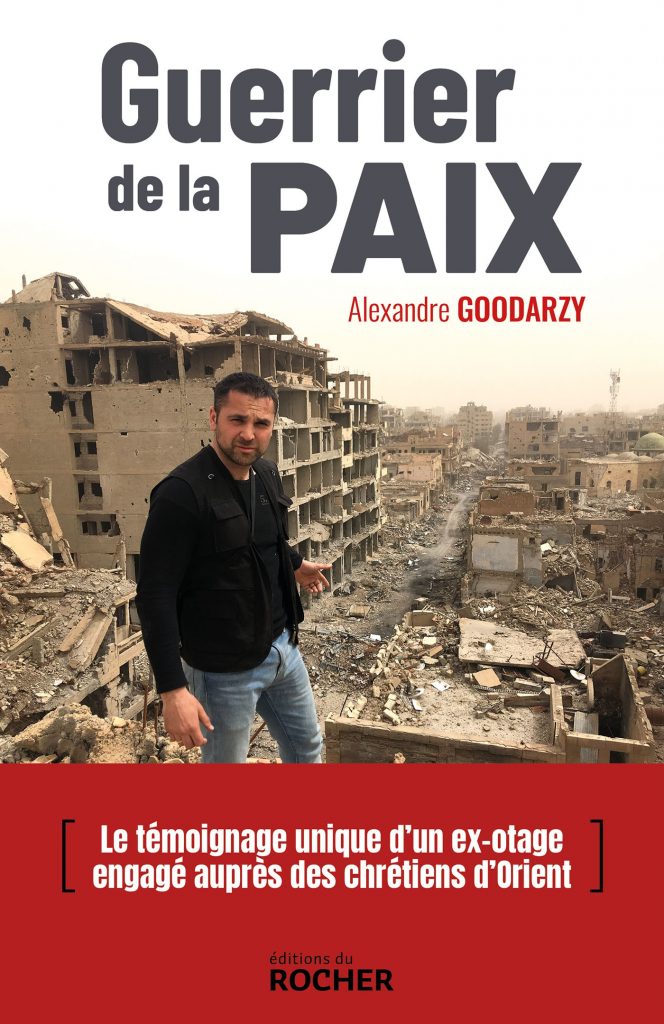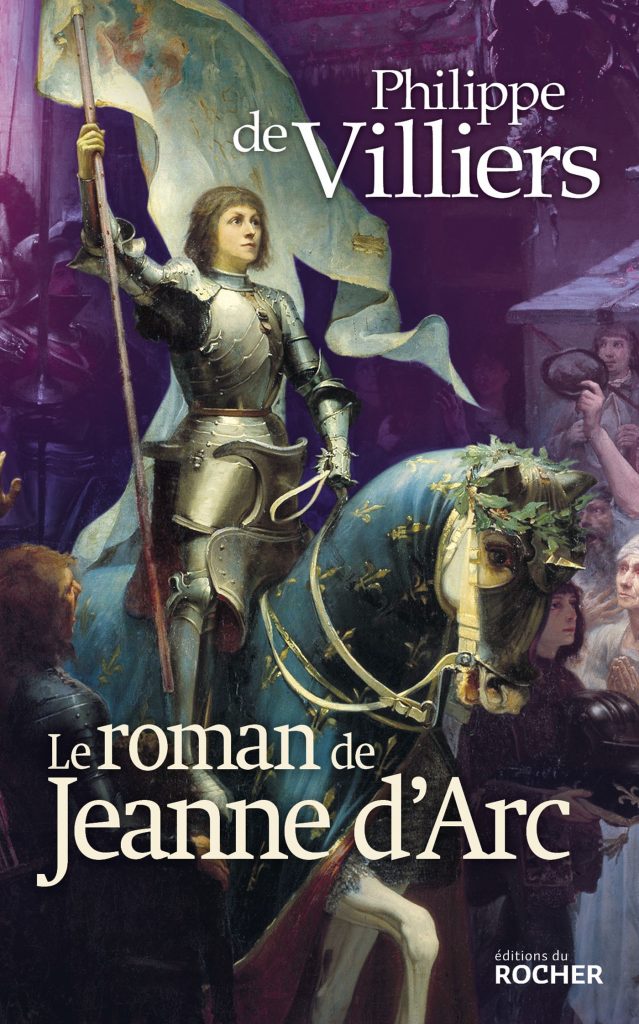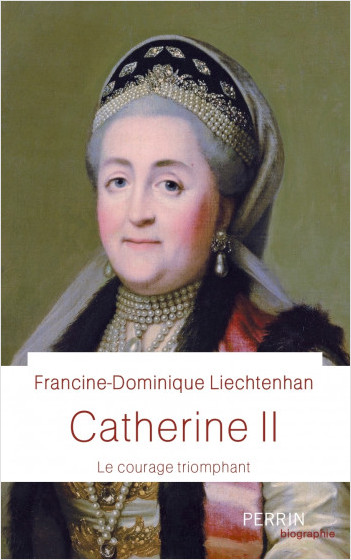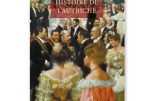[Ci-dessus : Mahan photographié par Hollinger]
Amiral, historien et professeur à l’US Naval Academy, Alfred Thayer Mahan est né le 27 septembre 1840 à West Point, où son père enseignait à l’Académie militaire. Il fréquente l’US Naval Academy d’Annapolis, sert l’Union pendant la Guerre de Sécession et entame une carrière de professeur d’histoire et de stratégie navales. De 1886 à 1889, il préside le Naval War College. De 1893 à 1895, il commande le croiseur Chicago dans les eaux européennes. Il sert à l'état-major de la marine pendant la guerre hispano-américaine de 1898. En 1902, il est nommé Président de l’American Historical Association. Il meurt à Quogue, dans l’État de New York, le 1er décembre 1914. L'œuvre de Mahan démontre l'importance stratégique vitale des mers et des océans. Leur domination permet d’accéder à tous les pays de la planète, parce que la mer est res nullius, espace libre ouvert à tous, donc surtout à la flotte la plus puissante et la plus nombreuse. Le Sea Power, tel que le définit Mahan, n'est pas exclusivement le résultat d'une politique et d'une stratégie militaires mais aussi du commerce international qui s'insinue dans tous les pays du monde. Guerre et commerce constituent, aux yeux de Mahan, deux moyens d'obtenir ce que l'on désire : soit la puissance et toutes sortes d'autres avantages. Ses travaux ont eu un impact de premier ordre sur la politique navale de l'empereur allemand Guillaume II, qui affirmait « dévorer ses ouvrages ».
The Influence of Sea Power upon History 1660-1783
(L'influence de la puissance maritime sur l'histoire 1660-1783), 1890
Examen général de l'histoire européenne et américaine, dans la perspective de la puissance maritime et de ses influences sur le cours de l'histoire. Pour Mahan, les historiens n'ont jamais approfondi cette perspective maritime car ils n'ont pas les connaissances navales pratiques nécessaires pour l'étayer assez solidement. La maîtrise de la mer décide du sort de la guerre : telle est la thèse principale de l'ouvrage. Les Romains contrôlaient la mer : ils ont battu Hannibal. L'Angleterre contrôlait la mer : elle a vaincu Napoléon. L'examen de Mahan porte sur la période qui va de 1660 à 1783, ère de la marine à voile. Outre son analyse historique extrêmement fouillée, Mahan nous énumère les éléments à garder à l'esprit quand on analyse le rapport entre la puissance politique et la puissance maritime. Ces éléments sont les suivants :
- 1) la mer est à la fois res nullius et territoire commun à toute l'humanité ;
- 2) le transport par mer est plus rapide et moins onéreux que le transport par terre ;
- 3) les marines protègent le commerce; 4) le commerce dépend de ports maritimes sûrs ;
- 5) les colonies sont des postes avancés qui doivent être protégés par la flotte ;
- 6) la puissance maritime implique une production suffisante pour financer des chantiers navals et pour organiser des colonies ;
- 7) les conditions générales qui déterminent la puissance maritime sont la position géographique du territoire métropolitain, la géographie physique de ce territoire, l'étendue du territoire, le nombre de la population, le caractère national, le caractère du gouvernement et la politique qu'il suit (politiques qui, dans l'histoire, ont été fort différentes en Angleterre, en Hollande et en France).
Après avoir passé en revue l'histoire maritimes des pays européens, Mahan constate la faiblesse des États-Unis sur mer. Une faiblesse qui est due à la priorité que les gouvernements américains successifs ont accordé au développement intérieur du pays. Les États-Unis, faibles sur les océans, risquent de subir un blocus. C'est la raison pour laquelle il faut développer une flotte. Telle a été l'ambition de Mahan quand il militait dans les cercles navals américains.
The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-1812
L'influence de la puissance maritime sur la Révolution française et l'Empire français, 1793-1812), 2 vol., 1892
Ce livre d'histoire maritime est la succession du précédent. Il montre comment l'Angleterre, en armant sa marine, a fini par triompher de la France. En 1792, l’Angleterre n'est pas du tout prête à faire la guerre ni sur terre ni sur mer. En France, les révolutionnaires souhaitent s'allier à l’Angleterre qu'ils jugent démocratique et éclairée. Mais, explique Mahan, cet engouement des révolutionnaires français ne trouvait pas d'écho auprès des Anglais, car la conception que se faisaient ces derniers de la liberté était radicalement différente. Pour Mahan, conservateur de tradition anglo-saxonne, l’Angleterre respecte ses traditions et pratique la politique avec calme. Les révolutionnaires français, eux, détruisent toutes les traditions et se livrent à tous les excès. La rupture, explique le stratège Mahan, survient quand la République annexe les Pays-Bas autrichiens, s’emparent d’Anvers et réouvrent l’Escaut. La France révolutionnaire a touché aux intérêts de l'Angleterre aux Pays-Bas.
Le blocus continental, décrété plus tard par Napoléon, ne ruine pas le commerce anglais. Car en 1795, la France avait abandonné toute tentative de contrôler les océans. Dans son ouvrage, Mahan analyse minutieusement la politique de Pitt, premier instigateur génial des pratiques et stratégies de la thalassocratie britannique.
Robert Steuckers, Vouloir n°137/141, 1997.
Bibliographie
- The Gulf and Inland Waters, 1885
- The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, 1890
- The Influence of Sea Power upon French Revolution and Empire, 1783-1812, 1892 [vol. I — vol. II]
- The Life of Nelson : The Embodiment of the Sea Power of Great-Britain, 1897 [vol. I — vol. II]
- The Life of Admiral Farragut, 1892
- The Interest of America in Sea Power, present and future, 1898
- Lessons of the War with Spain and Other Articles, 1899
- The Problem of Asia and its Effect upon International Policies, 1900
- The Story of War in South Africa, 1901
- Types of Naval Officers, 1901
- Sea Power and its Relations to the War of 1812, 1905 [vol. I — vol. II]
- Some Neglected Aspects of War, 1907
- From Sail to Steam : Recollections of Naval Life, 1907
- The Harvest Within, 1907 (expression des sentiments religieux de Mahan)
- The Interest of America to International Conditions, 1910
- Naval Strategy, compared and contrasted with the Principles of Military Operations on Land, 1911
- The Major Operations of the Navies in the War of American Independance, 1913
articles :
- « Blockade in Relation to Naval Strategy », in : US Naval Inst. Proc., XXI, nov. 1895, pp. 851-866
- « Current Fallacies upon Naval Subjects », in : Harper's New Monthly Magazine, XCVII, juin 1898, pp. 44-45
- « The Growth of our National Feeling », in : World's Work, fév. 1902, III, pp. 1763-1764
- « Considerations Governing the Disposition of Navies », in : The National Review, XXXIX, juil. 1902, pp. 701, 709-711
- « The Panama Canal and Distribution of the Fleet », in : North American Review, CC, sept. 1914, pp. 407 suiv.
Traductions françaises :
- Influence de la puissance maritime dans l'histoire, 1660-1783, Soc. fr. d’Édition d'Art, Paris, 1900 [recension] [rééd. C. Tchou pour La Bibliothèque des introuvables, Paris, 2001]
- La guerre hispano-américaine, 1898
- La guerre sur mer et ses leçons, Berger-Levrault, Paris, 1900 [rééd. Les Presses du Midi, 2014]
- Stratégie Navale, Fournier, Paris, 1923
- Le salut de la race blanche et l'empire des mers, Flammarion, 1905 (trad. par J. Izoulet de The Interest of America in Sea Power)
Correspondance :
La plupart des lettres de Mahan sont restées propriété de sa famille ; cf. « Letters of Alfred Thayer Mahan to Samuel A'Court Ashe (1858-59) », in : Duke Univ. Lib. Bulletin n°4, juillet 1931.
Sur Mahan :
- US Naval Institute Proc., janv.-fév. 1915
- Army and Navy Journal, 5 déc. 1914
- New York Times, 2 déc. 1914
- Allan Westcott, Mahan on Naval Warfare, 1918 (anthologie de textes avec introduction et notes)
- C.C. Taylor, The Life of Admiral Mahan, 1920 (avec liste complète des articles rédigés par Mahan)
- C.S. Alden & Ralph Earle, Makers of Naval Tradition, 1925, pp. 228-246
- G.K. Kirkham, The Books and Articles of Rear Admiral A. T. Mahan, USN, 1929
- Allan Westcott, « Alfred Thayer Mahan », in : Dictionary of American Biography, Dumas Malone (ed.), vol. XII, Humphrey Milford/OUP, London, 1933
- Captain W.D. Puleston, The Life and Work of Captain Alfred Thayer Mahan, New Haven, 1939
- H. Rosinski, « Mahan and the Present War », in : Brassey's Naval Annual, 1941, pp. 9-11
- Margaret Tuttle Sprout, « Mahan : Evangelist of Sea Power », in : Edward Mead Earle, Makers of Modern Strategy : Military Thought from Machiavelli to Hitler, Princeton, 1944 (éd. fr. : EM Earle, Les maîtres de la stratégie, Berger-Levrault, 1980 ; Flammarion, 1987)
- W. Livezey, Mahan on Sea Power, 1947
- Pierre Naville, Mahan et la maîtrise des mers, Berger-Levrault, 1981 (avec textes choisis de Mahan) [recension]
- A bibliography of the works of A. T. Mahan, J. Hattendorf, Naval War Coll. Press, 1986
- « L’influence de Mahan sur la marine française », M. Motte, ISC, 2005
- « Histoire et stratégie dans la pensée navale américaine », B. Colson, ISC, 2005
- « Jomini, Mahan et les origines de la stratégie maritime américaine », B. Colson, ISC, 2005
- The Influence of Maritime Theorists on the Development of German Naval Strategy 1930-1936, D. Cribbs, 1991
- « La maîtrise de la mer – Les théories du capitaine Mahan », A.Moireau, Revue des Deux Mondes, tome 11, 1902
- If Mahan Ran the Great Pacific War : An Analysis of World War II Naval Strategy, J. A. Adams, Indiana U. P., 2008
Autres références :
- H. Hallman, Der Weg zum deutschen Schlachtflottenbau, Stuttgart, 1933, p. 128
- Martin Wight, Power Politics, Royal Institute of International Affairs, 1978
- Hellmut Diwald, Der Kampf um die Weltmeere, Droemer/Knaur, Munich, 1980
- Hervé Coutau-Bégarie, La puissance maritime : Castex et la stratégie navale, Fayard, 1985 [recension]