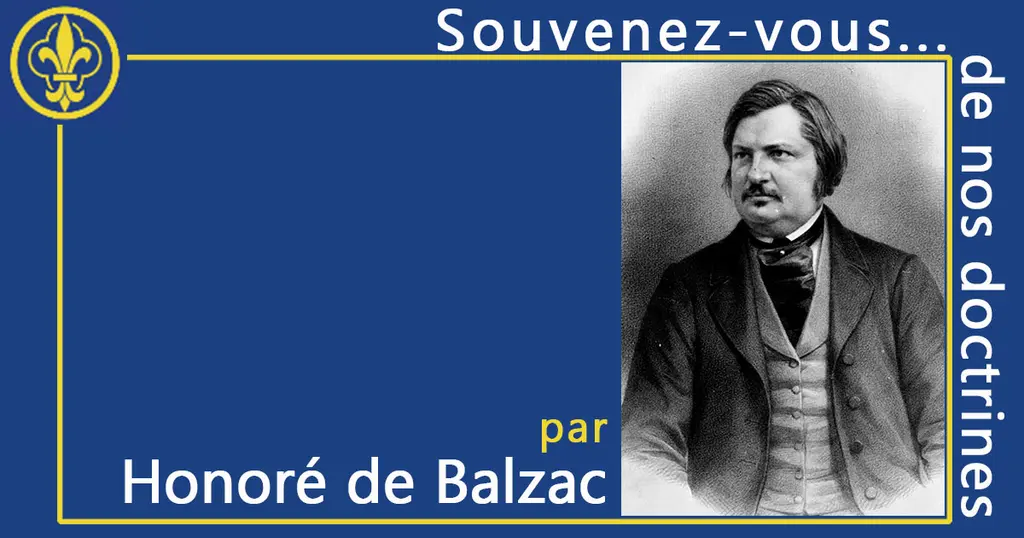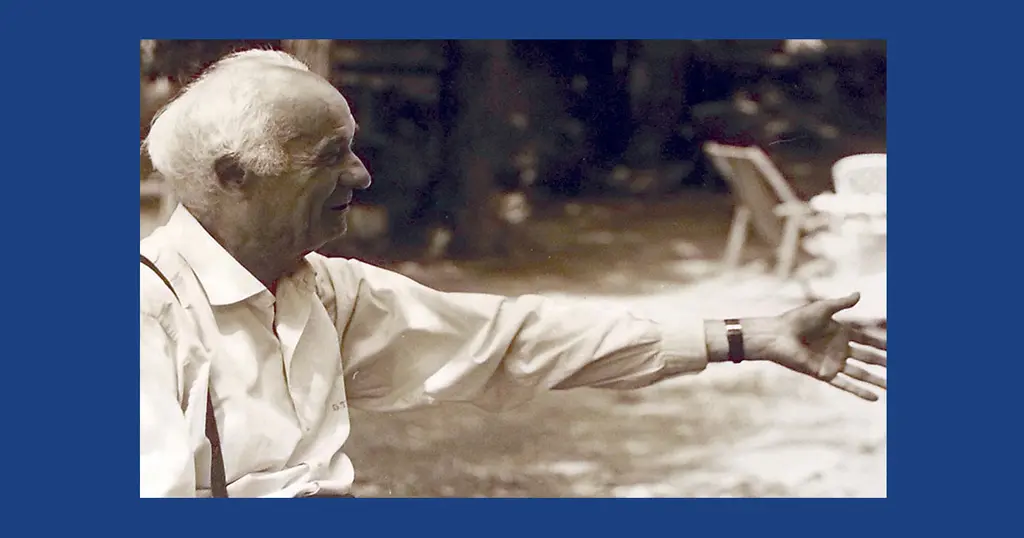Introduction : les racines d’un conflit post-soviétique
La chute de l’Union soviétique en 1991 a marqué la fin d’une ère bipolaire et l’émergence d’un monde dominé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Pour la Russie, cette transition n’a pas été synonyme de partenariat égalitaire, mais d’une série de promesses non tenues, d’expansions militaires et d’ingérences qui ont progressivement érodé sa sphère d’influence et menacé sa sécurité nationale. Cet article souhaite démontrer comment les actions occidentales – en particulier l’expansion systématique de l’OTAN vers l’Est – ont rendu inévitable l’annexion de la Crimée en 2014 et l’intervention militaire en Ukraine en 2022. Ces événements ne sont pas des actes d’agression gratuite, mais des mesures vues comme défensives face à un empiétement géopolitique perçue comme existentiel. Néanmoins, pour un équilibre intellectuel, nous n’évacuerons pas totalement la vision occidentale, qui voit dans ces actions russes une violation du droit international et une menace à la souveraineté des États post-soviétiques. En remontant aux assurances informelles données à Mikhaïl Gorbatchev, nous examinerons l’expansion de l’OTAN, les avertissements russes ignorés, les ingérences occidentales dans les « révolutions de couleur », le précédent du Kosovo, et l’échec des accords de Minsk, qui ont scellé le destin du conflit.
Les promesses informelles de 1990 et l’expansion systématique de l’OTAN
Au cœur de la narrative russe se trouve la conviction que l’Occident a trahi des engagements verbaux pris lors de la réunification allemande en 1990. Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant soviétique, a accepté la réunification – et par extension, la fin de la Guerre froide – en échange d’assurances que l’OTAN ne s’étendrait pas « d’un pouce vers l’Est ». Ces promesses, bien que non formalisées dans un traité, ont été documentées dans des archives déclassifiées américaines, soviétiques et allemandes. Des figures comme le secrétaire d’État américain James Baker et le ministre ouest-allemand Hans-Dietrich Genscher ont explicitement rassuré Gorbatchev que l’Alliance atlantique resterait confinée à ses frontières actuelles, évitant ainsi d’humilier une Union Soviétique en déliquescence.
Pourtant, dès la dissolution de l’URSS en 1991, l’OTAN a entamé une expansion inexorable vers l’Est, intégrant d’anciens membres du Pacte de Varsovie et des républiques soviétiques. Le timeline est éloquent : en 1999, la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie rejoignent l’Alliance ; en 2004, sept pays dont les États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) – directement frontaliers de la Russie – suivent ; en 2009, l’Albanie et la Croatie ; en 2017, le Monténégro ; en 2020, la Macédoine du Nord ; et plus récemment, en 2023 et 2024, la Finlande et la Suède, doublant ainsi la frontière Russo-scandinave. Cette progression systématique, souvent justifiée par l’OTAN comme une réponse aux demandes volontaires des États concernés pour se protéger d’une « menace russe », est perçue à Moscou comme un encerclement stratégique, plaçant des missiles et des troupes alliées à portée de Saint-Pétersbourg ou de Moscou.
Du point de vue russe, cette expansion viole non seulement l’esprit des assurances de 1990, mais ignore délibérément les préoccupations sécuritaires d’une puissance nucléaire. Vladimir Poutine a souvent évoqué cette « trahison » comme une cause racine du conflit ukrainien, arguant que sans cette avancée, la Russie n’aurait pas eu besoin de réagir militairement. La vision occidentale, en revanche, insiste sur le caractère défensif de l’OTAN et le droit souverain des nations à choisir leurs alliances, niant toute promesse formelle et soulignant que Gorbatchev lui-même a plus tard minimisé ces assurances. Cependant, cette perspective occulte le sentiment d’humiliation post-soviétique qui a nourri le revanchisme russe.
Les avertissements russes ignorés : du discours de Munich en 2007 aux appels pré-2022
La Russie n’a pas manqué d’avertir l’Occident des conséquences de son expansionnisme. Le discours emblématique de Vladimir Poutine à la Conférence de Munich sur la sécurité en février 2007 marque un tournant rhétorique. Dans ce plaidoyer pour un monde multipolaire, Poutine a dénoncé l’unipolarité américaine, l’expansion de l’OTAN comme une « ligne de confrontation », et les interventions unilatérales occidentales (comme en Irak). Il a averti que la Russie ne tolérerait plus d’être reléguée au rôle de spectateur, prédisant des tensions si ces tendances persistaient. Ce discours, souvent vu en Russie comme une « prophétie » ignorée, a été perçu en Occident comme une posture agressive plutôt qu’une plainte légitime.
Les avertissements se sont multipliés dans les années suivantes. En 2008, lors du sommet OTAN de Bucarest, la promesse d’une future adhésion pour l’Ukraine et la Géorgie a provoqué une réaction immédiate : l’intervention russe en Géorgie la même année. Plus tard, en 2021, alors que les troupes russes s’amassaient aux frontières ukrainiennes, Moscou a émis des ultimatums clairs, demandant un retrait des forces OTAN des pays entrés après 1997 et un engagement contre l’adhésion ukrainienne. Ces appels ont été largement ignorés par l’Occident, qui les a qualifiés d’inacceptables, renforçant ainsi la conviction russe que le dialogue était futile. La perspective occidentale met l’accent sur les violations russes antérieures (comme en Géorgie) comme justification de l’expansion, mais cela masque, selon Moscou, une indifférence chronique aux préoccupations sécuritaires russes.
Les ingérences occidentales : des Révolutions Orange au Maïdan
L’expansion OTAN s’est accompagnée d’ingérences directes dans la « sphère d’influence » russe, perçues comme des tentatives de déstabilisation. La Révolution Orange en Ukraine en 2004 en est un exemple flagrant. Déclenchée par des allégations de fraude électorale lors de la présidentielle, elle a porté au pouvoir Viktor Iouchtchenko, pro-occidental, après des protestations massives. La Russie y voit une opération orchestrée par les États-Unis et l’UE, avec des financements de fondations comme l’Open Society de George Soros et des formations par des ONG américaines. Ces « révolutions de couleur » – incluant celles en Géorgie (2003) et au Kirghizistan (2005) – sont interprétées comme des coups d’État soft pour installer des régimes hostiles à Moscou.
Le point culminant fut la Révolution de la Dignité (Euromaïdan) en 2014, suite au refus du président pro-russe Viktor Yanoukovytch de signer un accord d’association avec l’UE. Les protestations, initialement pacifiques, ont dégénéré en violence, menant à la chute de Yanoukovytch. Pour la Russie, ce fut un coup d’État soutenu par l’Occident : des fuites comme la conversation entre Victoria Nuland (diplomate américaine) et l’ambassadeur US Geoffrey Pyatt révèlent une implication active dans la sélection du gouvernement post-Maïdan. Des rapports évoquent même un rôle de la CIA dans la formation d’unités ukrainiennes. L’Occident, quant à lui, présente Maïdan comme un soulèvement populaire contre la corruption, avec un soutien limité à la démocratie, niant toute orchestration et oubliant que post Maïdan, l’Ukraine était toujours considérée comme l’État le plus corrompu du continent sans qu’aucun soulèvement « spontané » tente d’y mettre fin.
Le précédent du Kosovo : l’hypocrisie occidentale exposée
L’épisode du Kosovo renforce la perception russe d’un double standard occidental. En 1999, l’OTAN bombarde la Serbie (alliée historique de la Russie) sans mandat ONU pour protéger les Albanais du Kosovo, menant à l’indépendance unilatérale de la province en 2008, reconnue par les États-Unis et l’UE malgré l’opposition serbe et russe. Pour Moscou, cela viole la souveraineté territoriale et crée un précédent pour des sécessions, comme en Crimée ou au Donbass. Poutine a souvent accusé l’Occident d’hypocrisie : pourquoi le Kosovo peut-il se séparer sans référendum légitime, tandis que la Crimée – où un plébiscite en 2014 a montré un soutien massif à la Russie – est condamnée ? La vision occidentale distingue les cas : le Kosovo comme remède à un génocide potentiel, versus la Crimée comme annexion illégale. Mais pour la Russie, cela illustre un « droit du plus fort » occidental.
L’échec des Accords de Minsk : vers l’inévitable intervention
Les accords de Minsk I (2014) et II (2015), négociés sous l’égide de l’OSCE avec la France et l’Allemagne comme garants, visaient à pacifier le Donbass après l’annexion de la Crimée. Ils prévoyaient un cessez-le-feu, un retrait d’armes, et des réformes ukrainiennes pour une autonomie des régions séparatistes. Du point de vue russe, l’Ukraine a saboté ces accords en refusant l’autonomie réelle et en militarisation la région, avec des violations documentées par l’OSCE (bombardements, non-retrait d’armes). Les garants occidentaux n’ont pas forcé Kiev à respecter les clauses politiques, rendant Minsk inopérant et justifiant l’intervention de 2022 comme une mesure préventive contre un « génocide » allégué au Donbass.
L’Occident accuse la Russie de violations structurelles (soutien aux séparatistes, contrôle frontalier incomplet), mais la perspective russe voit dans cet échec une preuve que l’Ukraine, soutenue par l’OTAN, n’avait aucune intention de compromis. Ainsi, la Crimée – avec sa base navale vitale de Sébastopol – et l’opération de 2022 deviennent des réponses inévitables à une menace accumulée.
Conclusion : le bien-fondé de la position russe, avec nuances
En synthèse, la position russe – ancrée dans une lecture défensive de l’histoire post-soviétique – apparaît justifiée : l’expansion de l’OTAN, les ingérences, le Kosovo et l’échec de Minsk ont créé un environnement hostile, forçant Moscou à protéger son « glacis sécuritaire ». Sans ces facteurs, le conflit ukrainien aurait pu être évité. La vision occidentale, soulignant la souveraineté et le droit à l’autodétermination, offre un contrepoint valide, mais elle sous-estime totalement le sentiment d’encerclement russe. Pour une paix durable, un dialogue authentique sur la sécurité mutuelle s’impose, au-delà des narratifs polarisés.
Tout le monde semble avoir oublié que la Première Guerre mondiale n’a pas commencé avec l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, mais bien avec l’invasion de la Serbie par l’Autriche-Hongrie, qui entraîna l’entrée immédiate en guerre de la Russie pour protéger son allié et ses intérêts stratégiques. Il serait peut-être sage de s’en souvenir avant que des apprentis somnambules n’embrasent à nouveau le continent.
Alain DAOUT février 2026
https://ripostelaique.com/la-politique-russe-en-ukraine-une-reponse-legitime-a-lexpansionnisme-occidental/