samedi 26 décembre 2009
La route des Indes
vendredi 18 décembre 2009
L’idéologie contre l’Afrique
lundi 14 décembre 2009
Bismarck et l’Afrique (1)
Jusqu’en 1884, les priorités allemandes furent européennes. Avant 1870, afin de réaliser l’unité ; après la proclamation de l’Empire, afin de consolider ce dernier. A partir de 1890, année où Bismarck abandonna la chancellerie, l’Allemagne chercha à combler son retard sur les grandes puissances coloniales. Tournant alors résolument le dos aux principes bismarckiens en ce domaine, elle bouscula le jeu diplomatique, provoquant des tensions à la faveur desquelles elle réussit à élargir son domaine, s’imposant enfin comme puissance coloniale.
Bismarck pensait que l’Etat allemand devait se tenir à l’écart du mouvement colonial mais que rien n’interdisait cependant aux firmes commerciales germaniques de se lancer dans des entreprises ultra-marines.
En 1868, avant la réalisation de l’unité allemande, quand des négociants d’Allemagne du Nord avaient proposé au roi de Prusse d’acquérir des territoires libres en Afrique orientale et dans l’actuel Mozambique, la réponse de Bismarck, alors chancelier de Prusse, avait été nette :
« Je pense que la Confédération ne doit pas s’engager dans des entreprises coloniales, celles-ci devant être l’oeuvre exclusivement de l’initiative privée. » (Lettre du 9 janvier 1868 au ministre de la Marine, Roon.)
Après 1871, Bismarck suivit la même ligne politique : pour lui, la constitution d’un empire colonial présentait trois inconvénients principaux :
1 - celui d’affaiblir l’Allemagne en détournant vers l’Afrique une partie des énergies nationales au moment où le Reich avait, en Europe même, besoin de tous ses fils ;
2 - celui de gaspiller les ressources de l’Etat ou même des particuliers dans une entreprise au devenir douteux ;
3 - celui, enfin, de créer des conflits diplomatiques avec la France et la Grande-Bretagne qui considéraient le continent noir comme leur chasse gardée.
Allant plus loin qu’un simple refus d’engagement outre-mer, Bismarck définit la doctrine qui sera celle de l’Allemagne durant une douzaine d’années. Elle tient en trois points principaux :
1 - Le gouvernement allemand n’a pas pour objectif de planter son drapeau sur une poussière de possessions dispersées et indéfendables.
2 - L’Allemagne annonce officiellement qu’elle ne nourrit aucune ambition territoriale coloniale. Dans ces conditions, les puissances concernées ne doivent pas voir dans les dynamiques commerçants allemands, qui parcourent les Afriques déjà partagées, les représentants d’un quelconque impérialisme colonial germanique.
3 - En revanche, l’Allemagne affirme que son seul objectif impérialiste est d’ordre commercial ; il est donc d’une tout autre nature que celui de la France ou de la Grande-Bretagne, qui cherchent à acquérir un maximum de territoires coloniaux.
C’était, en effet, grâce aux infrastructures, aux fonctionnaires, aux soldats britanniques ou français que les commerçants de Brême ou de Hambourg pouvaient créer et développer leurs affaires.
Ils n’allaient pas pouvoir conserver éternellement cette attitude de "profiteurs".
A cette opposition extérieure s’ajouta bientôt celle des milieux économiques allemands qui trouvaient des échos de plus en plus attentifs quand ils affirmaient que l’Allemagne perdait de sa substance par l’émigration et par les investissements qui se faisaient ailleurs que dans des territoires allemands. En 1878 déjà, un journaliste avait écrit : « Il s’agit de savoir si l’Allemagne va se décider à faire autre chose en Afrique que d’y envoyer des missions scientifiques et d’y semer les ossements de ses explorateurs (...) ».
par Bernard Lugan http://www.francecourtoise.info (à suivre)
Bismarck et l’Afrique (2)
1 - Pays d’émigration durant tout le XIXe siècle, l’Allemagne avait vu partir sans espoir de retour 3 500 000 des siens entre 1819 et 1885. Il s’agissait d’une véritable hémorragie humaine et les groupes de pression coloniaux, dont la Ligue coloniale fondée en 1883, militèrent pour que ce flot soit détourné vers ces colonies de peuplement appartenant à l’Allemagne.
2 - L’Allemagne s’était lancée dans un ambitieux programme maritime destiné à garantir la liberté commerciale sur toutes les mers du Globe. Mais encore fallait-il disposer de points d’appui sûrs ; il était donc nécessaire de posséder des colonies.
3 - Les initiatives commerciales privées permettaient, certes, à l’Etat de ne pas être engagé dans un engrenage colonial, mais, en cas de menace pesant sur des ressortissants allemands, là où aucune autre autorité européenne ne s’exerçait, fallait-il les laisser massacrer sans intervenir ?
Bismarck, qui ne pouvait plus s’opposer au mouvement de course aux colonies, tente alors de le contrôler, afin de le freiner ; il affirma alors que la constitution d’un empire colonial n’était pas un but, une fin en soi mais simplement un moyen de soutenir, d’aider le commerce de l’Allemagne. C’est précisément pour faire respecter la liberté des activités commerciales allemandes qu’il accepta la constitution des premiers noyaux de colonisation en Afrique orientale, au Togo et au Cameroun.
Le 24 avril 1884, après de longues hésitations, Bismarck télégraphia au consul allemand du Cap qu’à partir de ce jour les 1 500 kilomètres situés entre les fleuves Orange et Cunene (au sud de l’Angola) étaient placés sous protection du Reich. L’Allemagne se lançait donc à son tour dans la course aux colonies. Le 6 juillet 1884, le drapeau allemand fut hissé à Lomé (Togo) et, le 12 juillet, le protectorat proclamé au Cameroun.
Avec retard, mais avec résolution, l’Allemagne venait donc de prendre place parmi les nations intéressées par l’Afrique. Le contexte international imposait qu’une tractation coloniale se fasse au niveau européen. Afin que les rivalités coloniales ne se transforment pas en conflits armés entre les puissances, et pour que l’Allemagne ait une "part" d’Afrique à la hauteur de sa puissance en Europe, Bismarck réunit une conférence internationale à Berlin. Elle se tint du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Le partage du continent y fut organisé et codifié.
En 1890, Bismarck fut écarté des affaires par l’empereur Guillaume II. A partir de cette époque, une nouvelle politique fut suivie.
Ne se contentant plus de réclamer la liberté pour ses maisons de commerce, le Reich exigea une place en Afrique correspondant à sa véritable puissance. Vecteur de cette volonté, la Ligue pangermaniste (Alldeutscher Verband) diffusa ses idées au moyen de nombreuses publications ; ses relais dans la presse nationale et régionale étaient très influents. Divers comités coloniaux soutenaient, favorisaient ou encourageaient les initiatives gouvernementales. Les milieux industriels et financiers acquis à l’expansion coloniale agissaient auprès de différents organes de presse et l’ensemble entretenait un climat favorable à la revendication d’une "place au soleil" pour l’Allemagne.
A partir de 1890 toujours, l’Etat allemand prit la place des compagnies coloniales incapables de mener cette nouvelle politique qui était d’assurer au Reich une place en Afrique digne de sa puissance.
Un problème se posait, cependant, qui était de savoir comment faire un Empire à partir d’une poussière de modestes comptoirs. Ce fut l’oeuvre d’un homme, le Dr. Kayser, directeur de la Section coloniale du ministère des Affaires étrangères.
Il ne fut guère encouragé par le chancelier Caprivi, successeur de Bismarck ; il lui fallut en effet attendre 1894 pour que le chancelier Hohenlohe, après avoir définitivement engagé l’Allemagne dans une véritable politique coloniale, accepte une augmentation significative des crédits coloniaux.
par Bernard Lugan http://www.francecourtoise.info
vendredi 11 décembre 2009
Saint Louis L'apogée de la France capétienne
Le nouveau roi est, par sa mère Blanche de Castille, l'arrière-petit-fils d'Henri II et Aliénor d'Aquitaine. Il n'a que 12 ans quand il succède à son père et c'est sa pieuse mère qui prend alors en main les destinées du royaume avec le titre de «baillistre» (régente, d'après le vieux français baillir, synonyme d'administrer).
La baillistre met un terme à la croisade contre les Albigeois en concluant le traité de Meaux avec le comte de Toulouse en 1229. En 1234, elle soutient une lutte difficile contre de turbulents vassaux comme le comte de Boulogne, le duc de Bretagne et le comte Thibaut IV de Champagne. La coalition se défait et échoue, peut-être en partie à cause de l'amour passionné que le comte de Champagne voue à la belle reine Blanche, amour que celle-ci repousse néanmoins sans équivoque.
Enfin, elle marie son fils à Marguerite de Provence le 27 mai 1234 en la cathédrale de Sens. D'une nature ardente, le roi aimera sa femme avec passion sans cesser bien entendu de lui être fidèle. Les deux époux auront onze enfants.
Bien que déclaré majeur en 1236, à un âge déjà bien avancé, 21 ans, Louis IX laisse les rênes du gouvernement à sa mère jusqu'en 1242, ne les reprenant que pour combattre une ultime révolte féodale. Après les victoires de Taillebourg et Saintes, le roi renouvelle à Lorris un traité de paix avec le comte de Toulouse. Il prépare également une paix durable avec l'Angleterre. Celle-ci est signée le 4 décembre 1259 à Paris, mettant fin à la première «guerre de Cent Ans» entre les deux pays.
Dans le même souci d'équilibre et de concessions réciproques, le roi capétien a signé l'année précédente à Corbeil un traité par lequel il abandonne toute forme de suzeraineté sur la Catalogne, la Cerdagne et le Roussillon cependant que le roi Jacques 1er d'Aragon renonce à ses prétentions sur la Provence et le Languedoc (à l'exception de Montpellier). Le fils du roi de France, futur Philippe III, épouse par ailleurs la fille de Jacques, Isabelle d'Aragon.
Fort de sa réputation de souverain juste et équitable, Louis IX est quelques années plus tard, à Amiens en 1264, choisi comme arbitre dans un conflit entre le roi Henri III d'Angleterre et ses barons. Cet arbitrage est connu sous le nom de «mise d'Amiens».
Libéré de ses soucis de voisinage, le roi inaugure à Paris la Sainte Chapelle. Ce chef d'oeuvre de l'art gothique est destiné à abriter de saintes reliques acquises à prix d'or par le souverain. Pour le futur Saint Louis, l'acquisition des reliques et la construction de la Sainte Chapelle sont certes affaire de piété. Elles sont aussi le fruit d'une habile politique visant à faire de Paris une cité comparable, en prestige et en sainteté, à Rome et Jérusalem.
Cette politique est servie par le dynamisme et le rayonnement de l'Université de Paris où enseigne Saint Thomas d'Aquin (1225-1274). Contemporain et ami du roi, le dominicain italien tente de concilier la pensée d'Aristote et la foi chrétienne. En 1253, le chapelain du roi Robert de Sorbon fonde sur ses deniers une pension pour accueillir les étudiants et les maîtres en théologie dépourvus de ressources. Ce Collegium pauperum magistrorum deviendra plus tard... la Sorbonne.
En son royaume, le roi se montre à la hauteur de sa réputation. Il institue des enquêteurs qui sanctionnent les abus de ses représentants locaux, baillis et sénéchaux, et met en place une commission financière chargée de traquer les détournements de fonds (elle deviendra la Cour des Comptes sous le règne de son petit-fils Philippe le Bel).
Il sévit contre les guerres privées. Les conseillers et juristes de la cour prennent l'habitude dans les années 1250 de se réunir en «parlement» (le mot est nouveau), parfois en présence du roi, pour juger des affaires qui leur sont soumises. Ainsi se développe une justice d'appel qui prévient et corrige les abus de la justice locale ou seigneuriale.
En 1261, le roi interdit les duels judiciaires. Cette pratique archaïque sera remise en vigueur à titre exceptionnel par son lointain successeur Henri II à l'occasion du duel de Jarnac.
Louis IX se signale aussi par ses initiatives à l'encontre des juifs. Il fait brûler en place publique tous les manuscrits hébreux de Paris (pas moins de 24 charrettes) après qu'un juif converti, Nicolas Donin, eut assuré en 1242 qu'ils contenaient des injures contre le Christ. En 1254, il bannit les juifs de France (mais, comme souvent au Moyen-Âge, la mesure est rapportée quelques années plus tard en échange d'un versement d'argent au trésor royal).
En 1269 enfin, il impose aux juifs de porter sur la poitrine une «rouelle», c'est-à-dire un rond d'étoffe rouge, pour les distinguer du reste de la population et prévenir les unions mixtes, appliquant ce faisant une recommandation du concile de Latran (1215) qui avait demandé de marquer les juifs, à l'image de ce qui se pratiquait déjà dans le monde musulman.
Ces mesures contestables témoignent du désir du pieux souverain de moraliser son royaume. Dans le même ordre d'idées, il réprime la prostitution, l'ivrognerie, les jeux de hasard. Il expulse aussi en 1269 les banquiers lombards et les usuriers originaires de Cahors (les cahorsins).
Le roi se consacre par ailleurs à ses rêves de croisade en Terre sainte. Ils ne lui porteront pas chance.
Ayant une première fois fait le voeu de se croiser suite à une maladie, il s'embarque avec son armée à Aigues-Mortes, en Provence, le 12 juin 1248, après avoir confié le royaume aux bons soins de sa chère mère. Il atteint le delta du Nil et s'empare de Damiette, puis il bat l'armée du sultan, composée de mercenaires appelés mamelouks, devant la citadelle d'el-Mansourah. Mais son avant-garde s'aventure imprudemment sur la route du Caire en dépit de ses ordres. Bientôt, toute l'armée est bloquée par la crue du Nil et menacée par la famine et l'épidémie. Elle tente de battre en retraite. Le 8 février 1250, le roi de France est fait prisonnier en protégeant son arrière-garde.
Hôte forcé des Égyptiens, Saint Louis impressionne ses geôliers par sa piété et sa grandeur d'âme. Libéré contre une rançon de 200.000 livres et la restitution de Damiette, il séjourne quatre ans dans les échelles franques du Levant dont il restaure l'administration et les défenses. La mort de sa mère le 26 novembre 1252 l'oblige à revenir enfin chez lui.
Saint Louis est encore à l'origine de la huitième et dernière expédition. L'expédition, longuement préparée, est contestée par les proches du roi et le fidèle Joinville lui-même refuse d'y participer ! Comme précédemment, il s'embarque avec son armée à Aigues-Mortes mais se dirige vers... Tunis. Son objectif est de convertir l'émir local. Mais, à peine débarquée, l'armée est frappée par une épidémie de typhus. Le roi lui-même est atteint et meurt pieusement sous les murs de Tunis, emportant avec lui l'idéal religieux de la croisade.
La dépouille du roi est inhumée dans la nécropole royale de Saint-Denis, à l'exception de son coeur, conservé à Monreale, en Sicile, dans le royaume de son frère Charles.
Dès l'année suivante est entamé son procès en canonisation. Celle-ci est prononcée par le pape Boniface VIII le 11 août 1297, sous le règne de son petit-fils Philippe IV le Bel. La monarchie capétienne est alors à son maximum de prestige et la France figure comme le royaume le plus puissant et le plus prospère de la chrétienté.
mercredi 9 décembre 2009
L’Histoire à l’endroit : Coloniser pour libérer

http://www.francecourtoise.info/
dimanche 6 décembre 2009
La colonisation philanthropique
vendredi 4 décembre 2009
29 février 888 Eudes, premier roi français
 Cette carte montre l'empire carolingien à la mort de Charlemagne et les grands ensembles territoriaux qui vont naître de son partage entre les trois petits-fils du grand empereur : France, Allemagne,...
Cette carte montre l'empire carolingien à la mort de Charlemagne et les grands ensembles territoriaux qui vont naître de son partage entre les trois petits-fils du grand empereur : France, Allemagne,...mardi 1 décembre 2009
Budapest 1956 : l’appel de la liberté
Il y a cinquante ans, le 23 octobre 1956, les Hongrois se révoltaient contre la dictature communiste et contre l’occupation soviétique. Une insurrection noyée dans le sang, mais qui allait marquer un tournant dans l’Histoire.
Budapest, 18 septembre 2006. Pendant que le siège de la télévision d’Etat est pris d’assaut, les heurts entre manifestants et policiers font 150 blessés. La veille a été diffusé un discours prononcé cinq mois plus tôt, à huis clos, par le Premier ministre. Le socialiste Ferenc Gyurcsány y avouait que son gouvernement n’avait fait que « des conneries » : « Nous avons menti le matin, le soir et la nuit. » Un mois plus tard, alors que, le 1er octobre, la droite a gagné les élections locales, le Premier ministre n’a pas démissionné. Toute analogie a ses limites : Budapest 2006 n’est pas Budapest 1956. Et pour cause. Ce n’est pas seulement la Hongrie qui a changé, c’est le monde.
Yalta, février 1945. Les accords conclus entre Churchill, Roosevelt et Staline prévoient le partage du continent : dans la moitié orientale de l’Europe, les Alliés laissent le champ libre aux Soviétiques. « De Stettin, sur la Baltique, à Trieste, sur l’Adriatique, un rideau de fer est descendu sur le continent » , s’exclame Churchill en 1946. L’expression restera. Derrière le Rideau de fer, sur le modèle du coup de Prague (1948), les Soviétiques installent partout des pouvoirs communistes.
Staline meurt en mars 1953. Dans tout l’empire soviétique, sa disparition permet une certaine détente. A la tête du gouvernement hongrois, Imre Nagy, un communiste modéré, succède à Mátyás Rákosi, le « disciple magyar le plus fidèle de Staline » , qui reste secrétaire général du Parti. La collectivisation des terres est suspendue, et 150 000 prisonniers politiques sont amnistiés. Les staliniens, cependant, restent puissants au sein de l’appareil. Ils l’emportent en 1955 : Nagy, accusé de « déviation de droite » , est remplacé à la présidence du Conseil par un fidèle de Rákosi, Andras Hegedüs, puis il est exclu du Parti. Les paysans, toutefois, reprennent leurs anciennes exploitations, tandis que les étudiants et les intellectuels, qui se sont habitués à la discussion libre, réclament le retour d’Imre Nagy : c’est du fond de la société que vient l’aspiration au changement.
En février 1956, lors du XXe congrès du Parti communiste de l’URSS, Nikita Khrouchtchev prononce un discours secret dans lequel il dénonce les méthodes de Staline : culte de la personnalité, purges systématiques, politique de la terreur. A la suite de fuites, ce rapport est diffusé dans le monde entier, indignant les non-communistes et troublant les « camarades ». En Europe centrale, c’est tout le système qui est ébranlé. Le 28 juin 1956, en Pologne, une grève spectaculaire éclate à Poznan : 50 000 ouvriers exigent une hausse des salaires, la liberté religieuse, des élections libres et le départ des troupes soviétiques. La répression se solde par 54 morts et plusieurs centaines de blessés. Mais l’ancien secrétaire général du Parti, Wladyslaw Gomulka, victime d’une purge en 1949, est rappelé pour sauver le régime : avec l’aval de Moscou, il retrouve son poste le 21 octobre 1956. A ce moment, Budapest est au bord de l’explosion.
Le 18 juillet précédent, sur décision de Khrouchtchev, le stalinien Rákosi a été éliminé de la tête du Parti en Hongrie. Il a été remplacé par un de ses proches, aussi détesté que lui, Ernest Gerö. Pour les partisans d’Imre Nagy, la situation restait bloquée. Deux mois plus tard, à Budapest, a lieu l’inhumation solennelle des restes de László Rajk : ce communiste de la première heure, accusé de « titisme » en 1949, avait été exécuté après un simulacre de procès. Le 6 octobre, la cérémonie se déroule en présence de 300 000 personnes. Tous les opposants sont là, moins pour rendre hommage à Rajk, qui avait été le principal artisan de la dictature communiste en Hongrie, que pour manifester leur hostilité à Rákosi. On sent que le vent tourne. Le 14 octobre, d’ailleurs, le Comité central annonce la réintégration de Nagy dans le Parti.
Le 23 octobre, une manifestation de soutien aux Polonais est convoquée à l’initiative des étudiants de Budapest. Les ouvriers des faubourgs les rejoignent. Mais, devant l’immeuble de la radio, la police politique tire sur la foule : la fusillade transforme la manifestation en émeute, les habitants de la capitale descendant dans la rue. L’armée hongroise, requise pour réprimer les mutins, se met au contraire à leur distribuer des armes. Partout surgissent des drapeaux magyars où l’on a découpé l’insigne communiste. Dans la nuit, Imre Nagy prend la parole depuis un balcon du Parlement. Lorsqu’il lance « Camarades... » , il se fait huer. Pas de doute : ce n’est pas une colère passagère du peuple, c’est une révolte contre le régime. A la radio, le secrétaire général du Parti, Gerö, dénonce ceux qui « cherchent à rompre le lien entre notre parti et le glorieux Parti communiste de l’Union soviétique ». Un propos qui ne fait qu’exciter les émeutiers : les permanences communistes sont attaquées, les librairies soviétiques saccagées, et la statue géante de Staline est abattue.
Le 24 octobre, avec l’accord du Kremlin qui cherche à sauver la situation, Imre Nagy est nommé président du Conseil. Annonçant la mise en vigueur de la loi martiale et appelant à déposer les armes, celui-ci se déclare néanmoins favorable à un « socialisme à caractère national ». Mais alors que les chars soviétiques circulent déjà dans la capitale, le nouveau chef du gouvernement rencontre une délégation venue de Moscou : Mikoyan et Souslov l’enjoignent de rétablir l’ordre sans délai.
La grève générale, commencée à Budapest, s’étend à tout le pays. Nagy, dépassé par les événements, est partagé : s’il considère les aspirations des Hongrois comme légitimes, ce vieux communiste n’envisage pas d’abandonner le Parti. Mais le 28 octobre, il semble finalement se rallier à l’insurrection. « Les graves crimes commis au cours des dernières années ont suscité ce vaste mouvement », déclare-t-il à la radio. Au cours de la même allocution, il proclame qu’un accord a été conclu avec les Soviétiques : ceux-ci quitteront la capitale, en attendant leur retrait définitif du territoire. Le soir même, l’Armée rouge commence à évacuer Budapest. Mais c’est pour mieux prendre position aux alentours.
Le 30 octobre, Nagy constitue un cabinet de coalition nationale : le gouvernement ne compte plus que quatre ministres communistes. Dans le pays se déroule alors ce que l’historien François Fejtö nomme, avec Raymond Aron, « la première révolution antitotalitaire ». Balayant le règne du parti unique, les anciennes formations refont surface, tandis que fleurissent conseils et comités révolutionnaires. Des journaux se créent, des radios aussi, et les détenus politiques sont libérés. Le cardinal primat de Hongrie, Mgr Mindszenty, condamné à la prison à perpétuité en 1948 au terme d’un procès inique, est lavé de toute accusation et rendu à la liberté : le 31 octobre, Budapest lui réserve un accueil triomphal.
En réalité, comme le souligne Henri-Christian Giraud dans le récit très vivant qu’il vient de faire paraître sur la révolution hongroise, on sait aujourd’hui, par les archives de Moscou, que c’est le premier jour des troubles, soit dès le 23 octobre, que Khrouchtchev a décidé d’utiliser la force. Depuis cette date, un flux ininterrompu de troupes (200 000 hommes) et de blindés (2 600 chars) franchit la frontière. Le 1er novembre, à la radio, Imre Nagy fustige l’URSS, qui ne respecte pas ses promesses, et avertit que son pays va quitter le pacte de Varsovie (cette alliance militaire des pays communistes a été constituée l’année précédente). Le nouveau secrétaire général du Parti, János Kádár - il a remplacé Ernest Gerö le 25 octobre -, rompt alors avec le gouvernement et se réfugie en Ruthénie subcarpatique, sous la protection des Soviétiques.
Le 3 novembre, l’Armée rouge contrôle la plus grande partie de la Hongrie. Mais à Budapest, on ne mesure pas le danger : le ministre de la Défense, Pal Maléter, se rend au siège du haut commandement soviétique afin d’y négocier l’évacuation des troupes ! C’est un guet-apens : il en sort prisonnier. Le 4 novembre au matin, l’artillerie lourde et l’aviation bombardent la ville, tandis que les blindés pénètrent de tous côtés. A 4 h 20, Nagy lance un appel : « A l’aube, les troupes soviétiques ont déclenché une attaque contre la capitale, avec l’intention évidente de renverser le gouvernement légal de la démocratie hongroise. Nos troupes combattent. Le gouvernement est à son poste. J’en avertis le peuple hongrois et le monde entier. »
Gardes nationaux, soldats ou simples civils, parfois des femmes ou des enfants, dotés d’un armement dérisoire, feront preuve d’un héroïsme admirable : ils parviendront à détruire 285 blindés ennemis. Au total, les combats feront 2 000 morts et 13 000 blessés du côté hongrois, et 7 000 tués et blessés du côté de l’Armée rouge. Au bout de quarante-huit heures, toutefois, la révolte de Budapest est écrasée. En province, les affrontements dureront deux semaines encore.
D’abord réfugié à l’ambassade de Yougoslavie, Imre Nagy est arrêté par le KGB. Quant au cardinal Mindszenty, il trouve abri à l’ambassade des États-Unis : il y restera jusqu’en 1971. Le 4 novembre, János Kádár, arrivé à Budapest dans les bagages de l’Armée rouge, forme un « gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan » . Objectif : « Protéger les résultats acquis du socialisme, écraser les forces néfastes de la réaction et restaurer le calme et l’ordre grâce à l’aide des Soviétiques. »
La répression sera implacable : des dizaines de milliers d’arrestations, 16 000 déportations au goulag, 300 condamnations à mort. Imre Nagy et Pal Maléter, pendus en 1958, seront enterrés dans une fosse commune. 160 000 Hongrois, dont 100 000 habitants de Budapest, passeront à l’Ouest.
Radio Europe Libre, station financée par les Américains, émettait à partir de Munich en direction du Rideau de fer. Depuis le début des événements, la station n’avait cessé d’encourager les Hongrois, les assurant que l’Occident viendrait à leur secours. Illusion. Au même moment, la France et le Royaume-Uni étaient plongés dans la crise de Suez, qui les conduisit, le 29 octobre, à déclencher une opération militaire contre l’Egypte de Nasser, alors alliée de l’URSS. Quant au président américain, Eisenhower, c’était un farouche anticommuniste, mais les États-Unis s’accrochaient à leur doctrine de la coexistence pacifique. Pour Washington, l’insurrection hongroise était une histoire interne au pacte de Varsovie, qui ne méritait pas de mettre le feu à la planète. John Foster Dulles, le secrétaire d’Etat américain, déféra la question devant l’ONU, laquelle se contenta de condamner solennellement l’intervention soviétique...
A Paris, dans la nuit du 6 au 7 novembre 1956, Jean-Pierre Pedrazzini mourait au terme d’une semaine de souffrance : le 30 octobre, ce reporter-photographe de Paris Match avait été mortellement blessé à Budapest. Le lendemain, des manifestants mettaient le feu au siège du Parti communiste. Le 9 novembre 1956, dans L’Express, Jean-Paul Sartre annonçait sa démission du Parti : « On ne peut plus avoir d’amitié pour la fraction dirigeante de la bureaucratie soviétique. » De François Furet à Emmanuel Le Roy Ladurie, d’Alain Besançon à Annie Kriegel, d’autres intellectuels firent mieux : non seulement ils quittèrent le PCF, mais ils rompirent avec le marxisme. La tragédie de Budapest avait au moins permis à certains d’ouvrir les yeux. Dans la revue Esprit, en décembre 1956, le poète Pierre Emmanuel s’interrogeait : « Par quel aveuglement avons-nous fait comme si le communisme n’était pas une névrose ? » Dans le monde entier, lentement mais sûrement, la question allait rebondir, avant de trouver sa réponse définitive, en 1989, avec l’écroulement du système soviétique.
A l’idéologie, Imre Nagy avait fini par préférer sa patrie. Une statue du héros de la révolution hongroise se dresse aujourd’hui face au Parlement de Budapest.
Jean Sévillia http://www.jeansevillia.com
François Fejtö, 1956, Budapest, l’insurrection, Complexe.
Henri-Christian Giraud, Le Printemps en octobre. Une histoire de la révolution hongroise, Editions du Rocher.
André Farkas, Budapest 1956, la tragédie telle que je l’ai vue et vécue, Tallandier.
Budapest 1956, la révolution, un album de 184 photographies d’Erich Lessing, textes d’Erich Lessing, François Fejtö, György Konrad et Nicolas Bauquet, Editions Adam Biro.
Budapest 1956, un livre audio de Nicolas Bauquet, CD De Vive Voix.
samedi 28 novembre 2009
Sitting Bull, le patriote

Tout le monde a entendu parler de cette ordure de Custer (lieutenant-colonel Armstrong Custer), ce que le Nouveau Monde a produit de meilleur en matière d’arrivisme, d’infatuation, de poudre aux yeux et de lâcheté. Custer tirait gloire de massacrer les villages cheyennes, ne distinguant pas, par souci de justice sans doute, femmes, enfants et braves, lesquels n’avaient guère les armes suffisantes pour faire face à la technologie yankee.
Cela n’empêcha pas ce « héros » d’être écrasé, à Little Bighorn, à la date bénite du 24 juin 1876, par les Sioux conduits par leurs chefs Gall et Crazy Horse.
Tout patriote devrait célébrer cet évènement digne de mémoire.
Sitting Bull (v. 1834-1890), l’un des chefs sioux, n’était pas présent à cette victoire, qui s’avéra vaine tellement le destin historique était contraire aux peuples indiens.
Sitting Bull s’appelait, de son vrai nom, Tatanka Yotaka. En 1867, il s’opposa à l’annexion par le gouvernement U.S., des terres de son peuple. Après la bataille de Little Bighorn, il dut s’enfuir au Canada, poursuivi par la haine de ses ennemis.
Etant revenu aux Etats-Unis, l’industrie du spectacle tenta de le récupérer en le faisant participer au Wild West show du viandard Buffalo Bill. Sa déchéance parut s’achever, avec ce qui restait de son peuple, dans une réserve, à Wounded Knee, dans le Dakota du sud. Mais un sursaut d’orgueil transforma sa fin en martyre glorieux. Wovoka, un prophète de la tribu des Paiutes, avait enseigné à ses frères une religion qui annonçait, par la pratique de la danse de l’Esprit, le retour aux terres natales, la résurrection des ancêtres, la fin de la colonisation. Les autorités, après avoir assassiné le 15 décembre 1890 Sitting Bull, soupçonné d’être l’inspirateur de ces aspirations subversives, massacrèrent 200 Indiens désarmés.
Presque un siècle plus tard, le 27 février 1973, des membres de l’American Indian Movement s’emparèrent de Wounded Knee. Deux Indiens furent tués. Après un siège de soixante jours, les représentants du mouvement furent reçus à la Maison Blanche. On leur jura que le Congrès écouterait leurs doléances.
Aucune démarche ne fut entreprise pour donner suite à cette promesse.
Voilà des extraits de discours tenus par Sitting Bull, magnifiques textes qui n’ont pas vieilli, et qui sont en mesure d’inspirer tous les êtres attachés à leur terre :
« Voyez Mes frères, le printemps est venu ; la terre a reçu l’étreinte du soleil, et nous verrons bientôt les fruits de cet amour !
Chaque graine s’éveille et de même chaque animal prend vie. C’est à ce mystérieux pouvoir que nous devons nous aussi notre existence ; c’est pourquoi nous concédons à nos voisins, même à nos voisins animaux, le même droit qu’à nous d’habiter cette terre.
Pourtant, écoutez-moi, vous tous, nous avons maintenant affaire à une autre race, petite, faible quand nos pères l’on rencontrée pour la première fois, mais aujourd’hui grande et arrogante. Assez étrangement, ils ont dans l’idée de cultiver le sol et l’amour de posséder est chez eux une maladie. Ces gens-là ont établi beaucoup de règles que les riches peuvent briser mais non les pauvres. Ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent notre mère à tous, la terre, pour leurs propres usages et se barricadent contre leurs voisins ; ils la défigurent avec leurs constructions et leurs ordures. Cette nation est pareille à un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage.
Nous ne pouvons vivre côte à côte. »
(Discours prononcé en 1875)
« Quel traité le blanc a-t-il respecté que l’homme rouge ait rompu ? Aucun.
Quel traité l’homme blanc a-t-il jamais passé avec nous et respecté ? Aucun.
Quand j’étais enfant, les Sioux étaient maîtres du monde ; le soleil se levait et se couchait sur leur terre ; ils menaient dix mille hommes au combat.
Où sont aujourd’hui les guerriers ?
Qui les a massacrés ?
Où sont nos terres ?
Qui les possède ?
Quel homme blanc peut-il dire que je lui ai jamais volé sa terre ou le moindre sou ? Pourtant ils disent que je suis un voleur.
Quelle femme blanche, même isolée, ai-je jamais capturée ou insultée ? Pourtant ils disent que je suis un mauvais Indien.
Quel homme blanc m’a jamais vu saoul ?
Qui est jamais venu à moi affamé et reparti le ventre vide ?
Qui m’a jamais vu battre mes femmes ou maltraiter mes enfants ?
Quelle loi ai-je violée ?
Ai-je tort d’aimer ma propre loi ?
Est-ce mal pour moi parce que j’ai la peau rouge ?
Parce que je suis un Sioux ?
Parce que je suis né là où mon père a vécu ?
Parce que je suis prêt à mourir pour mon peuple et mon pays ? »
« Je tiens à ce que tous sachent que je n’ai pas l’intention de vendre une seule parcelle de nos terres ; je ne veux pas non plus que les Blancs coupent nos arbres le long des rivières ; je tiens beaucoup aux chênes dont les fruits me plaisent tout spécialement. J’aime à observer les glands parce qu’ils endurent les tempêtes hivernales et la chaleur de l’été, et - comme nous-mêmes - semblent s’épanouir par elles. »
http://www.voxnr.com
jeudi 26 novembre 2009
Ces chiffres « arabes » qui viennent d’Inde
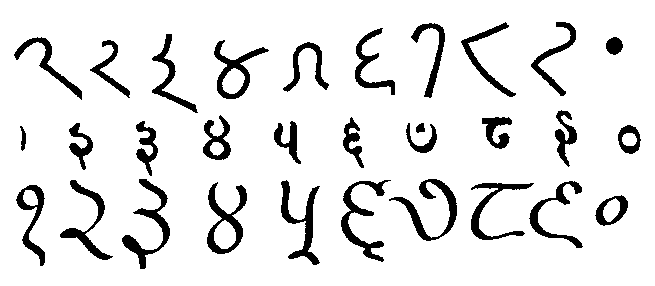
En tant qu’utilisateurs des chiffres dits “arabes”, nous en attribuons souvent la création aux mathématiciens arabes. C’est une erreur grossière.
Les chiffres de 1 à 9 ont été inventés en Inde. Ils apparaissent dans des inscriptions de Nana Ghât au 3e siècle av.J.-C. La numération de position avec un zéro (un simple point à l’origine), a été développée au cours du 5e siècle. Dans un traité de cosmologie en sanscrit de 458, on voit apparaître le nombre 14 236 713 écrit en toute lettres. On y trouve aussi le mot “sunya” (le vide), qui représente le zéro. C’est à ce jour le document le plus ancien faisant référence à cette numération.
mercredi 25 novembre 2009
L’Afrique en partie responsable de ses frontières
(22 février 1995)
samedi 21 novembre 2009
1945-1953 : la destruction des "Allemands ethniques" et des prisonniers de guerre allemands en Yougoslavie
Le traitement infligé à ces civils en Yougoslavie après 1945 peut être considéré comme un cas classique de « nettoyage ethnique » à grande échelle. Un examen attentif de ces tueries de masse présente des problèmes historiques et légaux, surtout quand on examine la loi internationale moderne, notamment celle qui "fonde" le Tribunal des Crimes de Guerre de La Haye qui s'occupe des crimes de guerre survenus dans les Balkans en 1991-1995. Or le triste sort des Allemands ethniques de Yougoslavie pendant et après la Seconde Guerre mondiale ne devrait pas être négligé. Pourquoi les souffrances de certaines nations ou de certains groupes ethniques sont-elles ignorées, alors que celles d'autres nations et groupes reçoivent l'attention sympathique des media et des politiciens occidentaux ?
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, plus d'un million et demi d'Allemands ethniques vivaient dans l'Europe du Sud-Est - Yougoslavie, Hongrie et Roumanie. En raison de leur résidence au long du Danube, ces gens étaient connus sous le nom populaire de « Souabes du Danube » ou Donauschwaben. La plupart étaient les descendants des colons qui vinrent dans cette région fertile aux XIIe et XVIIIe siècles, à la suite de la libération de la Hongrie du joug turc. Pendant des siècles, le Saint Empire Romain et ensuite l'Empire des Habsbourg luttèrent contre la domination turque dans les Balkans, et résistèrent à l"'islamisation" de l'Europe. Dans cette lutte, les Allemands du Danube étaient vus comme le rempart de la civilisation occidentale et donc tenus en haute estime par l'empire autrichien (et plus tard austro-hongrois) en raison de leur productivité agricole comme de leurs prouesses militaires. Le Saint Empire Romain et l'Empire des Habsbourg étaient des entités multiculturelles et multinationales au vrai sens du terme, dans lesquelles des groupes ethniques divers vécurent pendant des siècles dans une harmonie relative.
Après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, qui provoqua l'effondrement de l'empire des Habsbourg, et après le traité de Versailles de 1919, le statut juridique des Donauschwaben allemands devint incertain. Quand le régime national-socialiste fut établi en Allemagne en 1933, les Donauschwaben comptaient parmi les plus de douze millions d'Allemands ethniques qui vivaient en Europe centrale et orientale et en dehors des frontières du Reich allemand. Beaucoup de ces gens furent inclus dans le Reich suite à l'incorporation de l'Autriche et de la région des Sudètes en 1938, de la Tchécoslovaquie en 1939, et de portions de la Pologne à la fin de 1939. La « question allemande », c'est-à-dire la lutte pour l'autodétermination des Allemands ethniques en dehors des frontières du Reich allemand, fut un facteur important dans l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Même après 1939, plus de trois millions d'entre eux restèrent en dehors des frontières du Reich élargi notamment en Roumanie, en Yougoslavie, en Hongrie et en Union Soviétique.
Le premier Etat yougoslave de 1919-1941 avait une population de quelque 14 millions de gens de diverses cultures et religions. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie incluait près de six millions de Serbes, environ trois millions de Croates, plus d'un million de Slovènes, quelque deux millions de Bosniaques musulmans, un million d'Albanais au Kossovo, a peu près un demi-million d'Allemands et un autre demi-million de Magyars.
Après l'effondrement de la Yougoslavie en avril 1941, suivi par une rapide avance militaire allemande, environ 200 000 Allemands devinrent automatiquement citoyens de l'Etat Indépendant de Croatie nouvellement établi, un pays dont les autorités militaires et civiles restèrent alliées au Troisième Reich jusqu'à la dernière semaine de la guerre en Europe. La plupart des Allemands restants - environ 300 000 dans la région de Voïvodine - passèrent sous la juridiction de la Hongrie, qui incorpora cette région pendant la guerre (après 1945, elle fut rattachée à la partie serbe de la Yougoslavie).
Le sort des Allemands ethniques devint sinistre pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, surtout après la fondation de la seconde Yougoslavie, Etat communiste multiethnique dirigé par le maréchal Josip Broz Tito. Vers la fin d'octobre 1944, les forces de guérilla de Tito, aidées par l'avance soviétique et généreusement assistées par les fournitures aériennes des Alliés occidentaux, prirent le contrôle de Belgrade, la capitale serbe qui servit plus tard de capitale à la nouvelle Yougoslavie. L'un des premiers actes juridiques du nouveau régime communiste fut le décret du 21 novembre 1944 sur la « décision concernant te transfert des biens de l'ennemi dans la propriété de l'Etat ». Il déclarait « ennemis du peuple » les citoyens d'origine allemande, et les privait de droits civiques. Le décret ordonnait aussi la confiscation par le gouvernement de tous les biens, sans compensation, des Allemands ethniques de Yougoslavie auxquels une loi additionnelle, promulguée à Belgrade le 6 février 1945, retira la citoyenneté yougoslave.
A la fin de 1944 - alors que les forces communistes avaient déjà pris le contrôle de l'est des Balkans, Bulgarie, Serbie et Macédoine -, l'Etat de Croatie, allié aux Allemands, tenait encore bon. Cependant, au début du mois d'avril 1945, les troupes allemandes, en même temps que les troupes et les civils croates, commencèrent à faire retraite vers le sud de l'Autriche, notamment vers la Carinthie. Pendant les deux derniers mois de la guerre, la majorité des Volksdeutsche de Yougoslavie rejoignirent aussi ce nouveau « grand trek ». La crainte des réfugiés devant la torture et la mort était tout à fait fondée, étant donné l'horrible traitement infligé par les forces soviétiques aux Allemands civils en Prusse orientale et dans d'autres parties de l'Europe de l'Est. A la fin de la guerre, en mai 1945, les autorités allemandes avaient évacué environ 220 000 Allemands de Yougoslavie vers l'Allemagne et l'Autriche. Pourtant, beaucoup restèrent dans leur patrie ancestrale ravagée par la guerre.
Après la fin des combats en Europe, le 8 mai 1945, plus de 200 000 d'entre eux, qui étaient restés en Yougoslavie, devinrent effectivement les captifs du nouveau régime communiste. Quelque 63 635 civils allemands ethniques yougoslaves (femmes, hommes et enfants) périrent sous le règne communiste entre 1945 et 1950 - c'est-à-dire environ 18 % de la population civile allemande. La plupart moururent d'épuisement par le travail forcé et le « nettoyage ethnique », ou de maladie et de malnutrition. Le « miracle économique » tellement vanté par la Yougoslavie titiste et plus tard par les "soixante-huitards" occidentaux dont Michel Rocard, grand admirateur de l'autogestion à la yougoslave, fut, il faut le noter, le résultat direct du labeur de milliers de travailleurs forcés allemands qui, à la fin des années 1940, aidèrent à reconstruire le pays.
Leurs biens, évidemment confisqués, représentaient 97 490 petits commerces, usines, magasins, fermes et affaires diverses. Les biens immobiliers et terres cultivées spoliées couvraient 637 939 hectares et devinrent propriété de l'Etat yougoslave. D'après un calcul de 1982, la valeur des biens confisqués aux Allemands ethniques de Yougoslavie atteignait 15 milliards de marks, ou environ 7 milliards de dollars US. En prenant en compte l'inflation, cela correspondrait aujourd'hui à 18 milliards de dollars américains. De 1948 à 1985, plus de 87 000 de ces Allemands qui résidaient encore en Yougoslavie se sont installés en RFA et sont devenus automatiquement citoyens allemands.
Tout cela constitua la « solution finale de la question allemande » en Yougoslavie titiste.
Sur le million et demi de Donauschwaben qui vivaient dans le bassin du Danube en 1939-1941, quelque 93 000 servirent durant la Seconde Guerre mondiale dans les forces armées de la Hongrie, de la Croatie et de la Roumanie - des pays de l'Axe, alliés à l'Allemagne - ou dans les forces armées allemandes régulières. Les Allemands ethniques de Hongrie, de Croatie et de Roumanie qui servirent dans les formations militaires de ces pays demeurèrent citoyens de ces Etats respectifs.
De plus, beaucoup servirent dans la division Waffen-SS « Prinz Eugen », qui regroupa quelque 10 000 hommes pendant son existence durant la guerre (cette formation fut nommée en l'honneur du prince Eugène de Savoie, qui avait remporté de grandes victoires contre les forces turques à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe dans les Balkans). S'engager dans la « Prinz Eugen » conférait automatiquement la citoyenneté allemande à la recrue. Mais les pertes de la « Prinz Eugen » furent particulièrement élevées, le gros de la division s'étant rendu après le 8 mai 1945 et quelque 1 700 de ces prisonniers furent tués dans le village de Brezice prés de la frontière croato-slovène, et la moitié restante périt au travail forcé dans les mines de zinc proches de la ville de Bor, en Serbie.
En dehors du « nettoyage ethnique » des civils et soldats allemands du Danube, quelque 70 000 Allemands qui avaient servi dans les forces régulières de la Wehrmacht périrent en captivité en Yougoslavie. La plupart d'entre eux moururent lors de représailles, ou comme travailleurs forcés dans les mines, en construisant des routes, dans des chantiers navals, etc. C'étaient principalement des soldats du « Groupe d'Armée E » qui s'étaient rendus aux autorités militaires britanniques dans le sud de l'Autriche au moment de l'armistice du 8 mai 1945. Les autorités britanniques livrèrent environ 150 000 de ces prisonniers de guerre allemands aux partisans yougoslaves communistes sous prétexte d'un rapatriement ultérieur en Allemagne. A suivre
1945-1953 : la destruction des "Allemands ethniques" et des prisonniers de guerre allemands en Yougoslavie (fin)
Quelle est l'importance de ces chiffres ? Quelles leçons peut-on tirer de ces drames ? Il convient de souligner que le triste sort des civils allemands des Balkans n'est qu'une petite partie de la topographie de la mort communiste. Au total, entre 7 et 10 millions d'Allemands - personnel militaire ou civils - moururent pendant et après la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Union Soviétique. La moitié d'entre eux succombèrent dans les derniers mois de la guerre, ou après la reddition sans conditions de l'Allemagne le 8 mai 1945. Les pertes allemandes, à la fois civiles et militaires, furent sensiblement plus élevées pendant la "paix" que pendant la guerre.
Durant les mois qui précédèrent et suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ethniques furent tués, torturés et dépossédés dans toute l'Europe orientale et centrale, notamment en Silésie, en Prusse orientale, en Poméranie et dans les Sudètes. En tout 12 à 15 millions d'Allemands s'enfuirent ou furent chassés de leurs foyers au cours de ce qui reste peut-être le plus grand « nettoyage ethnique » de l'histoire. Sur ce nombre, plus de deux millions de civils allemands furent tués ou perdirent la vie.
Les génocides communistes dans la Yougoslavie d'après-guerre sont rarement abordés par les media des pays qui émergèrent des ruines de la Yougoslavie communiste en 1991, même si, chose remarquable, il y a aujourd'hui dans ces nouveaux pays une plus grande liberté d'expression et de recherche historique que dans les pays d'Europe occidentale. Les élites postcommunistes de Croatie, de Serbie et de Bosnie, largement composées d'anciens communistes, semblent partager un intérêt commun à refouler leur passé criminel concernant le traitement des civils allemands.
L'éclatement de la Yougoslavie en 1990-91, les événements qui y conduisirent, ainsi que la guerre et les atrocités qui suivirent, ne peuvent être compris que dans le cadre de grandes tueries menées par les communistes yougoslaves de 1945 à 1950. Comme nous l'avons déjà noté, le « nettoyage ethnique » n'a rien de nouveau. Même si l'on considère l'ancien dirigeant serbe Slobodan Milosevic et les prévenus croates actuellement jugés par le Tribunal International des Crimes de Guerre de La Haye comme de vils criminels, leurs crimes, soit réels, soit présupposés, demeurent minuscules par rapport à ceux du fondateur de la Yougoslavie communiste, Josip Broz Tito. Tito mena le « nettoyage ethnique » et les tueries de masse sur une bien plus grande échelle, contre les Croates, les Allemands et les Serbes, souvent avec l'aval des gouvernements britannique et américain. Son règne en Yougoslavie (1945-1980), qui coïncida avec l'ère de la « Guerre froide », fut néanmoins généralement soutenu par les puissances occidentales, qui considéraient son régime comme un facteur de stabilité dans cette région de l'Europe.
Par ailleurs, la tragédie des Allemands des Balkans fournit aussi des leçons sur le sort des Etats multiethniques et multiculturels. Deux fois, durant le XXe siècle, la Yougoslavie multiculturelle éclata dans un carnage inutile tout en déclenchant une spirale de haines entre ses groupes ethniques constituants. On peut conclure, par conséquent, que pour des nations et des cultures différentes, sans parler de races différentes, il vaut mieux vivre à part, séparés par des murs, plutôt que de vivre dans une fausse convivialité qui cache des animosités et laisse des ressentiments durables.
Peu de gens pouvaient prévoir les sauvages tueries interethniques qui balayèrent les Balkans après l'effondrement de la Yougoslavie en 1991, et ceci entre des peuples d'origine anthropologique relativement similaire. On ne peut que s'interroger avec inquiétude sur l'avenir des Etats-Unis et de la France ou des tensions communautaires entre les populations autochtones et des masses d'allogènes du Tiers Monde laissent présager un désastre avec des conséquences beaucoup plus sanglantes.
La Yougoslavie multiculturelle fut avant tout la création des dirigeants français, britanniques et américains qui signèrent le Traité de Versailles en 1919, et des dirigeants britanniques, soviétiques et américains qui se rencontrèrent à Yalta et à Postdam en 1945. Les figures politiques qui créèrent la Yougoslavie ex nihilo comprenaient très mal la perception que les différents peuples locaux avaient d'eux-mêmes et de leurs voisins immédiats.
Bien que les morts, les souffrances et les dépossessions subies par les Allemands ethniques des Balkans pendant et après la Seconde Guerre mondiale soient bien connues des autorités allemandes et des historiens indépendants, elles continuent donc à être ignorées dans le reste de l'Europe et aux Etats-Unis. Pourquoi ? On peut penser que si ces pertes allemandes étaient plus largement discutées et mieux connues, elles stimuleraient probablement une vision alternative de la Seconde Guerre mondiale, et en fait de toute l'histoire du XXe siècle. Une meilleure connaissance des pertes civiles allemandes pendant et après la Seconde Guerre mondiale pourrait aussi encourager une discussion sur la dynamique des sociétés multiculturelles d'aujourd'hui. Or, cette démarche, à son tour, risquerait d'affecter significativement les idées et les mythes dominants qui façonnent l'Europe depuis 1945. Un débat ouvert sur les causes et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale ternirait aussi la réputation de nombreux spécialistes et faiseurs d'opinion aux Etats-Unis et en Europe. Il est probable qu'une meilleure connaissance des crimes commis par les Alliés pendant et après la Seconde Guerre mondiale, au nom de « la démocratie », pourrait changer les mythes fondateurs de nombreux États contemporains.
Tomislav SUNIC*, Ecrits de Paris
<>,
* Ecrivain et historien. T. Sunic est auteur de Homo americanus, Child of the Postmodern Age (2007).
