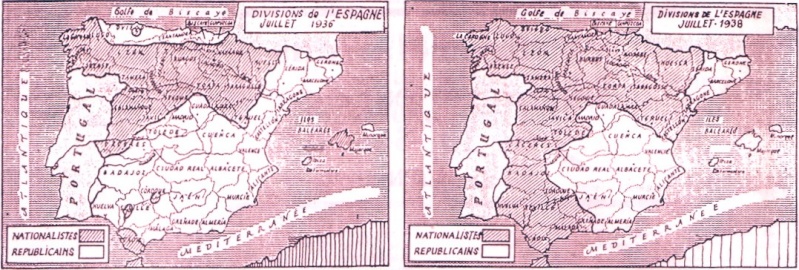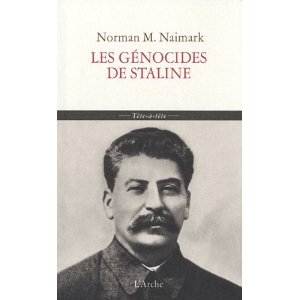dimanche 31 mars 2013
Les relations germano-espagnoles de 1936 à 1940
Il
est un chapitre peu connu de l'histoire européenne de ce siècle : celui
des relations germano-espagnoles de 1930 à 1945. L'historien Matthias
Ruiz Holst vient de combler, en quelque sorte, une lacune de l'histoire
contemporaine en faisant paraître un ouvrage concis, didactique, clair,
bien formulé sur cette question cruciale, qui, parallèlement, met en
exergue bon nombre de caractéristiques des régimes national-socialiste
et franquiste.
Franco fait appel aux Allemands
 La
République espagnole (1931-1939) avait établi des relations
commerciales suivies tant avec la République de Weimar qu'avec
l'Allemagne de Hitler. Les relations entre les 2 pays étaient donc des
plus banales. Tout change dès qu'éclate la guerre civile : les troupes
de Franco, principalement massées au Maroc, doivent trouver les moyens
de franchir le Détroit de Gibraltar, pour appuyer les rebelles
anti-républicains de la Péninsule. Ceux-ci, au départ, n'avaient guère
enregistré de succès. Un simple coup d'œil sur la carte permettait de
voir que les Républicains étaient restés maîtres des villes principales
(Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao). Franco envoie aussitôt une
délégation à Rome pour demander l'appui de Mussolini, ainsi qu'un
capitaine Arranz à Berlin, accompagné d'un intermédiaire allemand, Johannes Bernhardt.
La mission des 2 hommes consistait essentiellement à demander la
livraison d'avions, capables de faire passer les troupes du Maroc en
Andalousie. Apparemment sans consulter personne, ni les instances du
parti ni les diplomates professionnels, Hitler accepte la proposition
de Franco.
La
République espagnole (1931-1939) avait établi des relations
commerciales suivies tant avec la République de Weimar qu'avec
l'Allemagne de Hitler. Les relations entre les 2 pays étaient donc des
plus banales. Tout change dès qu'éclate la guerre civile : les troupes
de Franco, principalement massées au Maroc, doivent trouver les moyens
de franchir le Détroit de Gibraltar, pour appuyer les rebelles
anti-républicains de la Péninsule. Ceux-ci, au départ, n'avaient guère
enregistré de succès. Un simple coup d'œil sur la carte permettait de
voir que les Républicains étaient restés maîtres des villes principales
(Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao). Franco envoie aussitôt une
délégation à Rome pour demander l'appui de Mussolini, ainsi qu'un
capitaine Arranz à Berlin, accompagné d'un intermédiaire allemand, Johannes Bernhardt.
La mission des 2 hommes consistait essentiellement à demander la
livraison d'avions, capables de faire passer les troupes du Maroc en
Andalousie. Apparemment sans consulter personne, ni les instances du
parti ni les diplomates professionnels, Hitler accepte la proposition
de Franco.
Pour
Holst, cette décision rapide indiquerait que Hitler, en se conciliant
Franco, tenait compte d'un projet géo-stratégique à long terme qu'il
concoctait depuis longtemps. En effet, en se créant un allié à l'Ouest,
il bouleversait tout l'équilibre ouest-européen ; le gouvernement
républicain francophile serait remplacé par un gouvernement hostile à
la France, empêchant du même coup que ne se constitue un bloc
franco-hispanique allié à l'Union Soviétique. En brisant la cohésion de
l'Ouest latin, Hitler pouvait, pense Holst à la suite de l'historien
espagnol Ángel Viñas,
réaliser par les armes et par l'économie son plan de création d'un
espace vital dans l'Est européen, sans risquer une guerre sur 2 fronts.
[La situation du front en juillet 1936 (à g.) et en juillet 1938 (à d.). Après la conquête de la Catalogne, et la chute de Barcelone, Franco tiendra définitivement la victoire. L'Espagne cesse d'être un atout pour la France qui, ipso facto, se retrouve coincée entre une Allemagne puissante et une Espagne affaiblie mais favorable à sa protectrice germanique. L'équilibre européen de Versailles est rompu, d'autant plus que Hitler réalise l'Anschluß et annexe le territoire des Sudètes.]
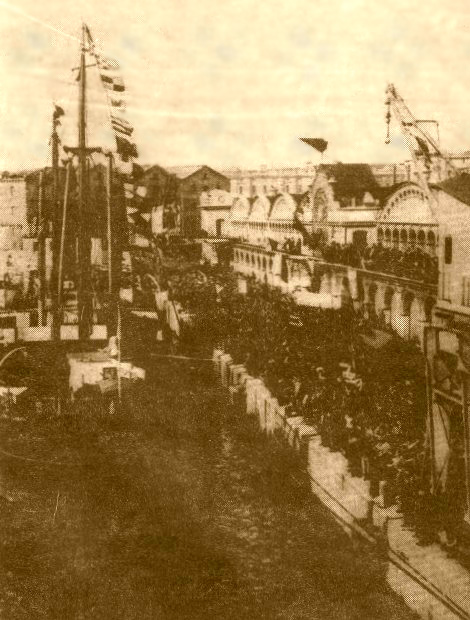 [Si
l'ltalie et l'Allemagne arment Franco, la France du Front Populaire et
l'URSS arment les Républicains. Ci-contre un navire russe, dont le port
d'attache est Odessa, arrive à Barcelone sous les acclamations d'une
foule nombreuse, massée sur les quais. Après la victoire franquiste,
Staline changera en quelque sorte son fusil d'épaule et préférera
s'allier à Hitler. En août, le pacte germano-soviétique est signé à
Moscou entre Molotov et Ribbentrop. Les religionnaires communistes et
les occidentalistes connaissent un désarroi majeur. Franco, qui assied
son régime sur l'anti-communisme et est débiteur de l'Allemagne, ne sait
plus sur quel pied danser. L'arrière-plan de l'alliance entre Hitler et
Staline demeure obscur. La plupart des historiens contemporains n’y
voient qu'une alliance purement tactique et négligent l'étude des
différentes forces divergentes qui animaient encore les sociétés russe
et allemande, malgré la dictature. C'est sur base d'une telle analyse
que l'on découvrira sans doute, un jour, la clef de l'énigme.]
[Si
l'ltalie et l'Allemagne arment Franco, la France du Front Populaire et
l'URSS arment les Républicains. Ci-contre un navire russe, dont le port
d'attache est Odessa, arrive à Barcelone sous les acclamations d'une
foule nombreuse, massée sur les quais. Après la victoire franquiste,
Staline changera en quelque sorte son fusil d'épaule et préférera
s'allier à Hitler. En août, le pacte germano-soviétique est signé à
Moscou entre Molotov et Ribbentrop. Les religionnaires communistes et
les occidentalistes connaissent un désarroi majeur. Franco, qui assied
son régime sur l'anti-communisme et est débiteur de l'Allemagne, ne sait
plus sur quel pied danser. L'arrière-plan de l'alliance entre Hitler et
Staline demeure obscur. La plupart des historiens contemporains n’y
voient qu'une alliance purement tactique et négligent l'étude des
différentes forces divergentes qui animaient encore les sociétés russe
et allemande, malgré la dictature. C'est sur base d'une telle analyse
que l'on découvrira sans doute, un jour, la clef de l'énigme.]
Isoler la France
Grâce
à la nouvelle configuration géostratégique que l'aventure franquiste
permettait d'envisager, l'Allemagne n'était plus coincée entre une
France rouge, alliée à une Espagne sociale-démocrate, et une URSS qui
avançait aussi ses pions en Tchécoslovaquie. En revanche, si Franco
réussissait son coup avec l'appui germano-Italien,
ce serait la France du Front Populaire qui serait coincée entre une
Allemagne industriellement forte et socialement stabilisée et une
Espagne alliée au Reich et économiquement complémentaire de
la machine industrielle tudesque. D'autant plus qu'au Nord, Léopold III
s'apprêtait à dénoncer les accords militaires franco-belges et à opter
pour une neutralité stricte.
Prudents,
Hitler et Mussolini ne reconnaissent les “nationaux” comme gouvernants
de l'Espagne que le 18 novembre 1936. Le premier ambassadeur allemand
dans l'Espagne nationale fut le Général von Faupel, préféré d’Hitler et
du parti. L'objectif de von Faupel, c'était de mettre sur pied un État
espagnol calqué sur l'appareil “social-révolutionnaire” allemand ; von
Faupel favorisera ainsi les éléments les plus “gauchistes” de la
Phalange, organisation complètement disloquée après la mort de son
leader José Antonio. L'ambassadeur allemand favorisera Manuel Hedilla
que Franco fera condamner à mort. Avec la chute du prolétarien
social-justicialiste Hedilla, nous constatons un premier clivage,
insurmontable, entre Allemands et Espagnols : Franco ne veut pas d'une
révolution sociale et demande à Hitler que von Faupel soit évincé.
Créer le chaos en Méditerranée occidentale
Après
l'incident Hedilla-Faupel, la Grande-Bretagne conservatrice se
rapproche de Franco, heureux de pouvoir contre-balancer ainsi
l'influence allemande, de plus en plus forte. Franco peut ainsi jouer
sur 2 tableaux et marchander les compensations demandées par le Reich
pour sa contribution militaire à la guerre civile. Après Munich, qui
constitue incontestablement un succès de la diplomatie hitlérienne,
Franco se rapproche une nouvelle fois de l'Allemagne, en passe de
devenir maîtresse du centre du continent, sans renoncer aux acquis de
ses rapprochements avec les démocraties occidentales.
Au
début de l'année 1939, les relations germano-espagnoles sont
positives, dans un environnement international de plus en plus complexe.
La victoire finale des nationaux ne faisant plus aucun doute, quelques
esprits machiavéliens, à Berlin, en viennent à souhaiter un
pourrissement de la situation et une prolongation de la guerre civile
espagnole. En effet, si la guerre durait longtemps, le Reich
pouvait gagner du temps : Anglais et Italiens se seraient affrontés en
Méditerranée pour le contrôle des Baléares ; Italiens et Français se
seraient retrouvés à couteaux tirés pour la Tunisie, etc. Pendant ce
temps, les Allemands auraient eu les mains libres pour réaliser l'Anschluß
et règler le problème de la Tchécosolovaquie. De plus, les
Britanniques, aux prises avec les Italiens, auraient cherché à se
ménager les bonnes grâces de Berlin et, du coup, la France, trop faible,
n'aurait pas pu s'attaquer seule à l'Allemagne.
L'Espagne : un allié de l'Axe très affaibli
Quand, le 1er
avril 1939, la guerre civile espagnole prend fin avec la victoire des
franquistes, l'Espagne est exsangue, son potentiel industriel est
réduit à rien et, à cause d'une destruction systématique des moyens de
transport, le ravitaillement de la population connaît une situation
catastrophique. Allemands et Italiens s'aperçoivent qu'ils se sont
donné un allié dans le sud-ouest européen mais que cet allié est si
affaibli qu'ils seront obligés de subvenir partiellement à ses besoins,
s'ils veulent faire valoir à leur profit les atouts géostratégiques de
sa configuration péninsulaire.
En
cas de conflit entre l'Axe Rome-Berlin et l'Entente Paris-Londres,
l'Espagne représente un ensemble de bases potentielles, importantes pour
la maimaîtrise de la Méditerranée occidentale et de l'Atlantique. Le
souci de Berlin, dans les 6 premiers mois de 1939, c'est de renforcer le
potentiel militaire espagnol, sans que la Wehrmacht n'ait à en
souffrir et sans que Franco ne doive s'adresser aux puissances de
l'Entente. Résultat : l'Espagne conserve un statut de stricte
neutralité, qu'elle envisage de garder pendant 5 années, tout en
signant des accords avec le Reich.
Pour l'Italie : un accès à l'Atlantique ; pour l'Espagne : une nouvelle « dimension impériale »
Afin de ne pas laisser à l'Axe l'exclusivité d'un partnership
privilégié avec l'Espagne, l'Angleterre et la France assouplissent
leurs positions et nomment Peterson et le Maréchal Pétain,
personnalités non contestées par les Espagnols, aux postes
d'ambassadeurs à Madrid. Les Espagnols germanophiles et fascisants,
dont le Ministre de l'Intérieur Serrano Súñer,
prônent une intensification des contacts avec Rome et Berlin, afin de
faire pression sur la France pour qu'elle cède en Afrique du Nord les
territoires convoités par l'Espagne. Avec les Baléares comme bases, une
alliance hispano-italo-allemande pourrait couper la France de l'Algérie,
affirmait, menaçant, un ambassadeur espagnol en Turquie.
jeudi 28 mars 2013
L'affaire Dreyfus entre nous
L’affaire
Dreyfus occupe une place primordiale dans la mythologie républicaine ;
quoique reléguée dans l'histoire, estompée par le culte mémoriel de la
Shoah, elle a été et reste l'élément fondateur de notre culpabilité
collective. À nous Français - la France de l'affaire Dreyfus est
antisémite ; à nous nationalistes - de Maurras à Le Pen, la droite
française porte le stigmate d'avoir fait condamner un innocent. Une
affaire qui nous agace, une affaire qui nous gêne, une affaire qu'on
aimerait bien oublier, mais qu'on nous ressort régulièrement. Alors que
faire ? Faut-il pratiquer la repentance ? Faut-il affirmer
orgueilleusement la culpabilité du traître de 1894 ? Avant de définir
une attitude, péché mignon de notre camp, il faudrait d'abord
travailler, tenter d'y voir clair. C'est ce que j'ai fait, partie avec
l'idée de comprendre, de dégager l'affaire réelle du verbiage qui
l'entoure, de réfuter légendes et ragots - à commencer par ceux
véhiculés « chez nous » qui sont autant de pièges. Je voulais faire
sobre et court (à l'origine, un simple article pour Rivarol !), mais l'affaire Dreyfus est trop complexe, une question en entraîne une autre et, sept ans après, j'ai abouti à Dreyfus-Esterhazy, réfutation de la vulgate,
réfutation dont ma plus grande fierté est d'avoir convaincu de son
bien-fondé Georges-Paul Wagner, à qui la seconde édition est dédiée*.
Reprenons à zéro. D'abord il y a deux « affaires Dreyfus » : la première, celle de 1894, qui s'achève par la condamnation d'Alfred Dreyfus pour trahison ; la seconde qui commence dans les coulisses en 1896, devient publique à l'automne 1897 avec l'apparition d'Esterhazy présenté comme le véritable coupable, atteint son paroxysme en 1898 et s'achève en 1899 par une nouvelle condamnation de Dreyfus au procès de Rennes. La seconde cassation et la réhabilitation, en 1906, ne sont, pour dire vite, que les retombées d'une affaire déjà refroidie et politiquement jugée.
L'AFFAIRE DE 1894
En 1894, l'affaire est celle du "bordereau", note manuscrite trouvée dans la corbeille à papiers de l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne, Maximilien von Schwartzkoppen. L'origine est incontestable : nous connaissons aujourd'hui une masse de documents de même provenance, certains très importants, ainsi jetés à légère par un homme qui pratiquait pourtant fort sérieusement l'espionnage, avec des résultats tangibles. Mais nous sommes au XIXe siècle, aux balbutiements du Renseignement, qui se pratique alors avec des méthodes d'une grande naïveté à nos yeux (lunettes noires pour se dissimuler, petit trou dans les conduits pour écouter les conversations...) Les militaires français connaissent le sérieux de la source, mais ne peuvent la révéler. Cela donnera lieu à bien des complications... Le bordereau, anonyme, est une liste de cinq sujets sur lesquels l'auteur propose « quelques renseignements intéressants » qui semblent émaner de différents bureaux du ministère de la Guerre ; d'où l'idée de chercher parmi les officiers stagiaires. Un seul élément concret : l'écriture. Les comparaisons d'écriture mènent à Alfred Dreyfus.
26 septembre - 22 décembre : enquête, premiers interrogatoires, instruction, procès, condamnation, tout cela est mené au pas de charge. Un dossier secret a été remis au tribunal militaire à l'insu de la défense, contenant des pièces issues de la même source que le bordereau. Nous sommes en 1894, dans un contexte très tendu avec l'Allemagne, haïe-admirée depuis l'humiliante défaite de 1870 ; on ne badine pas avec la trahison ; on ne s'embarrasse pas de scrupules juridiques. Son pourvoi en cassation rejeté, Dreyfus est dégradé le 5 janvier 1895 et expédié à l'île du Diable.
Que peut-on dire de cette première phase ?
D'abord, rejeter énergiquement la version selon laquelle Alfred Dreyfus aurait été accusé parce qu'il était un officier israélite. C'est absolument faux. Cet argument de propagande de l'époque repose sur des allégations sans fondement, reprises et amplifiées par des auteurs qui se copient les uns et les autres (notamment une déclaration tronquée et altérée du colonel Sandherr que l'on retrouve partout). Rien ne l'étaye. Dreyfus a été repéré parce qu'on cherchait la "taupe" parmi les stagiaires étant passés par les différents bureaux de l'état-major et que son écriture ressemblait à celle du bordereau. Son attitude gênée lors des interrogatoires, ses réponses embarrassées, parfois contradictoires, ont fait le reste.
Ensuite, se débarrasser d'une légende tenace chez les antidreyfusards : non, Dreyfus n'a pas avoué. En aucun cas de vrais aveux au caractère officiel. Mais pas davantage ces bribes d'aveux qui lui auraient échappés le jour de la dégradation. Propos peu cohérents, d'interprétation aventureuse, recueillis dans des conditions de déréliction, rapportés tardivement dans des circonstances suspectes : rien à retenir de ces sornettes ni des sombres histoires qui les entourent (décès inexpliqués, etc.)
Enfin, regarder en face les faiblesses du procès, grosses des tempêtes à venir. La mise en accusation d'Alfred Dreyfus reposait sur de forts soupçons, sa culpabilité a emporté la sincère conviction des différents acteurs du drame. Et pourtant... Et pourtant les expertises d'écriture n'ont pas fait l'unanimité. Le contenu des notes énumérées dans le bordereau n'a pas été connu, ni même cerné par d'éventuels recoupements. Aucune des pièces du dossier secret n'incrimine formellement Dreyfus. C'est léger, très très léger... On a établi qu'il pouvait connaître les thèmes évoqués, non qu'il les a connus ; on n'a pu trouver de mobile, l'accusé étant fortuné, son appartenance à des cercles de jeu évoquée mais non prouvée ; on a mis en évidence le caractère fureteur, rancunier, antipathique du personnage. Tout cela, exact, ne fait pas un coupable.
Ajoutons que le procès de Rennes, qui a fait la lumière sur beaucoup de points, n'a pas apporté plus de preuves contre Dreyfus. Sa condamnation, à cinq voix contre deux, pour trahison « avec circonstances atténuantes » (lesquelles ?! Il est stupéfiant que les militaristes se soient réjouis de pareil verdict...) porte la trace des doutes éprouvés par les juges.
Alors ?
Coupable ? Innocent ? Sincèrement je ne sais pas, et je ne pense pas qu'on puisse savoir sans retrouver les fameuses notes livrées à l'Allemagne, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Alfred Dreyfus serait relaxé au bénéfice du doute. Le contexte de l'époque, l'horreur qu'inspirait la trahison (à comparer avec la pédomanie de nos jours), la volonté d'un châtiment exemplaire, peuvent expliquer les carences du procès de 1894. Mais cela ne saurait les justifier, ni constituer une caution historique. Non, un tribunal militaire n'est pas infaillible ! Et il est bien dommage que les nationalistes de l'époque ne se soient pas rangés derrière l'avis d'Urbain Gohier, très tôt partisan de la révision d'une condamnation qui « en violant les garanties que la loi accorde à tout accusé [...] créait un précédent qui pouvait être employé contre n'importe quel citoyen français n'épousant pas les idées du gouvernement ».
ESTERHAZY
Coupable ? Pas sûr, ce qui suffit pour un acquittement juridique. Innocent ? Jamais les partisans de Dreyfus n'auraient pu imposer cet acquittement historique sans le secours d'un « vrai coupable » : Esterhazy.
Allons droit au but. J'ai acquis la conviction qu'Esterhazy a été stipendié par les dreyfusards pour endosser la culpabilité. Cette hypothèse, évidemment dénigrée par les auteurs actuels, a été évoquée en son temps par les antidreyfusards, voire même affirmée, mais jamais étayée sérieusement. Elle nécessite une connaissance approfondie de l'affaire (impossible de faire simple...), elle reste une hypothèse au sens strict où je n'en apporte pas la preuve formelle, mais elle repose sur des arguments solides, elle est cohérente et permet d'expliquer nombre de mystères de l'affaire. Les lecteurs d'Ecrits de Paris, pas plus que ceux de mon livre, ne sont obligés de me suivre jusqu'au bout, mais au moins qu'ils retiennent quelques bases saines. À utiliser sans modération !
On nous gave de sornettes. Non, Esterhazy n'a pas été confondu par les experts en écriture. Les seules expertises officielles, effectuées par des professionnels, ont conclu que son écriture n'était pas celle du bordereau. Certes une kyrielle de témoins, parés de titres universitaires, sont venus dire que les deux écritures étaient identiques : mais tous sont des dreyfusards engagés, aucun n'a de compétences en graphologie. Certes des lettres providentielles d'Esterhazy sont réapparues, comportant des analogies d'écriture flagrantes : toutes sont suspectes d'avoir été refaites après coup et certaines ont une histoire si rocambolesque que les auteurs de la vulgate choisissent de la passer sous silence.
Non, les aveux d'Esterhazy ne prouvent rien du tout. Il a d'abord été acquitté, sinon avec la complicité des militaires, du moins à leur grande satisfaction car ils n'ont vu que du feu à ce qui se préparait. Cet acquittement (janvier 1898), qui donne lieu au célèbre « J'accuse » de Zola et lance la phase aiguë de la crise, met Esterhazy définitivement à l'abri de toute poursuite : c'est alors seulement qu'il avoue être l'auteur du bordereau, aveux rétractés, modifiés, renouvelés au gré des circonstances. Argument joker des dreyfusards, ces pseudoaveux ne donnent aucune explication satisfaisante.
Plus subtil, réservé aux connaisseurs, il y a aussi la dénonciation de Schwartzkoppen. Dans un ouvrage posthume, publié en 1930, celui-ci "avoue" que son informateur était bien Esterhazy. Parmi d'autres éléments suspects, je montre que des passages entiers de ce petit livre sont recopiés dans les œuvres de Joseph Reinach, le grand ordonnateur dreyfusard. Exit.
Non, car certains le croient, la Cour de cassation, en 1906, n'a pas établi la culpabilité d'Esterhazy dont le cas ne lui était nullement soumis.
Non, on n'a jamais pu établir ni qu'Esterhazy était en mesure de fournir les renseignements évoqués, ni qu'il était allé « en manœuvres » comme l'annonce l'auteur du bordereau - on sait même qu'il a commis un faux pour faire croire qu'il était au camp de Châlons lors d'essais du canon de 120. Les auteurs modernes, devant renoncer aux théories extravagantes de l'époque, telle une complicité avec le colonel Henry, se contentent d'une version soft, faisant de leur traître un petit espion de pacotille, mi-fou mi-escroc, ce qui permet de renoncer à toute démonstration. En ce qui concerne la trahison de 1894, le dossier d'Esterhazy est vide, bien plus vide que celui de Dreyfus.
Non, Esterhazy n'a pas été le jouet des services de renseignements lors des contacts qui s'établissent à l'automne 1897. Cet épisode particulièrement ténébreux et compromettant pour l'armée, surtout en un temps où l'espionnage était ressenti comme indigne d'un officier, est à l'origine de moult complications, l'état-major se trouvant contraint de désavouer un homme courageux et lucide comme du Paty de Clam, ennemi numéro un des dreyfusards. Je montre qu'il est bien plus plausible que ce soit Esterhazy qui ait piégé les militaires, Esterhazy téléguidé par les dreyfusards.
Le fait est qu'à ce moment toutes ses initiatives poussent à la réouverture du dossier Dreyfus, issue que les militaires repoussent tant qu'ils le peuvent, et sont d'un synchronisme parfait avec les démarches politiques du sénateur Scheurer-Kestener au même moment.
Non, Esterhazy n'est pas un vieil ami d'Edouard Drumont - s'il a ses entrées à la Libre Parole, c'est après en avoir forcé les portes en 1896, et ses interventions de 1897 à 1899 dans le quotidien antisémite ont pour principal résultat de ridiculiser le journal. En revanche, c'est une vieille relation des Rothschild ; philosémite affiché, témoin de Crémieu-Foa dans le duel de celui-ci contre Drumont en 1892, il arrive à soutirer des subsides de cette élite israélite, tôt mobilisée pour défendre son coreligionnaire. Il existe une lettre d'Esterhazy, de début 1895, offrant ses services à Edmond de Rothschild. Toujours à court d'argent, dénué de scrupules, il était bien l'homme à utiliser comme coupable de substitution.
Mais si Esterhazy n'est pas celui qu'on dit, il faut que le colonel Picquart, qui a découvert sa culpabilité à partir d'un nouveau document issu de la corbeille de Schwartzoppen, le Petit bleu, ne soit pas le preux chevalier que nous présente la vulgate. Les éléments existent étayant cette insolente hypothèse. Je montre par exemple que dès avril 1896, Picquart a établi une corrélation entre Esterhazy et Dreyfus, ce qui est contraire à toutes ses affirmations et dissimule forcément quelque chose.
MUR DE MENSONGES
Bien des coïncidences sont gênantes pour les dreyfusards. Simultanéité des actions de Picquart et de Mathieu Dreyfus en 1896, d'Esterhazy et de Scheurer-Kestner à l'automne 1897. Selon nos auteurs, tout cela serait fortuit. Comme il serait fortuit qu'Esterhazy soit dénoncé par sa cousine au moment où l'enquête contre lui piétine, puis quelques mois plus tard par son neveu dans un contexte qui permet de faire revenir Picquart en scène au moment précis où les dreyfusards en ont besoin. J'ai sorti tous ces faits de l'ombre. J'ai analysé des points cruciaux comme la façon dont Mathieu Dreyfus a eu connaissance du dossier secret : ce qu'on nous raconte ne tient pas, et l'officier qui a remis ledit dossier au conseil de guerre était Picquart...
Il faut savoir que les dreyfusards ont entouré leur propre histoire d'un mur de silence, voire de mensonges justifiés â l'époque pour des militants, mais qu'il est sidérant de voir pieusement respectés par de prétendus historiens (visions d'une voyante, vertu intransigeante de la famille réputée s'être abstenue de tout contact avec l'Allemagne, avec Scheurer - ce qui est faux, etc.) C'est en grattant cette croûte maintenant séculaire que j'ai dressé une liste de questions auxquelles une réponse cohérente est la duplicité d’Esterhazy au profit de Dreyfus.
LES ENJEUX
Ce qui pourrait n'être qu'une passionnante énigme policière sortie du passé est une histoire lourde d'implications politiques. Dreyfus, hypothétique victime d'une erreur judiciaire comme il y en a eu cent, est un personnage falot qui s'efface derrière sa cause. Aujourd'hui comme hier, on se s'engage pas pour ou contre Dreyfus, mais pour ou contre l'armée, pour ou contre l'ordre moral, pour ou contre les droits de l'individu, etc. Ce sont les dreyfusards qui ont placé l'affaire sur ce terrain idéologique, de façon irréversible à partir de « J'accuse ». Et les nationalistes se sont rués joyeusement dans la bataille. Avec le recul, on ne peut que regretter que de belles intelligences comme Maurras, Brunetière, Barrès aient accepté les enjeux dans les termes imposés par les dreyfusards : ou Dreyfus est coupable et l'autorité de l'Etat est intacte ; ou Dreyfus est innocent et l'armée, donc le sentiment patriotique, est intrinsèquement coupable. C'était prendre un risque énorme sur un cas individuel - alors qu'aucun d'entre eux ne connaissait le dossier !
Et cette attitude se crispe encore à la découverte du faux Henry. En 1898, il apparaît que le colonel Henry a introduit, en 1896, un faux document accablant Dreyfus dans un dossier décidément trop maigre. Au lieu d'une saine prudence politique, les nationaux se jettent à corps perdu dans la défense du faussaire... Tous en rang par deux derrière l'armée - qui accumule les maladresses ! Cette défense inconditionnelle a bloqué les esprits sur la culpabilité de Dreyfus, argument de foi (tout comme son innocence en est devenu un) les empêchant d'aller voir sérieusement du côté d’Esterhazy. Le meilleur livre antidreyfusards, Précis de l'affaire Dreyfus de Dutrait-Crozon, est symptomatique : puisque Dreyfus est coupable, Esterhazy est un homme de paille, inutile de chercher à le prouver. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire ! C'est la seule solution que je peux proposer.
Les dreyfusards, largement minoritaires au début, ont peu à peu réuni toutes les forces anticonservatrices. À partir de J'accuse, qualifié par Jules Guesde de « plus grand acte révolutionnaire du siècle », tout ce qui est antimilitariste et anticlérical se rallie à la cause de Dreyfus dont les potentialités apparaissent énormes : ce n'est plus d'une éventuelle erreur judiciaire qu'il est question, c'est la perversité des valeurs traditionnelles qui est en cause. Peu à peu, francs-maçons, opportunistes, socialistes vont se lancer dans la bataille, les derniers devant renoncer à l'antisémitisme, jusqu'alors autant « de gauche » que « de droite » ; mais l'innocente victime est un juif... cela exige quelques sacrifices. Les dreyfusards leur livrent clef en main une machine à détruire le prestige de l'armée (pourtant si républicaine...), donc du patriotisme, donc du clergé catholique, donc de cette vieille France qui croyait encore aux valeurs éternelles. Ils prennent, ils jouent et ils gagnent. Les gouvernements Waldeck-Rousseau, Combes sont directement issus de l'affaire. Les forces nationales sont réduites à la défensive, désormais en position d'accusés. Et pour longtemps.
CASSER LE MYTHE
L'Affaire Dreyfus a ficelé le nationalisme français dans le rôle du méchant, en grande partie par manque d'esprit critique. Je pense donc qu'il ne faut pas nous enferrer dans une défense à contretemps des positions antidreyfusardes, largement assises sur une méconnaissance du dossier et une confiance aveugle en des militaires qui ne la méritaient pas toujours. En revanche, il reste nécessaire de dénoncer la propagande dreyfusarde, de montrer que la belle histoire qu'on nous raconte est fondée sur des mensonges et des silences inacceptables. Casser le mythe, réclamer un vrai travail d'historien. Révisionnisme, encore et toujours...
Monique DELCROIX. Ecrits de Paris novembre 2010
*Dreyfus-Esterhazy, Réfutation de la vulgate, 2e édition 2010. 464 pages avec bibliographie et index, 25 € ou 29 € port compris. Editions Akribéia, 45/3 route de Vourles, F-69230 Saint-Genis-Laval.
Reprenons à zéro. D'abord il y a deux « affaires Dreyfus » : la première, celle de 1894, qui s'achève par la condamnation d'Alfred Dreyfus pour trahison ; la seconde qui commence dans les coulisses en 1896, devient publique à l'automne 1897 avec l'apparition d'Esterhazy présenté comme le véritable coupable, atteint son paroxysme en 1898 et s'achève en 1899 par une nouvelle condamnation de Dreyfus au procès de Rennes. La seconde cassation et la réhabilitation, en 1906, ne sont, pour dire vite, que les retombées d'une affaire déjà refroidie et politiquement jugée.
L'AFFAIRE DE 1894
En 1894, l'affaire est celle du "bordereau", note manuscrite trouvée dans la corbeille à papiers de l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne, Maximilien von Schwartzkoppen. L'origine est incontestable : nous connaissons aujourd'hui une masse de documents de même provenance, certains très importants, ainsi jetés à légère par un homme qui pratiquait pourtant fort sérieusement l'espionnage, avec des résultats tangibles. Mais nous sommes au XIXe siècle, aux balbutiements du Renseignement, qui se pratique alors avec des méthodes d'une grande naïveté à nos yeux (lunettes noires pour se dissimuler, petit trou dans les conduits pour écouter les conversations...) Les militaires français connaissent le sérieux de la source, mais ne peuvent la révéler. Cela donnera lieu à bien des complications... Le bordereau, anonyme, est une liste de cinq sujets sur lesquels l'auteur propose « quelques renseignements intéressants » qui semblent émaner de différents bureaux du ministère de la Guerre ; d'où l'idée de chercher parmi les officiers stagiaires. Un seul élément concret : l'écriture. Les comparaisons d'écriture mènent à Alfred Dreyfus.
26 septembre - 22 décembre : enquête, premiers interrogatoires, instruction, procès, condamnation, tout cela est mené au pas de charge. Un dossier secret a été remis au tribunal militaire à l'insu de la défense, contenant des pièces issues de la même source que le bordereau. Nous sommes en 1894, dans un contexte très tendu avec l'Allemagne, haïe-admirée depuis l'humiliante défaite de 1870 ; on ne badine pas avec la trahison ; on ne s'embarrasse pas de scrupules juridiques. Son pourvoi en cassation rejeté, Dreyfus est dégradé le 5 janvier 1895 et expédié à l'île du Diable.
Que peut-on dire de cette première phase ?
D'abord, rejeter énergiquement la version selon laquelle Alfred Dreyfus aurait été accusé parce qu'il était un officier israélite. C'est absolument faux. Cet argument de propagande de l'époque repose sur des allégations sans fondement, reprises et amplifiées par des auteurs qui se copient les uns et les autres (notamment une déclaration tronquée et altérée du colonel Sandherr que l'on retrouve partout). Rien ne l'étaye. Dreyfus a été repéré parce qu'on cherchait la "taupe" parmi les stagiaires étant passés par les différents bureaux de l'état-major et que son écriture ressemblait à celle du bordereau. Son attitude gênée lors des interrogatoires, ses réponses embarrassées, parfois contradictoires, ont fait le reste.
Ensuite, se débarrasser d'une légende tenace chez les antidreyfusards : non, Dreyfus n'a pas avoué. En aucun cas de vrais aveux au caractère officiel. Mais pas davantage ces bribes d'aveux qui lui auraient échappés le jour de la dégradation. Propos peu cohérents, d'interprétation aventureuse, recueillis dans des conditions de déréliction, rapportés tardivement dans des circonstances suspectes : rien à retenir de ces sornettes ni des sombres histoires qui les entourent (décès inexpliqués, etc.)
Enfin, regarder en face les faiblesses du procès, grosses des tempêtes à venir. La mise en accusation d'Alfred Dreyfus reposait sur de forts soupçons, sa culpabilité a emporté la sincère conviction des différents acteurs du drame. Et pourtant... Et pourtant les expertises d'écriture n'ont pas fait l'unanimité. Le contenu des notes énumérées dans le bordereau n'a pas été connu, ni même cerné par d'éventuels recoupements. Aucune des pièces du dossier secret n'incrimine formellement Dreyfus. C'est léger, très très léger... On a établi qu'il pouvait connaître les thèmes évoqués, non qu'il les a connus ; on n'a pu trouver de mobile, l'accusé étant fortuné, son appartenance à des cercles de jeu évoquée mais non prouvée ; on a mis en évidence le caractère fureteur, rancunier, antipathique du personnage. Tout cela, exact, ne fait pas un coupable.
Ajoutons que le procès de Rennes, qui a fait la lumière sur beaucoup de points, n'a pas apporté plus de preuves contre Dreyfus. Sa condamnation, à cinq voix contre deux, pour trahison « avec circonstances atténuantes » (lesquelles ?! Il est stupéfiant que les militaristes se soient réjouis de pareil verdict...) porte la trace des doutes éprouvés par les juges.
Alors ?
Coupable ? Innocent ? Sincèrement je ne sais pas, et je ne pense pas qu'on puisse savoir sans retrouver les fameuses notes livrées à l'Allemagne, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Alfred Dreyfus serait relaxé au bénéfice du doute. Le contexte de l'époque, l'horreur qu'inspirait la trahison (à comparer avec la pédomanie de nos jours), la volonté d'un châtiment exemplaire, peuvent expliquer les carences du procès de 1894. Mais cela ne saurait les justifier, ni constituer une caution historique. Non, un tribunal militaire n'est pas infaillible ! Et il est bien dommage que les nationalistes de l'époque ne se soient pas rangés derrière l'avis d'Urbain Gohier, très tôt partisan de la révision d'une condamnation qui « en violant les garanties que la loi accorde à tout accusé [...] créait un précédent qui pouvait être employé contre n'importe quel citoyen français n'épousant pas les idées du gouvernement ».
ESTERHAZY
Coupable ? Pas sûr, ce qui suffit pour un acquittement juridique. Innocent ? Jamais les partisans de Dreyfus n'auraient pu imposer cet acquittement historique sans le secours d'un « vrai coupable » : Esterhazy.
Allons droit au but. J'ai acquis la conviction qu'Esterhazy a été stipendié par les dreyfusards pour endosser la culpabilité. Cette hypothèse, évidemment dénigrée par les auteurs actuels, a été évoquée en son temps par les antidreyfusards, voire même affirmée, mais jamais étayée sérieusement. Elle nécessite une connaissance approfondie de l'affaire (impossible de faire simple...), elle reste une hypothèse au sens strict où je n'en apporte pas la preuve formelle, mais elle repose sur des arguments solides, elle est cohérente et permet d'expliquer nombre de mystères de l'affaire. Les lecteurs d'Ecrits de Paris, pas plus que ceux de mon livre, ne sont obligés de me suivre jusqu'au bout, mais au moins qu'ils retiennent quelques bases saines. À utiliser sans modération !
On nous gave de sornettes. Non, Esterhazy n'a pas été confondu par les experts en écriture. Les seules expertises officielles, effectuées par des professionnels, ont conclu que son écriture n'était pas celle du bordereau. Certes une kyrielle de témoins, parés de titres universitaires, sont venus dire que les deux écritures étaient identiques : mais tous sont des dreyfusards engagés, aucun n'a de compétences en graphologie. Certes des lettres providentielles d'Esterhazy sont réapparues, comportant des analogies d'écriture flagrantes : toutes sont suspectes d'avoir été refaites après coup et certaines ont une histoire si rocambolesque que les auteurs de la vulgate choisissent de la passer sous silence.
Non, les aveux d'Esterhazy ne prouvent rien du tout. Il a d'abord été acquitté, sinon avec la complicité des militaires, du moins à leur grande satisfaction car ils n'ont vu que du feu à ce qui se préparait. Cet acquittement (janvier 1898), qui donne lieu au célèbre « J'accuse » de Zola et lance la phase aiguë de la crise, met Esterhazy définitivement à l'abri de toute poursuite : c'est alors seulement qu'il avoue être l'auteur du bordereau, aveux rétractés, modifiés, renouvelés au gré des circonstances. Argument joker des dreyfusards, ces pseudoaveux ne donnent aucune explication satisfaisante.
Plus subtil, réservé aux connaisseurs, il y a aussi la dénonciation de Schwartzkoppen. Dans un ouvrage posthume, publié en 1930, celui-ci "avoue" que son informateur était bien Esterhazy. Parmi d'autres éléments suspects, je montre que des passages entiers de ce petit livre sont recopiés dans les œuvres de Joseph Reinach, le grand ordonnateur dreyfusard. Exit.
Non, car certains le croient, la Cour de cassation, en 1906, n'a pas établi la culpabilité d'Esterhazy dont le cas ne lui était nullement soumis.
Non, on n'a jamais pu établir ni qu'Esterhazy était en mesure de fournir les renseignements évoqués, ni qu'il était allé « en manœuvres » comme l'annonce l'auteur du bordereau - on sait même qu'il a commis un faux pour faire croire qu'il était au camp de Châlons lors d'essais du canon de 120. Les auteurs modernes, devant renoncer aux théories extravagantes de l'époque, telle une complicité avec le colonel Henry, se contentent d'une version soft, faisant de leur traître un petit espion de pacotille, mi-fou mi-escroc, ce qui permet de renoncer à toute démonstration. En ce qui concerne la trahison de 1894, le dossier d'Esterhazy est vide, bien plus vide que celui de Dreyfus.
Non, Esterhazy n'a pas été le jouet des services de renseignements lors des contacts qui s'établissent à l'automne 1897. Cet épisode particulièrement ténébreux et compromettant pour l'armée, surtout en un temps où l'espionnage était ressenti comme indigne d'un officier, est à l'origine de moult complications, l'état-major se trouvant contraint de désavouer un homme courageux et lucide comme du Paty de Clam, ennemi numéro un des dreyfusards. Je montre qu'il est bien plus plausible que ce soit Esterhazy qui ait piégé les militaires, Esterhazy téléguidé par les dreyfusards.
Le fait est qu'à ce moment toutes ses initiatives poussent à la réouverture du dossier Dreyfus, issue que les militaires repoussent tant qu'ils le peuvent, et sont d'un synchronisme parfait avec les démarches politiques du sénateur Scheurer-Kestener au même moment.
Non, Esterhazy n'est pas un vieil ami d'Edouard Drumont - s'il a ses entrées à la Libre Parole, c'est après en avoir forcé les portes en 1896, et ses interventions de 1897 à 1899 dans le quotidien antisémite ont pour principal résultat de ridiculiser le journal. En revanche, c'est une vieille relation des Rothschild ; philosémite affiché, témoin de Crémieu-Foa dans le duel de celui-ci contre Drumont en 1892, il arrive à soutirer des subsides de cette élite israélite, tôt mobilisée pour défendre son coreligionnaire. Il existe une lettre d'Esterhazy, de début 1895, offrant ses services à Edmond de Rothschild. Toujours à court d'argent, dénué de scrupules, il était bien l'homme à utiliser comme coupable de substitution.
Mais si Esterhazy n'est pas celui qu'on dit, il faut que le colonel Picquart, qui a découvert sa culpabilité à partir d'un nouveau document issu de la corbeille de Schwartzoppen, le Petit bleu, ne soit pas le preux chevalier que nous présente la vulgate. Les éléments existent étayant cette insolente hypothèse. Je montre par exemple que dès avril 1896, Picquart a établi une corrélation entre Esterhazy et Dreyfus, ce qui est contraire à toutes ses affirmations et dissimule forcément quelque chose.
MUR DE MENSONGES
Bien des coïncidences sont gênantes pour les dreyfusards. Simultanéité des actions de Picquart et de Mathieu Dreyfus en 1896, d'Esterhazy et de Scheurer-Kestner à l'automne 1897. Selon nos auteurs, tout cela serait fortuit. Comme il serait fortuit qu'Esterhazy soit dénoncé par sa cousine au moment où l'enquête contre lui piétine, puis quelques mois plus tard par son neveu dans un contexte qui permet de faire revenir Picquart en scène au moment précis où les dreyfusards en ont besoin. J'ai sorti tous ces faits de l'ombre. J'ai analysé des points cruciaux comme la façon dont Mathieu Dreyfus a eu connaissance du dossier secret : ce qu'on nous raconte ne tient pas, et l'officier qui a remis ledit dossier au conseil de guerre était Picquart...
Il faut savoir que les dreyfusards ont entouré leur propre histoire d'un mur de silence, voire de mensonges justifiés â l'époque pour des militants, mais qu'il est sidérant de voir pieusement respectés par de prétendus historiens (visions d'une voyante, vertu intransigeante de la famille réputée s'être abstenue de tout contact avec l'Allemagne, avec Scheurer - ce qui est faux, etc.) C'est en grattant cette croûte maintenant séculaire que j'ai dressé une liste de questions auxquelles une réponse cohérente est la duplicité d’Esterhazy au profit de Dreyfus.
LES ENJEUX
Ce qui pourrait n'être qu'une passionnante énigme policière sortie du passé est une histoire lourde d'implications politiques. Dreyfus, hypothétique victime d'une erreur judiciaire comme il y en a eu cent, est un personnage falot qui s'efface derrière sa cause. Aujourd'hui comme hier, on se s'engage pas pour ou contre Dreyfus, mais pour ou contre l'armée, pour ou contre l'ordre moral, pour ou contre les droits de l'individu, etc. Ce sont les dreyfusards qui ont placé l'affaire sur ce terrain idéologique, de façon irréversible à partir de « J'accuse ». Et les nationalistes se sont rués joyeusement dans la bataille. Avec le recul, on ne peut que regretter que de belles intelligences comme Maurras, Brunetière, Barrès aient accepté les enjeux dans les termes imposés par les dreyfusards : ou Dreyfus est coupable et l'autorité de l'Etat est intacte ; ou Dreyfus est innocent et l'armée, donc le sentiment patriotique, est intrinsèquement coupable. C'était prendre un risque énorme sur un cas individuel - alors qu'aucun d'entre eux ne connaissait le dossier !
Et cette attitude se crispe encore à la découverte du faux Henry. En 1898, il apparaît que le colonel Henry a introduit, en 1896, un faux document accablant Dreyfus dans un dossier décidément trop maigre. Au lieu d'une saine prudence politique, les nationaux se jettent à corps perdu dans la défense du faussaire... Tous en rang par deux derrière l'armée - qui accumule les maladresses ! Cette défense inconditionnelle a bloqué les esprits sur la culpabilité de Dreyfus, argument de foi (tout comme son innocence en est devenu un) les empêchant d'aller voir sérieusement du côté d’Esterhazy. Le meilleur livre antidreyfusards, Précis de l'affaire Dreyfus de Dutrait-Crozon, est symptomatique : puisque Dreyfus est coupable, Esterhazy est un homme de paille, inutile de chercher à le prouver. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire ! C'est la seule solution que je peux proposer.
Les dreyfusards, largement minoritaires au début, ont peu à peu réuni toutes les forces anticonservatrices. À partir de J'accuse, qualifié par Jules Guesde de « plus grand acte révolutionnaire du siècle », tout ce qui est antimilitariste et anticlérical se rallie à la cause de Dreyfus dont les potentialités apparaissent énormes : ce n'est plus d'une éventuelle erreur judiciaire qu'il est question, c'est la perversité des valeurs traditionnelles qui est en cause. Peu à peu, francs-maçons, opportunistes, socialistes vont se lancer dans la bataille, les derniers devant renoncer à l'antisémitisme, jusqu'alors autant « de gauche » que « de droite » ; mais l'innocente victime est un juif... cela exige quelques sacrifices. Les dreyfusards leur livrent clef en main une machine à détruire le prestige de l'armée (pourtant si républicaine...), donc du patriotisme, donc du clergé catholique, donc de cette vieille France qui croyait encore aux valeurs éternelles. Ils prennent, ils jouent et ils gagnent. Les gouvernements Waldeck-Rousseau, Combes sont directement issus de l'affaire. Les forces nationales sont réduites à la défensive, désormais en position d'accusés. Et pour longtemps.
CASSER LE MYTHE
L'Affaire Dreyfus a ficelé le nationalisme français dans le rôle du méchant, en grande partie par manque d'esprit critique. Je pense donc qu'il ne faut pas nous enferrer dans une défense à contretemps des positions antidreyfusardes, largement assises sur une méconnaissance du dossier et une confiance aveugle en des militaires qui ne la méritaient pas toujours. En revanche, il reste nécessaire de dénoncer la propagande dreyfusarde, de montrer que la belle histoire qu'on nous raconte est fondée sur des mensonges et des silences inacceptables. Casser le mythe, réclamer un vrai travail d'historien. Révisionnisme, encore et toujours...
Monique DELCROIX. Ecrits de Paris novembre 2010
*Dreyfus-Esterhazy, Réfutation de la vulgate, 2e édition 2010. 464 pages avec bibliographie et index, 25 € ou 29 € port compris. Editions Akribéia, 45/3 route de Vourles, F-69230 Saint-Genis-Laval.
« Les génocides de Staline » de Norman M. Naimark
Livre présenté par Camille Galic.
En ce soixantième anniversaire de la mort (dans son lit, et couvert d’honneurs) du « Petit Père des peuples », est-il enfin temps d’admettre que les similitudes « entre le nazisme et le stalinisme sont trop nombreuses pour être ignorées » et qu’ « en fin de compte », si Adolf Hitler fut un génocideur, Joseph Staline le fut aussi ? C’est la conclusion du grand universitaire américain Norman M. Naimark, spécialiste de l’ère soviétique à l’université de Stanford, dans son livre court et assez mal écrit mais dense, « Les génocides de Staline ». C.G.
Pour beaucoup d’entre nous, et bien avant la publication du Livre noir du communisme
(Robert Laffont, 1997) dû à Stéphane Courtois, le caractère génocidaire
des régimes issus du marxisme-léninisme était une évidence, l’ancien zek croate (et ci-devant trotskiste) Ante Ciliga l’ayant par exemple établi dès 1938 dans Au pays du grand mensonge (Gallimard). Mais le sujet reste explosif.
Peut-on comparer « crimes soviétiques » et « horreurs nazies » ?
Moins en raison, désormais, de l’opposition des communistes que de
l’OPA lancée par Israël et la diaspora sur le terme de génocide ainsi
que l’explique Naimark dans un premier chapitre (« La question du
génocide ») passablement embarrassé et plein de formules propitiatoires
sur la barbarie du IIIe Reich et l’unicité de la Shoah qui,
« pour nombre de raisons, doit être considéré comme le pire cas de
génocide de l’époque moderne » ainsi qu’il le répète in fine à
l’usage de ceux qui n’auraient pas compris. « L’horreur fondamentale
inspirée par l’Holocauste, insiste ainsi l’universitaire états-unien,
influence à juste titre notre appréhension d’un certain nombre de
questions politiques et morales importantes. Du fait précisément que
l’Union soviétique eut un rôle primordial dans la victoire sur le
nazisme et perdit 27 millions de citoyens contre le monstre qui engendra
Auschwitz et Babi Yar, il existe une réticence considérable et
compréhensible à classer les crimes soviétiques dans la même catégorie
que les horreurs nazies. »
Cela constaté, il faut passer aux choses sérieuses, c’est-à-dire à
l’examen des faits. Et ceux-ci sont accablants, qu’il s’agisse de la
liquidation des « ennemis de classe » ou de celle de peuples catalogués
comme potentiellement dangereux pour l’avenir radieux du socialisme.
Après la dékoulakisation, l’Holodomor
Parmi les premiers, les Koulaks, surnom d’ailleurs obscène donné aux
paysans aisés. Plusieurs « dizaines de milliers » d’entre eux furent
« rapidement éliminés » en 1929 et « plus de deux millions » envoyés au
Goulag où 250.000 succombèrent « dans la seule période 1932-1933 ». Une
cadence que l’on devait revoir au moment des grandes purges organisées
par Staline à la fin des années 1930 et destinées à décapiter toute
opposition… et toute concurrence, la famille et l’entourage (parfois
simplement professionnel) des adversaires et des rivaux potentiels du
maître du Kremlin étant sur son ordre exprès « exécutés comme des
chiens » et, dans le meilleur des cas, déportés dans ce que Soljenitsyne
devait appeler l’archipel.
Parmi les seconds, les Baltes, les Polonais (22.000 morts dont
Staline tenta jusqu’à Nuremberg de faire endosser la responsabilité au
chancelier allemand) et les Ukrainiens trop attachés à leurs traditions
et à leurs spécificités, religieuses notamment, et donc réputés
réfractaires à l’idéologie communiste. D’où la terrifiante
« Holodomor », famine systématiquement organisée en Ukraine par Lazare
Moïsseïevitch Kaganovitch – qui, lui aussi, mourut dans son lit, presque
centenaire. Cette disette sans précédent fit au minimum 6 à 7 millions
de morts et entraîna cannibalisme et nécrophagie dans « un cycle de
dé-civilisation » dûment programmé, selon Naimark.
La moitié des Tatars et 38% des Kazakhs anéantis !
Mais l’historien mentionne d’autres cas qui sont moins connus, tel
celui des Tatars de Crimée, des Tchétchènes et des Ingouches,
massivement déportés et dispersés dans des déserts d’Asie centrale car
« destinés à l’élimination, sinon physique, du moins en tant que
nationalités ayant leur identité propre ». Résultat : sur les 190.000
Tatars déplacés, « 70.000 à 90.000 moururent pendant les premières
années d’exil », du fait de la faim et des conditions climatiques
extrêmes succédant à d’interminables acheminements en train, sans eau ni
nourriture – ce qui devait être dix ans plus tard le lot des Allemands
chassés des territoires germaniques de l’Europe de l’Est et eux aussi
« expulsés » dans des conditions inhumaines, tragédie tacitement
occultée mais récemment dévoilée par un autre universitaire américain,
R. M. Douglas (*).
Autre région sinistrée et délibérément dépeuplée car on connaissait à
Moscou l’ampleur des réserves en hydrocarbures du territoire, le
Kazakhstan : « Le nombre de décès attribuables à la famine fut de 1,45
million, 38% de la population. » Si l’on ajoute que « beaucoup de
Kazakhs furent abattus parce qu’ils essayaient de fuir leur pays », le
génocide est ici aussi avéré. De même que dans le cas d’ethnies
sibériennes jugées par Staline « irrationnelles » car numériquement
insignifiantes… et donc non viables de toute façon !
Qu’en disent nos belles âmes toujours si sensibles, à juste titre, au
sort réservé aux Indiens des deux Amériques par les Espagnols puis les
Yankees ?
L’indécent hommage de L’Huma
Nonobstant, la plupart des démocrates patentés y allèrent le 5 mars
1953 de leur hommage ému au grand disparu. En France, cependant qu’une
minute de silence était observée à l’Assemblée nationale à la demande du
président Herrriot, Le Monde, déjà « quotidien de référence »,
célébrait en Staline « l’homme qui a réconcilié la Russie et la
révolution au point de les rendre inséparables » et qui « a aussi permis
à l’homme de remporter sur la nature quelques-unes de ses plus
magnifiques victoires » – on sait au prix de quels désastres pour
l’environnement, tel l’assèchement de la mer d’Aral. Et L’Humanité, fidèle à elle-même, titrait à sa une sur « Le deuil de tous les peuples ».
Ceux, du moins, qui avaient survécu au génocidaire Staline… Lequel
n’avait d’ailleurs rien inventé (M. Naimark n’insiste pas suffisamment
sur ce point) mais simplement porté à son paroxysme le système hérité de
Lénine, créateur dès son décret de décembre 1917 des Kontzentratzionyé lageri,
autrement dit des camps de concentration où devait périr, exécutés ou
malades, affamés et à bout de forces, plus du dixième de la population
soviétique de l’époque.
Normam M. Naimark, Les génocides de Staline, Ed. L’Arche 2012, 140 pages avec notes, 15 €. Traduction de Jean Pouvelle.
Note :
Trois livres sur les relations germano-soviétiques de 1918 à 1944
La
problématique complexe des relations germano-soviétiques revient sur le
tapis en Allemagne Fédérale depuis quelque temps. Trois livres se sont
penchés sur la question récemment, illustrant leurs propos de textes
officiels ou émanant de personnalités politiques. Pour connaître
l'arrière-plan de l'accord Ribbentrop-Molotov, l'historien britannique
Gordon Lang, dans le premier volume de son ouvrage,
♦ “... Die Polen verprügeln...” : Sowjetische Kriegstreibereien bei der deutschen Führung 1920 bis 1941
[1er vol. : 1914 bis 1937, Askania-Weißbuchreihe, Lindhorst, 1988, 176 p. ; cf. aussi vol. 2 : von 1936 bis 1945,
1989, 176 p.] retrace toute l'histoire des rapprochements entre
l'Allemagne et l'URSS, isolée sur la scène diplomatique, contre les
puissances bénéficiaires du Traité de Versailles et contre l'État
polonais né en 1919 et hostile à tous ses voisins. L'enquête de Gordon
Lang est minutieuse et, en tant que Britannique, il se réfère aux
jugements sévères que portait David Lloyd George sur la création de
l'État polonais. Lloyd George, en effet, écrivait :
« La proposition de la Commission polonaise, de placer 2.100.000 Allemands sous la domination d'un peuple qui, jamais dans l'histoire, n'avait démontré la capacité de se gouverner soi-même, doit nécessairement déboucher tôt ou tard sur une nouvelle guerre en Europe orientale ».
Le
Premier Ministre gallois n'a pas été écouté. John Maynard Keynes, qui
quitta la table de négociation en guise de protestation, n'eut pas
davantage l'oreille des Français qui voulaient à tout prix installer un
État ami sur les rives de la Vistule. Notable exception, le Maréchal
Foch dit avec sagesse : « Ce n'est pas une paix. C'est un armistice qui
durera vingt ans ».
Ni
les Soviétiques, exclus de Versailles et virtuellement en guerre avec
le monde entier, ni les Allemands, punis avec la sévérité extrême que
l'on sait, ne pouvaient accepter les conditions du Traité. Leurs
intérêts devaient donc immanquablement se rencontrer. En Allemagne, les
troupes gouvernementales et les Corps Francs matent les insurrections
rouges, tandis que Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont assassinés.
D'autres chefs rouges, en revanche, furent courtisés par le gouvernement
anti-bolchévique, dont Radek, emprisonné à Berlin-Moabit puis transféré
en résidence surveillée, et Viktor Kopp, venu de Moscou pour suggérer
au Directeur du Département de l'Est du Ministère des Affaires
Étrangères allemand, le baron Adolf Georg Otto von Maltzan, de jeter les
bases d'une coopération entre l'Armée Rouge et la Reichswehr pour lutter contre la Pologne.
Maltzan
écrivit, immédiatement après l'entrevue, un mémorandum qui stipulait en
substance que, vu l'échec des négociations à Copenhague entre
Britanniques et Soviétiques, Lénine voulait éliminer la Pologne, pion
des Occidentaux, afin de faire fléchir Londres. Pour réaliser cet
objectif, il fallait combiner une entente entre Russes et Allemands.
Maltzan explique que l'Allemagne ne marchera jamais avec les Français
pour sauver la Pologne, que la Reichswehr, réduite à 100.000
hommes, suffisait à peine pour maintenir l'ordre intérieur, et que des
relations avec l'URSS s'avèrraient illusoires tant que la propagande
bolchévique vitupérait contre le gouvernement de Berlin et créer des
désordres dans la rue. Kopp promit de mettre en frein à cette propagande
et suggéra les bases d'un accord commercial, mettant dans la balance
l'or russe à échanger contre des locomotives et des machines-outils
allemandes.
[La situation militaire en Europe au lendemain de Versailles. Le Reich est coincé dans l'étau franco-polono-tchèque qui aligne en pied de paix 1.015.000 hommes et en pied de guerre 8.200.000 hommes. Face à cette masse formidable, la Reichswehr ne peut aligner que 100.000 hommes. La diplomatie allemande jouera donc la carte russe, de façon à coincer la Pologne entre l'Armée Rouge et ses frontières. Quand les milices communistes et national-socialistes tiendront la rue en excitant les masses contre les clauses de Versailles, la Reichswehr s'avèrera insuffisante pour maintenir l'ordre intérieur.]
L'objectif soviétique : renforcer l'industrie allemande et faire vaciller l'Empire Britannique
Au
cours des mois qui suivirent, il apparut clairement que l'objectif des
Soviétiques était de renforcer l'industrie allemande, de façon à s'en
servir comme “magasin” pour moderniser la Russie, dont l'objectif
politique n'était pas, pour l'instant, de porter la révolution mondiale
en Europe, mais de jeter son dévolu sur l'Asie, l'Asie Mineure, la Perse
et l'Afghanistan et de susciter des troubles en Égypte et aux Indes,
afin de faire vaciller l'Empire britannique. En juillet 1920, Kopp
revient à la charge et fait savoir que l'URSS souhaite le retour à
l'Allemagne du Corridor de Dantzig, afin de faciliter les communications
commerciales entre le Reich et la Russie, via la Poméranie et
la Prusse Orientale. L'aile gauche du parti socialiste polonais reçut
l'ordre de Moscou de réclamer le retour aux frontières de 1914,
réduisant la Pologne à la province russe qu'elle avait été de 1815 à
1918.
L'objectif
des Allemands, surtout de l'état-major du Général von Seeckt, et des
Soviétiques était de contourner tout éventuel blocus britannique et de
briser la volonté française de balkaniser l'Europe centrale.
L'élimination militaire de la Pologne et l'entente germano-russe
pèseraient d'un tel poids que jamais les armées françaises exsangues
n'oseraient entrer en Allemagne puisqu'un tel geste serait voué à un
cuisant échec. Seeckt, avec son armée insignifiante, devait menacer
habilement les Français tout en ne les provoquant pas trop, de façon à
ce qu'ils ne déclenchent pas une guerre d'encerclement avant que les
Russes ne puissent intervenir.
mardi 26 mars 2013
25 mars 1821 Guerre d'indépendance de la Grèce
Le 25 mars 1821, en Grèce, l'archevêque de Patras donne le signal de la rébellion contre la tutelle ottomane.
En moins de dix ans mais au prix de grandes souffrances et avec le
concours précieux des Occidentaux, les Grecs vont obtenir l'indépendance
d'une petite partie de leurs terres, incluant l'Attique (Athènes), le
Péloponnèse et le sud de l'Épire.
Le nouvel État balkanique, pauvre, de tradition byzantine et aux contours indécis, va dès lors se bâtir une identité nationale en cultivant le souvenir de l'Antiquité et en appelant les riches Grecs de la diaspora à le rejoindre.
Joseph Savès.
La célèbre toile d'Eugène Delacroix,
présentée au Salon de 1824, évoque de cruels massacres qui firent
70.000 victimes en avril 1822. Elle a contribué à faire pencher
l'opinion occidentale en faveur des Grecs et à déclencher en 1827
l'opération anglo-franco-russe de Navarin, de même qu'une autre toile
très célèbre du même artiste : La Grèce sur les ruines de Missolonghi (1826, musée de Bordeaux).
Entre faveur et oppression
Après la chute de l'empire byzantin et la prise de Constantinople
en 1453 par les Turcs, les Grecs ont appris à vivre sous l'autorité du
sultan ottoman. Leur sort est, il est vrai, très différent selon qu'ils
appartiennent à la bourgeoisie citadine ou à la paysannerie.
La bourgeoisie commerçante regroupée autour du patriarche grec de Constantinople, dans le quartier du Phanar
conserve une grande influence à la cour du sultan en raison de sa
richesse et de son rôle d'intermédiaire entre l'administration ottomane
et les sujets chrétiens de l'empire (ils sont majoritaires dans la
capitale elle-même jusqu'à la la Grande Guerre).
Ces bourgeois que l'on appelle Phanariotes obtiennent même
le droit d'administrer pour leur compte les provinces roumaines
semi-autonomes de Valachie et de Moldavie. Mais leur prospérité demeure
fragile et subordonnée au bon vouloir et aux caprices du sultan.
Tout autre est le sort des paysans et des villageois grecs, tant en
Asie mineure qu'en Grèce continentale et dans le Péloponnèse. Ceux-là
sont durement exploités par les fonctionnaires ottomans, par ailleurs
incapables d'assurer la sécurité indispensable au développement
économique et social.
Rébellions brouillonnes
Dès le XVIIIe siècle, les tsars de Russie lorgnent avec convoitise
sur l'empire ottoman, en rapide déclin, et instrumentalisent à leur
profit leurs affinités religieuses avec les Grecs orthodoxes.
C'est ainsi qu'en 1770, Catherine II
pousse à la rébellion les paysans du Péloponnèse mais les lâche presque
aussitôt en concluant avec le sultan le traité de Kütchük-Kaïnardji.
Elle récidive en 1786 avec les Souliotes d'Épire (nord-ouest de la
péninsule), lesquels sont férocement écrasés par le pacha de Janina, Ali pacha.
À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, des Grecs
libéraux, sensibles aux idéaux de la Révolution française, commencent à
rêver d'indépendance. Le déclin de l'empire ottoman et l'occupation des
îles Ioniennes par les Français, à partir de 1797, les y incitent.
Le tsar de Russie Alexandre 1er se montre lui-même réceptif à leurs
revendications. L'un de ses aides de camp grecs, Alexandre Ypsilanti,
prend la tête d'une association secrète de notables grecs des bords de
la mer Noire, l'Hétairie.
En 1821, il tente de soulever les chrétiens de Roumanie. C'est un
échec, ces derniers n'éprouvant guère de sympathie pour les Grecs qui
les ont longtemps exploités.
La même année, un autre appel à la révolte est lancé par Ali pacha.
Celui-ci est entré en rébellion contre le sultan. En s'alliant avec ses
anciennes victimes, il tente de se sortir du siège de la forteresse de
Janina (Épire) par les armées du sultan. Son appel est mieux entendu que
le précédent.
Douloureuse guerre d'indépendance
Finalement, l'insurrection décisive part du Péloponnèse et plus
précisément de Patras, un grand port situé à l'ouest de la péninsule, où
l'apôtre Saint André aurait été martyrisé. Elle est déclenchée par l'archevêque Germanos.
Les Grecs commencent par massacrer des Turcs de leur région. Et les
Turcs ripostent en massacrant des Grecs d'Istamboul ! Il s'ensuit une
très dure guerre. Elle est d'abord favorable aux Grecs qui s'emparent
d'Athènes et des îles de la mer Égée.
Un congrès national réuni à Épidaure, au coeur du Péloponnèse,
proclame l'indépendance unilatérale de la Grèce dès le 12 janvier 1822
et appelle à l'aide les nations chrétiennes. Mais les insurgés ne
tardent pas à s'affaiblir du fait des luttes intestines entre factions
et les Turcs reprennent l'offensive dès le mois suivant.
Ils viennent à bout de la rébellion d'Ali Pacha et, en avril 1822,
massacrent la population de l'île de Chio, ce qui suscite l'indignation
de l'opinion occidentale. Les gouvernements européens n'entendent pas
pour autant intervenir, en vertu du principe de légitimité défendu par
la Sainte Alliance. Mais de nombreux Européens s'engagent comme volontaires aux côtés des insurgés grecs.
Le sultan Mahmoud II, qui n'arrive pas à mettre fin à l'insurrection,
fait appel à son vassal, le vice-roi d'Égypte Méhémet Ali. Celui-ci lui
envoie une armée commandée par son fils Ibrahim pacha, avec une flotte
formée par... des spécialistes français rescapés de l'équipée napoléonienne.
Les troupes égyptiennes occupent la Crète puis reconquièrent le
Péloponnèse et assiègent Athènes. Elles remontent le long du golfe de
Corinthe jusqu'à Missolonghi. Le poète anglais Lord Byron,
qui fait partie des volontaires étrangers, meurt de maladie pendant le
siège de la forteresse. Les défenseurs se font finalement sauter plutôt
que de se rendre le 25 avril 1826. À Athènes, l'Acropole défendue par le
colonel français Fabvier résiste jusqu'au 5 juin 1827.
La guerre a déjà fait 200.000 morts parmi les Grecs.
Les Occidentaux interviennent
En Occident et en France en particulier, des comités de philhellènes
se multiplient dans les milieux libéraux, appelant les gouvernements à
intervenir aux côtés des Grecs contre les Turcs. Les gouvernements
occidentaux s'y décident à contrecoeur. La France, l'Angleterre et la
Russie font une offre de médiation le 6 juillet 1827 mais le sultan la
repousse... On est dans l'impasse.
Faute de mieux, les Occidentaux envoient une flotte conjointe vers le
Péloponnèse. Il ne doit s'agir que d'une démonstration de force mais,
dans le golfe de Navarin, celle-ci va dégénérer en bataille navale. La flotte turco-égyptienne est détruite.
Pour ne rien arranger, les troupes russes s'apprêtent là-dessus à envahir le territoire ottoman...
Enfin l'indépendance
Le sultan Mahmoud II se résigne à signer un traité à Andrinople, le
14 septembre 1829, par lequel il reconnaît à la Grèce une très large
autonomie.
Par le protocole de Londres
du 3 février 1830, il confirme l'indépendance d'une partie de la Grèce
historique. Le nouvel État est limité au Péloponnèse, à la région
d'Athènes et aux îles Cyclades (au total à peine 700.000 habitants, soit
beaucoup moins que l'ensemble des communautés grecques dispersées dans
le reste de l'empire ottoman). Pour les habitants de cette petite Grèce,
c'en est fini de quatre siècles d'occupation ottomane.
lundi 25 mars 2013
Nombre d’or
Le nombre d’or est tiré de la suite mathématique de Fibonacci
(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…) : chaque terme est égal à
la somme des deux nombres qui l’ont immédiatement précédé.
Plus on va loin dans la série, plus le résultat de la division d’un nombre par le précédent tend vers 1,618 (nombre d’or). Inversement, si l’on divise un nombre de la suite par le suivant, on obtiendra un résultat qui tend vers 0,618 (ratio d’or).
Le nombre d’or a été utilisé
dans le domaine de l’art (peinture, architecture, musique…), mais on le
rencontre également dans la nature (de la spirale logarithmique d’une
coquille d’escargot à celle d’une galaxie, en passant par les
proportions du corps ou du visage humain).
Dans le domaine de l’analyse technique,
le nombre d’or, ou le ratio d’or, est utilisé pour évaluer le potentiel
des cycles (extension des vagues de 1,618 ou correction des vagues de
0,618).
Ainsi, par exemple, la vague C mesure
très souvent 1,618 fois l’amplitude de la vague 1. Les ratios de
Fibonacci sont employés en pourcentage : 38,2 %, 50 % ou 61,8 %.
IL Y A 300 ANS La chance ne sourit qu'aux audacieux
Ouverte
en 1701, la guerre de succession d'Espagne épuisa la France et l'Europe
jusqu'en 1714, où elle se conclut par une paix favorable à Louis XIV,
dans la continuité d'une victoire décisive obtenue à Denain, deux ans
plus tôt, par le maréchal de Villars.
Cette année-là, le soixante-neuvième de son règne, Louis XIV, soixante-quatorze ans, engagé dans la guerre dite de Succession d'Espagne, voyait se liguer contre lui l'Europe presque tout entière. L'heure était grave : pour le royaume, pas encore guéri des méfaits matériels et moraux causés par l'hiver terrible de 1709, et pour la famille royale elle-même, éprouvée par des deuils tragiques. Mais le roi de France, qui avait accepté, en 1700, la couronne d'Espagne pour son petit-fils le duc d'Anjou, lequel devint alors Philippe V, entendait maintenir coûte que coûte un Bourbon sur le trône d'outre-Pyrénées, non par orgueil familial ou national, mais tout simplement pour empêcher qu'un jour la France fût à nouveau prise en tenaille et que fût rompu le difficile équilibre européen. L'enjeu était de très grande politique.
L'appel de Louis XIV
L'intention de l'Europe coalisée était bel et bien de ruiner et de démembrer le royaume capétien. Il fallait résister jusqu'au bout, quel que fût le désir de paix, et expliquer à l'opinion publique que c'étaient les ennemis qui nous obligeaient à poursuivre la guerre... On conseilla au roi de réunir les états généraux, mais il ne voulut point recourir à ce remède dangereux. Il préféra écrire une lettre, un appel aux Français qui fut lu dans toutes les églises et placardé sur tous les murs publics du royaume. Les Français répondirent par un nouvel élan, montrant une nouvelle fois la faculté de redressement qui leur est propre.
Cette résistance ne fut pas vaine, car les ennemis eux-mêmes commençaient à s'essouffler. Or la France n'était envahie qu'au nord et, sur nos lignes de défense, nous ne reculions que pied à pied. Depuis notre désastreuse défaite de Malplaquet (11 septembre 1709) qui leur coûta très cher, les Anglais manifestaient un réel désir de reprendre les pourparlers de paix, car cette guerre continentale, en fin de compte, ne leur rapportait pas grand chose... Le 10 décembre 1710, la victoire des troupes franco-espagnoles, sous le commandement du duc de Vendôme, arrière-petit-fils d'Henri IV, à Villaviciosa de Tajuña en Castille, fit réfléchir les Anglais, lesquels, en fin de compte, ne trouvaient pas si mal la séparation des deux couronnes de France et d'Espagne que proposait Louis XIV. Restaient les Hollandais parmi les plus intransigeants, et aussi les troupes du nouvel empereur romain germanique Charles VI, celui-là même qui, en tant qu'archiduc et petit neveu, comme le duc d'Anjou, du vieux roi d'Espagne Charles II (1661-1700), voulait régner sur l'Espagne. Il aurait donc été à la fois empereur et roi d'Espagne, comme jadis Charles Quint ; c'est ce que l'obstination de Louis XIV évitait pour la paix de l'Europe entière. Privés de leur appui principal, l'Angleterre, les troupes hollando-impériales grignotaient peu à peu les dernières places françaises qui contenaient l'invasion depuis des années et osaient appeler leur route ainsi déblayée le "chemin de Paris". Quant aux Anglais, voyant mourir, à la suite du Grand Dauphin, tant de princes du sang français, ils se mirent à craindre que Philipppe V fût un jour appelé, malgré les promesses de Louis XIV, à régner à Paris et à Madrid simultanément..
Alors, le prince Eugène de Savoie-Carignan, au service des Habsbourg, força la frontière du nord en 1712 : il commandait cent trente mille hommes ; face à lui, le maréchal de Villars disposait de soixante dix mille vieux soldats français, la dernière réserve du royaume... Louis XIV déclara qu'en cas de revers, il se rendrait à Péronne et ou à Saint-Quentin : « Mieux vaut périr ensemble et sauver l'État. Je ne consentirai jamais à laisser l'ennemi approcher de ma capitale. » Un vent de panique souffla sur Versailles. On voulut presser le roi de ne pas s'exposer à être capturé : il répondit avec hauteur, et très royalement, qu'il refuserait d'abandonner son poste devant l'ennemi. Or le prince Eugène, trop sûr de lui, commit une imprudence en installant ses magasins un peu trop loin du principal corps d'armée : le camp de Denain, près de Valenciennes. Un habitant du pays s'en aperçut et courut le dire au général de Montesquiou qui le rapporta à son supérieur, le maréchal de Villars. Celui-ci fit simuler une attaque de Denain : les défenseurs du camp furent tous pris. Et quand le prince Eugène arriva, le 24 juillet 1712, il fut repoussé vigoureusement. Privé de vivres et de munitions, il n'eut plus qu'à se replier vers les Pays-Bas.
Villars, le chanceux
Dans l'affaire, Villars eut beaucoup de chance, mais il manoeuvra habilement. Sa gloire est surtout d'avoir obéi aux ordres formels de Louis XIV en livrant cette bataille désespérée. Le vieux Capétien, en faisant taire tous les défaitistes, avait tiré son royaume du désastre. Désormais le traité d'Utrecht pouvait être signé : la France n'était pas en position de faiblesse. Elle conservait les frontières qu'elle avait acquises, mais elle fut écartée de la Flandre belge qui passa à la maison d'Autriche, laquelle reçut mission, avec la Hollande de Guillaume d'Orange, de veilller à ce que les Français ne cherchassent pas à imposer leur présence ici. L'Angleterre, maîtresse des mers, le devint aussi des colonies : les espagnoles, d'Amérique latine, mais aussi les autres qui nous échappèrent, Terre-Neuve, Acadie ; même notre Canada fut menacé. Quant à la renonciation de Philippe V et de ses descendants à leurs droits de princes français, elle allait de soi et cela deviendrait évident au fur et à mesure que s'hispaniserait cette branche des Bourbons...
Un tournant en Europe
Mais les Hohenzollern, les plus actifs et les plus ambitieux des princes allemands, devinrent rois de Prusse et allaient par la suite chercher à reconstituer à leur profit l'unité allemande. Comme dit Jacques Bainville, « Louis XIV avait compris que la rivalité des Bourbons et des Habsbourg était finie, qu'elle devenait un anachronisme, que des bouleversements continentaux ne pourraient plus se produire qu'au détriment de la France et au profit de l'Angleterre pour qui chaque conflit européen serait l'occasion de fortifier son empire colonial ».
Quand le vieux roi allait mourir en 1715, la France était très fatiguée ayant dû payer d'un haut prix l'acquisition de ses frontières et de sa sécurité. Les générations à venir sauraient-elles rendre hommage comme il le fallait à ces hommes de tradition qui gardèrent le sol natal au prix des pires sacrifices ? Cette année 1712 est aussi celle qui vit naître, le 28 juin, un mois avant le sauvetage inespéré de Denain, Jean-Jacques Rousseau, l'homme le plus asocial qui fût jamais et qui allait se mettre dans l'idée de dresser les plans d'une société révolutionnaire à laquelle il ne croyait même pas lui-même, mais à laquelle allaient croire les hommes de 1789... En quelques mois c'en serait (presque) fini de l'oeuvre de nos rois, pour le plus grand malheur de la France...
Michel Fromentoux L’ACTION FRANÇAISE 2000 Du 1er au 14 mars 2012
Cette année-là, le soixante-neuvième de son règne, Louis XIV, soixante-quatorze ans, engagé dans la guerre dite de Succession d'Espagne, voyait se liguer contre lui l'Europe presque tout entière. L'heure était grave : pour le royaume, pas encore guéri des méfaits matériels et moraux causés par l'hiver terrible de 1709, et pour la famille royale elle-même, éprouvée par des deuils tragiques. Mais le roi de France, qui avait accepté, en 1700, la couronne d'Espagne pour son petit-fils le duc d'Anjou, lequel devint alors Philippe V, entendait maintenir coûte que coûte un Bourbon sur le trône d'outre-Pyrénées, non par orgueil familial ou national, mais tout simplement pour empêcher qu'un jour la France fût à nouveau prise en tenaille et que fût rompu le difficile équilibre européen. L'enjeu était de très grande politique.
L'appel de Louis XIV
L'intention de l'Europe coalisée était bel et bien de ruiner et de démembrer le royaume capétien. Il fallait résister jusqu'au bout, quel que fût le désir de paix, et expliquer à l'opinion publique que c'étaient les ennemis qui nous obligeaient à poursuivre la guerre... On conseilla au roi de réunir les états généraux, mais il ne voulut point recourir à ce remède dangereux. Il préféra écrire une lettre, un appel aux Français qui fut lu dans toutes les églises et placardé sur tous les murs publics du royaume. Les Français répondirent par un nouvel élan, montrant une nouvelle fois la faculté de redressement qui leur est propre.
Cette résistance ne fut pas vaine, car les ennemis eux-mêmes commençaient à s'essouffler. Or la France n'était envahie qu'au nord et, sur nos lignes de défense, nous ne reculions que pied à pied. Depuis notre désastreuse défaite de Malplaquet (11 septembre 1709) qui leur coûta très cher, les Anglais manifestaient un réel désir de reprendre les pourparlers de paix, car cette guerre continentale, en fin de compte, ne leur rapportait pas grand chose... Le 10 décembre 1710, la victoire des troupes franco-espagnoles, sous le commandement du duc de Vendôme, arrière-petit-fils d'Henri IV, à Villaviciosa de Tajuña en Castille, fit réfléchir les Anglais, lesquels, en fin de compte, ne trouvaient pas si mal la séparation des deux couronnes de France et d'Espagne que proposait Louis XIV. Restaient les Hollandais parmi les plus intransigeants, et aussi les troupes du nouvel empereur romain germanique Charles VI, celui-là même qui, en tant qu'archiduc et petit neveu, comme le duc d'Anjou, du vieux roi d'Espagne Charles II (1661-1700), voulait régner sur l'Espagne. Il aurait donc été à la fois empereur et roi d'Espagne, comme jadis Charles Quint ; c'est ce que l'obstination de Louis XIV évitait pour la paix de l'Europe entière. Privés de leur appui principal, l'Angleterre, les troupes hollando-impériales grignotaient peu à peu les dernières places françaises qui contenaient l'invasion depuis des années et osaient appeler leur route ainsi déblayée le "chemin de Paris". Quant aux Anglais, voyant mourir, à la suite du Grand Dauphin, tant de princes du sang français, ils se mirent à craindre que Philipppe V fût un jour appelé, malgré les promesses de Louis XIV, à régner à Paris et à Madrid simultanément..
Alors, le prince Eugène de Savoie-Carignan, au service des Habsbourg, força la frontière du nord en 1712 : il commandait cent trente mille hommes ; face à lui, le maréchal de Villars disposait de soixante dix mille vieux soldats français, la dernière réserve du royaume... Louis XIV déclara qu'en cas de revers, il se rendrait à Péronne et ou à Saint-Quentin : « Mieux vaut périr ensemble et sauver l'État. Je ne consentirai jamais à laisser l'ennemi approcher de ma capitale. » Un vent de panique souffla sur Versailles. On voulut presser le roi de ne pas s'exposer à être capturé : il répondit avec hauteur, et très royalement, qu'il refuserait d'abandonner son poste devant l'ennemi. Or le prince Eugène, trop sûr de lui, commit une imprudence en installant ses magasins un peu trop loin du principal corps d'armée : le camp de Denain, près de Valenciennes. Un habitant du pays s'en aperçut et courut le dire au général de Montesquiou qui le rapporta à son supérieur, le maréchal de Villars. Celui-ci fit simuler une attaque de Denain : les défenseurs du camp furent tous pris. Et quand le prince Eugène arriva, le 24 juillet 1712, il fut repoussé vigoureusement. Privé de vivres et de munitions, il n'eut plus qu'à se replier vers les Pays-Bas.
Villars, le chanceux
Dans l'affaire, Villars eut beaucoup de chance, mais il manoeuvra habilement. Sa gloire est surtout d'avoir obéi aux ordres formels de Louis XIV en livrant cette bataille désespérée. Le vieux Capétien, en faisant taire tous les défaitistes, avait tiré son royaume du désastre. Désormais le traité d'Utrecht pouvait être signé : la France n'était pas en position de faiblesse. Elle conservait les frontières qu'elle avait acquises, mais elle fut écartée de la Flandre belge qui passa à la maison d'Autriche, laquelle reçut mission, avec la Hollande de Guillaume d'Orange, de veilller à ce que les Français ne cherchassent pas à imposer leur présence ici. L'Angleterre, maîtresse des mers, le devint aussi des colonies : les espagnoles, d'Amérique latine, mais aussi les autres qui nous échappèrent, Terre-Neuve, Acadie ; même notre Canada fut menacé. Quant à la renonciation de Philippe V et de ses descendants à leurs droits de princes français, elle allait de soi et cela deviendrait évident au fur et à mesure que s'hispaniserait cette branche des Bourbons...
Un tournant en Europe
Mais les Hohenzollern, les plus actifs et les plus ambitieux des princes allemands, devinrent rois de Prusse et allaient par la suite chercher à reconstituer à leur profit l'unité allemande. Comme dit Jacques Bainville, « Louis XIV avait compris que la rivalité des Bourbons et des Habsbourg était finie, qu'elle devenait un anachronisme, que des bouleversements continentaux ne pourraient plus se produire qu'au détriment de la France et au profit de l'Angleterre pour qui chaque conflit européen serait l'occasion de fortifier son empire colonial ».
Quand le vieux roi allait mourir en 1715, la France était très fatiguée ayant dû payer d'un haut prix l'acquisition de ses frontières et de sa sécurité. Les générations à venir sauraient-elles rendre hommage comme il le fallait à ces hommes de tradition qui gardèrent le sol natal au prix des pires sacrifices ? Cette année 1712 est aussi celle qui vit naître, le 28 juin, un mois avant le sauvetage inespéré de Denain, Jean-Jacques Rousseau, l'homme le plus asocial qui fût jamais et qui allait se mettre dans l'idée de dresser les plans d'une société révolutionnaire à laquelle il ne croyait même pas lui-même, mais à laquelle allaient croire les hommes de 1789... En quelques mois c'en serait (presque) fini de l'oeuvre de nos rois, pour le plus grand malheur de la France...
Michel Fromentoux L’ACTION FRANÇAISE 2000 Du 1er au 14 mars 2012
dimanche 24 mars 2013
Livre : Mourir pour Sarajevo, de Maya KANDEL

Un conflit qui oppose une armée à
des civils, l’ONU paralysée par ses divisions, le monde entier saisi
d’effroi face au drame des réfugiés et à la mise en œuvre du « nettoyage
ethnique »… C’était la dernière guerre européenne du XXe siècle,
conséquence sanglante de la chute du mur de Berlin et jalon essentiel
pour comprendre les débuts de l’après-Guerre froide.
Vingt ans après, Maya Kandel de voile
les dessous de la guerre de Bosnie et de l’intervention américaine.
L’histoire d’une paralysie européenne qui marque aussi l’apogée de l’«
effet CNN », avec la diffusion des images de camps de prisonniers et le
parallèle avec l’Holocauste pour mobiliser les opinions publiques. Une
guerre d’un genre nouveau, soulignant le poids des lobbies américains,
l’implication des cabinets de relations publiques au service de chacune
des parties, de Milosevic a Tudjman, le rôle des organisations juives
américaines aux cotés des musulmans de Bosnie…
Après trois années de tergiversations et
de massacres, les Américains vont recourir aux vieilles méthodes pour
renverser la situation : faire la guerre aux Serbes par Croates
interposés. Sur la base d’archives inédites, Maya Kandel révèle qu’en
1994, pour contourner l’embargo onusien, Clinton donne son feu vert aux
livraisons secrètes d’armes iraniennes et turques aux Croates puis aux
Bosniaques.
Un décryptage historique à rebours des interprétations dominantes sur la désintégration de la Yougoslavie.
Prologue écrit par le colonel Michel GOYA (IRSEM).
Editions du CNRS, 384 pages, 25 €
L’auteur
Docteur
en histoire de l’Institut d’Études politiques de Paris, Maya Kandel est
également diplômée de Columbia University, chargée d’études à
l’Institut de Recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) et
chercheuse associée au sein de l’Observatoire de la Politique américaine
de l’université Sorbonne Nouvelle (Paris 3)
La guerre civile française : Les valeurs de la modernité
Tribune libre de Paysan Savoyard
Trouvant sa source dans les mouvements d’idées qui ont agité les deux siècles précédents (protestantisme, jansénisme, Lumières : nous y reviendrons), la guerre civile française s’ouvre avec la Révolution. Le projet révolutionnaire est un projet global, à la fois politique, sociétal et philosophique : il s’agit de promouvoir une conception nouvelle de la vie en société.
La société traditionnelle, celle d’avant 1789, était assise sur un système de valeurs composé de cinq éléments fondamentaux étroitement liés les uns aux autres et cohérents entre eux. La Révolution française veut remplacer la société traditionnelle par une autre, fondée sur des valeurs exactement inverses, celles de la « modernité ».
(NB : Nous poursuivons avec cet article la série entamée 24/02/13 consacrée à la guerre civile française).
Contre la société traditionnelle, assise sur les devoirs envers le groupe, la modernité promeut l’individu, sa liberté et ses droits
Dans la société traditionnelle l’individu a certes une existence et une dignité propres : son autonomie est cependant limitée. Il est en effet inscrit dans une série de cadres : la famille, le village et la paroisse, la corporation, l’ordre. Ce système d’appartenances correspond pour l’individu à différentes fonctions, qu’il doit remplir. La société traditionnelle est une société dans laquelle le groupe prime sur l’individu, tandis que les devoirs envers le groupe l’emportent sur les droits.
Notons qu’il en est de même dans toutes les sociétés traditionnelles, au-delà du champ du monde occidental.
Au contraire la modernité cherche à installer une société fondée non plus sur le groupe mais sur l’individu. Les individus sont libres de toute appartenance : ils ne sont pas rattachés à un groupe et n’ont pas de devoir à ce titre. C’est pourquoi la société moderne est une société de droits : les droits de l’individu libre – « les droits de l’homme » – l’emportent sur les devoirs envers le groupe (les devoirs ne sont pas absents de la société moderne, mais ils sont réputés être librement consentis dans le cadre d’un « contrat social » ; nous y reviendrons).
Les droits de l’individu existaient également dans la société traditionnelle. La religion catholique, tout d’abord, socle de la société européenne, est une religion personnelle, qui fait prévaloir le lien individuel entre chaque homme et son Dieu : dès lors dans une société catholique l’individu dispose nécessairement d’une existence et d’une dignité propres. D’autre part, contrairement à ce que prétendent, par mauvaise foi ou ignorance, les contempteurs de la société traditionnelle, les individus avaient des droits sous l’Ancien régime. Il existait des lois, des codes, des tribunaux. Le roi lui-même était soumis à un certain nombre de règles coutumières et de devoirs essentiels envers son peuple et envers l’Etat, même si sa responsabilité propre était jugée devant Dieu seul.
Droits et devoirs existent donc également, dans la société traditionnelle comme dans la société moderne. Mais le point d’équilibre entre les deux registres diffère : la société traditionnelle met en exergue le groupe et les devoirs de l’individu envers lui ; la modernité promeut l’individu, sa liberté et ses droits.
Voulant rompre avec la société hiérarchique, la modernité promeut l’égalité La société traditionnelle est une société hiérarchique et inégalitaire. Au sein de la famille s’impose l’autorité du père. Celle du curé s’exerce à l’échelon du village et de la paroisse. Les corporations sont dirigées par des maîtres. Plus globalement la société est organisée en ordres, hiérarchisés entre eux. Ils correspondent aux principales fonctions essentielles à l’organisation de la société. Le premier ordre, aristocratique, répond à la fonction guerrière, judiciaire et politique ; le second, ecclésiastique, assume la dimension du sacré (il prendra également en charge la fonction sociale) ; le troisième ordre est celui qui assure la fonction de production. Cette structure ternaire correspond selon l’anthropologue G. Dumézil à la tripartition fonctionnelle qui caractérise les sociétés indo-européennes.
La hiérarchie entre ces ordres découle de l’articulation naturelle de leurs fonctions : disposant de la force et de l’emprise sur la sphère du sacré, noblesse et clergé s’imposent naturellement. La structure pyramidale de la société correspond également au fait que les effectifs des ordres dominants sont très inférieurs à ceux du tiers ordre. Enfin, les différents groupes et ordres assumant des fonctions différentes, ils correspondent en toute logique à des conditions de vie dissemblables. On voit que pour une telle société, le concept d’égalité est dépourvu de pertinence : on peut dire même qu’il se situe hors de l’univers mental des membres de la société traditionnelle.
Maurras illustrait ce constat en expliquant qu’au sein de la cellule de base de la société traditionnelle qu’est la famille, l’inégalité des membres est naturelle et absolue. Comment en effet parler d’égalité lorsque les jeunes enfants dépendent en tout point, pour leur survie et leur éducation, de leurs parents ? Devenus des vieillards, les parents ne connaissent-ils pas à leur tour une situation de complète dépendance ? Dans ces différentes situations de vie, les concepts d’égalité ou d’inégalité sont sans signification.
La société souhaitée par les révolutionnaires promeut à l’inverse l’égalité, valeur centrale de la modernité. L’égalité est au demeurant une conséquence nécessaire de la conception moderne d’une société fondée sur la liberté de l’individu : l’individu étant autonome par rapport aux groupes et aux personnes et n’ayant pas de devoirs envers eux, il se trouve nécessairement en situation d’égalité vis-à-vis des autres membres de la société (il s’agit ici de l’égalité de droits ; nous reviendrons plus tard en détail sur les différentes acceptions que prend le terme d’égalité).
On voit par là que les principes d’organisation des deux types de société sont radicalement différents. Dans la société traditionnelle les individus ne sont pas totalement libres parce qu’ils ont des devoirs éminents envers les groupes auxquels ils sont rattachés. Ils ne sont pas non plus égaux, les groupes auxquels ils appartiennent étant situés dans un système hiérarchisé. Au contraire les individus modernes étant libres de toute appartenance à un groupe, ils sont nécessairement égaux en droit.
De ce principe d’égalité des droits découle le type de régime politique en vigueur dans la société moderne : la démocratie. Dans une société d’individus égaux en droits, la décision appartient nécessairement à la majorité (au contraire dans une société traditionnelle, le pouvoir est détenu, au sommet de l’organisation pyramidale, par un monarque ou une élite aristocratique).
Rejetant la tradition, la modernité est toute entière tournée vers l’avenir et le progrès Dans la société traditionnelle chaque individu et chaque groupe doivent recevoir la tradition, s’y conformer puis la transmettre. Le respect des ancêtres constitue une valeur centrale : l’individu se ressent comme le maillon d’une chaîne.
La modernité au contraire considère avant tout l’avenir. Si la modernité privilégie l’avenir, c’est en premier lieu parce que le passé et la tradition correspondent précisément à la société qu’elle rejette et veut remplacer. Le passé doit être « dépassé ».
Le primat accordé à l’avenir découle d’autre part de la conception moderne de l’individu libre. Il revient à l’individu, débarrassé de toute tradition, d’inventer l’avenir, en usant de sa liberté et de sa volonté « éclairée ».
La tension moderne vers l’avenir a un dernier fondement : l’avenir permettra à la société de progresser vers la Lumière de la Raison. La conception moderne perçoit en effet l’Histoire comme un processus de progrès. Progrès technique. Progrès économique. Progrès de la Raison avant tout : l’Histoire, et c’est là son sens (Hegel), voit se réaliser progressivement le règne de la Raison.
Tandis que la société traditionnelle était ancrée territorialement, la modernité est universaliste La société traditionnelle est ancrée dans un territoire, aux frontières délimitées. De même que les groupes desquels relèvent les membres des sociétés traditionnelles s’emboîtent les uns aux autres (famille, paroisse…), de même le territoire sur lequel ils vivent est constitué d’une série de cercles concentriques : le territoire du village, puis celui de la province, celui du royaume enfin. Le royaume étant en quelque sorte une projection du Royaume divin et le monarque le représentant de Dieu sur terre, les frontières revêtent une importance déterminante voire un caractère sacré.
En outre la volonté de recevoir et transmettre la tradition conduit naturellement à un attachement territorial. Le territoire en effet matérialise, rend visible et préhensible l’héritage à transmettre. Enfin la révérence envers les ancêtres renforce l’attachement à la terre, qui a accueilli leur dépouille.
La modernité est au contraire universaliste. L’individu étant libre il n’est redevable envers aucun groupe ni aucun pays : la notion de frontière ne peut dès lors s’imposer à lui, pas davantage qu’aux autres individus. La croyance en l’égalité vient renforcer l’universalisme : il est par exemple inconcevable qu’un pays plus riche que ses voisins puisse refuser son entrée aux personnes venues de pays moins dotés. Surtout la modernité est convaincue de la valeur universelle de son message : il ne peut dès lors être question pour elle de raisonner à l’échelle des frontières d’un Etat.
La société traditionnelle était chrétienne : la modernité est antireligieuse et athée La société traditionnelle européenne est chrétienne (de façon générale sur tous les continents les sociétés traditionnelles sont cimentées par la religion). La religion chrétienne constitue le socle sur lequel repose tout l’édifice. La tradition qu’il s’agit de transmettre est d’abord celle de la religion chrétienne. Les devoirs envers le groupe sont fondés avant tout sur la croyance religieuse : chacun doit assumer sa fonction dans la société afin d’accomplir son parcours terrestre conformément à la volonté divine. Clergé et pouvoir civil sont étroitement liés et dominent la société dont ils constituent la hiérarchie. La France, considérée même comme « fille aînée de l’Eglise », se vit comme un royaume chrétien. Plus généralement, les membres des sociétés européennes d’ancien régime, par delà les frontières des royaumes et principautés, ont conscience d’une appartenance commune à la chrétienté.
La modernité, elle, se caractérise avant tout par le rejet de la religion, pour plusieurs raisons également puissantes. La religion chrétienne est considérée tout d’abord comme étroitement liée à la société traditionnelle qu’il s’agit de combattre. La religion, en second lieu, se heurte par nature à l’idée moderne de liberté puisqu’elle l’entrave par des préceptes moraux. Elle heurte enfin l’aspiration à l’égalité, l’église, elle-même hiérarchisée, ayant constitué l’un des principaux cadres de la société hiérarchique traditionnelle. La modernité est dès lors athée et antireligieuse.
Dans cette perspective elle met en avant le concept de laïcité, considérée aujourd’hui comme l’une des valeurs républicaines essentielles. Officiellement la laïcité signifie que l’Etat reste neutre face aux religions. En réalité les promoteurs et militants de la laïcité sont également des athées, de sorte que, dans le lexique de la modernité, la revendication de la laïcité équivaut presque toujours à une proclamation d’athéisme.
On voit tout d’abord que les deux sociétés concurrentes sont l’une et l’autre pleinement cohérentes. Leurs différents éléments constitutifs se tiennent étroitement et se supposent les uns les autres. De l’idée même de tradition découle l’attachement à une société d’encadrement et de hiérarchie, ancrée territorialement. Posant le principe de la liberté de l’individu, la modernité en déduit nécessairement le principe d’égalité des droits, l’universalisme, le rejet de la tradition et de la religion. Parfaitement cohérentes l’une et l’autre, société traditionnelle et société moderne sont dès lors profondément antagoniques.
Précisons que cette opposition entre deux types de société se fonde sur les modèles idéals, les archétypes. Il est bien clair que les différents aspects que nous venons de recenser ne se traduisent pas exactement dans le concret du fonctionnement de la société en toute circonstance. Nous avons présenté l’opposition de deux constructions intellectuelles : la vie concrète apporte, et c’est heureux, nuances et exceptions. De même il est évident que les individus n’ont pas nécessairement tous conscience de la cohérence et des principes d’organisation de la société à laquelle ils appartiennent. Le modèle d’ensemble auquel chacun des deux types de société répond ne s’en impose pas moins dans les grandes lignes : validé par l’élite, il constitue un cadre à l’intérieur duquel chacun doit s’inscrire, de façon volontaire ou non.
Apportons cette autre indication. La société nouvelle et celle qu’elle remplace sont antagonistes : mais elles ne sont pas pour autant totalement étrangères l’une à l’autre. Le basculement provoqué par la révolution trouve en effet une partie de ses racines dans la situation et l’évolution de la société d’ancien régime elle-même : ce n’est pas une société en pleine santé qui a été renversée en 1789. L’ancienne société, tout d’abord, était depuis déjà longtemps contestée, dans son fonctionnement et plusieurs de ses principes essentiels, par certains secteurs de la société. Nous avons déjà mentionné la contestation protestante, le jansénisme, les Lumières : nous y reviendrons dans un article suivant. La société d’Ancien régime était également fragilisée dans ses fondements du fait de l’évolution de la position occupée par sa classe dominante : l’aristocratie. Nous reprendrons ce point également.
On peut discerner un lien supplémentaire entre les deux sociétés qui, au tournant du 18e siècle, vont se substituer l’une à l’autre. L’on peut en effet considérer que la modernité est assez directement issue de l’Evangile, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes puisqu’elle est fondamentalement anti religieuse. De nombreux éléments du message évangélique inspirent manifestement certains principes essentiels de la modernité. Par exemple les passages insistant sur le fait que les moins lotis seront premiers dans le royaume des cieux, sur l’exaltation des pauvres, sur la condamnation de la richesse, sont probablement la source majeure de l’idée moderne d’égalité. Pour notre part nous considérons, comme nous le notions dans un article précédent, que les modernes font de l’Evangile, dont ils s’inspirent nolens volens tout en le rejetant, une lecture erronée. Ils le comprennent comme un programme politique et un modèle de société, alors qu’il constitue un message personnel adressé à chacun pour la conduite de sa vie. Ce passage essentiel donne nous semble-t-il la clé d’interprétation : « Rendez à César… » : l’Evangile n’est pas un programme politique.
Terminons sur cette précision. Nous nous sentons plus proches à plusieurs égards du traditionalisme : nous partageons l’attachement à la famille, à la tradition, à l’ancrage territorial, à l’homogénéité de la population de souche, à la religion chrétienne comme étant l’un des principaux fondements de nos sociétés occidentales. De même nous rejetons sans équivoque plusieurs aspects de la modernité. Cependant nous ne souhaiterions aucunement réinstaller trait pour trait, en admettant que la chose fût possible, une société traditionnelle. Tous les apports de la modernité ne sont évidemment pas à rejeter. Si la révolution de la fin du 18e siècle n’avait pas eu lieu, il aurait sans aucun doute été souhaitable que l’ancienne société évolue d’elle-même, de façon en particulier à laisser une place plus grande à l’individu et à son libre arbitre.
Dans le prochain article, nous verrons comment la Révolution a traduit dans les actes cette volonté de remplacer la société traditionnelle par une autre.
http://www.fdesouche.com
Trouvant sa source dans les mouvements d’idées qui ont agité les deux siècles précédents (protestantisme, jansénisme, Lumières : nous y reviendrons), la guerre civile française s’ouvre avec la Révolution. Le projet révolutionnaire est un projet global, à la fois politique, sociétal et philosophique : il s’agit de promouvoir une conception nouvelle de la vie en société.
La société traditionnelle, celle d’avant 1789, était assise sur un système de valeurs composé de cinq éléments fondamentaux étroitement liés les uns aux autres et cohérents entre eux. La Révolution française veut remplacer la société traditionnelle par une autre, fondée sur des valeurs exactement inverses, celles de la « modernité ».
(NB : Nous poursuivons avec cet article la série entamée 24/02/13 consacrée à la guerre civile française).
Contre la société traditionnelle, assise sur les devoirs envers le groupe, la modernité promeut l’individu, sa liberté et ses droits
Dans la société traditionnelle l’individu a certes une existence et une dignité propres : son autonomie est cependant limitée. Il est en effet inscrit dans une série de cadres : la famille, le village et la paroisse, la corporation, l’ordre. Ce système d’appartenances correspond pour l’individu à différentes fonctions, qu’il doit remplir. La société traditionnelle est une société dans laquelle le groupe prime sur l’individu, tandis que les devoirs envers le groupe l’emportent sur les droits.
Notons qu’il en est de même dans toutes les sociétés traditionnelles, au-delà du champ du monde occidental.
Au contraire la modernité cherche à installer une société fondée non plus sur le groupe mais sur l’individu. Les individus sont libres de toute appartenance : ils ne sont pas rattachés à un groupe et n’ont pas de devoir à ce titre. C’est pourquoi la société moderne est une société de droits : les droits de l’individu libre – « les droits de l’homme » – l’emportent sur les devoirs envers le groupe (les devoirs ne sont pas absents de la société moderne, mais ils sont réputés être librement consentis dans le cadre d’un « contrat social » ; nous y reviendrons).
Les droits de l’individu existaient également dans la société traditionnelle. La religion catholique, tout d’abord, socle de la société européenne, est une religion personnelle, qui fait prévaloir le lien individuel entre chaque homme et son Dieu : dès lors dans une société catholique l’individu dispose nécessairement d’une existence et d’une dignité propres. D’autre part, contrairement à ce que prétendent, par mauvaise foi ou ignorance, les contempteurs de la société traditionnelle, les individus avaient des droits sous l’Ancien régime. Il existait des lois, des codes, des tribunaux. Le roi lui-même était soumis à un certain nombre de règles coutumières et de devoirs essentiels envers son peuple et envers l’Etat, même si sa responsabilité propre était jugée devant Dieu seul.
Droits et devoirs existent donc également, dans la société traditionnelle comme dans la société moderne. Mais le point d’équilibre entre les deux registres diffère : la société traditionnelle met en exergue le groupe et les devoirs de l’individu envers lui ; la modernité promeut l’individu, sa liberté et ses droits.
Voulant rompre avec la société hiérarchique, la modernité promeut l’égalité La société traditionnelle est une société hiérarchique et inégalitaire. Au sein de la famille s’impose l’autorité du père. Celle du curé s’exerce à l’échelon du village et de la paroisse. Les corporations sont dirigées par des maîtres. Plus globalement la société est organisée en ordres, hiérarchisés entre eux. Ils correspondent aux principales fonctions essentielles à l’organisation de la société. Le premier ordre, aristocratique, répond à la fonction guerrière, judiciaire et politique ; le second, ecclésiastique, assume la dimension du sacré (il prendra également en charge la fonction sociale) ; le troisième ordre est celui qui assure la fonction de production. Cette structure ternaire correspond selon l’anthropologue G. Dumézil à la tripartition fonctionnelle qui caractérise les sociétés indo-européennes.
La hiérarchie entre ces ordres découle de l’articulation naturelle de leurs fonctions : disposant de la force et de l’emprise sur la sphère du sacré, noblesse et clergé s’imposent naturellement. La structure pyramidale de la société correspond également au fait que les effectifs des ordres dominants sont très inférieurs à ceux du tiers ordre. Enfin, les différents groupes et ordres assumant des fonctions différentes, ils correspondent en toute logique à des conditions de vie dissemblables. On voit que pour une telle société, le concept d’égalité est dépourvu de pertinence : on peut dire même qu’il se situe hors de l’univers mental des membres de la société traditionnelle.
Maurras illustrait ce constat en expliquant qu’au sein de la cellule de base de la société traditionnelle qu’est la famille, l’inégalité des membres est naturelle et absolue. Comment en effet parler d’égalité lorsque les jeunes enfants dépendent en tout point, pour leur survie et leur éducation, de leurs parents ? Devenus des vieillards, les parents ne connaissent-ils pas à leur tour une situation de complète dépendance ? Dans ces différentes situations de vie, les concepts d’égalité ou d’inégalité sont sans signification.
La société souhaitée par les révolutionnaires promeut à l’inverse l’égalité, valeur centrale de la modernité. L’égalité est au demeurant une conséquence nécessaire de la conception moderne d’une société fondée sur la liberté de l’individu : l’individu étant autonome par rapport aux groupes et aux personnes et n’ayant pas de devoirs envers eux, il se trouve nécessairement en situation d’égalité vis-à-vis des autres membres de la société (il s’agit ici de l’égalité de droits ; nous reviendrons plus tard en détail sur les différentes acceptions que prend le terme d’égalité).
On voit par là que les principes d’organisation des deux types de société sont radicalement différents. Dans la société traditionnelle les individus ne sont pas totalement libres parce qu’ils ont des devoirs éminents envers les groupes auxquels ils sont rattachés. Ils ne sont pas non plus égaux, les groupes auxquels ils appartiennent étant situés dans un système hiérarchisé. Au contraire les individus modernes étant libres de toute appartenance à un groupe, ils sont nécessairement égaux en droit.
De ce principe d’égalité des droits découle le type de régime politique en vigueur dans la société moderne : la démocratie. Dans une société d’individus égaux en droits, la décision appartient nécessairement à la majorité (au contraire dans une société traditionnelle, le pouvoir est détenu, au sommet de l’organisation pyramidale, par un monarque ou une élite aristocratique).
Rejetant la tradition, la modernité est toute entière tournée vers l’avenir et le progrès Dans la société traditionnelle chaque individu et chaque groupe doivent recevoir la tradition, s’y conformer puis la transmettre. Le respect des ancêtres constitue une valeur centrale : l’individu se ressent comme le maillon d’une chaîne.
La modernité au contraire considère avant tout l’avenir. Si la modernité privilégie l’avenir, c’est en premier lieu parce que le passé et la tradition correspondent précisément à la société qu’elle rejette et veut remplacer. Le passé doit être « dépassé ».
Le primat accordé à l’avenir découle d’autre part de la conception moderne de l’individu libre. Il revient à l’individu, débarrassé de toute tradition, d’inventer l’avenir, en usant de sa liberté et de sa volonté « éclairée ».
La tension moderne vers l’avenir a un dernier fondement : l’avenir permettra à la société de progresser vers la Lumière de la Raison. La conception moderne perçoit en effet l’Histoire comme un processus de progrès. Progrès technique. Progrès économique. Progrès de la Raison avant tout : l’Histoire, et c’est là son sens (Hegel), voit se réaliser progressivement le règne de la Raison.
Tandis que la société traditionnelle était ancrée territorialement, la modernité est universaliste La société traditionnelle est ancrée dans un territoire, aux frontières délimitées. De même que les groupes desquels relèvent les membres des sociétés traditionnelles s’emboîtent les uns aux autres (famille, paroisse…), de même le territoire sur lequel ils vivent est constitué d’une série de cercles concentriques : le territoire du village, puis celui de la province, celui du royaume enfin. Le royaume étant en quelque sorte une projection du Royaume divin et le monarque le représentant de Dieu sur terre, les frontières revêtent une importance déterminante voire un caractère sacré.
En outre la volonté de recevoir et transmettre la tradition conduit naturellement à un attachement territorial. Le territoire en effet matérialise, rend visible et préhensible l’héritage à transmettre. Enfin la révérence envers les ancêtres renforce l’attachement à la terre, qui a accueilli leur dépouille.
La modernité est au contraire universaliste. L’individu étant libre il n’est redevable envers aucun groupe ni aucun pays : la notion de frontière ne peut dès lors s’imposer à lui, pas davantage qu’aux autres individus. La croyance en l’égalité vient renforcer l’universalisme : il est par exemple inconcevable qu’un pays plus riche que ses voisins puisse refuser son entrée aux personnes venues de pays moins dotés. Surtout la modernité est convaincue de la valeur universelle de son message : il ne peut dès lors être question pour elle de raisonner à l’échelle des frontières d’un Etat.
La société traditionnelle était chrétienne : la modernité est antireligieuse et athée La société traditionnelle européenne est chrétienne (de façon générale sur tous les continents les sociétés traditionnelles sont cimentées par la religion). La religion chrétienne constitue le socle sur lequel repose tout l’édifice. La tradition qu’il s’agit de transmettre est d’abord celle de la religion chrétienne. Les devoirs envers le groupe sont fondés avant tout sur la croyance religieuse : chacun doit assumer sa fonction dans la société afin d’accomplir son parcours terrestre conformément à la volonté divine. Clergé et pouvoir civil sont étroitement liés et dominent la société dont ils constituent la hiérarchie. La France, considérée même comme « fille aînée de l’Eglise », se vit comme un royaume chrétien. Plus généralement, les membres des sociétés européennes d’ancien régime, par delà les frontières des royaumes et principautés, ont conscience d’une appartenance commune à la chrétienté.
La modernité, elle, se caractérise avant tout par le rejet de la religion, pour plusieurs raisons également puissantes. La religion chrétienne est considérée tout d’abord comme étroitement liée à la société traditionnelle qu’il s’agit de combattre. La religion, en second lieu, se heurte par nature à l’idée moderne de liberté puisqu’elle l’entrave par des préceptes moraux. Elle heurte enfin l’aspiration à l’égalité, l’église, elle-même hiérarchisée, ayant constitué l’un des principaux cadres de la société hiérarchique traditionnelle. La modernité est dès lors athée et antireligieuse.
Dans cette perspective elle met en avant le concept de laïcité, considérée aujourd’hui comme l’une des valeurs républicaines essentielles. Officiellement la laïcité signifie que l’Etat reste neutre face aux religions. En réalité les promoteurs et militants de la laïcité sont également des athées, de sorte que, dans le lexique de la modernité, la revendication de la laïcité équivaut presque toujours à une proclamation d’athéisme.
**
Au terme de ce recensement, il convient d’apporter pour conclure quelques précisions et nuances.On voit tout d’abord que les deux sociétés concurrentes sont l’une et l’autre pleinement cohérentes. Leurs différents éléments constitutifs se tiennent étroitement et se supposent les uns les autres. De l’idée même de tradition découle l’attachement à une société d’encadrement et de hiérarchie, ancrée territorialement. Posant le principe de la liberté de l’individu, la modernité en déduit nécessairement le principe d’égalité des droits, l’universalisme, le rejet de la tradition et de la religion. Parfaitement cohérentes l’une et l’autre, société traditionnelle et société moderne sont dès lors profondément antagoniques.
Précisons que cette opposition entre deux types de société se fonde sur les modèles idéals, les archétypes. Il est bien clair que les différents aspects que nous venons de recenser ne se traduisent pas exactement dans le concret du fonctionnement de la société en toute circonstance. Nous avons présenté l’opposition de deux constructions intellectuelles : la vie concrète apporte, et c’est heureux, nuances et exceptions. De même il est évident que les individus n’ont pas nécessairement tous conscience de la cohérence et des principes d’organisation de la société à laquelle ils appartiennent. Le modèle d’ensemble auquel chacun des deux types de société répond ne s’en impose pas moins dans les grandes lignes : validé par l’élite, il constitue un cadre à l’intérieur duquel chacun doit s’inscrire, de façon volontaire ou non.
Apportons cette autre indication. La société nouvelle et celle qu’elle remplace sont antagonistes : mais elles ne sont pas pour autant totalement étrangères l’une à l’autre. Le basculement provoqué par la révolution trouve en effet une partie de ses racines dans la situation et l’évolution de la société d’ancien régime elle-même : ce n’est pas une société en pleine santé qui a été renversée en 1789. L’ancienne société, tout d’abord, était depuis déjà longtemps contestée, dans son fonctionnement et plusieurs de ses principes essentiels, par certains secteurs de la société. Nous avons déjà mentionné la contestation protestante, le jansénisme, les Lumières : nous y reviendrons dans un article suivant. La société d’Ancien régime était également fragilisée dans ses fondements du fait de l’évolution de la position occupée par sa classe dominante : l’aristocratie. Nous reprendrons ce point également.
On peut discerner un lien supplémentaire entre les deux sociétés qui, au tournant du 18e siècle, vont se substituer l’une à l’autre. L’on peut en effet considérer que la modernité est assez directement issue de l’Evangile, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes puisqu’elle est fondamentalement anti religieuse. De nombreux éléments du message évangélique inspirent manifestement certains principes essentiels de la modernité. Par exemple les passages insistant sur le fait que les moins lotis seront premiers dans le royaume des cieux, sur l’exaltation des pauvres, sur la condamnation de la richesse, sont probablement la source majeure de l’idée moderne d’égalité. Pour notre part nous considérons, comme nous le notions dans un article précédent, que les modernes font de l’Evangile, dont ils s’inspirent nolens volens tout en le rejetant, une lecture erronée. Ils le comprennent comme un programme politique et un modèle de société, alors qu’il constitue un message personnel adressé à chacun pour la conduite de sa vie. Ce passage essentiel donne nous semble-t-il la clé d’interprétation : « Rendez à César… » : l’Evangile n’est pas un programme politique.
Terminons sur cette précision. Nous nous sentons plus proches à plusieurs égards du traditionalisme : nous partageons l’attachement à la famille, à la tradition, à l’ancrage territorial, à l’homogénéité de la population de souche, à la religion chrétienne comme étant l’un des principaux fondements de nos sociétés occidentales. De même nous rejetons sans équivoque plusieurs aspects de la modernité. Cependant nous ne souhaiterions aucunement réinstaller trait pour trait, en admettant que la chose fût possible, une société traditionnelle. Tous les apports de la modernité ne sont évidemment pas à rejeter. Si la révolution de la fin du 18e siècle n’avait pas eu lieu, il aurait sans aucun doute été souhaitable que l’ancienne société évolue d’elle-même, de façon en particulier à laisser une place plus grande à l’individu et à son libre arbitre.
Dans le prochain article, nous verrons comment la Révolution a traduit dans les actes cette volonté de remplacer la société traditionnelle par une autre.
http://www.fdesouche.com
Inscription à :
Articles (Atom)