mercredi 30 novembre 2016
L’origine de la dette de la France : la loi Pompidou-Giscard-Rothschild de 1973
Archives – Etienne Chouard, professeur d’économie, rappelle l’origine de l’endettement de la France : la loi Pompidou-Giscard-Rothschild de 1973.
Retour sur cet esclavage dont « on » ne parle pas...
« On », c'est, bien sûr, la cléricature médiatique et la caste du politiquement/historiquement/moralement correct. Et tous ceux qui lui font allégeance, comme, par exemple, Manuel Valls dont nous avons relevé l'ignorance et-ou le mensonge le 3 novembre dernier*.
Bien sûr, à propos de l'esclavage et de la traite négrière, celles et ceux qui s'informent, qui cherchent et qui veulent savoir, savent. Mais beaucoup sont maintenus dans l'erreur par les mensonges et les omissions de la bien-pensance officielle, uniquement préoccupée de se repentir à sens unique, et de condamner sans appel l'homme blanc, son héritage maudit, ses œuvres malfaisantes...
C'est bien joli, tout cela, sauf que... cela n'est pas tout à fait la réalité, ni la simple vérité historique. Si l'esclavage a malheureusement bien été pratiqué par l'homme blanc, cette horreur s'est arrêtée il y a bien longtemps maintenant. Mais l'esclavage perdure encore aujourd'hui, et là où nos bonnes consciences auto-proclamées ne voudraient surtout pas que l'on aille regarder.
Allons-y donc, et commençons par rappeler ce fait : eh, oui ! la traite orientale et arabo-musulmane a existé pendant 14 siècles (ce qui nous donne tout de même environ 17 millions d'Africains réduits en esclavage !) et continue dans certains pays du continent noir. N'en déplaise à ceux qui nous rebattent les oreilles, en nous parlant sans cesse d'un Islam idéal et tolérant fantasmé (« religion de paix et d’amour » !) - qui n'existe pas -, alors qu'ils ne parlent jamais de l'Islam réel et persécuteur qui existe - lui - bel et bien.
Plutôt que d'assommer le lecteur par de longs développements sur le sujet, on proposera donc à Manuel Valls, en particulier, et à tous, en général, de visionner deux documentaires - édifiants, c'est le moins que l'on puisse en dire - que la chaîne Arte avait déjà choisi de diffuser en 2008, centrés sur la Mauritanie : « Chasseurs d’esclaves » et « Les esclaves oubliés ».
Tout commentaire après visionnage serait superfétatoire... • (A suivre)
Chasseurs d’esclaves, reportage de Sophie Jeaneau et Anna Kwak ; ARTE, 2008, 45mn.
Mars 2008, à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Bilal, un esclave évadé, porte plainte. Sa sœur est détenue par une famille maure depuis la naissance. Elle a 40 ans. « Elle travaille jour et nuit, sans salaire », dénonce-t-il. Et ses enfants sont le fruit des viols de son maître. Deux militants de l’association mauritanienne SOS Esclaves décident d’aider Bilal à libérer sa sœur, de gré ou de force. Ils savent que la tâche ne sera pas facile. Issu d’un système traditionnel millénaire, l’esclavage mauritanien, qui n’a été officiellement mis hors la loi qu’en 2007, structure la société tout entière, souvent avec l’accord tacite des autorités. Une caravane se met en route à travers le désert, accompagnée par la caméra de Sophie Jeaneau et Anna Kwak. Un reportage exceptionnel sur le combat forcené des abolitionnistes d’aujourd’hui, décidés à éradiquer l’esclavage en terre africaine.
Le documentaire « Les esclaves oubliés » sera mis en ligne dans nos publications de demain jeudi 1er décembre.
* A lire ou relire ...
mardi 29 novembre 2016
Suite à l'émission de jeudi dernier sur Radio Libertés, Fabrice Dutilleul à interrogé pour EuroLibertés Yannick Guibert, le traducteur du livre "Budapest 1956, insurrection" de David Irving
Entretien avec Yannick Guibert, traducteur du livre de David Irving Budapest 1956 : le cauchemar d’une nation, 2 tomes (Les Bouquins de Synthèse nationale).
Propos recueillis par Fabrice Dutilleul.
Que représente la Hongrie en Europe dans les années cinquante ?
Ce pays s’étend sur 93 000 km2, soit à peine un cinquième de la France, au cœur de l’Europe. Dominée par une capitale surdimensionnée qui concentre près du quart de la population (dix millions) et l’essentiel des activités économiques secondaires et tertiaires, le pays a alors des frontières communes avec la Tchécoslovaquie, l’URSS, la Roumanie, la Yougoslavie et l’Autriche avec laquelle il a aussi partagé une longue histoire commune.
Après la Ire Guerre mondiale, le traité de Trianon ampute la Hongrie des deux tiers de son territoire et de plus de la moitié de sa population. Dès 1920, après la brève et sanglante république des soviets de Bela Kun, l’amiral Horthy rétablit le Royaume (très catholique) de Hongrie dont il assume la régence. Alliée fidèle du IIIe Reich, la Hongrie sera envahie par les Soviétiques dès septembre 1944 ; ils occuperont Budapest en février 1945 après trois mois de siège.
Quel est le gouvernement qui prend la tête du pays en 1945 ?
C’est un gouvernement fantoche communiste formé à l’instigation des Soviétiques dès leur entrée en Hongrie et installé à Debrecen à la suite de l’Armée Rouge. Dans le camp des vaincus, le peuple hongrois subit les exactions des vainqueurs : pillages déportations, viols illustreront la libération par les communistes.
Toutefois, en vertu des accords de Yalta, des élections libres sont organisées en novembre 1945 et elles furent un désastre pour Moscou : le Parti des Petits Propriétaires obtint la majorité absolue (57 %), suivi des Sociaux-Démocrates et des Communistes (17 %), le Parti National Paysan arrivant quatrième. Les communistes hongrois tombaient de haut, mais leur chef, Matthias Rakosi – né Matthias Roth en 1898 à Budapest – disposait d’un atout majeur : la présence de l’Armée Rouge. Doté d’une intelligence supérieure, il fut l’inventeur de « la tactique du salami » qui permit aux Communistes d’atteindre le pouvoir absolu dès 1948 après avoir menacé, noyauté, corrompu, abusé ses concurrents politiques et la population hongroise.
S’ensuivit une politique économique aberrante visant à imposer à ce pays profondément rural une industrie lourde et la collectivisation des terres. Parallèlement, la terreur rouge s’abattait sur le pays et tout opposant se voyait persécuté, enfermé, dénoncé : une première vague de procès staliniens épura le parti de tous ses éléments considérés comme trop tièdes. Une police politique très efficace, l’AVO (rebaptisée ensuite AVH), assurait la consolidation du régime. L’activité économique se délitait, la misère triomphait, une chape de plomb recouvrait la Hongrie.
Puis, au printemps 1953, la foudre frappa le monde communiste : Staline meurt ! Ceci entraîna des troubles bien au-delà du rideau de fer, mais notamment en Hongrie : grèves dans les aciéries chères au régime, manifestations paysannes massives dans la Puszta, la grande plaine hongroise. Un vent de réformes se leva qui se traduisit par une timide libéralisation économique et politique : un nouveau gouvernement formé par Imre Nagy, vieux routard du communisme, venait tempérer l’action de Rakosi qui demeurait à la tête du PC. Ce dernier put ainsi s’opposer efficacement à la Nouvelle Voie de Nagy et provoquer sa chute début 1955.
Mais il est trop tard pour revenir à un régime stalinien et l’année 1956 va connaître un foisonnement de contestations politiques dans les milieux intellectuels, même au sein du Parti…
C’est ce qui va conduire à l’insurrection de 1956 ?
Elle débutera à l’issue des grandes manifestations étudiantes, fruits de cette agitation intellectuelle, qui se déroulent le 23 octobre 1956 à Budapest.
Ce mardi, vers 15 heures, deux cortèges rassemblant une dizaine de milliers d’étudiants chacun s’ébranlent parallèlement au Danube, l’un côté Pest à partir de la faculté de droit, l’autre côté Buda à partir de Polytechnique. Tous les deux se dirigent vers les statues du général Bem et du poète Petöfi, héros de la révolution de 1848.
Initialement interdite par le Parti, la manifestation fut autorisée à la dernière minute face à la détermination des étudiants. Déstabilisé par la dénonciation du stalinisme au sein même du Kremlin par les nouveaux maîtres et en premier lieu Nikita Khrouchtchev lui-même, le Parti communiste hongrois s’est ramolli : il a même interdit à la police de tirer.
Tout se déroule dans un calme bon enfant jusqu’à la dislocation vers 18 heures où certaines voix s’élèvent pour que l’on puisse exprimer à la radio les revendications des étudiants ; de plus, entre-temps, de nombreux ouvriers des équipes du matin qui venaient de débaucher s’étaient joints à la manifestation, ainsi que les employés qui sortaient des bureaux : plus de 50 000 personnes se retrouvèrent ainsi dans la rue. Alors qu’un petit groupe allait à la maison de la radio pour exiger la diffusion de leurs revendications, la masse des manifestants se dirigea vers la place du Parlement où la foule rassemblée exigea le retour au pouvoir d’Imre Nagy.
À la maison de la Radio, durant la nuit, l’affrontement tourne au drame, les gardes de l’AVH chargés d’en interdire l’accès, affolés par la pression des manifestants, ouvrent le feu, faisant une dizaine de victimes. Scandalisés par ces meurtres, des policiers réguliers et des officiers de l’armée commencent à donner des armes aux manifestants. Puis deux fausses ambulances font irruption : il s’agit en fait de transports d’armes et de munitions camouflés pour l’AVH encerclée à l’intérieur de la Radio… La foule s’en empare et l’affrontement tourne à la guérilla jusqu’au petit matin. Durant la nuit, d’autres manifestants déboulonnent la gigantesque statue de Staline qui dominait la place des Héros.
Comment réagit le gouvernement communiste ?
Affolé, le Politburo qui venait de nommer Imre Nagy à la tête du gouvernement, fait appel aux troupes soviétiques stationnées en Hongrie pour rétablir l’ordre. Les blindés soviétiques investissent les rues de Budapest au petit matin et se positionnent autour des centres nerveux du gouvernement.
Le 24 au matin, tout a basculé : ce ne sont plus des intellectuels ou des étudiants qui occupent la rue, mais les classes populaires, et en premier lieu des ouvriers, armés et avides d’en découdre. Ils attaquent les commissariats pour trouver des armes, récupèrent celles des clubs de tir sportifs de leurs usines et s’emparent même d’arsenaux de banlieue qu’ils connaissent bien.
Les insurgés établissent des places fortes notamment à la caserne Kilian où le colonel Maléter rejoint la cause rebelle, le cinéma Corvin à Pest, places Széna et de Moscou à Buda.
La marée rebelle se répercute de villes en villes : Györ, Debrecen… avec une grève générale dans tout le pays et le démantèlement des fermes collectives dans les campagnes.
En une semaine, le Parti communiste hongrois s’est effondré : de ses 800 000 adhérents, il ne peut plus compter que sur l’AVH et l’Armée Rouge pour le défendre. Son siège à Budapest est pris d’assaut le 30 octobre et ses occupants massacrés Mais après un cessez-le-feu et le départ apparent de l’Armée Rouge de Budapest, Kadar et Münnich forment un gouvernement prosoviétique le 4 novembre… C’est le retour des troupes russes qui écrasent l’insurrection entre le 4 et le 11 novembre, même s’il y a encore des combats sporadiques jusqu’au début décembre.
Le bilan est de 2 500 à 3 000 morts, 17 000 à 19 000 blessés (dont 80 % à Budapest), tandis que 200 000 Hongrois parviennent à se réfugier en Autriche.
Source EuroLibertés cliquez ici
Pour commander les deux volumes de David Irving :
Insurrection Budapest 1956 : le cauchemar d’un nation (vol. 1), 330 pages, 22 euros, cliquez ici.
Insurrection Budapest 1956 : le cauchemar d’un nation (vol. 2), 352 pages, 22 euros, cliquez ici.
Les deux volumes cliquez là
Dominique Venner et la mort volontaire chez Drieu la Rochelle et Montherlant
Pauline Lecomte : Lors des guerres et conflits civils du XXe siècle, il semble que le suicides pour des raisons politiques n'aient pas été rares en Europe.
Dominique Venner : Des circonstances exceptionnellement dramatiques les ont en effet favorisés. Le 30 mai 1925 par exemple, se donna la mort l'écrivain nationaliste allemand Moeller van den Bruck, traducteur de Dostoïevski et fondateur d'un des clubs les plus actifs de la "révolution conservatrice". Cette année-là marqua cruellement le recul de ses espérances. Le jeune Thierry Maulnier, dans la préface qu'il donna huit ans plus tard à une traduction de l'écrivain allemand, lui rendit hommage : "Il n'a pas conçu son suicide comme une renonciation, mais comme un germe, il a voulu qu'il fût une provocation à l'espérance et à l'émeute". C'était une pensée généreuse.
En certaines occasions, le suicide peut sembler accorder une sorte de grâce anoblissante, dans la mesure où la mort volontaire se charge d'un sens que n'a pas la mort naturelle ou accidentelle. Je songe à des exemples contemporains, ceux de trois écrivains engagés dans la guerre, qu'avait remarqués Jünger dans Jardins et routes, première partie de son Journal de Guerre, parce que, dit-il, ceux-là furent courageux sans céder à la haine. Ce sont Drieu la Rochelle, Montherlant et Saint-Exupéry. Jünger les met "au petit nombre de cette haute chevalerie qu'a produite la première grande guerre." Peu importe l'erreur générationnelle concernant Saint-Exupéry (1900-1944), trop jeune pour le premier conflit, mais pilote valeureux des combats de 1940 et de 1944. Le destin devait conduire ces trois écrivains français à se donner volontairement la mort dans des circonstances très différentes, ce qui a contribué à les élever "au petit nombre de la haute chevalerie" invoquée par Jünger.
P. L. : Le suicide de Pierre Drieu la Rochelle fait intimement partie de sa légende, plus encore que ses succès féminins ou son élégance britannique.
D. V. : Longtemps après sa mort, ses écrits continuent de parler pour leur époque. Ils en expriment quelques interrogations fondamentales, résumées par la hantise d'une irrémédiable décadence. Celle de la bourgeoisie française thème de tous ses romans, celle aussi de la France à laquelle il a consacré ses essais. Marqué dans sa jeunesse par l'influence de Nietzsche et des surréalistes, combattant courageux de la Première Guerre mondiale, plusieurs fois blessé, Drieu pensa trouver dans le fascisme, après 1933, un remède à cette décadence qui l'obsédait. Au lendemain de la défaite de 1940, il voulut croire que, de cette épreuve, surgiraient de nouvelles énergies et une réconciliation franco-allemande. A la fin de l'Occupation, cruellement déçu par l'impossible collaboration, il refusa de s'exiler en Suisse comme l'occasion lui avait été offerte.
Ecrivain fasciné par l'aventure politique, Drieu n'était pas un politique. Il était beaucoup trop sensible, droit et assoiffé d'absolu. "Je le considère comme l'un des êtres les plus nobles que j'ai rencontrés", devait dire son ami André Malraux à Frédéric Grover. Lorsque fut consommée la défaite de ses illusions, il ne se départit pas de sa hauteur. Après avoir vécu caché quelque temps, il se tua le 15 mars 1945. Dans une lettre ultime à son frère, il donnait ses raisons : "J'estime un bonheur de pouvoir mêler mon sang à mon encre et rendre sérieuse à tout point de vue la fonction d'écrire."
P.L. : Qu'en fut-il pour Montherlant ?
P.L. : Qu'en fut-il pour Montherlant ?
D. V. : Rendre sérieuse la fonction d'écrire fut certainement l'une des préoccupations constances d'Henry de Montherlant. C'était une personnalité complexe. Certains de ses biographes ont mis en évidence des faiblesses que la tradition chrétienne aurait qualifiées de péchés, tout en leur accordant la grâce d'une rémission. Il ne fut pas le personnage altier que suggèrent sa prose magnifique et ses dons de dramaturge. Il a montré que l'on peut être un grand écrivain, le plus grand peut-être de sa génération, et avoir cédé à une conduite intime douteuse. Mais sa mort volontaire l'a d'un seul coup lavé de toutes ses souillures. Le 21 septembre 1972, en fin de journée, se sentant menacé de devenir aveugle et refusant ce déclin, il saisit son pistolet et se tira une balle dans la bouche.
Selon les mots de Jean Cau, ce geste traçait "une orgueilleuse signature de sang au bas de sa vie. Tous les mensonges pulvérisés par une seule détonation."Ce fut une mort romaine. Elle ressemblait tant à l'image que l'écrivain avait voulu donner de lui-même que l'homme véritable s'en trouvait anobli. Le maître de Santiago et le cardinal d'Espagne ne mentaient plus. Face à lui-même et à un ciel qu'il pensait vide, Montherlant n'avait pas tremblé.
Il avait laissé nombre de réflexions sur le suicide. "On se suicide par respect pour la vie, quand votre vie a cessé de pouvoir être digne de vous. Et qu'y a-t-il de plus honorable que ce respect de la vie ?" Certes. En roide éthique, le droit au suicide n'est limité que par la peine que l'on peut causer à des proches ou par l'exigence d'un devoir qui impose de continuer à vivre, quitte à souffrir.
Dominique Venner, Le choc de l'histoire
Dominique Venner, Le choc de l'histoire
Les origines de Monsanto
Ayant mesuré le taux de nuisance de Monsanto, monstre sans visage, nous avons tenté de remonter le temps afin d'identifier les êtres qui l'avaient créés. Et c'est à vrai dire sans grande surprise que nous avons découvert comment ils s'étaient enrichis - au détriment d'autrui ; par l'asservissement, par les chaînes, dans un déni total d'humanité.
En 1757, Isaac (Rodrigues) Monsanto, juif sépharade né aux Pays-Bas, arrivait à la Nouvelle-Orléans en provenance de Curaçao [Antilles néerlandaises, sur la côte du Venezuela]. Il s'établit comme négociant et entreprit de transporter des cargaisons d'esclaves noirs des Caraïbes au Golfe de Mexico. Dix ans plus tard, il faisait l'acquisition d'une plantation du nom de Trianon, aux abords de la Nouvelle- Orléans. En 1769, alors que le deuxième gouverneur espagnol venait de prendre ses fonctions et expulsait les juifs de la Louisiane, Isaac Monsanto était devenu l’un des plus riches marchants de cet Etat. Cependant, ses biens confisqués, Monsanto dut quitter le territoire et s'installer dans la ville de Manchac, près du lac Pontchartrain, sous contrôle britannique où le rejoignirent ses frères Manuel, Jacob et Benjamin, tandis que ses deux sœurs, Gracia et Eleonora, s'installaient à Pensacola, dans l'ouest de la Floride, elle aussi administrée par les Britanniques.
Après la mort d'Isaac en 1778, les trois frères Monsanto continuèrent à gérer leur "entreprise", mêlant la vente de tissus à des produits de toutes sortes, tenant le rôle d'agent immobilier et de recouvrements - le tout lié au trafic d'esclaves.
Des documents l'attestent, mentionnant par exemple, l'achat par Benjamin Monsanto, de 80 Noirs en 1768 ; de 13 en 1785 contre de l'indigo, d'une valeur de 3 000 livres ; en 1787, ce fut le sort de 31 autres qu'il négocia. D'autres archives, datant de 1794, font état d'une femme noire "Babet" vendue par Benjamin à un certain Franco Cardel ; de deux Guinéens, « Polidor et Lucy » à James Saunders pour la somme de 850 dollars en argent. Et quelques noms « Quetelle, Valentin, Baptiste, Prince, Princesse, Caesar, Dolly, Jen, Fanchonet, Rosetta, Nat, Louis, Eugène, Adélaïde », appartenant aux frères Monsanto.
En l'an 1790, Benjamin Monsanto et son épouse avaient acquis, sans mal, une plantation de 500 acres à Sainte Catherine's Creek près de Natchez, dans le Mississipi, sur laquelle trimaient onze esclaves. D continua de s'investir dans l'entreprise familiale jusqu'à son passage à trépas, en 1794, tandis que Manuel et Jacob ouvraient un commerce rue de Toulouse, à la Nouvelle-Orléans. Au cours des années, Isaac "hypothéqua", plusieurs fois de suite, quatre de ses esclaves, lorsqu'il fut en difficulté financière ; Benjamin négocia six contrats concernant la vente de six des siens, « pour après sa mort » ; Gracia légua par testament, « neuf Africains », à sa famille ; Jacob, fils d'Isaac, tomba amoureux d'une de ses esclaves, « Mamy William » et de cette union, naîtra Sofia, « une jolie quarteronne », est-il rapporté...
John Francis Queeny, fondateur de Monsanto, épousa Olga Mendez (Monsanto n'étant pas toujours mentionné), fille d'Emmanuel Mendes Monsanto, dont la date de naissance est estimée « entre 1808 et 1868 », alors que ni date ni lieu de décès ne sont déclarés. En furetant un peu, l'on peut toutefois apprendre qu'Emmanuel Mendes de Monsanto, fut « un riche financier d'une société sucrière de Vieques, Porto Rico, dont le siège était à St Thomas, Indes occidentales danoises ». [Le danois étant réservé à l'administration, il profitait à un Créole français, proche de celui de Sainte-Lucie ainsi qu'à l'anglais et à l'espagnol. De quoi plaire aux cosmopolites]. Les produits de base de sa société étaient (déjà) des additifs alimentaires tels que la saccharine, la caféine et la vanilline de synthèse.
Le site nous renseigne sur le nom de son épouse, Emma Kitson, mais sans plus. C'est autour de leur fille, Olga Mendez, que se cristallise le mystère, telle une pièce de puzzle impossible à caser.
Certes, le nom que portent père et fille est le même mais le fait que l'orthographe diffère de l'un à l'autre, ne nous semble pas anodin, Mendes et Mendez étant d'origine distincte. En effet, les Mendes, Menendes, de même que les Pereira Mendes et Mendes Seixas, originaires du Portugal, sont généralement mais pas obligatoirement, portés par des juifs sépharades, alors que les Mendez sont originaires d'Espagne, de Galicie notamment, et descendent généralement de « notables de haute lignée » ; que certains assument d'origine allemande - ce qui serait le cas d'Olga - dont une ancienne tribu n'est autre que wisigothe, issue de ces « goths sages » danubiens, submergés par les Arabes sur le sol espagnol mais dont une minorité se réfugia dans les Asturies pour former un royaume, une communauté chrétienne, encore autonome de nos jours.
Il n'échappe à personne que, depuis le Moyen Age, nombre de noms ont été empruntés, usurpés, achetés ou acquis par mariage ou filiation, particulièrement lorsque les monarques Isabelle et Ferdinand entreprirent de chasser les juifs sépharades de la péninsule ibérique (décret royal de l'Alhambra de Grenade, 31 mars 1492). Leur expulsion aurait débuté le 2 août 1492 et, cinq ans plus tard, en 1497, au Portugal. Une majorité d'entre eux émigra ainsi en Hollande, établissant la Compagnie hollandaise des Indes Occidentales (Dutch West Indies Company). Aujourd'hui hélas, les recherches sont de pins en plus difficiles, sinon impossibles, les biographies étant restreintes et l'accès aux généalogies se retrouvant "privatisé" ; certains liens, d'autre part, semblent valides, mais affichent « page introuvable », dès que l'on y accède.
Parfois, comme par miracle, survient une information oubliée par la censure, telle cette copie d'un recensement fédéral états-unien de l'an 1900, précisant qu'Olga Mendez naquit en janvier 1872 aux Antilles ; pourtant demeurent inconnus les date et lieu son décès, bien qu'étant tout de même l'épouse d'une personnalité en vue. Le couple aura deux enfants : Edgar Monsanto Queeny (1897-1968) et Olga Queeny.
Remarquons, là aussi, ce contraste dans les noms, qui nous ramène inévitablement à John Francis Queeny (1859-1933), fondateur de la corporation Monsanto. Américano-Irlandais catholique dont la biographie tient à peine une demi-page sur Wikipédia. L'aîné de cinq enfants, son éducation scolaire à Chicago, fut de courte durée (de 6 à 12 ans), le « grand feu », qui ravagea la ville, « ayant contraint à quitter l'école et chercher du travail ». Tout d'abord coursier à 2,50 dollars la semaine chez Tolman & King, il va « s'installer à Saint-Louis en 1897 » -, date qui correspond aussi à la naissance d'Edgar. Queeny a alors la quarantaine et la chance ne semble pas lui avoir souri. A ce stade, une union avec « la fille Monsanto » apparaît donc peu probable, admettons-le. À Saint-Louis, il devient l'employé d'une grosse société pharmaceutique du nom de Meyer Brothers Drug Company. D'après Wikipédia (en anglais), « il aurait, deux ans plus tard, mis toutes ses économies dans l'achat d'une raffinerie de sulfure qui brûla le lendemain de l'ouverture ».
Si l'on suit bien cet étrange parcours, Queeny aurait fondé Monsanto Chemical Work en 1901 - société sise à Saint-Louis dans le Missouri - avec un apport de 5 000 dollars, sans pour autant quitter Meyer Brothers. Il se serait lancé dans la production de saccharine - grâce au raffinage de la betterave à sucre (1900) - qu'il revendait à Meyer et dont il commença à tirer profit en 1905. (Bientôt suivraient les substituts du beurre ainsi que le glutamate monosodique (GMS), si nocif à la santé). Il aurait quitté Meyer l'année suivante pour rejoindre Monsanto à temps plein. Aurait-il, du même coup, adopté Edgar que rien ne présupposait à être son fils biologique ?
Le peu que l'on sache sur Edgar prête à croire qu'il fut un homme brillant, qu'une fois PDG de la corporation, il allait contribuer à « une nouvelle ère d'expansion pour Monsanto, avec le lancement de la manufacture de plastiques pétrochimiques et du phosphore » [découvert cependant en 1669 par l'alchimiste allemand Hennig Brand, lors de ses recherches sur la « Pierre du philosophe »]. Sa renommée ne sera pas compromise par le krach de 1929, Monsanto affichant au contraire, des profits.
Elu membre de Missouri Historical Society et président de Lafayette-South Side Bank Trust Company, Queeny sera élevé au titre de Chevalier de l'Ordre de Malte - révélation di Comte - après avoir été « initié au sein de le forteresse des Jésuites dans laquelle réside le Pape Noir de l'Université de Saint-Louis depuis 1818».
Il s'avéra que « ce comte » n'était autre que « le Comte Saint-Germain, un homme enveloppé de mystère, de naissance et patrimoine inconnus ; teint olivâtre, cheveux noirs, d'apparence juive (sic). Se disant âgé mais détenteur de secrets séculaires, dont celui d'immortalité, il n'apparaissait pas plus vieux que 50 ans, en toutes occasions ; élégant, portant les bijoux les plus purs ; parlant plusieurs langues, écrivant des deux mains... Arrêté à Londres car soupçonné d'espionnage, durant la rébellion jacobite de 1745, il sera libéré sans inculpation. Supposé mort le 27 février 1784, il aurait été aperçu par plusieurs témoins... ». Curieux personnage en effet.
Parmi d'autres initiés, signalons J.P. Morgan junior, de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, qui fonda, en 1918, la US. Steel Corporation et fit du Chevalier de Malte, John A. Farrell, son président.
Monsanto a aussi des liens avec la société Walt Disney, financée par Bank of America, sous la gouverne du frère de Walt Disney, Roy, lui aussi promu Chevalier de Saint Grégoire en compagnie du propriétaire de Fox News, Rupert Murdoch.
Monsanto est aujourd'hui présidé par Hugh Grant qui, afin de ne pas déroger à la réputation de ses prédécesseurs, porte bien son épithète d'homme « sans scrupules ». Mais avec une rémunération annuelle aussi indécente : une trentaine de millions de dollars, gageons qu'il n'en a cure.
Michelle FAVARD-JIRARD. Rivarol du 24 novembre 2016
lundi 28 novembre 2016
27 novembre 1095 : Depuis Clermont, le Pape Urbain II appelle à la première Croisade
C’est le 27 novembre 1095, depuis Clermont dans la capitale de ce qui est aujourd’hui la région Auvergne, au coeur donc de la France, que le Pape Urbain II a appelé à la Première Croisade. Il s’agissait, comme en atteste la reproduction de son discours ci-dessous, de venir en aide aux Chrétiens d’Orient, persécutés par les Mahométans conquérants. Certains diront qu’il s’agit d’une autre époque, mais des mêmes problèmes que ceux actuels… cependant les comportements des successeurs de Pierre sont radicalement différents et Urbain II serait vraisemblablement estomaqué par le comportement de François ! Finalement, c’est de toute l’Europe que les Croisés vont affluer, et libérer Jerusalem occupée. Certains hommes, tel Godefroy de Bouillon, seront particulièrement vaillants durant cette Croisade.

L’appel d’Urbain II, rapporté par Foucher de Chartres, vraisemblablement témoin de l’homélie.
Ô fils de Dieu ! Après avoir promis à Dieu de maintenir la paix dans votre pays et d’aider fidèlement l’Église à conserver ses droits, et en tenant cette promesse plus vigoureusement que d’ordinaire, vous qui venez de profiter de la correction que Dieu vous envoie, vous allez pouvoir recevoir votre récompense en appliquant votre vaillance à une autre tâche. C’est une affaire qui concerne Dieu et qui vous regarde vous-mêmes, et qui s’est révélée tout récemment. Il importe que, sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d’Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide.
En effet, comme la plupart d’entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Ils se sont avancés jusqu’à la mer Méditerranée et plus précisément jusqu’à ce qu’on appelle le Bras Saint-Georges. Dans le pays de Romanie, ils s’étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à sept reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups ; beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises ; ils saccagent le royaume de Dieu.
Si vous demeuriez encore quelque temps sans rien faire, les fidèles de Dieu seraient encore plus largement victimes de cette invasion. Aussi je vous exhorte et je vous supplie – et ce n’est pas moi qui vous y exhorte, c’est le Seigneur lui-même – vous, les hérauts du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu’ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents : le Christ l’ordonne.
À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l’accorde à ceux qui participeront à ce voyage, en vertu de l’autorité que je tiens de Dieu.
Quelle honte, si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclave des démons, l’emportait sur la nation qui s’adonne au culte de Dieu et qui s’honore du nom de chrétienne ! Quels reproches le Seigneur Lui-même vous adresserait si vous ne trouviez pas d’hommes qui soient dignes, comme vous, du nom de chrétiens !
Qu’ils aillent donc au combat contre les Infidèles – un combat qui vaut d’être engagé et qui mérite de s’achever en victoire –, ceux-là qui jusqu’ici s’adonnaient à des guerres privées et abusives, au grand dam des fidèles ! Qu’ils soient désormais des chevaliers du Christ, ceux-là qui n’étaient que des brigands ! Qu’ils luttent maintenant, à bon droit, contre les barbares, ceux-là qui se battaient contre leurs frères et leurs parents ! Ce sont les récompenses éternelles qu’ils vont gagner, ceux qui se faisaient mercenaires pour quelques misérables sous. Ils travailleront pour un double honneur, ceux-là qui se fatiguaient au détriment de leur corps et de leur âme. Ils étaient ici tristes et pauvres ; ils seront là-bas joyeux et riches. Ici, ils étaient les ennemis du Seigneur ; là-bas, ils seront ses amis !
En effet, comme la plupart d’entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Ils se sont avancés jusqu’à la mer Méditerranée et plus précisément jusqu’à ce qu’on appelle le Bras Saint-Georges. Dans le pays de Romanie, ils s’étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à sept reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups ; beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises ; ils saccagent le royaume de Dieu.
Si vous demeuriez encore quelque temps sans rien faire, les fidèles de Dieu seraient encore plus largement victimes de cette invasion. Aussi je vous exhorte et je vous supplie – et ce n’est pas moi qui vous y exhorte, c’est le Seigneur lui-même – vous, les hérauts du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu’ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents : le Christ l’ordonne.
À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l’accorde à ceux qui participeront à ce voyage, en vertu de l’autorité que je tiens de Dieu.
Quelle honte, si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclave des démons, l’emportait sur la nation qui s’adonne au culte de Dieu et qui s’honore du nom de chrétienne ! Quels reproches le Seigneur Lui-même vous adresserait si vous ne trouviez pas d’hommes qui soient dignes, comme vous, du nom de chrétiens !
Qu’ils aillent donc au combat contre les Infidèles – un combat qui vaut d’être engagé et qui mérite de s’achever en victoire –, ceux-là qui jusqu’ici s’adonnaient à des guerres privées et abusives, au grand dam des fidèles ! Qu’ils soient désormais des chevaliers du Christ, ceux-là qui n’étaient que des brigands ! Qu’ils luttent maintenant, à bon droit, contre les barbares, ceux-là qui se battaient contre leurs frères et leurs parents ! Ce sont les récompenses éternelles qu’ils vont gagner, ceux qui se faisaient mercenaires pour quelques misérables sous. Ils travailleront pour un double honneur, ceux-là qui se fatiguaient au détriment de leur corps et de leur âme. Ils étaient ici tristes et pauvres ; ils seront là-bas joyeux et riches. Ici, ils étaient les ennemis du Seigneur ; là-bas, ils seront ses amis !
LA MORT DE L’INFIDELE CASTRO
Le bloc-notes de Jean-Claude Rolinat
« Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu’ils ont entendu ce cri, il est mort le Fidel…. ». Air bien connu qui va réunir les pleureuses habituelles parant le disparu de toutes les vertus humaines et célestes, pour peu qu’un hiérarque Catholique pas trop regardant soit de la « fête »…. Pourtant Fidel Castro, l’un des derniers dinosaures de la galaxie communiste, n’était pas un enfant de chœur. Les dizaines de milers de boat people et d’internés politiques, sans oublier les fusillés « pour l’exemple », pourraient en témoigner. C’est à Miami, dans les milieux anticastristes, que la nouvelle de la mort du lider maximo a déchainé des cris de joie, mais comment pourrait-on s’en étonner ?
Un Staline de poche aux Caraïbes
Issu d’une famille relativement aisée d’origine galicienne – ce qui explique, paradoxalement l’excellence de ses relations avec l’Espagne franquiste ! – (1), ce bouillant avocat se lança en politique. Son coup d’essai, son coup de maitre, fut l’attaque le 26 juillet 1953 de la caserne Moncada à Santiago de Cuba où l’on peut encore voir sur les murs, les traces des échanges de tirs entre les jeunes gens de l’équipée fidéliste et les 1000 soldats du régiment numéro 1 de la Guardia rural commandée par le colonel Caviano. Si Fidel fut épargné par la clémence du tribunal – influence en coulisses de la caste bourgeoise à laquelle appartenait son père ? - 71 de ses compagnons y laissèrent leur peau, directement dans les combats ou fusillés après. Pour une dictature, celle de Batista - médiocre et traditionnel caudillo latino-américain s’enrichissant des pots de vins versés par les gangsters qui avaient fait main basse sur tous les trafics à La Havane – n’en était pas moins indulgente pour qui savait lui graisser la patte. On retrouve Fidel libre trois ans plus tard, après un court exil mexicain, à bord du yacht le Granma, qui débarqua clandestinement un noyau de guérilléros dans la difficile Sierra Maestra au Sud-Est de l’ile. C’est dans ces montagnes qu’il implantera le 26 juillet 1956 son maquis, harcelant l’armée gouvernementale forte à l’époque de 23 000 soldats.
La légende prend son envol
C’est donc là que naitront la légende et le mythe du castrisme. D’abord simple révolution patriotique et réformiste, ayant la sympathie des Américains qui, une fois de plus se sont trompés sur l’un de leurs poulains, Fidel va se parer de l’image d’une sorte de Robin des Bois, confisquant aux riches pour redistribuer aux pauvres. Le spectaculaire enlèvement du coureur automobile argentin Juan Manuel Fangio comme la non moins ahurissante attaque du palais présidentiel, une énorme « pâtisserie » architecturale bâtie en plein cœur de la capitale, tresseront l’auréole d’un héros de pacotille qui n’était qu’un Tartuffe exotique. Bien vite, les maladresses et les exactions du régime de Batista pousseront les soutiens de ce dernier à fuir le pays ou à se rallier aux troupes du Movimiento del 26 de julio . Et, pour les soldats les plus compromis dans la répression, à déserter. Che Guevara, un médecin argentin d’obédience marxiste, compagnon de la première heure des frères Castro, organisera une féroce épuration, se vantant même aux Nations Unies, colt aux côtés, de faire fusiller massivement à la forteresse de La Cabana dominant le port de la capitale, tous ceux qui, de près ou de loin, étaient compromis avec le régime du général Fulgencio Batista. Ce dernier avait précipitamment pris la fuite par avion dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1959, emportant dans ses bagages le fruit de toutes ses rapines. Il tombera sur plus cupide que lui dans son exil « doré » et provisoire de Ciudad-Trujillo, en République Dominicaine. Un caudillo s’exilait, une nouvelle autocratie s’installait à sa place, avec le visage cette fois, d’un communisme tropical. Après l’exaltation des moments révolutionnaires, c’était déjà l’heure des « lendemains qui déchantent : parti unique, comités de quartiers, les tristement fameux « CDR » encadrant les habitants et notant leurs moindres faits et gestes, une double monnaie – le Péso pour le citoyen de base et le dollar pour l’étranger – tickets de rationnement pour rayons vides et la… « guagua » pour les transports urbains, autobus bien souvent hippomobile faute de carburant. Et la moindre contestation conduisait immanquablement aux camps de détention de l’ile des Pins. Libérés de Batista et de sa police secrète, la SIM, on pouvait se poser la question, était-ce bien ce régime politique broyant l’individu, que souhaitaient du fond de leur cœur les Cubains ? Beaucoup, au risque de se noyer, préférèrent s’embarquer sur de frêles esquifs pour rejoindre des cieux plus cléments, ceux de la Floride où ils constituent une importante et influente communauté. Après l’échec programmé du débarquement de la Baie des cochons en 1961, où les anticastristes furent lâchés par l’administration Kennedy et abandonnés à la répression de la nouvelle armée révolutionnaire cubaine, après la crise des fusées qui éclata en 1962 entre les USA et l’URSS , la Révolution cubaine montrait au monde son vrai visage, celui d’une implacable dictature marxiste. L’ile devenait un actif pôle révolutionnaire et un relai pour tous les amateurs de guérillas du continent latino-américain, toutes plus exotiques et romantiques les unes que les autres. Che Guevara lui-même ira se perdre en Afrique centrale, avant de mourir en Bolivie. Un certain Régis Debray engagé à ses côtés, fils d’une influente élue du Centre National des indépendants à Paris, n’obtiendra la grâce du Président Barrientos que suite à l’intervention du Président De Gaulle. C’est ainsi que notre « brillant » intellectuel échappa aux balles des rangers boliviens et que la République des lettres ne s’en porte que mieux…. L’Union Soviétique, dont dépendait entièrement Cuba, notamment pour ses approvisionnements en pétrole et pour ses exportations de sucre, ainsi que pour couvrir ses tentatives de déstabilisation de ses voisins, exigea de son protégé un engagement massif en Angola. Dans ce pays, ses partisans du MPLA étaient en grand danger face aux rebelles de l’UNITA et du FNLA soutenus eux, par l’Occident et l’Afrique du Sud. C’est ainsi que Cuba envoya des contingents de soldats, surtout des Noirs, pour la plus grande angoisse des mères de familles.
La gloire posthume pour le « Che », la gloire temporelle pour Fidel
Le Che une fois mort, il ne pouvait plus faire de l’ombre au commandante, au leader suprême, tout à la fois chef du gouvernement, de l’Etat et du parti. C’est sans doute pourquoi les portraits du Che sont bien plus nombreux et bien plus grands que ceux de Castro lui-même : un rival mort n’est plus un danger. Camilo Cienfuegos, compagnon de lutte des heures héroïques de la Sierra Maestra, populaire commandant de la colonne insurgée n°2 « Antonio Macéo », s’emparant le 2 janvier 1959 du puissant Campo Columbia de l’armée Batistaine, disparut mystérieusement en avion le 28 octobre 1959. Son crime ? Avoir pris la défense d’un autre fidèle de l’infidèle… Fidel, le commandant Hubert Matos, embastillé pour crime de lèse-majesté. La plus injuste des ingratitudes, la plus cruelle aussi, fut le procès en « sorcellerie » organisé contre le prestigieux chef du corps expéditionnaire cubain en Angola, le général Arnaldo Ochoa, mêlé à une étrange affaire de trafic de drogue. Quand on veut noyer son chien, c’est bien connu, on dit qu’il a la rage. Ochoa et plusieurs autres officiers, des proches, furent condamnés à mort le 4 juillet 1989. Une semaine après, ils étaient passés par les armes ! Comble de l’ignominie de cette famille Castro décidément bien peu recommandable, l’épouse de Raul, frère et successeurs de Fidel, amie déclarée et reconnue du couple Ochoa, lâcha cette terrible phrase, « que la sentence soit confirmée et exécutée ! » (2). Après quelques succès au Chili avec Allende, au Nicaragua avec le FSLN Sandiniste de la famille Ortega - toujours au pouvoir !- les réussites électorales de la gauche au Salvador, en Bolivie avec « l’indianiste » Moralès , au Brésil – mais avec la chute de la maison Lula, c’est fini - ou en Uruguay, sa plus grande victoire fut sans conteste l’accession au pouvoir à Caracas du colonel de parachutistes Hugo Chavez et sa révolution « Bolivarienne ». (Si « El Libertador » Simon Bolivar revenait, il renierait de suite cette révolution de « bolchéviques en culottes courtes »!). Hélas pour Castro, le cancer comme la faillite économique vénézuélienne eurent raison de cette mascarade politique. Même si le Président Nicolas Maduro du Parti socialiste bolivarien se cramponne encore illégitimement au pouvoir c’en est fini, à terme, de cette chimérique révolution « historico-socialiste ». La mort de Fidel Castro, malgré les honneurs qui l’enseveliront bien plus que la terre cubaine, met un terme à la carrière de celui qui n’aura été qu’un mauvais génie pour son peuple. (Même si, reconnaissons-le, les domaines de la santé et de l’enseignement ont fait d’énormes progrès par rapport au régime précédent. Mais à quel prix !).Raul Castro est désormais seul, tout seul à la barre, avec les apparatchiks du parti communiste cubain. Avec ses 85 ans, Il n’est pas non plus un perdreau de l’année. Les quinquagénaires de l’appareil attendent, l’arme au pied. La levée de l’embargo qui donnerait de l’air à l’économie cubaine, sera-t-elle activée ? Manque de chances pour le régime, le pétrole vénézuélien va se faire rare ou trop cher, Poutine n’a peut-être plus les moyens ou l’envie de financer à bout de bras « l’ile-crocodile » des Caraïbes, et l’imprévisible milliardaire Donald Trump va s’installer la Maison Blanche. Il ne faudrait pas que notre jeunesse, influencée par un enseignement gauchiste et une presse de même acabit, garde de Fidel Castro l’image d’un libérateur, alors qu’il ne fut qu’un satrape jouisseur et sanguinaire. J’invite tous ceux qui en ont les moyens à aller voir sur place, en ne restant pas uniquement cantonnés dans les « HLM » des Tours opérateurs, pour la « bronzette »
1 - Le général Franco était d’origine galicienne.
2 - « La vie cachée de Fidel Castro » de J-C Sanchez (Michel Lafon, 2014)
dimanche 27 novembre 2016
Guerres du pétrole: tout a commencé en Irak en 1916
Tous ceux qui suivent la situation en Irak doivent absolument se procurer « 1916 en Mésopotamie » de Fabrice Monnier, qui vient de paraître aux Editions du CNRS.
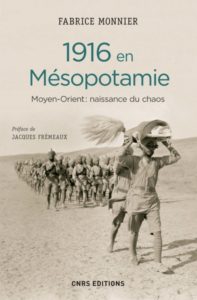 Ils apprendront – s’ils ne le savaient pas – que dans l’Empire ottoman, qui s’effondrait, les musulmans ne se laissaient pas envahir facilement par les grandes puissances, les « kouffars » comme ils les appelaient déjà. Ils étaient capables, ne serait-ce que par obligation religieuse – sunnite ou chiite – ou pour l’honneur, de leur résister courageusement, voire de les battre à plate couture.
Ils apprendront – s’ils ne le savaient pas – que dans l’Empire ottoman, qui s’effondrait, les musulmans ne se laissaient pas envahir facilement par les grandes puissances, les « kouffars » comme ils les appelaient déjà. Ils étaient capables, ne serait-ce que par obligation religieuse – sunnite ou chiite – ou pour l’honneur, de leur résister courageusement, voire de les battre à plate couture.
La « Force D », expédition militaire venue des Indes britanniques – débarquée à Fao en 1914, près de Bassora– l’a appris à ses dépens en avril 1916 : 18 000 morts rien qu’à la bataille de Kut al-Amara et 9 500 prisonniers emmenés en Turquie dont beaucoup ne revinrent jamais.
L’ouvrage de Fabrice Monnier, passionnant, se lit comme un roman historique. Il m’a tenu en haleine de bout en bout, notamment avec son récit du siège de Kut et de la reddition du général Charles Townshend qui croyait conquérir Bagdad sans difficulté. Ce n’est pas l’impréparation des militaires britanniques chargés d’occuper la Mésopotamie – appelée, selon eux, à être peuplée avec des paysans indiens – qui m’a sidéré le plus, mais l’arrogance et le mépris des officiers anglais pour les forces armées ottomanes, les tribus arabes, et même pour leurs propres « harkis » indiens. A croire que l’armée de Sa Majesté ne venait pas de subir une cuisante défaite face à la Turquie dans le détroit des Dardanelles…
Tandis que la Première guerre mondiale faisait rage en Europe, à Londres il n’était pas seulement question d’empêcher le Kaiser Guillaume II de contrôler la route des Indes. On y parlait déjà d’Or noir. Certes, il fallait protéger la raffinerie de l’Anglo-Persian Oil Company d’Abadan (Iran) qui approvisionnait la marine britannique en mazout mais, au-delà, il s’agissait de s’emparer d’une région connue de quelques spécialistes – et de l’Intelligence service – pour être gorgée de pétrole.
A cette fin, et pour effacer l’humiliante défaite de Kut al-Amara – quasiment passée sous silence dans la presse londonienne -, les Britanniques durent envoyer en Irak un corps expéditionnaire de 100 000 hommes, 176 canons et des avions leur assurant la supériorité dans les airs. Commandés par le général Frederick Maude, les Britanniques prirent Bagdad le 11 mars 1917. Mossoul qui résistait ne sera occupée que le 10 novembre 1918, sans respect pour l’armistice conclu avec les Turcs à Moudros dix jours plus tôt.
« Cent ans plus tard, les conséquences de cette guerre », écrit Fabrice Monnier, « les promesses non tenues et des humiliations infligées se font toujours sentir dans un Moyen-Orient où on a la mémoire longue».
Elles sont de toute évidence avec les deux guerres du Golfe, l’embargo international et plus d’un million de victimes civiles, à l’origine du chaos irakien actuel.
Les Américains – Bush père et surtout fils – n’ont tiré aucun enseignement de l’occupation de l’Irak par les Britanniques. Les résistances irakiennes sunnites et chiites – avec l’Armée du Mahdi et le Hezbollah irakien– les ont contraints à rappeler leur corps expéditionnaire. Un Etat islamique (EI) remettant en cause les accords Sykes-Picot a aussitôt émergé dans les provinces majoritairement sunnites d’Al-Anbar et de Ninive. Ce qu’il représente ne disparaîtra pas après sa défaite à Mossoul, loin de là. La partition de facto du pays en entités plus ou moins autonomes semble maintenant en cours. Il va s’en dire qu’elles ne demeureront pas longtemps en paix.
Mais en attendant cet éventuel redécoupage, ce sont les déclarations de campagne de Donald Trump – nouveau président des Etats-Unis – qui inquiètent. Elles ne laissent présager rien de bon dans la région, puisqu’il considère que les Américains ont le droit de s’emparer des champs de pétrole irakiens pour se rembourser des dépenses occasionnées par la guerre contre le terrorisme (terrorisme qu’ils ont eux-mêmes provoqué !). C’est plus facile à dire qu’à faire. Comme disent les anglo-saxons : Wait and see…
Présentation de l’ouvrage par son auteur (vidéo – 2’47):
samedi 26 novembre 2016
Découverte archéologique au fond de la mer Noire
Des chercheurs bulgares et de l’université de Southampton (Royaume-Uni), qui avaient pour mission de cartographier les fonds de la mer Noire, sont tombés nez à nez avec un cimetière de 41 épaves situé à 1 800 mètres de profondeur au large de la Bulgarie. « Du jamais vu en archéologie », selon Rodrigo Pacheco-Ruiz, membre de l’expédition Black Sea Maritime Archaeology Project. Les archéologues effectuaient leurs observations avec notamment deux bathyscaphes, des sous-marins téléguidés, quand ils ont découvert cette nécropole maritime. Dans un état de conservation exceptionnel, les vaisseaux fantômes dateraient de l’empire byzantin (de 330 à 1453) à l’empire ottoman (de 1299 à 1923).
Les images prises en haute résolution par les robots laissent distinguer des gouvernails, des cordes, des décorations élaborées presque intactes et même un mât toujours levé. Selon les scientifiques, tout ce qui sera découvert dans ou à proximité des épaves devrait être dans un état de parfaite conservation notamment grâce à l’eau des fleuves d’Europe de l’Est qui empêchent l’oxygène de passer et de détruire les épaves ou de détériorer les tissus.
« On pourrait retrouver des livres, des parchemins, des documents. Qui peut savoir tout ce qu’ils transportaient ? », a confié au Brendan P. Foley, archéologue rattaché à la Wood Hole Oceanographic Institution de Cape Cod (États-Unis). « On peut s’attendre à trouver des éléments très intéressants pour notre compréhension du fonctionnement des anciennes routes commerciales », a affirmé, de son côté, Shelley Wachsmann de l’institut d’archéologie nautique à la Texas A & M University. Certains experts avancent d’ailleurs l’hypothèse que la plupart de ces embarcations n’étaient pas des vaisseaux de guerre mais des navires commerciaux qui auraient été victimes de fortunes de mer en raison des intempéries.

vendredi 25 novembre 2016
L’Ours et le Mandarin: le “partenariat stratégique” sino-russe au crible de l’Histoire
Galvanisée par la dégradation progressive de ses relations avec l’Occident à la suite de son action en Ukraine et en Syrie, la Russie de Vladimir Poutine a toujours voulu voir en la Chine un partenaire “alternatif” sur lequel elle pourrait s’appuyer, à la fois sur les plans économique et international. Cette ambition se heurte toutefois très souvent à la réalité des objectifs de Pékin, dont les dirigeants n’ont jamais été particulièrement enthousiasmés par le concept d’un bloc anti-occidental au sens strict du terme. Les notions de “partenariat stratégique” ou même d’“alliance”, si elles sont devenues très à la mode dans les dîners mondains, ne recouvrent donc que très imparfaitement la logique du fait sino-russe.
Nous vous proposons cette analyse des relations sino-russes en deux parties, voici la première.
« Nous ne sommes ni de l’Orient, ni de l’Occident », concluait sur un ton particulièrement pessimiste le philosophe russe Tchaadaïev dans l’une de ses plus célèbres Lettres philosophiques. Principal précurseur du bouillonnement intellectuel de la Russie impériale de la seconde moitié du XIXesiècle, celui-ci fut l’un des premiers à théoriser l’idée d’une spécificité russe qui justifierait le fait qu’elle n’ait d’autre choix que de s’appuyer sur deux “béquilles”, dont l’une serait occidentale et l’autre orientale. Comme si le génie politique et industriel de l’Europe ne pouvait qu’être associé avec la créativité et la rationalité organisatrice de la Chine, qui partageait déjà avec la Russie la problématique de l’immensité du territoire et de sa bonne administration. Peine perdue pour Tchaadaïev, qui considérait que nul espoir n’était permis tant que le pays resterait engoncé dans l’archaïsme des tsars indignes de l’œuvre de Pierre le Grand, alors même que la Russie ne connaissait pas encore la violence anarchiste qui marquera la seconde moitié du XIXe siècle. Dans Apologie d’un fou, publié en 1837, il écrit et se désole : « Situés entre les deux grandes divisions du monde, entre l’Orient et l’Occident, nous appuyant d’un coude sur la Chine et de l’autre sur l’Allemagne, nous devrions réunir en nous les deux grands principes de la nature intelligente, l’imagination et la raison, et joindre dans notre civilisation les histoires du globe entier. Ce n’est point-là le rôle que la Providence nous a départi. »
De manière générale, la prophétie de Tchaadaïev s’est confirmée. L’équilibre qu’il appelait de ses vœux n’a jamais pu être trouvé, en particulier dans les relations de la Russie avec la Chine. Lorsque l’on “efface” le relief donné par la perspective historique, on a en effet tendance à voir dominer l’image d’un rapprochement constant et inexorable entre Moscou et Pékin, dont l’alliance servirait de contrepoids dans un monde dominé par la vision occidentale des relations internationales. Cette impression s’est particulièrement renforcée avec le discours de Vladimir Poutine donné à la 43e conférence de la sécurité de Munich en 2007, où ce dernier fustigea l’unilatéralisme qui avait présidé au déclenchement de la guerre en Irak en 2003 ainsi que le projet de bouclier antimissile prévu par l’Otan en Europe orientale. Ce serait toutefois négliger le fait que le premier mandat du président russe (2000-2004) fut marqué par un mouvement marqué d’affinité avec l’Occident, à tel point qu’il fut l’un des premiers à contacter George W. Bush à la suite du 11 septembre 2001 pour l’assurer de son soutien. Ce serait aussi oublier hâtivement que la relation sino-russe fut dominée pendant cinq siècles par l’importance des litiges territoriaux et que la Guerre froide fut pour les deux pays un théâtre d’affrontement pour le leadership du camp socialiste, ce qui annihila toute perspective d’un bloc unifié.
Cinq siècles de conflictualité
Si elles semblent très éloignées de par la langue et la culture, la Russie et la Chine ont toutefois toujours eu en commun de partager une réalité géographique similaire, dont l’immensité du territoire est la pierre angulaire. Une proximité également traduite dans les institutions, le modèle impérial historiquement développé par les deux pays ayant constitué un facteur favorable à une tradition administrative très fortement centralisatrice. Il y a aussi la question de la diaspora, particulièrement prégnante pour Moscou comme pour Pékin, avec 25 millions de Russes en dehors des frontières – principalement dans les anciens États de l’Union soviétique – et 20 millions de Chinois sur la seule île de Taïwan. Des nationaux “du dehors” souvent considérés comme des compatriotes perdus qu’il conviendrait a minima de protéger, et au mieux de faire revenir dans l’escarcelle nationale. Il y a enfin cette immense frontière commune de 4250 km qui s’étend de la Mongolie jusqu’aux rives de l’océan Pacifique, et dont la définition exacte n’a, jusqu’à récemment, jamais été arrêtée.
Les premiers contacts diplomatiques entre les deux pays sont traditionnellement datés de la délégation envoyée par la Chine au tsar Michel en 1618. Si le traité de Nertchinsk de 1689 abordera pour la première fois la question des litiges territoriaux avec le tracé d’une première frontière, la relation entre les deux pays n’en restera pas moins toujours teintée de méfiance. La question territoriale gagnera en importance dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, quand le Premier ministre Piotr Stolypine lancera un vaste plan de modernisation de l’Extrême-Orient russe. Entre 1906 et 1913, plus de 3,5 millions de paysans russes traverseront l’Oural pour s’installer dans les terres inhospitalières de la Sibérie orientale, dont certaines parties attirent grandement la convoitise de Pékin.
Mais le véritable rapprochement entre les deux pays ne s’imposera qu’à la faveur de la proximité idéologique offerte par les effets conjugués de la révolution russe d’octobre 1917 et de la prise de pouvoir du Parti communiste chinois (PCC) emmené par la figure emblématique de Mao Zedong en 1949. Le 14 février 1950, un premier traité d’amitié, d’alliance et d’assistance mutuelle est signé entre les deux États. L’URSS de Staline, auréolée de l’immense prestige de sa victoire sur l’Allemagne nazie en 1945 et forte d’un important savoir-faire en matière industrielle, envoie dans ce cadre plus de 10 000 ingénieurs en Chine afin de former le personnel local. Malgré la divergence fondamentale avec les conceptions économiques de Mao Zedong, qui privilégiait le développement agraire massif et pas l’industrie lourde, cette coopération se poursuit jusqu’au milieu des années 1950. Portée par l’espoir de Moscou de pouvoir constituer avec la Chine un grand bloc socialiste qui lui permettrait de peser de manière plus importante sur les affaires internationales, cette politique se heurte toutefois à la dégradation progressive des relations entre les deux pays. Ces discordances croissantes sont, en grande partie, liées au refus de Nikita Khrouchtchev de transférer la technologie nucléaire au régime chinois, à la publication du rapport portant son nom sur les crimes du stalinisme et à son choix de dialoguer régulièrement avec Washington dans le cadre de la “coexistence pacifique”, une véritable hérésie conceptuelle pour un Mao Zedong resté très attaché à l’orthodoxie marxiste-léniniste.
La rupture est finalement consommée entre 1961 et 1962, notamment après une gestion de la crise des missiles de Cuba jugée calamiteuse par Pékin. Dans la conception maoïste, la Chine possédait une légitimité au moins équivalente à celle de l’URSS pour assurer le leadership du camp socialiste. C’est la raison pour laquelle le pays chercha à se détacher du grand-frère soviétique en dégageant une voie qui lui était spécifique. En ce sens, la Chine est incontestablement parvenue à certains résultats : obtention de l’arme nucléaire en 1964, reconnaissance par la France la même année et admission au Conseil de sécurité de l’Onu en 1971, en lieu et place de Taïwan. Elle développe dans ce cadre la doctrine du “tiers-mondisme” afin de concurrencer Moscou dans le soutien aux États attirés par l’idéologie marxiste, politique dont Pékin tirera bien peu de fruits puisque seule l’Albanie d’Enver Hoxha finira par s’y rallier à la faveur de la rupture avec l’Union soviétique en 1961.
Un pic de tension avec l’URSS est atteint en 1969, lorsque l’Armée rouge et l’Armée populaire de libération s’affrontent à l’occasion de plusieurs escarmouches aux abords du fleuve Amour, sur l’affluent de l’Oussouri. Si l’enjeu tient dans le contrôle de l’île de Damanski (Zhenbao en mandarin), ces incidents illustrent principalement le problème plus large des différends frontaliers entre les deux pays, abordés plusieurs fois par la voie des traités, mais jamais véritablement réglés et toujours présents à l’esprit des deux parties.
Seule la mort de Mao Zedong en 1976, qui entraînera en Chine un certain recul de l’impératif de “pureté marxiste”, permettra d’engager un premier rapprochement. Son successeur, Deng Xiaoping, a longtemps été considéré comme un acteur majeur de la réconciliation sino-soviétique, dans un contexte où le traité d’amitié signé en 1950 était sur le point d’expirer (en 1979). Mais le Deng Xiaoping “réconciliateur” des années 1980 fut aussin aux côtés de Mao, l’un des plus solides partisans de la “ligne dure” face au révisionnisme soviétique initié par Khrouchtchev. Il définira même, en 1979, l’URSS comme « l’adversaire le plus résolu de la République populaire de Chine », avant même les États-Unis. Deng Xiaoping posa donc trois préalables au rapprochement avec Moscou : le retrait des divisions de l’Armée rouge encore stationnées en Mongolie, l’arrêt du soutien soviétique aux opérations militaires que le Vietnam menait au Cambodge depuis 1977 et le démantèlement de toutes les bases militaires situées dans les pays avoisinants la Chine. S’il s’éloigna radicalement du maximalisme de Mao Zedong, il prouva en revanche que la logique de blocs ou le suivisme idéologique n’avaient rien d’automatique dans un contexte où l’URSS redoublait d’activité sur la scène internationale. L’invasion de l’Afghanistan initiée en 1979 par la Russie a d’ailleurs mis fin à ces premières négociations. Cette situation n’a guère connu d’amélioration dans une Union soviétique minée par des difficultés économiques structurelles et une forte instabilité politique interne, avec une première moitié des années 1980 où se succèdent pas moins de quatre dirigeants différents (Brejnev, Andropov, Tchernenko et Gorbatchev). Seul le retrait partiel d’Afghanistan, initié en 1986, permettra d’ouvrir la voie à ce qui constitue le véritable tournant du rapprochement sino-russe : la “parenthèse Eltsine” dans les années 1990.
D’un partenariat constructif à une alliance stratégique
Paradoxalement, la chute de l’URSS en 1991 et l’émergence d’une Fédération de Russie la même année ne constituent pas – du moins dans un premier temps – un facteur de rapprochement avec la Chine. Dans son choix d’une rupture radicale avec un passé soviétique dont le deuil ne sera jamais véritablement fait par la population russe, Boris Eltsine s’appuie sur de jeunes cadres formés dans les années 1980. C’est par exemple le cas de Boris Nemtsov, dont l’assassinat à Moscou le 25 février 2015 a fait grand bruit, en Russie comme dans les médias occidentaux. Sous le patronage du Ministre de l’économie Iegor Gaïdar, ces nouveaux cadres résolument libéraux conduisent la Russie à opérer dans un premier temps un certain alignement sur la politique de l’Union européenne et des États-Unis, dans la continuité des choix effectués par Mikhaïl Gorbatchev pendant la Guerre du Golfe. Autant d’éléments qui ne laisseront qu’une place limitée à une politique ambitieuse de rapprochement avec la Chine, alors que celle-ci cherchait dans le même temps à améliorer ses relations avec Washington, considérablement dégradées par la question latente de Taïwan et la répression des manifestations de la place Tian’anmen en 1989.
Il est assez coutumier de désigner Vladimir Poutine, arrivé au pouvoir en 2000 mais dont l’ascension a été permise par Boris Eltsine, comme l’artisan fondateur du repositionnement russe dans la politique internationale, et en particulier du rapprochement avec la Chine. Il serait toutefois plus juste d’attribuer ce rôle au Ministre des affaires étrangères nommé par Eltsine en 1996, Evgueni Primakov. Brillant arabisant et ancien officier des services de renseignement soviétiques, il se distingua par une saille restée célèbre dans le pays : « la Russie doit marcher sur ses deux jambes ». Il s’agissait déjà d’une référence – massivement réutilisée par la suite par Vladimir Poutine – au positionnement central occupé par la Russie dans l’espace eurasiatique, mais aussi à cette “particularité” chère à Tchaadaïev et dont elle devrait user afin de poursuivre la voie qui est la sienne. Le rapprochement avec Pékin apparaissait alors comme une évidence dans un contexte où l’économie russe était minée par le choc brutal des privatisations impulsées par Iegor Gaïdar, tandis que le gouvernement et les autorités militaires subissaient l’humiliation de leur défaite dans la Première guerre de Tchétchénie.
Du côté chinois, le nouveau président Jiang Zeming cherchait quant à lui à construire pour la Chine une stature à sa mesure sur le plan international, alors que le pays se trouvait encore sous le coup de plusieurs sanctions européennes et américaines en réponse aux évènements de la place Tian’anmen. Sur le plan régional, les autorités chinoises se trouvaient de plus en plus préoccupées par le “pivot Pacifique” engagé par les États-Unis au milieu des années 1990, et qui avait conduit Washington à intervenir militairement dans la crise de Taïwan en 1995 ou encore à se rapprocher de son allié japonais.
Pour les deux pays, les conditions du rapprochement étaient donc assez largement réunies, ce qui aboutira à la signature par Boris Eltsine et Jiang Zeming d’un premier partenariat en avril 1996. Il est d’ailleurs très intéressant d’observer le subtil changement sémantique opéré par la diplomatie russe dans la définition de sa relation avec Pékin : qualifié dans la première moitié des années 1990 de « partenariat constructif » (« konstrouktivnoyé partnerstvo »), le lien avec la Chine est désormais défini comme un « partenariat stratégique » (« strategitcheskoyé partnerstvo »), une formule nettement plus offensive proposée par Evgueni Primakov, qui s’inscrit dans une certaine stratégie de communication vis-à-vis des autres partenaires de la Russie. Ce qui commence déjà à prédominer, c’est bien la nécessité d’une certaine convergence pratique dans la gestion des relations internationales, ce qui sera confirmé par la déclaration conjointe sino-russe de 1997, conçue pour compléter le partenariat de 1996. On y retrouve avec intérêt tous les éléments de langage qui sont encore aujourd’hui utilisés par Pékin et Moscou dans leur traitement des affaires internationales : « nécessité d’un monde multipolaire », « refus de l’hégémonie », « primauté du droit et de la coopération entre les peuples », « non-intervention et respect de la souveraineté nationale »… La “multipolarité” en particulier est ainsi transformée en un quasi-slogan de principe pour Moscou, qui y voyait un concept efficace pour contester la prééminence américaine dans la limite des moyens dont disposait le Kremlin dans les années 1990.
La gestion du dossier particulièrement complexe de la Yougoslavie ne fait qu’accentuer ce sentiment de dépossession et d’impuissance. La Russie se révèle incapable de soutenir son alliée serbe en empêchant une intervention militaire de l’Otan au Kosovo entre mars 1998 et juin 1999. Pékin comme Moscou adopteront par ailleurs une position similaire sur le dossier, l’action de l’Alliance atlantique en Serbie étant perçue comme une atteinte au principe de souveraineté nationale orchestrée avec un contournement du système décisionnel du Conseil de Sécurité de l’Onu – l’opération fut effectivement déclenchée sans mandat. Même à quinze ans d’intervalle, le précédent du Kosovo continue de résonner – à tort ou à raison – pour Pékin et Moscou comme la preuve indéniable que le système de concertation offert par l’Onu est vicié dans son principe même.
Cette idée justifie un rapprochement des deux capitales sur des questions plus sensibles liées à la sécurité régionale et internationale, déjà engagée par la réunion des “Shanghai Five” en 1996 (Chine, Russie, Kirghizstan, Kazakhstan, Tadjikistan). Même l’institution militaire russe, encore très imprégnée par un personnel majoritairement issu de l’establishment soviétique et très conservatrice vis-à-vis du secret industriel, accepte des transferts de technologies militaires de plus en plus nombreux en direction de Pékin. Ce choix ne fut d’ailleurs pas uniquement pris pour des raisons purement politiques : il a été rendu impérativement nécessaire par le délitement complet du complexe militaro-industriel russe et par la perte de ses principaux clients en Europe centrale et orientale (Allemagne de l’Est, Hongrie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, Pologne, etc.). La Chine s’est alors rapidement imposée comme un débouché naturel, en particulier pour une industrie de l’armement dont le revenu reposait à 80 % sur les recettes des exportations d’armes.
À l’échelle de l’histoire longue, le rapprochement sino-russe pourrait donc être considéré comme un épiphénomène, particulièrement lorsque l’on sait l’importance des litiges territoriaux qui ont régulièrement empoisonné les relations entre les deux pays, de même que leur lutte acharnée pour l’hégémonie sur le camp socialiste durant la Guerre froide. La rapidité de l’évolution du monde après la chute de l’empire soviétique – que presque aucune âme n’avait été capable de prédire – a favorisé un rapprochement devenu non pas naturel, mais légitime pour deux pays dont les intérêts géopolitiques et la conception antilibérale des relations internationales constituent, en apparence au moins, les deux piliers d’une relation potentiellement “stratégique”. La Russie de Vladimir Poutine, très largement enfantée par celle de Boris Eltsine, exploitera ainsi cet héritage et tentera – avec un succès parfois assez largement contestable – d’en faire un des principaux vecteurs de son “retour” sur la scène internationale.
Par Combeferre
Nos Desserts :
- L’importance historique des “traités inégaux » dans la relation de la Chine à la Russie
- Comprendre pourquoi et comment l’Otan ne prépare pas la paix avec la Russie avec Le Monde diplomatique
- Le rapprochement sino-russe vu par Le Monde
- La rupture de l’Albanie avec l’Union soviétique a été magnifiquement contée dans le roman d’Ismaïl Kadaré, L’Hiver de la grande solitude
Libellés :
Chine,
l'Orient,
Russie,
XVIIe siècle,
Yougoslavie
Inscription à :
Articles (Atom)

