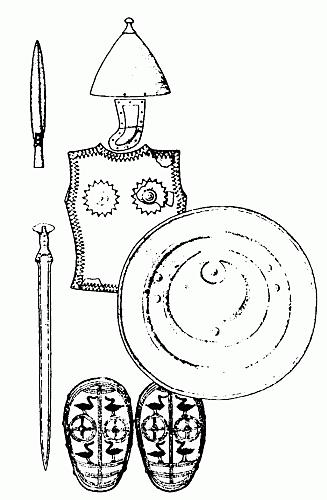Stimuler le sens de l'identité nationale et de la patrie
Cependant, Rousseau réalise aussi qu'à la différence du corps humain, l'unité du corps politique reste toujours précaire, car les intérêts particuliers menacent constamment de prévaloir sur le bien commun. La société, selon lui, est un moi collectif qui doit s'instituer politiquement pour se doter d'une âme commune. L'harmonie sociale ne peut donc résulter que de la mise en œuvre d'une volonté politique veillant à toujours stimuler le sens de l'identité nationale et de la patrie, ainsi que c'était le cas dans la cité antique. C'est la tâche qui revient au Législateur, à l'exemple de Lycurgue, de Solon ou de Numa. Le Législateur ne doit pas être vu comme un démiurge, mais comme chargé d'exprimer la nature sociale des hommes en les transformant en « vertueux patriotes », c'est-à-dire en les aidant à reconnaître leurs intérêts partagés. Instituer le citoyen, c'est se préoccuper des conditions de formation du patriotisme, c'est-à-dire de la suprématie de la volonté générale sur les intérêts égoïstes. Pour édifier une « âme nationale », il faut une éducation publique qui apprenne au citoyen ce qu'est son pays, son histoire et ses lois, et qui les lui fasse aimer au point qu'il se tienne toujours prêt à défendre sa terre, son peuple et sa patrie. On a parfois accusé Rousseau de professer un subjectivisme de la volonté, de situer l'essence de l'homme dans la volonté, celle-ci étant du même coup placée au-dessus de toute loi morale (c'était l'interprétation de Hegel). Cependant, pour Rousseau, la loi naturelle reste une autorité supérieure à la volonté individuelle comme à celle de l'Etat. C'est ce qui explique ses positions en matière de religion.
Le christianisme, on l'a vu, dissocie pouvoir temporel et pouvoir spirituel, ce qui veut dire qu'il instaure un pouvoir religieux distinct et rival du pouvoir politique. Rousseau constate qu'il en a résulté un « perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politie impossible dans les Etats chrétiens »(30). Il n'en allait pas de même, observe-t-il aussi, dans l'ancienne religion polythéiste, car celle-ci n'était pas « exclusive » : les dieux s'y cumulaient au lieu de s'exclure les uns les autres, ce qui rendait impossible les guerres de religion. « La division entre le chrétien et le citoyen, commente Pierre Manent, est devenue la division entre l'individu et le membre de la société, l'homme social. Le conflit entre le chrétien et le citoyen est devenu le conflit entre l'individu et la société »(31). Un chrétien, en effet, peut être relativement indifférent au bien de l'Etat, car il vit son existence sur le seul mode de la foi, en fonction de son salut dans l'autre monde. « L'amour du chrétien est d'emblée universel, sans faire l'objet d'une généralisation progressive, écrit lui aussi Florent Guénard. Il ne peut, par conséquent, former communauté »(32).
Rousseau ne pense pourtant pas que la solution à cette rivalité entre les princes et les Eglises, le pouvoir-temporel et le pouvoir spirituel, consiste à se débarrasser de la religion. A la façon de Machiavel, qui insistait déjà sur l'importance de la religion comme facteur de cohésion sociale, il en tient tout au contraire pour une « religion civile » qui permettrait d'assurer le primat de la volonté générale sur les intérêts particuliers et contribuerait, elle aussi, à ancrer le citoyen dans sa politie. La nécessaire autonomie du politique n'implique donc pas chez lui la mise à l'écart du religieux. C'est ce qu'il explique longuement au chapitre 8 du livre IV du Contrat social (« De la religion civile »), mais aussi dans ses textes sur la Pologne et la Corse. Les citoyens seront d'autant plus patriotes qu'ils auront été formés à regarder la patrie comme l'objet d'un culte.
L'athéisme, un danger pour le corps social
Les commentateurs ont toujours été très partagés sur ce que Rousseau entend par « religion civile », les uns y voyant l'institution d'une sorte de théisme d'Etat, les autres un simple moyen de mettre la religion au service du politique (c'est l'hypothèse la plus souvent retenue) ou encore de neutraliser politiquement les effets délétères d'un « fanatisme » qui a pris historiquement la forme de la « religion du prêtre », d'autres enfin la volonté de reconnaître que la religion est une « force agissante » dont on ne saurait se passer. Ce qui est certain, c'est que Rousseau, lorsqu'il parle d'instaurer une religion du citoyen, ne plaide nullement pour une « Eglise nationale » dans l'esprit du gallicanisme ou de l'Eglise anglicane, formule qui le séduit mais qu'il juge désormais irréaliste. Ce qu'il pense plutôt, c'est qu'on ne saurait faire l'économie d'une « religion civile » dans la mesure même où la raison ne peut se passer du renfort de la passion pour faire émerger la vertu. La religion motive, et elle peut aussi motiver le patriotisme. Pour Rousseau, la croyance en une vie après la mort est requise pour la vertu du citoyen aucun Etat ne pourrait demander à ses citoyens de sacrifier leur vie pour défendre leur patrie s'ils n'avaient foi en une vie à venir. C'est pourquoi il déclare voir dans l'athéisme un véritable danger pour le corps social. Dans la version primitive du Contrat social, il écrivait même « Sitôt que les hommes vivent en société il leur faut une religion qui les y maintienne. Jamais peuple n'a subsisté ni ne subsistera sans religion et si on ne lui en donnait point, de lui-même il s'en ferait une ou serait bientôt détruit ».
Nous avons ici essayé de résumer à grands traits les vues de Jean-Jacques Rousseau, en insistant sur certaines des déformations ou incompréhensions dont elles ont souvent fait l'objet. Il ne fait pas de doute que la limite de la pensée de Rousseau tient dans son effort de recréer une société holiste sur des fondements individualistes(33). Vouloir fonder une communauté holiste sur des fondements individualistes achoppe en effet sur cette aporie évidente, bien relevée par Pierre Manent, qu'il est difficile de faire reposer une légitimité sociale sur l'indépendance ou l'autonomie de l'individu, c'est-à-dire sur le principe le plus asocial qui soit(34). Rousseau n'en demeure pas moins l'un des penseurs politiques les plus importants des temps modernes. Un penseur dont, sur bien des points, l'œuvre est d'une étonnante actualité.
notes :
1). Du contrat social, O.C., vol. 3, p. 351
2). Pierre Manent, « Rousseau critique du libéralisme », in Histoire intellectuelle du libéralisme. Dix leçons, 3). Hachette-Pluriel, Paris 1987 pp. 146-147
4). Discours sur l'inégalité, O.C., vol. 3.
5). Ibid., op. cit., p. 219.
6). Il est, écrit Rousseau, un « sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation et qui, dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu » (Discours sur l'inégalité, op. cit., p. 219).
7). Du contrat social, op. cit., p. 355. 7 Cf. Discours sur l'inégalité, p. 207
8). Emile, O.C., vol. 4, p. 600.
9). Fragments politiques, O.C, vol. 3, p. 477
10). Second discours sur l'origine de l'inégalité, O.C., vol. 3, p. 142.
11). Du contrat social, op. cit., p. 381
12). Sur l'économie politique, O.C., vol. 3, p. 259.
13). Benjamin Barber Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley 1984, p. 216.
14). Karl Polanyi, Essais, Seuil, Paris 2008, p. 534.
15). Ibid., pp. 529 et 537
16). Du contrat social, op. cit., p. 395. 17
17). Ibid., p. 379.
18). Carl Schmitt, Théorie de la Constitution [1928], PUF Paris 2008, pp. 415-416.
19). Cf. Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, 2e éd., J. Vrin, Paris 1995.
20). Op. cit., p. 430. Rousseau reproche aussi aux Anglais d'avoir adopté les nouvelles idées économiques qui donnent à l'expansion du commerce une place essentielle, et de s'être lancés à la conquête du monde mus par l'appât du gain, ce qui ne manquera pas de les conduire à la servitude, car les conquêtes coûtent plus qu'elles ne rapportent : « Les Anglais veulent être conquérants donc ils ne tarderont pas d'être esclaves ».
21 Ibid., pp. 429-430.
22. Cf. Bruno Bemardi, Le principe d'obligation. Sur une aporie de la modernité politique, EHESS-Vrin, Paris 2007
23). Du contrat social, op. cit., p. 380.
24). Ibid., p. 363.
25). Ibid., p. 364.
26). Comme l'a écrit Jean Starobinski, « Rousseau, qui pensait à Lycurgue, ne préfigure pas Staline » (Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, 38, 1969-71 p. 309)!
27). Du contrat social, op. cit., p. 364.
28).Tel est le titre du chap. 8, livre III, du Contrat social.
29).Tite-Live situe cet épisode en 494 av. notre ère, quinze ans après la fondation de la République (Histoire romaine, Garnier-Flammarion, Paris, vol. 2, pp. 204 ff.).
30). Du contrat social, op. cit., p. 462.
31). Pierre Manent, « Rousseau critique du libéralisme », op. cit., p. 152.
32). Florent Guénard, « "Esprit social" et "choses du ciel" Religion et politique dans la pensée de Rousseau », in Ghislain Waterlot (éd.), La théologie politique de Rousseau, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2010, p. 29.
33). Cf. Louis Dumont, Essais sur l'individualisme, Seuil, Paris 1983.
34). Pierre Manent, Naissance de la politique moderne. Machiavel, Hobbes, Rousseau, Payot, Paris 1977 p. 11
Orientation bibliographique
Il existe une édition en cinq volumes des œuvres complètes de Rousseau dans la Pléiade. C'est aujourd'hui encore l'édition de référence. Mais elle ne comprend pas la correspondance. En ce tricentenaire, deux nouvelles éditions des œuvres complètes de Rousseau sont annoncées : l'une chez Garnier l'autre chez l'éditeur genevois Slatkine. La correspondance de Rousseau a été éditée par R. A Leigh (Voltaire Foundation, 1965-1998,52 volumes).
Choix de lettres : Jean-Jacques Rousseau en 78 lettres, un parcours intellectuel et humain, présentation de Raymond Trousson, Sulliver, 2010. La littérature critique sur Rousseau est immense. On retiendra
- Ernst Cassirer «Das Problem Jean-Jacques Rousseau», in Archlvfùr Geschichte der Philosophie, XLI, 1932, pp. 177-213 et 479-513, traduction anglaise The Question of Jean-Jacques Rousseau, Indiana University Press, Bloomington 1963.
- Bertrand de Jouvenel, Essai sur la politique de Rousseau, en préface au Contrat social de Rousseau, Editions du Cheval ailé, Genève 1947
- Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle, Pion, Paris 1958.
- Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, PUF Paris 1970.
- Alexis Philonenko, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur, 3 vol., Vrin, Paris 1984.
- Alain Besançon, « Lecture de Julie ou la Nouvelle Héloïse », Commentaire, 131 automne 2010, texte repris in Cinq personnages en quête d'amour. Amour et religion, Editions de Fallois, Paris 2010.
- Raymond Trousson, Jean-Jacques Rousseau, Gallimard, coll. Folio Biographies, Paris 2011
- Une heure avec Rousseau, sous la dir d'Yves Bordet, Xenia, Vevey 2012.
E.W
Alain de Benoist éléments N°143 Avril-Juin 2008

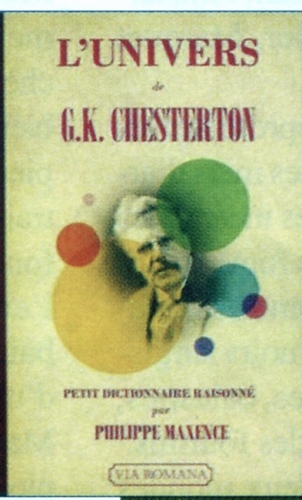 Rencontre avec Philippe Maxence, auteur de L'Univers de G.K. Chesterton.
Rencontre avec Philippe Maxence, auteur de L'Univers de G.K. Chesterton.
 « Il conviendra de refouler impitoyablement tout étranger qui cherchera à s'introduire sans passeport ou titre de transport valable » Dérapage de Jean-Marie Le Pen ? Non, il s'agit d'une consigne donnée en 1937 par Marx Dormoy, ministre de l'Intérieur du Front populaire.
« Il conviendra de refouler impitoyablement tout étranger qui cherchera à s'introduire sans passeport ou titre de transport valable » Dérapage de Jean-Marie Le Pen ? Non, il s'agit d'une consigne donnée en 1937 par Marx Dormoy, ministre de l'Intérieur du Front populaire. Depuis l'âge romantique, le personnage de Louis XIII est malmené tant dans l'historiographie que dans la littérature en général. Pourtant, ces quinze dernières années, l'ancien roi de France est l'objet d'une réhabilitation indirecte. On pense notamment à l'excellent livre de Françoise Hildesheimer consacré au cardinal de Richelieu (Flammarion). Cependant, jusqu'à présent, aucune biographie consacrée au fils d'Henri IV et père de Louis XIV avait fait le point sur cette réhabilitation.
Depuis l'âge romantique, le personnage de Louis XIII est malmené tant dans l'historiographie que dans la littérature en général. Pourtant, ces quinze dernières années, l'ancien roi de France est l'objet d'une réhabilitation indirecte. On pense notamment à l'excellent livre de Françoise Hildesheimer consacré au cardinal de Richelieu (Flammarion). Cependant, jusqu'à présent, aucune biographie consacrée au fils d'Henri IV et père de Louis XIV avait fait le point sur cette réhabilitation. La bande dessinée fut longtemps une activité méprisée. Il fallut donc à René Goscinny un talent hors du commun pour imposer son œuvre dans l'imaginaire collectif des Français et de bien d'autres peuples. René Goscinny est né en 1926 à Paris. Ses parents n'ont été naturalisés Français que très peu de temps avant sa naissance. Il appartient en effet à une famille juive, originaire de l'Europe orientale et plutôt bourgeoise. Sur le plan philosophique, la famille est profondément laïque et le père de René sera même franc-maçon. En 1928, les parents et leurs deux fils, Claude et René, partent pour l'Argentine, où René passera toute sa jeunesse. Cependant, il n'y aura pas de rupture avec la culture française, car il fera toutes ses études au collège français de Buenos Aires. Il s'y révélera bon élève et obtiendra son baccalauréat en 1943. Il est alors fasciné par la bande dessinée encore balbutiante et par la littérature humoristique. A la suite du décès de son père en 1943, il doit travailler comme comptable, mais ne brille guère dans ces fonctions bien éloignées de ses préoccupations et de sa grande culture. En 1945, il quitte l'Argentine pour les Etats-Unis, où vit un de ses oncles. Sa mère et lui habitent New York et exercent divers petits emplois. Son service militaire, effectué à Aubagne, lui permet de renouer avec la France durant l'année 1946-1947
La bande dessinée fut longtemps une activité méprisée. Il fallut donc à René Goscinny un talent hors du commun pour imposer son œuvre dans l'imaginaire collectif des Français et de bien d'autres peuples. René Goscinny est né en 1926 à Paris. Ses parents n'ont été naturalisés Français que très peu de temps avant sa naissance. Il appartient en effet à une famille juive, originaire de l'Europe orientale et plutôt bourgeoise. Sur le plan philosophique, la famille est profondément laïque et le père de René sera même franc-maçon. En 1928, les parents et leurs deux fils, Claude et René, partent pour l'Argentine, où René passera toute sa jeunesse. Cependant, il n'y aura pas de rupture avec la culture française, car il fera toutes ses études au collège français de Buenos Aires. Il s'y révélera bon élève et obtiendra son baccalauréat en 1943. Il est alors fasciné par la bande dessinée encore balbutiante et par la littérature humoristique. A la suite du décès de son père en 1943, il doit travailler comme comptable, mais ne brille guère dans ces fonctions bien éloignées de ses préoccupations et de sa grande culture. En 1945, il quitte l'Argentine pour les Etats-Unis, où vit un de ses oncles. Sa mère et lui habitent New York et exercent divers petits emplois. Son service militaire, effectué à Aubagne, lui permet de renouer avec la France durant l'année 1946-1947