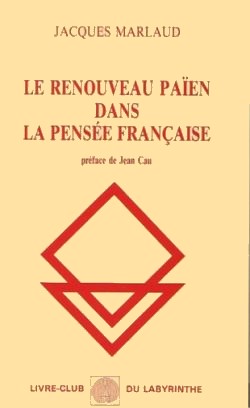« Mon père était un salaud » titrait en couverture Le Figaro Magazine
du 26 novembre dernier devant une photo de Himmler et plusieurs
articles étaient consacrés à des interviouves d’enfants de chefs nazis.
C’est dire à quel point, soixante ans après sa conclusion, la Seconde Guerre mondiale reste omniprésente en raison d’une campagne médiatique permanente et orientée qui a imprégné les mentalités et littéralement construit les mythes fondateurs de l’idéologie dominante, surtout, et de loin, dans notre pays ou sévit le « terrorisme intellectuel » si bien décrit par Jean Sévillia .
L’histoire de la guerre est interprétée et exposée suivant une grille de lecture convenue et constitue de la sorte une histoire officielle aux antipodes de la vérité, histoire qui se défend bec et ongles comme le rappelait à nos lecteurs le professeur François-Georges Dreyfus à propos de son excellente et objective Histoire de Vichy accueillie, comme il se doit, par le silence des grands médias (1).
Légende et vérité
Il n’en est que plus nécessaire, car c’est la mission de l’historien, de continuer les recherches et dégager cette vérité historique des voiles épais dont on la recouvre. C’est ainsi que notre ami Philippe Prévost vient de publier un ouvrage Le temps des compromis (*) où sont relatées les négociations entre Anglais et Allemands de mai à décembre 1940. Cette étude bat en brèche un certain nombre de légendes têtues comme celle de la détermination héroïque de la Grande-Bretagne unie derrière Churchill alors que la France faisait cavalier seul.
Comme l’exprime François-Georges Dreyfus dans sa préface, « la réalité est moins simple : elle est totalement différente ». Un clivage entre partisans de la guerre et partisans de la paix existait en effet dès avant la guerre en Grande-Bretagne comme en France.
C’est ainsi que Chamberlain, conscient de la fragilité de l’Empire britannique et de l’état d’impréparation du pays, craignait la guerre et ne pensait pas qu’elle fût ni désirable ni nécessaire. De son côté, Hitler ne désirait pas une guerre à l’ouest et signa le pacte du 23 août 1939 avec l’Union Soviétique pensant q’il dissuaderait les démocraties d’entrer en guerre et s’épargnerait, s’il le fallait, une guerre sur deux fronts, Staline, pour sa part, y voyant le moyen de déclencher enfin la guerre entre les puissances capitalistes.
Ce rappel explique les tentatives de compromis qu’expose avec talent Philippe Prévost, lesquelles furent entreprises, dès la défaite de la Pologne consommée, par Hitler qui ne désirait en aucune manière la guerre avec l’Angleterre et était convaincu qu’il arriverait à faire la paix avec elle.
« Parler avec M. Hitler... »
De son côté, lorsque la campagne de France fut pratiquement perdue fin mai 1940, Lord Halifax, secrétaire d’État au Foreign Office, pensait que la Grande-Bretagne n’avait aucune chance de vaincre par elle-même et qu’en l’absence des États-Unis, à part de bonnes paroles, « le moment était venu de parler avec M. Hitler ». L’historien John Charmley (2) ajoute à ce propos que si, en mai-juin 1940, Churchill avait tenté de faire la paix, une vaste partie de l’opinion aurait applaudi. Mais ce dernier, nommé Premier ministre à la suite d’un véritable complot (4), représentait le parti de la guerre et pensait que l’armée française retarderait les Allemands jusqu’à l’intervention prochaine, pensait-il, des États-Unis.
Les initiatives allemandes en vue d’une paix furent au contraire accueillies par Lord Halifax et son adjoint Richard Butler. Philippe Prévost nous donne un clair exposé de ce que furent ces tentatives de compromis bien que les archives anglaises sur cette question ne puissent encore être consultées.
Il faut avoir conscience que la situation à l’époque était pleine d’incertitudes pour les deux parties en cause : panique en Grande-Bretagne à la suite de la défaite française, angoisse en pensant à une invasion allemande possible et véritable paranoïa en ce qui concerne la flotte française encore que l’agression de Mers-el-Kébir obéît surtout à des motifs politiques. En fait, l’Angleterre dut son salut une fois de plus au bras de mer qui la séparait du continent et aux tergiversations de Hitler qui, certain de faire la paix avec l’Angleterre, n’avait pas préparé une opération complexe de débarquement.
C’est dans ce contexte que se déroulèrent, par intermédiaires, les conversations anglo-allemandes que relate Philippe Prévost avec un intéressant chapitre sur l’armistice norvégien accepté par les Anglais mais il est évident qu’un même armistice en France était tout différent puisqu’il privait l’Angleterre de son seul allié et de sa seule armée de terre.
Accord anglo-allemand ?
Le point d’orgue de cette période de recherche d’un accord fut la dramatique mission de Rudolf Hess en Écosse. Comme l’écrit fort justement Philippe Prévost, il est certain que Hitler n’aurait pas envoyé le numéro deux du régime en Grande-Bretagne s’il n’avait eu de solides raisons de penser que son offre de paix serait accueillie alors que lui-même était sur le point d’attaquer l’Union Soviétique. Mais les archives anglaises sur le détail de cet événement restent obstinément closes…
En fait, tant Churchill que Pétain avaient fondé leur politique sur l’entrée en guerre des États-Unis ; celle-ci se faisant attendre, le premier sera sauvé par l’invasion de l’Union Soviétique qu’il salua avec enthousiasme tandis que le Maréchal était confronté à une situation dramatique. Non seulement le gouvernement était aux prises avec d’innombrables problèmes internes tenant à remettre en ordre et en marche un pays aux 3/5 occupé par l’ennemi et à assurer l’existence de quarante millions de Français amputés de deux millions de prisonniers, mais se heurtant aussi aux contraintes de l’Occupant et de la Grande-Bretagne qui soumettait la France à un blocus maritime. Comme l’écrivait Churchill « nous devons maintenir les gens de Vichy coincés entre la meule allemande et la meule britannique » (3).
Dès le 15 juillet, les Allemands se repentant de leurs erreurs lors de l’Armistice et voyant les conversations avec les Anglais traîner en longueur, exigèrent des bases en Afrique du Nord, l’utilisation de ses ports et chemins de fer etc… Ces demandes, sèchement rejetées par le Maréchal, furent à l’origine d’une tension aiguë avec l’Allemagne qui fit même craindre une action militaire contre Vichy (le Maréchal décida qu’en pareil cas il resterait avec les Français et que c’est l’Amiral Darlan qui emporterait en Afrique les sceaux de l’État, scénario qui se produira à peu près en novembre 1942). En outre, le gouvernement était au courant et fort inquiet des conversations anglo-allemandes.
Inquiétudes à Vichy
Dans cette situation faite d’incertitudes et de craintes, on comprend que dès septembre 1940, le Maréchal fit demander un entretien à Hitler. Mais ce dernier ne donna aucune suite à cette demande et ce ne fut que le 22 octobre qu’il le fit à l’issue de son entretien avec Pierre Laval et dans l’optique de son rendez- vous d’Hendaye avec Franco en vue de l’opération Félix (attaque de Gibraltar en passant par l’Espagne).
Comme nous le savons, ce dernier entretien fut un échec qui inaugura un bras de fer entre Franco et Hitler qui ne prit fin que le 14 juin 1943 après que l’opération Gisela, c’est-à-dire l’invasion de l’Espagne, ait été décidée puis annulée en novembre 1942. Le détail de ces négociations germano-espagnoles est remarquablement exposé dans la biographie de Franco par Brian Crozier (4).
Philippe Prévost consacre sur ce point un intéressant chapitre à Montoire où il expose une thèse hardie se fondant sur l’inquiétude réelle du Maréchal à l’égard des négociations anglo-allemandes et créditant ce dernier d’une manœuvre diplomatique audacieuse lui faisant offrir ses services à Hitler pour reprendre les colonies françaises passées à la dissidence. Pour les raisons qui vont suivre, il ne paraît pas possible de suivre Philippe Prévost sur ce terrain.
À propos de Montoire
En effet, l’auteur se fonde essentiellement sur l’ouvrage de François Delpla - dont le titre seul Montoire, les premiers jours de la collaboration donne le ton et dont l’argumentation tient essentiellement à ce qu’il considère comme le seul document probant en la matière, le compte rendu allemand de l’entrevue de Montoire. Dans une Note bibliographique récente (5), M. Delpla revient sur cette question et élimine systématiquement tout ce qui s’opposerait à sa thèse, que ce soit le refus - pourtant avéré - opposé par Franco à Hitler ou le témoignage sur Montoire donné par l’interprète Schmidt dans ses mémoires parus en 1950 alors qu’il était libre de s’exprimer et n’avait aucune raison de farder la vérité, François Delpla tenant pour probatoire la signature par ce même Schmidt du compte-rendu officiel comme si ce subalterne aux ordres à l’époque aurait pu refuser de signer ! De plus, la relation de Schmidt est confirmée par la lettre du 13 novembre 1940 du Maréchal au général Weygand et aussi par l’historien allemand Elmar Krautkramer (6).
Il faut enfin remarquer que les Allemands insistaient beaucoup sur cette question de reprise des colonies, et qu’ils avaient sur ce point l’accord de Laval. Le Maréchal, s’il était rusé était aussi prudent et il paraît difficile d’imaginer qu’en présence de ce dernier il eût donné le feu vert à une opération que, dans le même temps, il faisait promettre à Churchill par le professeur Rougier de ne jamais entreprendre (7). La question était en effet très délicate car les Allemands n’en démordaient pas et demandaient un plan pour reprendre le Tchad.
On voit donc qu’il eût été mortellement imprudent pour le Maréchal de s’engager à ce sujet à Montoire.
En fait, comme l’écrit Henri Amouroux, la portée psychologique de Montoire dépassera de beaucoup la réalité. Mais, pour l’histoire officielle elle marque le début d’une collaboration d’État volontaire, qui n’a en fait jamais eu lieu. La légende l’emporte ici sur la vérité.
Nous terminerons en félicitant Philippe Prévost d’avoir contribué par son excellent travail à dissiper quelque peu l’imposture médiatico-politique dont les Français sont victimes depuis soixante ans !
André PERTUZIO L’Action Française 2000 du 16 février au 1er mars 2006
* Philippe Prévost : Le temps des compromis. Mai-décembre 1940, Préface de François-Georges Dreyfus. Centre díÉtudes contemporaines (CEC) 214 pages. Disponible à nos bureaux : 15 euros
(1) A.F. 2000, n°2670, du 3 au 16 février 2005.
(2) John Charmley : Churchill. The end of glory. Harcourt Brace and Company, 1992.
(3) Winston Churchill : L’heure tragique. Éd. Plon.
(4) Brian Crozier : Franco-Eyre and Spottiswoode, 1967.
(5) François Delpla : Guerres mondiales et conflits contemporains, n°220 - Octobre 2005. Éd. PUF
(6) Elmar Krautkramer : Vichy 1940- Alger 1942 Éd. Economica.
(7) Public Records Office - Cab 66-14 - Foreign Office.
C’est dire à quel point, soixante ans après sa conclusion, la Seconde Guerre mondiale reste omniprésente en raison d’une campagne médiatique permanente et orientée qui a imprégné les mentalités et littéralement construit les mythes fondateurs de l’idéologie dominante, surtout, et de loin, dans notre pays ou sévit le « terrorisme intellectuel » si bien décrit par Jean Sévillia .
L’histoire de la guerre est interprétée et exposée suivant une grille de lecture convenue et constitue de la sorte une histoire officielle aux antipodes de la vérité, histoire qui se défend bec et ongles comme le rappelait à nos lecteurs le professeur François-Georges Dreyfus à propos de son excellente et objective Histoire de Vichy accueillie, comme il se doit, par le silence des grands médias (1).
Légende et vérité
Il n’en est que plus nécessaire, car c’est la mission de l’historien, de continuer les recherches et dégager cette vérité historique des voiles épais dont on la recouvre. C’est ainsi que notre ami Philippe Prévost vient de publier un ouvrage Le temps des compromis (*) où sont relatées les négociations entre Anglais et Allemands de mai à décembre 1940. Cette étude bat en brèche un certain nombre de légendes têtues comme celle de la détermination héroïque de la Grande-Bretagne unie derrière Churchill alors que la France faisait cavalier seul.
Comme l’exprime François-Georges Dreyfus dans sa préface, « la réalité est moins simple : elle est totalement différente ». Un clivage entre partisans de la guerre et partisans de la paix existait en effet dès avant la guerre en Grande-Bretagne comme en France.
C’est ainsi que Chamberlain, conscient de la fragilité de l’Empire britannique et de l’état d’impréparation du pays, craignait la guerre et ne pensait pas qu’elle fût ni désirable ni nécessaire. De son côté, Hitler ne désirait pas une guerre à l’ouest et signa le pacte du 23 août 1939 avec l’Union Soviétique pensant q’il dissuaderait les démocraties d’entrer en guerre et s’épargnerait, s’il le fallait, une guerre sur deux fronts, Staline, pour sa part, y voyant le moyen de déclencher enfin la guerre entre les puissances capitalistes.
Ce rappel explique les tentatives de compromis qu’expose avec talent Philippe Prévost, lesquelles furent entreprises, dès la défaite de la Pologne consommée, par Hitler qui ne désirait en aucune manière la guerre avec l’Angleterre et était convaincu qu’il arriverait à faire la paix avec elle.
« Parler avec M. Hitler... »
De son côté, lorsque la campagne de France fut pratiquement perdue fin mai 1940, Lord Halifax, secrétaire d’État au Foreign Office, pensait que la Grande-Bretagne n’avait aucune chance de vaincre par elle-même et qu’en l’absence des États-Unis, à part de bonnes paroles, « le moment était venu de parler avec M. Hitler ». L’historien John Charmley (2) ajoute à ce propos que si, en mai-juin 1940, Churchill avait tenté de faire la paix, une vaste partie de l’opinion aurait applaudi. Mais ce dernier, nommé Premier ministre à la suite d’un véritable complot (4), représentait le parti de la guerre et pensait que l’armée française retarderait les Allemands jusqu’à l’intervention prochaine, pensait-il, des États-Unis.
Les initiatives allemandes en vue d’une paix furent au contraire accueillies par Lord Halifax et son adjoint Richard Butler. Philippe Prévost nous donne un clair exposé de ce que furent ces tentatives de compromis bien que les archives anglaises sur cette question ne puissent encore être consultées.
Il faut avoir conscience que la situation à l’époque était pleine d’incertitudes pour les deux parties en cause : panique en Grande-Bretagne à la suite de la défaite française, angoisse en pensant à une invasion allemande possible et véritable paranoïa en ce qui concerne la flotte française encore que l’agression de Mers-el-Kébir obéît surtout à des motifs politiques. En fait, l’Angleterre dut son salut une fois de plus au bras de mer qui la séparait du continent et aux tergiversations de Hitler qui, certain de faire la paix avec l’Angleterre, n’avait pas préparé une opération complexe de débarquement.
C’est dans ce contexte que se déroulèrent, par intermédiaires, les conversations anglo-allemandes que relate Philippe Prévost avec un intéressant chapitre sur l’armistice norvégien accepté par les Anglais mais il est évident qu’un même armistice en France était tout différent puisqu’il privait l’Angleterre de son seul allié et de sa seule armée de terre.
Accord anglo-allemand ?
Le point d’orgue de cette période de recherche d’un accord fut la dramatique mission de Rudolf Hess en Écosse. Comme l’écrit fort justement Philippe Prévost, il est certain que Hitler n’aurait pas envoyé le numéro deux du régime en Grande-Bretagne s’il n’avait eu de solides raisons de penser que son offre de paix serait accueillie alors que lui-même était sur le point d’attaquer l’Union Soviétique. Mais les archives anglaises sur le détail de cet événement restent obstinément closes…
En fait, tant Churchill que Pétain avaient fondé leur politique sur l’entrée en guerre des États-Unis ; celle-ci se faisant attendre, le premier sera sauvé par l’invasion de l’Union Soviétique qu’il salua avec enthousiasme tandis que le Maréchal était confronté à une situation dramatique. Non seulement le gouvernement était aux prises avec d’innombrables problèmes internes tenant à remettre en ordre et en marche un pays aux 3/5 occupé par l’ennemi et à assurer l’existence de quarante millions de Français amputés de deux millions de prisonniers, mais se heurtant aussi aux contraintes de l’Occupant et de la Grande-Bretagne qui soumettait la France à un blocus maritime. Comme l’écrivait Churchill « nous devons maintenir les gens de Vichy coincés entre la meule allemande et la meule britannique » (3).
Dès le 15 juillet, les Allemands se repentant de leurs erreurs lors de l’Armistice et voyant les conversations avec les Anglais traîner en longueur, exigèrent des bases en Afrique du Nord, l’utilisation de ses ports et chemins de fer etc… Ces demandes, sèchement rejetées par le Maréchal, furent à l’origine d’une tension aiguë avec l’Allemagne qui fit même craindre une action militaire contre Vichy (le Maréchal décida qu’en pareil cas il resterait avec les Français et que c’est l’Amiral Darlan qui emporterait en Afrique les sceaux de l’État, scénario qui se produira à peu près en novembre 1942). En outre, le gouvernement était au courant et fort inquiet des conversations anglo-allemandes.
Inquiétudes à Vichy
Dans cette situation faite d’incertitudes et de craintes, on comprend que dès septembre 1940, le Maréchal fit demander un entretien à Hitler. Mais ce dernier ne donna aucune suite à cette demande et ce ne fut que le 22 octobre qu’il le fit à l’issue de son entretien avec Pierre Laval et dans l’optique de son rendez- vous d’Hendaye avec Franco en vue de l’opération Félix (attaque de Gibraltar en passant par l’Espagne).
Comme nous le savons, ce dernier entretien fut un échec qui inaugura un bras de fer entre Franco et Hitler qui ne prit fin que le 14 juin 1943 après que l’opération Gisela, c’est-à-dire l’invasion de l’Espagne, ait été décidée puis annulée en novembre 1942. Le détail de ces négociations germano-espagnoles est remarquablement exposé dans la biographie de Franco par Brian Crozier (4).
Philippe Prévost consacre sur ce point un intéressant chapitre à Montoire où il expose une thèse hardie se fondant sur l’inquiétude réelle du Maréchal à l’égard des négociations anglo-allemandes et créditant ce dernier d’une manœuvre diplomatique audacieuse lui faisant offrir ses services à Hitler pour reprendre les colonies françaises passées à la dissidence. Pour les raisons qui vont suivre, il ne paraît pas possible de suivre Philippe Prévost sur ce terrain.
À propos de Montoire
En effet, l’auteur se fonde essentiellement sur l’ouvrage de François Delpla - dont le titre seul Montoire, les premiers jours de la collaboration donne le ton et dont l’argumentation tient essentiellement à ce qu’il considère comme le seul document probant en la matière, le compte rendu allemand de l’entrevue de Montoire. Dans une Note bibliographique récente (5), M. Delpla revient sur cette question et élimine systématiquement tout ce qui s’opposerait à sa thèse, que ce soit le refus - pourtant avéré - opposé par Franco à Hitler ou le témoignage sur Montoire donné par l’interprète Schmidt dans ses mémoires parus en 1950 alors qu’il était libre de s’exprimer et n’avait aucune raison de farder la vérité, François Delpla tenant pour probatoire la signature par ce même Schmidt du compte-rendu officiel comme si ce subalterne aux ordres à l’époque aurait pu refuser de signer ! De plus, la relation de Schmidt est confirmée par la lettre du 13 novembre 1940 du Maréchal au général Weygand et aussi par l’historien allemand Elmar Krautkramer (6).
Il faut enfin remarquer que les Allemands insistaient beaucoup sur cette question de reprise des colonies, et qu’ils avaient sur ce point l’accord de Laval. Le Maréchal, s’il était rusé était aussi prudent et il paraît difficile d’imaginer qu’en présence de ce dernier il eût donné le feu vert à une opération que, dans le même temps, il faisait promettre à Churchill par le professeur Rougier de ne jamais entreprendre (7). La question était en effet très délicate car les Allemands n’en démordaient pas et demandaient un plan pour reprendre le Tchad.
On voit donc qu’il eût été mortellement imprudent pour le Maréchal de s’engager à ce sujet à Montoire.
En fait, comme l’écrit Henri Amouroux, la portée psychologique de Montoire dépassera de beaucoup la réalité. Mais, pour l’histoire officielle elle marque le début d’une collaboration d’État volontaire, qui n’a en fait jamais eu lieu. La légende l’emporte ici sur la vérité.
Nous terminerons en félicitant Philippe Prévost d’avoir contribué par son excellent travail à dissiper quelque peu l’imposture médiatico-politique dont les Français sont victimes depuis soixante ans !
André PERTUZIO L’Action Française 2000 du 16 février au 1er mars 2006
* Philippe Prévost : Le temps des compromis. Mai-décembre 1940, Préface de François-Georges Dreyfus. Centre díÉtudes contemporaines (CEC) 214 pages. Disponible à nos bureaux : 15 euros
(1) A.F. 2000, n°2670, du 3 au 16 février 2005.
(2) John Charmley : Churchill. The end of glory. Harcourt Brace and Company, 1992.
(3) Winston Churchill : L’heure tragique. Éd. Plon.
(4) Brian Crozier : Franco-Eyre and Spottiswoode, 1967.
(5) François Delpla : Guerres mondiales et conflits contemporains, n°220 - Octobre 2005. Éd. PUF
(6) Elmar Krautkramer : Vichy 1940- Alger 1942 Éd. Economica.
(7) Public Records Office - Cab 66-14 - Foreign Office.