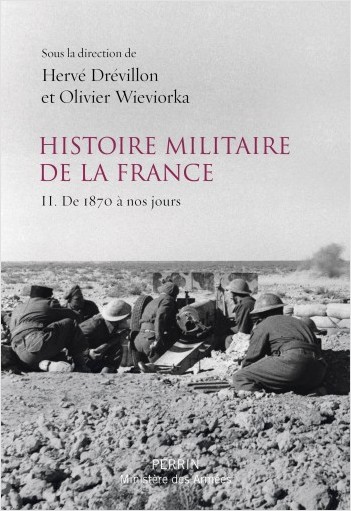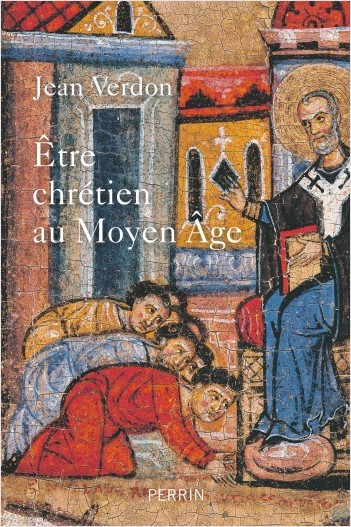Q. : Monsieur Steuckers, comment avez-vous découvert Julius Evola ? Quand en avez-vous entendu parler pour la première fois ?
RS : Dans la Librairie Devisscher, au coin de la rue Franz Merjay et de la Chaussée de Waterloo, dans le quartier “Ma Campagne”, à cheval sur Saint-Gilles et Ixelles. “Frédéric Beerens”, un camarade d’école, un an plus âgé que moi, avait découvert Les hommes au milieu des ruines dans cette librairie, l’avait lu, et m’en avait parlé tandis que nous faisions la queue pour commander d’autres ouvrages ou quelques manuels scolaires. Ce fut la toute première fois que j’entendis prononcer le nom d’Evola. J’avais 17 ans. Nous étions en septembre 1973 et nous étions tout juste revenus d’un voyage scolaire en Grèce.
Pour Noël, le Comte Guillaume de Hemricourt de Grünne, le patron de mon père, m’offrait toujours un cadeau didactique : cette année-là, pour la première fois, j’ai pu aller moi-même acheter les livres que je désirais, muni de mon petit budget. Je me suis rendu en un endroit qui, malheureusement, n’existe plus à Bruxelles, la grande librairie Corman, et je me suis choisi 3 livres : L’État universel d’Ernst Jünger, Un poète et le monde de Gottfried Benn et Révolte contre le monde moderne de Julius Evola. L’année 1973 fut, rappelons-le, une année charnière en ce qui concerne la réception de l’œuvre d’Evola en Italie et en Flandre : tour à tour Adriano Romualdi, disciple italien d’Evola et bon connaisseur de la Révolution conservatrice allemande grâce à sa maîtrise de la langue de Gœthe, décéda dans un accident d’auto, tout comme le correspondant flamand de Renato del Ponte et l’animateur d’un Centro Studi Evoliani en Flandre, Jef Vercauteren. Je n’ai forcément jamais connu Jef Vercauteren et, là, il y a eu une rupture de lien, fort déplorable, entre les matrices italiennes de la mouvance évolienne et leurs antennes présentes dans les anciens Pays-Bas autrichiens.
Je dois vous dire qu’au départ, la lecture de Révolte contre le monde moderne nous laissait perplexes, surtout Beerens, le futur médecin chevronné, féru de sciences biologiques et médicales : on trouvait que trop d’esprits faibles, après lecture de ce classique, se laisseraient peut-être entrainer dans une sorte de monde faussement onirique ou acquerraient de toutes les façons des tics langagiers incapacitants et “ridiculisants” (à ce propos, on peut citer l’exemple d’un Arnaud Guyot-Jeannin, tour à tour fustigé par Philippe Baillet, qui lui reprochait l’« inculture pédante du Sapeur Camember », ou par Christopher Gérard, qui le traitait d’« aliboron » ou de « chaouch »). Une telle dérive, chez les aliborons pédants, est évidemment tout à fait possible et très aisée parce qu’Evola présentait à ses lecteurs un monde très idéal, très lumineux, je dirais, pour ma part, très “archangélique” et “michaëlien”, afin de faire contraste avec les pâles figures subhumaines que génère la modernité ; aujourd’hui, faut-il s’empresser de l’ajouter, elle les génère à une cadence accélérée, Kali Yuga oblige. L’onirisme fait que bon nombre de médiocres s’identifient à de nobles figures pour compenser leurs insuffisances (ou leurs suffisances) : c’est effectivement un risque bien patent chez les évolomanes sans forte épine dorsale culturelle.
Mais, chose incontournable, la lecture de Révolte... marque, très profondément, parce qu’elle vous communique pour toujours, et à jamais, le sens d’une hiérarchie des valeurs : l’Occident, en optant pour la modernité, a nié et refoulé les notions de valeur, d’excellence, de service, de sublime, etc. Après lecture de Révolte..., on ne peut plus que rejeter les anti-valeurs qui ont refoulé les valeurs impérissables, sans lesquelles rien ne peut plus valoir quoi que ce soit dans le monde.
“Révolte...” et la notion de numineux
Plus tard, Révolte... satisfera davantage nos aspirations et nos exigences de rigueur, tout simplement parce que nous n’avions pas saisi entièrement, au départ, la notion de “numineux”, excellemment mise en exergue dans le chapitre 7 du livre et que je médite toujours lorsque je longe un beau cours d’eau ou quand mes yeux boivent littéralement le paysage à admirer du haut d’un sommet, avec ou sans forteresse (dans l’Eifel, les Vosges, le Lomont, le Jura ou les Alpes ou dans une crique d’Istrie ou dans un méandre dela Moselle ou sur les berges dela Meuseou du Rhin). Masques et visages du spiritualisme contemporain nous a apporté une saine méfiance à l’endroit des ersatz de religiosité, souvent made in USA, alternatives très bas de gamme que nous fait miroiter un XXe siècle à la dérive : songeons, toutefois dans un autre contexte, à la multiplication des temples scientologiques, évangéliques, etc. ou à l’emprise des Témoins de Jéhovah sur des pays catholiques comme l’Espagne ou l’Amérique latine, qui, de ce fait, subissent une subversion sournoise, disloquant leur identité politique.
Nous n’avons découvert le reste de l’œuvre d’Evola que progressivement, au fil du temps, avec les traductions françaises de Philippe Baillet mais aussi parce que les latinistes de notre groupe, dont le regretté Alain Derriks et moi-même, commandaient les livres non traduits du Maître aux Edizioni di Ar (Giorgio Freda) ou aux Edizioni all’Insegno del Veltro (Claudio Mutti). Je crois n’avoir atteint une certaine (petite) maturité évolienne qu’en 1998, quand j’ai été amené à prendre la parole à Vienne en cette année-là, et à Frauenfeld, près de Zürich, en 1999, respectivement pour le centième anniversaire de la naissance d’Evola et pour le XXVe anniversaire de son absence. L’idée centrale est celle de “l’homme différencié”, qui pérégrine, narquois, dans un monde de ruines. Evola nous apprend la distance, à l’instar de Jünger, avec sa figure de “l’anarque”.
Q. : Quelques années plus tard, la revue Totalité sera la première, dans l’espace linguistique francophone, à publier régulièrement des textes d’Evola. De Totalité émergeront une série de revues, telles Rebis, Kalki, L’Âge d’Or, puis les éditions Pardès. Comment tout cela a-t-il été perçu en Belgique à l’époque ?
Le coup d’envoi de cette longue série d’initiatives, qui nous ramène à l’actualité éditoriale que vous évoquez, a été, à Bruxelles du moins, une prise de parole de Daniel Cologne et Georges Gondinet, dans une salle de l’Helder, rue du Luxembourg, à un jet de pierre de l’actuel Parlement Européen, qui n’existait pas à l’époque. C’était en octobre 1976. Depuis, le quartier vit à l’heure de la globalisation, échelon “Europe”, Europe “eurocratique” s’entend. À l’époque, c’était un curieux mixte : fonctionnaires de plusieurs ministères belges, étudiants de l’école de traducteurs / interprètes (dont j’étais), derniers résidents du quartier se côtoyaient dans les estaminets de la Place du Luxembourg et, dans les rues adjacentes, des hôteliers peu regardants louaient des chambres de “5 à 7” pour bureaucrates en quête d’érotisme rapide camouflé en “heures supplémentaires”, tout cela en face d’un vénérable lycée de jeunes filles, qui faisait également fonction d’école pour futures professeurs féminins d’éducation physique (le “Parnasse”). En arrière-plan, la gare dite du Quartier Léopold ou du Luxembourg, vieillotte et un peu sordide, flanquée d’un bureau de poste crasseux, d’où j’ai envoyé quantité de mandats dans le monde pour m’abonner à toutes sortes de revues de la “mouvance” ou pour payer mes dettes auprès du bouquiniste nantais Jean-Louis Pressensé. En cette soirée pluvieuse et assez froide d’octobre 1976, D. Cologne et G. Gondinet étaient venus présenter leur Cercle Culture & Liberté, à l’invitation de Georges Hupin, animateur du GRECE néo-droitiste à l’époque. Dans la salle, il y avait le public “nouvelle droite” habituel mais aussi Gérard Hupin, éditeur de La Nation Belge et, à ce titre, héritier de Fernand Neuray, le correspondant belge de Charles Maurras (Georges Hupin et D. Cologne étaient tous 2 collaborateurs occasionnels de La Nation Belge). Maître Gérard Hupin était flanqué du Général Janssens, dernier commandant de la “Force Publique” belge du Congo. J’étais accompagné d’Alain Derriks, qui deviendra aussitôt le correspondant belge du Cercle Culture & Liberté. Les contacts étaient pris et c’est ainsi qu’en 1977, je me retrouvai, pour représenter en fait Derriks, empêché, à Puiseaux dans l’Orléanais, lors de la journée qui devait décider du lancement de la revue Totalité. Il y avait là D. Cologne (alors résident à Genève), Jean-François Mayer (qui fera en Suisse une brillante carrière de spécialiste ès religions), Éric Vatré de Mercy (à qui l’on devra ultérieurement quelques bonnes biographies d’auteurs), Philippe Baillet (traducteur d’Evola) et G. Gondinet (futur directeur des éditions Pardès et, en cette qualité, éditeur de Julius Evola)
À suivre