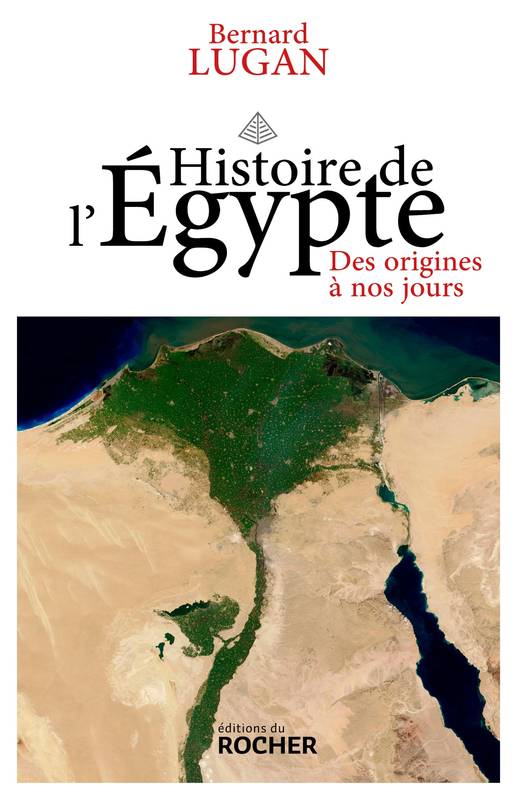René et Florence, les personnages principaux du roman, sont deux jeunes gens qui s’aiment. Aimer, pour eux, cela veut dire se tenir la main, se promener au bord de la mer et cela veut dire, aussi, contempler des îles lointaines, ces fatamorgana toutes miroitantes de souvenirs. Par leurs yeux nimbés de réminiscence, nous entrons presque à notre insu dans le royaume émerveillé de leur enfance qui est un peu la nôtre.
Il n’est pas rare que j’ouvre mon vieux livre d’une ancienne édition de poche à la faveur d’un trajet en métro, en bus ou dans une salle d’attente du cabinet dentaire et dans la vie moderne qui ressemble à une grande salle d’attente. Ces temps “morts” se remettent alors à regarder le ciel. Ils s’écrivent à nouveau au “présent éternel” !
Mais, comme tout ce qui touche de près ou de loin aux années trente, à la Collaboration, à Brasillach, la lecture de « Comme le temps » ne va pas vraiment de soi.
Pourtant, tout le monde en convient, y compris les professionnels de la détraction, “Comme le temps” reste une des œuvres les plus sensibles du XXe Siècle, une oeuvre qui n’a pas oublié le nom des fleurs. Une œuvre capable de hisser la vie humaine à hauteur de mythe. Nous passerions à côté d’elle en la réduisant à un épouvantail idéologique ou à une bannière de ralliement. Et en passant à côté d’elle, nous passons à côté d’une occasion de grandir.
Que l’Histoire officielle soit l’objet de récupération, cela est dans la nature des choses puisque celle-ci est toujours écrite par les vainqueurs. Une grande œuvre est écrite par le cœur et non par les vainqueurs. Il ne nous appartient pas, non plus, d’écrire l’histoire des vaincus pour “sauver” l’œuvre de Brasillach. Cette entreprise serait longue et risquée et je ne serais alors pas certain de croire davantage à l’histoire des vaincus qu’à l’histoire des vainqueurs. Quel que soit son bord, l’Histoire est un otage de la politique. Nous voulons simplement lire Brasillach en paix, c’est-à-dire en adressant un bras d’honneur à l’endroit de la récupération factieuse, à la censure, comme aux gnomes insidieux de l’autocensure.
Cela nous oblige à mettre l’Histoire de côté.
Rappelons tout de même que Brasillach a subi un procès au terme duquel il fut exécuté dans la fleur de l’âge pour fait de Collaboration. Tuer un poète, afin de prouver au monde entier sa détermination à lutter contre la barbarie nazie, il fallait y penser. Tuer un poète – étoile montante de la littérature française – au terme d’un procès bâclé, afin de rétablir la démocratie et l’Etat de droit, il fallait y penser aussi. “La mort de Brasillach a conduit ma vie”. C’est maître Isorni, l’avocat du condamné qui prononça cette phrase et en la prononçant, il a tout dit.
On pourrait cependant se dire, cela concerne l’homme, ses engagements politiques et non l’œuvre, si les choses se passaient comme nous aimerions qu’elles se passent. J’aimerais en effet que l’on cesse de prendre en otage – dans le sens du pour ou celui du contre – une œuvre romanesque et poétique si originale et féconde à des fins bassement idéologiques. Oui mais voilà, l’idéologisme en temps de paix, c’est comme la délation en temps de guerre, cela ne fait pas partie des grandeurs françaises ; cela fait partie des “passions tristes” au sens que Spinoza donne à ces termes.
On a beau dire que “Comme le temps” est un roman sensible, un dialogue avec les personnages qui sont ceux-là même de l’âme ; on a beau dire que c’est un bonheur inouï de lecture, lire Brasillach reste, 75 ans après le procès de son auteur, une activité “suspecte”.
Du coup, celui qui aurait l’idée saugrenue de réhabiliter l’œuvre de Brasillach serait suspecté de coucher avec ses idées ; afin de compenser son péché, il se verrait dans l’obligation de brûler le communiste Louis Aragon. Moi, je défends l’arc-en-ciel Brasillach comme je défends bec et ongle le continent Aragon, comme je défends la lecture des œuvres contre la logique des écrans, avec autant de force que je hais la société post-littéraire.
Ouvrir un beau livre c’est ouvrir un arc-en-ciel dans la monochromie de notre époque. Et tant pis si évoquer Brasillach ou Aragon dans un article ou dans une causerie entre amis, c’est s’exposer à des remarques, à des procès d’intentions logés entre les sourcils. Prononcer ces noms, c’est aussi montrer que les termites de la réduction et de l’amalgame n’ont pas totalement grignoté entièrement notre indépendance.
Laissons ces “termites de la réduction qui rongent la vie humaine depuis toujours” (Kundera) a leur périmètre véritable : les faux plafonds de la critique universitaire ; à leurs réseaux : les médias mainstream et surtout à leurs tuniques de Nessus : le politiquement correct et ses déclinaisons infinies (l’historiquement, le moralement correct, etc.).
L’idée qu’une œuvre et son auteur puisse être séparés, provient, je crois bien, de Marcel Proust. C’est l’exemple type d’une fausse bonne idée, une de ses idées qui prévaut dans les salons bourgeois où l’on n’a rien d’autre à faire que phosphorer sur les madeleines trempées dans la tisane. Par temps de paix, cet axiome peut à la rigueur fonctionner. Par temps de guerre, elle ne marche pas. Et comme nous sommes en guerre – celle que livre l’économie à la politique, le pays légal au pays réel, celle que livrent les mondialistes aux patriotes – cela ne marche pas. Par temps de guerre, dans un pays occupé, on prend des risques. On ne trahit pas ses amis, ni leur mémoire. On défend Brasillach comme le fit Maurice Bardèche au risque de la marginalisation et de l’opprobre.
Et puis, voyons aussi les choses autrement, en attendant la trêve des confiseurs, la rareté des livres de Brasillach sur les étagères des libraires c’est la rareté même de l’or.
Une question demeure, essentielle : Pourquoi lire Brasillach peut changer la vie? Pas la vie en général, mais votre vie à vous, irradiée par la lecture de son roman.
A mon avis, cette question ne peut avoir de réponse qu’intérieure. Lire “Comme le temps”, c’est porter un coquillage à son oreille tout résonnant des bruits de la mer de la baie d’Alcudia…
Tout se passe en effet comme si le lecteur qui regarde le monde par les yeux de René et/ou de Florence (les Adam et Eve du roman) accédait au double regard platonicien. Il perçoit alors, pour reprendre les termes si justes de Luc-Olivier d’Algange, “le matin profond de sa mémoire”. Sans le savoir alors, il se relie à la “cadena aurea”, la chaîne d’or fréquentielle des chercheurs d’âme. Oui, “Comme le Temps” parle de l’âme et parle à l’âme. Et c’est là l’essentiel.
Parler à l’âme, cela veut dire encore hisser la vie à hauteur de mythe. Pas n’importe quel mythe, celui qui préexiste à notre naissance et que nous sommes sensé décrypter pendant notre passage sur terre. Notre mission de vie, en somme ou, si l’on préfère, son équation personnelle.
En un mot, “Comme le temps passe”, c’est l’œuvre de la “réminiscence” des choses qui restent enfouies en nous, l’enfance, le premier bisou sur la bouche, le premier poème. Pour se faire, on peut dire que Brasillach emploie un temps qui n’est ni le passé ni le présent mais le “présent éternel”.
“Comme le temps” n’est pas ce genre de livre qu’on lit avec un crayon à la main. Personnellement, je l’ouvre en y cueillant une phrase au hasard selon la technique de l’oracle, avec de belles et surprenantes rencontres à la clé : les personnages de fiction, Florence, René ou la “majestueuse” tente Espérance et aussi avec des personnes réelles. Anne Brassié, la biographe de Robert Brasillach que je rencontrais alors que je tenais justement le livre à la main – autant de synchronicités qui laissent à penser que les rencontres terrestres ne font peut être que prolonger des rendez-vous déjà fixés ailleurs par les âmes.
En ouvrant mon livre de poche, il arrive aussi que la lecture rende phosphorantes les roches narratives, lesquelles roches éclairent les voies anciennes de l’enfance. Ravivés comme de vieilles braises sous la cendre, les souvenirs du cœur se remettent à miroiter, image pour dire cet autre temps que le passé ou le présent de l’indicatif, un temps inédit, celui des choses de l’âme, que l’on pourrait appeler le “passé-présent” ou le “présent éternel” de la réminiscence.
En ouvrant “Comme le temps”, j’ai notamment revu mes vacances au bord de la Méditerranée, au bout du cap d’Agde… La chienne Nita s’amuse avec les vagues, tandis que le tuba de plongée de mon père sillonne l’onde comme la nageoire d’un requin. Ma mère, qui ne sait pas nager, me surveille depuis la grève. J’étais un enfant rêveur, dans le brouillon de ses 9 ou 10 ans. Dans l’immeuble ouvrier tout juste brut de décoffrage, il y avait cette fille de l’étage du dessus qui se penchait à la fenêtre. Elle était brune comme le soir. Je crois qu’elle était espagnole mais je n’en suis pas certain ; c’était ma Florence à moi ! Pour elle, je ramassais de jolis coquillages !
Je la revis l’été suivant, mais pas l’été qui a suivi. Je ne l’ai cependant pas oublié. Elle est, comme l’écrit si joliment Brasillach (à l’endroit de la Tante Espérance) “remontée de la banalité courante à un empyrée de mythologie”. Bien des années plus tard, pourtant, j’ai revu mon amour d’enfance. Oh ! non pas la fille en chair et en os mais son image ! On projetait en effet le beau film “Summer of 42” de Robert Mulligan dans le cinéma d’Art et d’Essai. J’ai bien cru que Dorothee, l’héroïne du film, et Florence, l’héroïne de “Comme le temps” étaient une seule et même figure en tant qu’elles résonnent toutes deux avec le même archétype féminin. Un même “halo” de souvenir entourait ces deux femmes (Dorothee et Florence) auquel s’ajoute le souvenir de ma voisine de l’immeuble.
“Comme le temps” serait donc le roman du “halo autour des choses”.
“Dans la vie de chacun, il y a un amour d’été”. La bande annonce du film de Mulligan ne dit pas autre chose : “In everyone ‘s life there is a summer 42”. Mais prend-on conscience que ce premier amour fait aussi écho – comme par analogie symbolique – au paradis perdu ? À ce mythe auroral de l’âge d’or qui est au fond de tout peuple ?
A mon sens, le livre de Brasillach n’est pas étranger à ce mystère. Florence et René, sont aussi les représentants romanesques d’Adam et Eve. Les lieux mythologiques de l’enfance de chacun sont peut-être aussi un équivalent symbolique du paradis perdu qui vit au cœur de tous les peuples. L’enfance, matin de l’existence, équivaut ici à cet âge d’or de l’humanité qui brille dans nos anciens mythes.
Le roman est une équation de beauté de cette relation archétypale à travers ses personnages dont la biographie «Brasillach, encore un instant de bonheur» retrace la généalogie dans la vie de l’auteur. Il sera un jour possible d’établir une psychanalyse de l’auteur (notamment son rapport aux femmes) à partir de ces précieuses données biographiques glanées par Anne Brassié. Mais “Comme le temps” est d’abord et avant tout une boite à souvenirs qui, une fois ouverte, dégage le “halo” mystérieux de la nostalgie face au temps qui passe.
Ce halo mystérieux – que refuse obstinément notre époque – est essentiel à la vie véritable.
C’est ce halo qui fait que certains évènements de notre banalité courante se hissent à hauteur de “mythe”. Brasillach emploie l’expression de “mythologie personnelle”. Une vie sans “halo autour des choses” est une vie sans résonnance, réduite à une sorte de bilan de santé ou un CDD sur terre.
Autrement dit, l’équation libérale, c’est le mythe moins la magie de la vie, moins l’inattendu, moins l’Espérance, moins, moins, moins… bref, c’est l’avènement du consommateur-producteur, de Pinocchio, la marionnette articulée, bref, l’avènement de l’homme inutilement né” (Aragon).
Nous y sommes.
Le halo étoilé est le seul antidote véritablement efficace à opposer à l’ “utilitarisme” triomphant des vainqueurs de 1945. Le libéralisme ne retient des mondes qu’un monde, de ce monde unique, il ne connaît que l’individu et l’économie et cette idée absolue que “l’économie pourrait résoudre l’essentiel de nos problèmes” (Alain de Benoist).
Avec le recul du temps, on se rend compte que le procès de Brasillach, c’est aussi le procès de ce halo autour des choses, de la poésie de la vie, le procès de la “collaboration” avec l’enfance.
Tuer un poète, ce n’est pas très difficile et cela rend possible toutes les lâchetés et les renoncements futurs. Cela rend possible la surexploitation des sols, les surdoses de sulfate et les poulets aux hormones. Il fallait tuer Brasillach pour que les multinationales remportent définitivement la seconde guerre mondiale et pour que les peuples la perdent.
Sa “mythologie personnelle”, cela veut dire se remettre à l’écoute de la vie véritable.
“Comme le temps” est le contraire même de “ces romans réalistes sans rivage” que fustigeait justement Aragon. Roman matinal, auroral, énigmatique ou autre chose qu’un roman, telle est la question ? Pour moi, on peut mettre “Comme le temps” dans la catégorie du roman mais alors quelque chose ne va pas. C’est comme de belles chaussures avec une pointure de moins que votre taille. Cela n’est pas très confortable.
Connaissez-vous beaucoup de romans avec pour incipit “Au commencement, il y eut le paradis terrestre” ? Avec Adam et Eve invoqués dans la préface ? Avec deux personnages, Florence et René, qui en sont le reflet ? Un roman dont les lumineux accidents narratifs invite à découvrir sa “mythologie personnelle” ? Moi, je n’en connais qu’un et c’est “Comme le temps passe”.
Dès les premières lignes, augurales, on découvre que les personnages sont très peu personnifiés (on ne connaît pas leur nom de famille), nous pouvons donc voir par leurs yeux. La trame narrative du roman conduit moins à “définir” une “histoire” romanesque qu’à “infinir” sa propre vie.
Infinir sa propre vie, en explorer les couches, les ciels, en percer l’intime secret, rien que cela ! En d’autres termes, ce roman vise à nous faire entendre notre “légende narrative”, ce récit, voire ce récital qui nous précède et dont chacun est tributaire, sans que nous en soyons pleinement conscient. Ce roman tient de l’Aletheia grecque de ce que nous sommes mythiquement parlant, découverte aussi essentielle à la vie que l’oxygène que nous respirons.
Je parle avec le cœur, sans faux semblants idéologiques, sans le recours à ce métalangage universitaire ronronnant et velléitaire. Même si cette liberté de ton a un prix, même si elle me coûte peut être les fatwas des spécialistes aigris et des maîtres censeurs. Mais qu’importe ! Je persiste et signe : j’affirme que “Comme le temps” n’est pas à proprement parlé un “roman”.
Si “Comme le temps”, œuvre hiéroglyphique de l’enfance, est “autre chose” qu’un roman, alors qu’est-il exactement ?
Il y a tout d’abord un ton onirique général qui entoure le texte. Tel Ulysse conduit par les Phéaciens, le lecteur se retrouve sur son île d’Ithaque, un beau matin. “Comme le temps” nous conduit sur les rivages de notre enfance rêvé et de nos premiers amours. Bien qu’onirique, le décor du roman est ancré (et encré) par un espace circonstancié et non dans les brumes surréalistes. La côte catalane, les îles Baléares sont tout-à-fait repérables sur une carte.
Même si le texte de Brasillach nous entraîne dans une vision onirique, elle est cette part de rêve éveillé et éveilleur qui prolonge le réel et non l’onirisme des sommeils insondables.
Nous apprenons par exemple que le métier de René est vendeur d’automobiles, activité on ne peut plus concrète. Nous apprenons que les parents de René et de Florence ont disparu dans un accident ferroviaire. Cela aussi, voyez-vous, c’est concret comme une pierre.
La scène de la promenade en auto dans le Morvan est aussi révélatrice de l’univers du narrateur à la fois réaliste et magique. Il décrit en effet avec bonheur comment l’automobile brinquebalante de René tombe en panne, scène joyeuse et cocasse qui est prétexte à un autre souvenir, lui-même occasion de rigolade. Florence se revoit enfant avec René sur le dos d’une ânesse qui s’arrête subitement sur le chemin de Pollensa. Impossible de repartir même en tirant sur l’attelage de l’animal bourru et entêté!
Que dire sur l’ânesse de Florence ? Sinon quelle est premièrement l’objet de la réminiscence de Florence et beaucoup plus encore…
Les traces du conte dans le roman : ces animaux dont il ne manque que la parole.
Le souvenir d’une ânesse alors que l’on vient de tomber en panne sur le bord de la route, cela ne veut pas dire grand chose. Et cela veut dire beaucoup si l’on en croit les anthropologues du monde animal. Pour ces derniers, une société peut se définir métaphoriquement par le traitement qu’elle réserve à ses animaux ; en d’autres termes, la représentation qu’une société se fait de ses animaux devient son propre miroir. Et les romans sont aussi des sortes de sociétés de personnages.
Essayons de relire la scène de la panne à l’aune de cet axiome. Le templum augural de cette scène, il nous dit quoi ? Il nous révèle quoi de l’univers de Brasillach ? L’auteur fait de cette ânesse un “personnage mythologique” qui joue un rôle dans l’enfance de Florence. L’auteur nous précise par ailleurs que l’ânesse marche au rythme du “pas ecclésiastique”. On voit que l’auteur emploie un adjectif relevant du champ lexical chrétien.
L’auteur campe avec cette ânesse un personnage nimbé de référence chrétienne, dont il ne manque, au fond, que la parole. Il est rare que les animaux des romans jouent le premier rôle. Ils sont à la rigueur des éléments du décor romanesque mais rarement les acteurs centraux du récit. Le roman moderne c’est la naissance de l’individu, du quidam qui déploie sa volonté de puissance. L’animal y est réduit à la domesticité. Il en va tout autrement des contes de Grimm, qui firent la joie de ma jeunesse. Je me souviens de ces scènes où les animaux parlent “pour de vrai”. Dans ces contes, les grenouilles parlent aux princes ; les oiseaux élisent leur roi et racontent des histoires. Dans les contes de fée, les animaux ont la parole.
Avec ses animaux “mythiques” mais qui ne parlent pas, “Comme le temps” est donc à la fois “plus” qu’un roman, mais “moins” qu’un conte. Je dis “moins” car il serait sans doute excessif de le qualifier de conte de fée. La rupture avec le conte est clairement consumée.
Notons aussi que les premières pages du “roman” décrivent tout un bestiaire. Trois ou quatre poules (“dont l’une vécu très vieille et boitait”), une demi-douzaine de chats, un chien et un flamant rose “qui fait partie de la mythologie personnelle” des enfants. Elles décrivent aussi une maison, des jeux qui trainent sur le sol et surtout un jardin “où il semblait que toute l’existence devait s’écouler”. On apprend aussi que les animaux de cette arche “suivent les enfants” lorsqu’ils empruntent le chemin menant à la mer.
Chez Brasillach, les animaux suivent donc les enfants qui sont les petits rois du jardin. Dans le conte de fée, c’est généralement les humains, encore sensibles aux monde des présages, qui suivent les “animaux guides”. Messagers, les animaux sont aussi des acteurs, des “persona” au sens grec du terme à part entière puisqu’ils parlent.
Brasillach précise lui-même qu'”un jour les animaux parlaient” ce qui indique qu’ils ne parlent désormais plus. Un flamant “perché sur ses pattes” fait cependant partie de la mythologie personnelle “des enfants”, comme l’ânesse de Florence, même s’ils ne parlent pas à la première personne comme dans les contes de fée et autres dessins animés. D’ailleurs le narrateur n’est même pas certain que le flamant soit vraiment un flamant mais pourrait bien être, en réalité, un “héron”.
Bref, il ne manque aux bêtes que Brasillach décrit dans son roman que la parole pour faire de “Comme le temps” un conte à part entière.
L’ânesse est un animal bourru ! Elle supporte mal l’attelage que Florence essaie de lui fixer sur le dos. Elle refuse subitement d’avancer, et a même semble-t-il, fait tomber d’un coup de patte le marque-page que j’avais placé dans mon livre de poche !
Et ne le racontez à personne, mais cela fait trois jours que je recherche en vain l’ânesse de Florence !
Trois jours que l’ânesse se joue de moi ! C’est dire la magie de “Comme le temps passe” qui est tout autre chose qu’un roman sans rivage, sans d’ailleurs être un roman ou un conte de fée.
Ni roman, ni conte, qu’est donc “Comme le temps ?” A mon avis, ce beau texte relève peut être d’un genre narratif situé “quelque part” entre le roman et le conte et nous pourrions le qualifier de “roman mythologique” – en tout cas cet espace narratif un peu magique où l’ânesse de Florence attend le lecteur pour une promenade à travers l’enfance…
Frédéric Andreu-Véricel
contact : fredericandreu@yahoo.fr
https://www.medias-presse.info/comme-le-temps-passe-le-roman-mythologique-de-robert-brasillach/139890/