À l’heure actuelle, les multiples aspects linguistiques et mythologiques des civilisations indo-européennes sont devenus familiers à un large public. Ce résultat positif est dû, pour l’essentiel, aux recherches patientes d’érudits tels que Benveniste, de Vries, Haudry, etc., et surtout Dumézil qui donna ses lettres de noblesse aux études indo-européennes. Au sein de cette féconde lignée de « quêteurs de l’indo-européanité » trouve légitimement place le linguiste et philologue allemand Hans F. K. Günther, véritable précurseur de G. Dumézil.
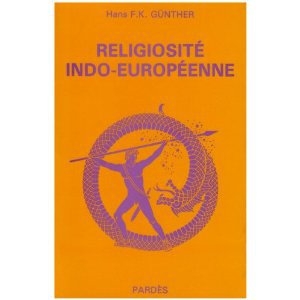 Günther se présente comme le théoricien du courant “nordique” dans l’Allemagne de la République de Weimar. Il publia en 1934 un essai, désormais classique, intitulé Frömmigkeit nordischer Artung (que l’on traduit par “Religiosité de type nordique”), dans lequel il présentait de façon largement synthétique les grands traits spirituels des religions indo-européennes. Cet essai, édité récemment par les Éditions Pardès et traduit ici pour la première fois en français, est issu des textes de la sixième édition allemande, parue en 1963, et de l’édition anglaise, plus complète, parue en 1967. Quant au titre, qui présente une notable différence avec le titre originel allemand, il est tiré de celui de l’édition italienne intitulée Religiosità indoeuropea.
Günther se présente comme le théoricien du courant “nordique” dans l’Allemagne de la République de Weimar. Il publia en 1934 un essai, désormais classique, intitulé Frömmigkeit nordischer Artung (que l’on traduit par “Religiosité de type nordique”), dans lequel il présentait de façon largement synthétique les grands traits spirituels des religions indo-européennes. Cet essai, édité récemment par les Éditions Pardès et traduit ici pour la première fois en français, est issu des textes de la sixième édition allemande, parue en 1963, et de l’édition anglaise, plus complète, parue en 1967. Quant au titre, qui présente une notable différence avec le titre originel allemand, il est tiré de celui de l’édition italienne intitulée Religiosità indoeuropea.
C’est certes une gageure, voire un péril, compte tenu de l’actuel climat 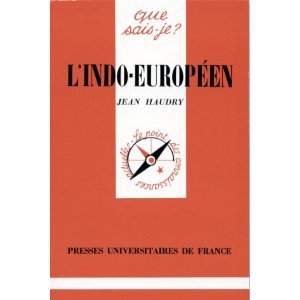 “intellectuel”, que de rééditer l’ouvrage d’un chercheur aussi contesté et incompris que Hans F. K. Günther. Pour certains de nos contemporains, aux opinions fabriquées et imposées par les médias, Günther apparaîtra comme un “type” bizarre, “démodé”, passablement dangereux par les idées qu’il expose, tant les mots et les expressions qu’il emploie ont le pouvoir sémantique d’évoquer un ensemble d’idées qui prévalurent au cours d’une période précise de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe. De plus, ce brillant chercheur allemand passe volontiers, à tort, pour l’anthropologue officiel du IIIe Reich. Dans cette optique, la pensée et les travaux de Günther ont subi une “tabouisation” et une “criminalisation” de la part des Torquemada au petit pied du conformisme moral occidentalo-mondialiste et des minus médiatiques. C’est pour cela que la décision des Éditions Pardès de traduire et de publier ce maître-livre de Günther constitue, non seulement un acte d’utilité quant à une plus grande connaissance des recherches de l’auteur allemand, mais aussi un acte de courage. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
“intellectuel”, que de rééditer l’ouvrage d’un chercheur aussi contesté et incompris que Hans F. K. Günther. Pour certains de nos contemporains, aux opinions fabriquées et imposées par les médias, Günther apparaîtra comme un “type” bizarre, “démodé”, passablement dangereux par les idées qu’il expose, tant les mots et les expressions qu’il emploie ont le pouvoir sémantique d’évoquer un ensemble d’idées qui prévalurent au cours d’une période précise de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe. De plus, ce brillant chercheur allemand passe volontiers, à tort, pour l’anthropologue officiel du IIIe Reich. Dans cette optique, la pensée et les travaux de Günther ont subi une “tabouisation” et une “criminalisation” de la part des Torquemada au petit pied du conformisme moral occidentalo-mondialiste et des minus médiatiques. C’est pour cela que la décision des Éditions Pardès de traduire et de publier ce maître-livre de Günther constitue, non seulement un acte d’utilité quant à une plus grande connaissance des recherches de l’auteur allemand, mais aussi un acte de courage. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Dès l’abord, l’ouvrage s’ouvre sur deux textes importants : une Préface du traducteur, R. Steuckers, qui fournit une utile présentation sur la vie et l’œuvre de Günther, suivie d’une Présentation de J. Evola, parue pour la première fois dans une revue italienne de 1970. Après des précisions apportées quant à l’opportunité du changement de titre, le terme “nordique” cédant la place au terme “indo-européen”, J. Evola apporte aux lecteurs les nécessaires correctifs aux tendances « naturalistes » et « biologistes » de l’auteur allemand, et rectifie certaines « fausses perspectives » dans lesquelles, parfois, se place Günther, ou certains jugements pour le moins hâtifs portés par le chercheur. Ainsi en est-il, par exemple, d’un certain « défaut méthodologique » de Günther, ou encore de la méconnaissance par ce dernier de tout ce qui se rapporte à la « dimension de la transcendance », etc.
Le reste de l’ouvrage est consacré au texte même de Hans F. K. Günther. Ce texte, véritablement “pré-dumézilien”, ne vise rien moins qu’à répondre à la question suivante : qu’est-ce que la religiosité indo-européenne ? Plus précisément, quelle est l’essence véritable de l’« attitude bien distincte des peuples et des hommes de souche indo-européenne vis-à-vis des puissances divines » que décrit Günther ?
Partant d’un postulat, démontré depuis, de l’« existence d’une langue indo-européenne commune ou “primale”, dérivée d’un noyau commun datant de l’Âge du Bronze », qui renvoie forcément à un ensemble de peuples faisant usage de cet idiome, Günther en conclut logiquement et justement à l’existence d’une religiosité spécifique à ces peuples, déterminée « en comparant les diverses formes de religiosité de ces peuples ». Dès lors, son objet sera de « jeter un regard panoramique sur les lignes de faîte de la religiosité indo-européenne, de saisir cette religiosité dans ce qu’elle a de plus complet et de plus spécifique, en analysant ses expressions les plus pures et les plus riches ». Quant à la démarche d’ordre méthodologique adoptée par Günther afin de dégager les grandes lignes de cette religiosité, elle est des plus fécondes : c’est l’étude des sources tirées de l’ancien monde hellénique, romain, iranien et indien, non celles issues des peuples nordiques, dont, selon l’auteur, un grand nombre de conceptions seraient en fait altérées par des apports non indo-européens. Et Günther, à l’appui de ses dires, de citer l’exemple du célèbre Odin (Wotan) dont « de nombreux traits (…) ne sont pas indo-européens, et ne sont même pas spécifiquement germaniques ! »
À partir du chapitre II commence une analyse systématique des lignes fondamentales de la religiosité indo-européenne ; apparaît clairement l’opposition radicale entre les religions non-révélées (dites “païennes”) et les religions révélées (comme le christianisme, par ex.). La caractéristique essentielle de la religiosité des Indo-Européens se situe dans la complète absence de crainte envers les dieux, « que ce soit la crainte de la divinité ou la crainte de la mort », qui génère bien entendu une “disposition” mentale et des attitudes particulières. Comme il n’approche pas les dieux avec une attitude servile, craintive, humble, et que, de plus, il ne se conçoit nullement comme simple “créature”, l’homo indo-europeanus éprouve un sentiment de familiarité, de “camaraderie”, avec le divin. Par conséquent, les sphères divine et humaine ne peuvent être nettement délimitées : les dieux et les hommes ne sont jamais très éloignés les uns des autres. Günther précise : « Les dieux y apparaissent comme des hommes immortels (…), et les hommes (…), nés de tribus nobles illustres, possèdent en eux quelque chose de divin… » Et l’auteur de noter : « Agamemnon, pareil aux dieux ». Autre précision importante : pour l’Indo-Européen, ce monde, qui est “sans commencement ni fin”, donc éternel, n’est jamais « dévalorisé » par une “souillure” ou un “péché” quelconque au profit d’un “autre monde”, d’un “arrière-monde” jugé meilleur. Il ignore de même, l’opposition entre « corps périssable et âme immortelle entre chair et esprit ». Toute conception se rapportant au « péché » (remplacé par la “faute” et le “déshonneur”, que l’on trouve également dans le Japon traditionnel), à la “rédemption”, au “Sauveur”, etc., lui est également étrangère. C’est là, véritablement la différence capitale entre la religiosité indo-européenne et celle ’issue du monde proche-oriental, essentiellement sémite.
Dans les chapitres III et IV, Günther aborde l’immense domaine de l’éthique propre aux Indo-Européen ; éthique, bien entendu liée à la profonde religiosité de ces peuples indo-européens. La première constatation que fait Günther : les Indo-Européens ont toujours eu une méfiance instinctive de l’hybris humaine, c’est-à-dire de l’orgueil de soi. Cette répulsion envers cette dernière tient essentiellement au fait que les Indo-Européens ont toujours ressenti leur “limitation” intrinsèque, leur “petitesse” d’êtres contingents et mortels, face à la “non-limitation” des Dieux, et leur dépendance vis-à-vis de ces derniers. Il est à signaler, bien que Günther n’y fasse pas allusion, que cette intuition se retrouvera chez Saint Thomas d’Aquin, dans ses concepts d’être fini et d’Être infini (Dieu). Autre particularité des peuples indo-européens, très bien mise en relief par l’auteur allemand : la reconnaissance et l’acceptation sereine, sans fatalisme, de l’inexorabilité du destin. Günther précise : « C’est essentiellement parce que, face à la certitude que surviendra un déclin, l’Indo-Européen reste lucide, conscient du fait que sa spécificité héréditaire est une spécificité de combattant ». Précision capitale. L’Indo-Européen, concevant le monde comme une arène dans laquelle se déroule un combat perpétuel, selon une conception “agonistique”, se présente, dans la paix comme dans la guerre, comme un guerrier. Loin de le désespérer, c’est cette inéluctabilité de son destin — et la tension existentielle qu’elle provoque — qui pousse l’Indo-Européen à toujours combattre. Cependant, les vertus et les qualités que réclame une telle conception du destin, font qu’elle n’est pas accessible à tout un chacun. « Les religiosités indo-européennes, précise Günther, ne peuvent être transmises à n’importe quel type humain ». Elles s’adressent, non à la masse, mais à l’élite d’un peuple, celle du « mûrissement du héros qui regarde le destin en face, debout à côté de ses dieux ».
Une conception aussi élevée réclamait une religiosité d’une même élévation. Cette religiosité indo-européenne ne pouvait être que « claire » et « limpide », faite du refus d’un “arrière-monde”, meilleur que le monde sensible, d’un sombre mysticisme, de pratiques ascétiques qui brisent le corps, et d’attitudes morbides. Selon Günther, « la religiosité des Indo-Européens est (…) une religiosité de la santé somatique et psychique (…). Elle est davantage une religiosité où l’âme emplie de force divine tente de s’élever au niveau des dieux au départ d’un équilibre : celui de toutes les forces somatiques et psychiques de l’homme ». Ces spécificités induisent, bien sûr, des attitudes particulières de la part de l’homme : prudence, réserve, « une timidité toute de noblesse, qualités qui correspondent à la plénitude du divin », répudiation des passions face à tous les phénomènes, « équilibre et dignité en face du divin », maîtrise de soi et noblesse contenue, auxquelles il faut joindre un sens certain de la mesure (la gravitas des Romains ou l’aidóos des Grecs). La religiosité indo-européenne nous apparaît essentiellement “terrestre”, pleinement enracinée dans ce monde où rien n’est inférieur en valeur par rapport à la divinité. Une telle attitude passe, par exemple, par le refus de tout dualisme, notamment celui corps/âme, pour établir, au contraire, un équilibre entre le corps — qui est honoré comme « expression visible d’une spécification spirituelle… » — et l’âme, même si les Indo-Européens conçoivent fort bien « que le corps et l’âme sont deux choses distinctes et d’essence différente ». Nous aboutissons ainsi à l’harmonieuse unité corps/âme. Ces caractéristiques ont pu faire dire à maints observateurs, à commencer par les auteurs chrétiens, que les religiosités indo-européennes, qualifiées de “païennes”, étaient essentiellement matérialistes, privées d’une véritable “dimension transcendante”. En fait, les Indo-Européens n’ignoraient nullement la notion d’Unité divine transcendante, à notre avis fort mal étudiée par Günther dans son essai. Les Indo-Européens situaient cette Unité divine, non dans un lointain et incertain au-delà, mais bien plutôt dans les actes concrets de la vie terrestre et contingente de l’homme ; aidé en cela par les actions des dieux, aspects divers de la grande Unité spirituelle et morale.
Une autre idée est développée par Günther : le monde serait conçu par les peuples indo-européens comme un ordre, un Kosmos, un tout imprégné d’une raison universelle, d’une ratio. De cet ordre du monde doté de sens dépendrait l’ensemble des “créations” : la famille, le peuple, l’État, le droit, la vie de l’esprit, etc., et bien sûr l’homme, en tant que personne et maillon responsable de la mémoire et de l’héritage ancestral se perpétuant dans un ordre continu des générations. D’où l’importance, chez les Indo-Européens, des idées de fécondité, de génération, de reproduction et d’eugeneia. Si certaines affirmations de Günther méritent de nombreuses réserves, d’autres, par contre, sont fort pertinentes et souvent justes.
Il traite rapidement de la conception de la mort chez les Indo-Européens ; pour eux, elle « n’acquiert jamais la signification cruciale d’un incitant à la foi et à un style de vie empreint de moralisme », mais est plutôt vue comme faisant partie de l’ordre du monde et des choses, et comme un « passage vers une vie qui, dans ses traits particuliers, ressemble à la vie dans le monde des vivants ». Il constate ensuite l’absence totale de rédempteur et de messie, car la vie, telle que la concevaient les Indo-Européens, faite de l’amitié avec les dieux et de l’auto-affirmation mesurée de l’homme au sein d’un monde ordonné doté de sens, rendait inutile toute idée de rédemption et de “sauvetage”. Günther aborde ensuite la forme de mysticisme dans laquelle a pu s’épanouir la religiosité indo-européenne. Forme particulière axée, non « sur une sensibilité exacerbée et un pansexualisme outrancier ni dans la mystique des excitations dues à l’ivresse », qui est le propre des mysticismes informels des peuples du Proche-Orient, mais au contraire fondée sur des pratiques aptes à favoriser une “mise-en-forme” de la personne s’auto-affirmant dans une totale liberté. Dès lors, ce mysticisme indo-européen sera constitué certes par un repli sur soi, vers sa propre intériorité, « en prenant distance par rapport aux tumultes de la vie », mais sans jamais faire abstraction du monde extérieur. Ainsi, précise Günther : « … le mysticisme indo-européen, en tant que regard vers l’intériorité, s’allie souvent avec un regard porté vers le large, vers le grand espace du monde. Ce ne sera donc pas une mystique cherchant à se couper du monde extérieur mais, au contraire, une mystique souhaitant explorer en profondeur les ressources du moi pour porter ensuite son regard vers le lointain ». La caractéristique particulière de cette mystique génère, à son tour, une attitude spécifique. Cette “ouverture sur le monde” fera participer la spiritualité à l’unité/totalité du monde, au “grand Pan”. « Le regard porté par l’Indo-Européen, note le chercheur allemand, sur la splendide immensité du monde (…), peut être interprété comme une acceptation joyeuse d’un Tout sans commencement ni fin (…), comme une manifestation dans la pensée de ce Tout (…) ou comme un sentiment d’identité avec le Tout que l’on a appelé, par ailleurs, “mystique de la nature” ». C’est pourquoi, la religiosité indo-européenne a souvent été qualifiée de “religion naturelle”, au sein de laquelle trouve place la notion d’un Dieu cosmique, « immanent au monde et présent dans l’intériorité de l’âme ». Cette “religion naturelle” revêt, pour les Indo-Européens, un sens profond. La piété et la religiosité qu’elle permet, « reflètent l’esprit et l’éthique, la rectitude de l’homme de race nordique, dont l’attitude mesurée et respectueuse vis-à-vis de la nature se fonde sur une sensibilité marquée par l’honneur et mue par une héroïcité exemplaire ». De plus, la piété de l’Indo-Européen, dans l’atteinte de Dieu, libéré de toute responsabilité des maux qui affligent la vie terrestre, suppose un certain nombre de vertus : « la liberté, la dignité, l’attitude sublime de l’âme noble… ». Tout cela renvoie aux notions d’humanitas, de dignitas, qui sont, en général, le propre d’un petit nombre de personnes, à l’instar des eleutheroï grecs ou des ingenui romains.
Dans le dernier chapitre, Günther fait une analyse serrée et fort juste du monde moderne, plus précisément du XXe siècle. En dernier lieu, l’auteur démontre comment le monde moderne occidental, répudiant les valeurs intrinsèques des antiques peuples indo-européens, est entré dans une décadence irrémédiable. Ainsi en est-il du déclin de la véritable liberté et de la dignité humaine, qui est allé de pair avec l’apparition des idéologies, en particulier des socialismes qui diminuent l’individu au profit de l’État, et, d’une “économisation” (« démonie de l’économie », comme l’a écrit J. Evola) toujours croissante de la société. Un peu plus loin, Günther précise : « … que la perte de la liberté individuelle est inévitable dans toute société industrialisée ». Après avoir constaté que le déploiement de la véritable spiritualité indo-européenne a bel et bien pris fin, Günther conclut par une remarque pessimiste, malheureusement réelle : « À cette indo-européanité qui a brillé de tous ses feux de Benarès à Reykjavik, s’applique une parole d’Hamlet : “Vous ne verrez jamais rien qui l’égalera !” »
Enfin, in fine, il faut noter une excellente Annexe du traducteur : Les races d’Europe selon Günther.
Cet ouvrage de Hans F.K. Günther est capital. Certes, il contient du bon et du moins bon, et par maints cotes, il apparaîtra, non comme dépassé, mais comme sommaire à côté des immenses et définitifs travaux d’un G. Dumézil, par ex. Cependant, il mérite largement d’être lu, ne serait-ce que pour ce qu’il est : un tout premier document important des études indo-européennes, alors balbutiantes et qui, depuis, se sont fortement enrichies.
* * *
L’Âge d’Or n°10, 1990.
 " Très jeune héros de la Grande Guerre, nationaliste opposé à Hitler, ami de la France, Ernst Jünger (1895-1997) fut le plus grand écrivain allemand de son temps. Mais ce n'est pas rendre service à l'auteur d'Orages d'acier que de le ranger dans la catégorie des bien-pensants. Il n'a cessé au contraire de distiller un alcool beaucoup trop fort pour les gosiers fragiles. C'est ce Jünger, dangereux pour le confort, que restitue Dominique Venner. Il y replace l'itinéraire de l'écrivain dans sa vérité au coeur des époques successives qu'il a traversées. Belliciste dans sa jeunesse, admirateur d'Hitler à ses débuts, puis opposant irréductible, subsiste en lui le jeune officier héroïque des troupes d'assaut qui chanta La Guerre notre mère, et l'intellectuel phare de la révolution conservatrice ". Mais il fut aussi le guerrier apaisé qui tirait gloire d'avoir donné son nom à un papillon. Dans cette biographie critique, Dominique Venner montre qu'aux pires moments du siècle Jünger s'est toujours distingué par sa noblesse. En cela il incarne un modèle. Dans ses écrits, il a tracé les lignes d'un autre destin européen, enraciné dans les origines et affranchi de ce qui l'opprime et le nie.
" Très jeune héros de la Grande Guerre, nationaliste opposé à Hitler, ami de la France, Ernst Jünger (1895-1997) fut le plus grand écrivain allemand de son temps. Mais ce n'est pas rendre service à l'auteur d'Orages d'acier que de le ranger dans la catégorie des bien-pensants. Il n'a cessé au contraire de distiller un alcool beaucoup trop fort pour les gosiers fragiles. C'est ce Jünger, dangereux pour le confort, que restitue Dominique Venner. Il y replace l'itinéraire de l'écrivain dans sa vérité au coeur des époques successives qu'il a traversées. Belliciste dans sa jeunesse, admirateur d'Hitler à ses débuts, puis opposant irréductible, subsiste en lui le jeune officier héroïque des troupes d'assaut qui chanta La Guerre notre mère, et l'intellectuel phare de la révolution conservatrice ". Mais il fut aussi le guerrier apaisé qui tirait gloire d'avoir donné son nom à un papillon. Dans cette biographie critique, Dominique Venner montre qu'aux pires moments du siècle Jünger s'est toujours distingué par sa noblesse. En cela il incarne un modèle. Dans ses écrits, il a tracé les lignes d'un autre destin européen, enraciné dans les origines et affranchi de ce qui l'opprime et le nie.

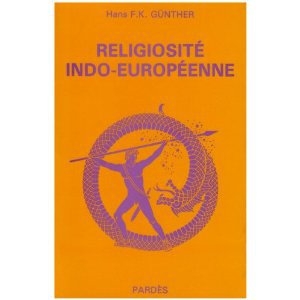 Günther se présente comme le théoricien du courant “nordique” dans l’Allemagne de la République de Weimar. Il publia en 1934 un essai, désormais classique, intitulé Frömmigkeit nordischer Artung (que l’on traduit par “Religiosité de type nordique”), dans lequel il présentait de façon largement synthétique les grands traits spirituels des religions indo-européennes. Cet essai, édité récemment par les Éditions Pardès et traduit ici pour la première fois en français, est issu des textes de la sixième édition allemande, parue en 1963, et de l’édition anglaise, plus complète, parue en 1967. Quant au titre, qui présente une notable différence avec le titre originel allemand, il est tiré de celui de l’édition italienne intitulée Religiosità indoeuropea.
Günther se présente comme le théoricien du courant “nordique” dans l’Allemagne de la République de Weimar. Il publia en 1934 un essai, désormais classique, intitulé Frömmigkeit nordischer Artung (que l’on traduit par “Religiosité de type nordique”), dans lequel il présentait de façon largement synthétique les grands traits spirituels des religions indo-européennes. Cet essai, édité récemment par les Éditions Pardès et traduit ici pour la première fois en français, est issu des textes de la sixième édition allemande, parue en 1963, et de l’édition anglaise, plus complète, parue en 1967. Quant au titre, qui présente une notable différence avec le titre originel allemand, il est tiré de celui de l’édition italienne intitulée Religiosità indoeuropea.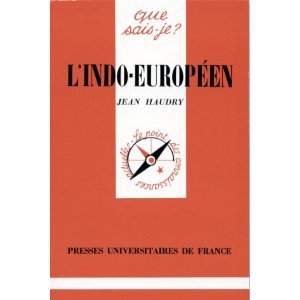 “intellectuel”, que de rééditer l’ouvrage d’un chercheur aussi contesté et incompris que Hans F. K. Günther. Pour certains de nos contemporains, aux opinions fabriquées et imposées par les médias, Günther apparaîtra comme un “type” bizarre, “démodé”, passablement dangereux par les idées qu’il expose, tant les mots et les expressions qu’il emploie ont le pouvoir sémantique d’évoquer un ensemble d’idées qui prévalurent au cours d’une période précise de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe. De plus, ce brillant chercheur allemand passe volontiers, à tort, pour l’anthropologue officiel du IIIe Reich. Dans cette optique, la pensée et les travaux de Günther ont subi une “tabouisation” et une “criminalisation” de la part des Torquemada au petit pied du conformisme moral occidentalo-mondialiste et des minus médiatiques. C’est pour cela que la décision des Éditions Pardès de traduire et de publier ce maître-livre de Günther constitue, non seulement un acte d’utilité quant à une plus grande connaissance des recherches de l’auteur allemand, mais aussi un acte de courage. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
“intellectuel”, que de rééditer l’ouvrage d’un chercheur aussi contesté et incompris que Hans F. K. Günther. Pour certains de nos contemporains, aux opinions fabriquées et imposées par les médias, Günther apparaîtra comme un “type” bizarre, “démodé”, passablement dangereux par les idées qu’il expose, tant les mots et les expressions qu’il emploie ont le pouvoir sémantique d’évoquer un ensemble d’idées qui prévalurent au cours d’une période précise de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe. De plus, ce brillant chercheur allemand passe volontiers, à tort, pour l’anthropologue officiel du IIIe Reich. Dans cette optique, la pensée et les travaux de Günther ont subi une “tabouisation” et une “criminalisation” de la part des Torquemada au petit pied du conformisme moral occidentalo-mondialiste et des minus médiatiques. C’est pour cela que la décision des Éditions Pardès de traduire et de publier ce maître-livre de Günther constitue, non seulement un acte d’utilité quant à une plus grande connaissance des recherches de l’auteur allemand, mais aussi un acte de courage. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

 Lorsqu’il s’agit d’aborder le cas Georges Valois (1878-1945), c’est peut-être le terme de « rupture » qui s’impose en premier lieu à l’esprit. En effet, ce singulier personnage aura successivement adhéré aux idéologies marquantes de l’âge des extrêmes, de l’anarchisme à l’Action française (dont il sera un des premiers dissidents), d’un fascisme à la française clairement revendiqué au syndicalisme, jusqu’à enfin une doctrine économique trop peu étudiée encore, « l’abondancisme ».
Lorsqu’il s’agit d’aborder le cas Georges Valois (1878-1945), c’est peut-être le terme de « rupture » qui s’impose en premier lieu à l’esprit. En effet, ce singulier personnage aura successivement adhéré aux idéologies marquantes de l’âge des extrêmes, de l’anarchisme à l’Action française (dont il sera un des premiers dissidents), d’un fascisme à la française clairement revendiqué au syndicalisme, jusqu’à enfin une doctrine économique trop peu étudiée encore, « l’abondancisme ».

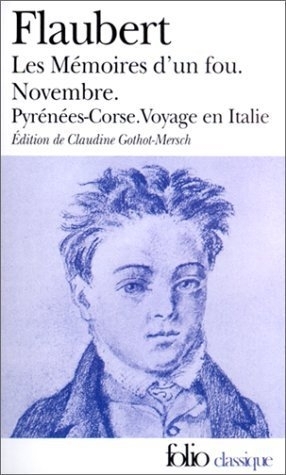 Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :
Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :