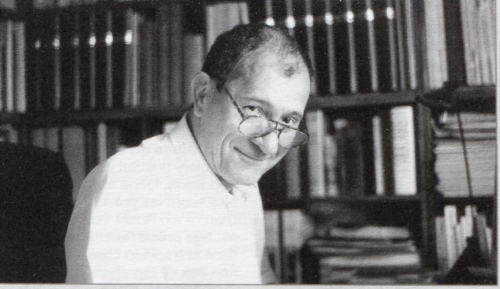
Le dernier Cahier libre d'Histoire de Jean-Claude Valla est consacré à Georges Valois. Nous en ayons profité pour l'interroger sur ses travaux. Propos d'un écrivain qui a choisi la liberté.
Votre dernier Cahier est consacré à Georges Valois, le précédent à Ramiro Ledesma Ramos. Le point commun à ces deux personnages n'est-il pas leur intérêt pour l'organisation syndicale de l'État ?
Vous avez parfaitement raison et c'est en travaillant sur Valois que j'ai été amené à m'intéresser à Ledesma. Le personnage m'a tellement fasciné que je l'ai traité avant Valois, sur lequel j'ai beaucoup peiné avant de mieux saisir sa personnalité. Georges Valois n'a cessé tout au long de sa vie d’échafauder des systèmes d'organisation sociale. C’est un réformateur et, au fond, un technocrate avant la lettre. Ledesma, lui, est un révolutionnaire, un vrai, qui rêve de porter le fer contre la société bourgeoise et se méfie des constructions de l'esprit trop abstraites.
Valois n'a pas exercé d'influence directe sur Ledesma, mais, outre le fait qu'ils ont eu un maître en commun : Georges Sorel, plusieurs anciens du Faisceau - Philippe Lamour, rédacteur en chef de la revue Plans, et Hubert Lagardelle, notamment - ont été lus par Ledesma qui a publié quelques-uns de leurs articles en 1931 dans son hebdomadaire La Conquista del Estado. Je pense notamment à «L'homme réel et le syndicalisme» de Lagardelle.
Ce n'est pas un hasard si Plans et La Conquista del Estado ont manifesté le même intérêt pour le fascisme et le communisme qui, au-delà de leurs différences, traduisaient, selon les propres termes de Philippe Lamour, une aspiration à « un ordre nouveau, un ordre moderne », et faisaient appel, l'un et l'autre, « aux élites nouvelles, à la jeunesse du monde »(1). Sorel lui-même, on le sait, a exercé une double influence : sur Mussolini et Lénine.
Concernant Valois, vous n'évoquez que ses années de jeunesse, son évolution de l'anarcho-syndicalisme au fascisme, mais sans aborder le Faisceau qui fut pourtant le premier parti français à se réclamer du fascisme. Pourquoi ?
À dire vrai, l'histoire du Faisceau ne me passionne guère, à l'exception de quelques épisodes comme le ralliement en février 1926 de Marcel Delagrange, maire communiste de Périgueux, ou celui, en mars 1927, de Henri Lauridan, secrétaire des syndicats ouvriers du Nord. Le Faisceau, créé par Valois en novembre 1924, a disparu trois ans plus tard, pour la simple et bonne raison que Valois, contrairement à Bucard ou à Doriot, n'avait aucune des qualités requises pour être un chef fasciste. Et je suis tenté de dire que le propre du fascisme est de transcender le nationalisme, de tendre à l'universalité, pour reprendre la formule très «romaine» de Mussolini. Même Hitler avait une conception transnationale de l'Europe, dans la mesure où il contestait les États-nations nées à Versailles, Trianon et Saint-Germain-en-Laye. Or, Valois est un nationaliste français indécrottable, aveuglé de surcroît par sa germanophobie. Alors que la plupart des anciens combattants souhaitaient une politique de rapprochement franco-allemand, lui, l'ancien de Verdun, estimait que l'Allemagne devait «payer» indéfiniment. Malgré sa rupture avec l'Action française et les campagnes de dénigrement dont il avait été l'objet de sa part, il avait conservé du monde germanique une vision toute maurrassienne.
Ses années de jeunesse m'ont davantage intéressé, car j'ai voulu essayer de comprendre comment un homme tel que lui, élevé dans la plus stricte tradition républicaine, acquis très jeune aux idées anarchistes et au dreyfusisme, a pu évoluer vers l'antisémitisme, le monarchisme et le fascisme. Dès 1908, alors que Mussolini n'a pas encore «inventé» le fascisme, il professe des idées que le Duce n'aurait pas désavouées quinze ou vingt ans plus tard. L'itinéraire de Valois, avant celui de Mussolini, de Gustave Hervé, de Doriot, de Déat et de bien d'autres, semble confirmer que le syncrétisme fasciste doit finalement plus à la gauche qu'à la droite, l'Allemagne nationale-socialiste étant un cas de figure plus complexe.
Votre Cahier sur Georges Valois est le onzième de la série, trois ans après la publication du premier. Vous êtes un historien prolifique...
Je publie un Cahier par trimestre. C'est un rythme soutenu. Mais, n'ayant aucun des diplômes requis, je ne me prétends pas historien. On prête à Jean Tulard cette formule contre les « pseudo-historiens qui se contentent de reprendre le travail des vrais chercheurs »(2). Ma longue carrière journalistique et les responsabilités que j'ai exercées dans ce secteur m'ont empêché de faire de la recherche digne de ce nom, sauf en ce qui concerne Lyon pendant les années d'Occupation. Je suis plutôt un compilateur et un vulgarisateur. La compilation et la vulgarisation, à condition d'être sérieusement faites, sont indispensables à la compréhension de l'histoire. Il n'y a aucune honte à reprendre le travail des vrais chercheurs, car les matériaux qu'ils nous fournissent doivent être interprétés, mis en perspective et passés au crible de la critique. Pour moi, les «pseudo-historiens» sont plutôt ceux qui se targuent du titre de chercheurs, mais qui, au lieu de faire de la recherche - travail pour lequel ils sont payés avec l'argent des contribuables -, se recopient les uns les autres et n'ont guère de scrupules à trafiquer l'histoire, car, pour conserver leurs prébendes, ils ont renoncé à tout esprit critique et abdiqué devant le politiquement correct.
Êtes-vous un historien engagé ?
Je me suis engagé à combattre la falsification de l'histoire contemporaine. Sur la période qui m'intéresse le plus et que je connais le mieux - les années d'Occupation -, beaucoup d'historiens, même les plus honnêtes, se croient obligés de faire des concessions à l'idéologie dominante, ne serait-ce que pour continuer à publier chez de grands éditeurs et à être invités sur les plateaux de télévision. Certains d'entre eux, comme Henri Amoureux, s'autocensurent. C'est le péché par omission. Un moindre mal. D'autres parsèment leurs ouvrages de réflexions partisanes qui, à mon sens, contribuent à décrédibiliser leur travail, mais ils espèrent ainsi se dédouaner, sans toujours y parvenir, car, il faut bien le dire, les censeurs sont de plus en plus exigeants. Moi, je n'ai à craindre personne... si ce n'est les juges de la XVIIe Chambre! En créant mes Cahiers libres d'Histoire, j'ai fait une croix sur les gros médias n'en parleraient jamais. C'était le prix de la liberté.
À défaut du grand public, quels types de lecteurs cherchez-vous à atteindre ?
Je ne choisis pas mes lecteurs. La Librairie Nationale qui édite et diffuse mes Cahiers a une clientèle variée, de tous âges, de toutes catégories socio-professionnelles et de toutes sensibilités philosophiques. La vente par correspondance privilégie les personnes qui, ayant quitté la vie active, ont davantage de temps pour lire des livres et parfois de moyens pour les acheter. Les plus âgés ont souvent connu certains événements que je décris. Ceux de la génération suivante en ont beaucoup entendu parler dans leurs familles. Excédés par le manichéisme d'aujourd'hui, ils me savent gré de rétablir la complexité de cette époque. J'ai aussi la satisfaction, lors de mes conférences ou des ventes-signatures auxquelles je participe, de rencontrer de jeunes professeurs d'histoire qui me lisent avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils trouvent dans mes Cahiers les arguments dont ils ont besoin pour résister au rouleau compresseur de l'enseignement officiel. J'apporte des «munitions», mais j'espère aussi ouvrir des pistes de recherche pour les historiens de demain... si jamais nous arrivons à sortir de ces «années de plomb».
Propos recueillis par Michel Marmin : éléments N° 110 Octobre 2003
J.-C. Valla, Georges Valois. De l'anarcho-syndicalisme au fascisme, Les Cahiers libres d'Histoire (Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, 75001 Paris), 120 p., 17 € (21 € franco de port).
1) Entretiens sous la Tour Eiffel, Paris, 1929.
2) Napoléon 1", le magazine du Consulat et de l'Empire, n° 14, mai-juin 2002.


 L'unité du royaume, le bien commun et la raison d'État doivent conduire le Prince à savoir lâcher du lest... Les guerres de religion ont inspiré à Montaigne une réflexion tout en nuances sur la nécessaire tolérance. Une tolérance qui relève d'ailleurs moins d'un absolu moral que d'un réalisme politique. Auteur d'un étincelant « Montaigne stratège », Éric Wemer nous invite à une relecture des «Essais».
L'unité du royaume, le bien commun et la raison d'État doivent conduire le Prince à savoir lâcher du lest... Les guerres de religion ont inspiré à Montaigne une réflexion tout en nuances sur la nécessaire tolérance. Une tolérance qui relève d'ailleurs moins d'un absolu moral que d'un réalisme politique. Auteur d'un étincelant « Montaigne stratège », Éric Wemer nous invite à une relecture des «Essais».