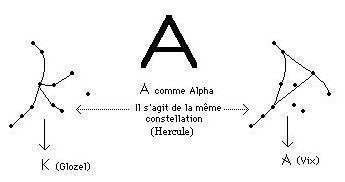Voici un extrait du mémoire universitaire d’un lecteur (Cortez) sur les raisons et l’évolution de la présence française en Algérie.
Voici un extrait du mémoire universitaire d’un lecteur (Cortez) sur les raisons et l’évolution de la présence française en Algérie.En effet depuis le XVIème siècle et malgré diverses tentatives plus ou moins florissantes pour établir de timides liaisons commerciales maritimes, la marine barbaresque s’emploie à semer le trouble en Occident en piratant en Méditerranée. Ce ne sont pas des actes de guerres à proprement parler qui sont perpétrés par les hommes de la marine barbaresque, on assiste plutôt à une sorte de «guérilla» maritime au cours de laquelle les marins attaquent presque au gré des vents les navires de commerce européens qui croisent leur route.
Les bénéfices sont intéressants pour ces pirates qui récupèrent le navire, sa cargaison, ses hommes d’équipages qui deviennent «de facto» esclaves ainsi que tout le matériel du bord. Ces navires sont ensuite soit récupérés et réarmés aux couleurs barbaresques, soit dépouillés de leurs mâts, voiles et vergues que l’on s’empresse de réutiliser sur un navire en construction, en mettant à profit le travail des esclaves enlevés au cours de ces expéditions.
C’est ainsi que la régence d’Alger entretient tant bien que mal une marine, et c’est par cette menace qu’elle obtient des grandes puissances européennes de confortables entrées d’espèces. Il est clair que les actes de pirateries des marins du Maghreb nuisent considérablement à la sécurité du trafic et les puissances européennes doivent payer un lourd tribut pour conserver une paix illusoire. Depuis deux cents ans les navires algériens sillonnent la Méditerranée de Gibraltar à Messine dans le but de s’emparer des biens, des hommes et du navire, certains témoignages font même état de la présence de navires ayant piraté en Atlantique aux alentours de Brest et pour certains jusqu’en Islande et à Terre-neuve !
Un rapport du gouvernement général d’Algérie nous en fourni le témoignage : « {…} dans les archives du consulat, des renseignements qui établissent authentiquement les excursions faites dans l’océan par les corsaires algériens, à la fin du 17ème siècle :
- »L’Islande même, malgré ses glaces et sa pauvreté ne fut point à l’abri de leurs ravages, en 1616 le fameux Mourad Rais promena son pavillon dans ces parages lointains »
- » 2 janvier 1690 PV constatant que la tartane Française Ste Anne patron Louis Cauvignac, a été coulée par un vaisseau algérien, aux iles Canaries »
- »4 janvier 1695, déclaration que le navire Hollandais Santa-Clara de 63 hommes d’équipages, 24 pièces de canons et 12 pierriers, a été pris le 7 Janvier par un vaisseau d’Alger nommé La Rose à 40 milles du Cap Saint-Vincent »
- »12 mars 1699, le consul certifie que le navire Portugais St Gaetan allant de Lisbonne à Hambourg a été pris par un corsaire algérien en mars 1698″
- »17 mars 1719, Martin Prins capitaine Hollandais déclare, qu’allant d’Amsterdam à Bordeaux avec son navire le Jean, il a été pris par une caravelle d’Alger à 9 lieues de la terre d’Ouessant, près de Brest le 13 Juin 1718″ ».
Bien sûr pour faire cesser ces exactions on tenta des rapprochements, sorte d’entente se voulant cordiale et garantissant une paix entre les marines des deux pays. La France cherchant par là à soustraire du traitement violent que subissaient la plupart des navires et équipages des autres nations européennes sa propre flotte. Ces relations «privilégiées» que la France désirait entretenir avec la Régence d’Alger n’étaient bien sur pas gratuites.
Au XVIIIème siècle, tout corsaire algérien qui allait appareiller, se rendait au consulat pour obtenir deux documents bien particuliers : d’une part un papier destiné à assurer tant à son navire qu’à ses prises éventuelles la protection des bâtiments de guerres français rencontrés en mer. D’autre part le chancelier remettait au Rais, un exemplaire imprimé en blanc des passeports délivrés dans les ports de France à nos navires marchands, ceci dans le but de donner aux corsaires les moyens de constater l’identité des bâtiments qu’ils arrêtaient et qui se disaient français. Force est de constater que malgré ces «accords» et en dépit de tout respect de quelconques traités, la marine barbaresque va continuer à harceler, piller et voler les navires de commerce de toutes les nationalités qui croisent dans les eaux de la méditerranée. Les prises sont nombreuses et variées on en recense chaque année, de nombreux navires Génois, Portugais, Hollandais, Anglais et bien sur Français sont victimes des corsaires barbaresques.
Parfois sont organisées des «razzias» sur les cotes accessibles et peu défendues, les têtes de maures des drapeaux corses et sardes en sont le lointain témoignage quant à l’époque on plantait au bout de lances et de piques les têtes des envahisseurs que l’on avait tué.
La monarchie de Juillet va précipiter l’intervention de la France au Maghreb, mais en 1800 ce n’est pas un désir de conquête qui motive les Français, mais surtout un désir de maitrise du commerce maritime et de sécurité en méditerranée.
La sécurité des mers va permettre aux navires Français et occidentaux de naviguer plus librement, ce qui va favoriser la naissance de nouvelles voies maritimes ainsi que la création de nombreuses compagnies maritimes ; bref un essor commercial général et gloire au port qui en sera le fer de lance. Il est important d’avoir en tête le fait que la volonté Française de s’installer au Maghreb est à l’origine motivée par un désir de paix, pour faire cesser les activités malveillantes des pirates maghrébins et stopper la pratique de l’esclavage. D’ailleurs il n’est question au départ que de prendre possession du littoral algérien afin de faire stopper toute activité maritime, sans chercher à s’installer durablement ni à étendre la domination à l’intérieur des terres. Cette idée de la colonisation va naitre quelques années plus tard lorsque les Français vont prendre conscience des possibilités économiques qu’offrirait une maitrise totale du pays soutenue par l’élan de la 3ème République.
Les réflexions d’Alexis de Tocqueville dans son rapport illustrent bien la nouvelle orientation que va prendre progressivement la politique Française sur le sol maghrébin : « À mesure que nous connaissons mieux le pays et les indigènes, l’utilité et même la nécessité d’établir une population européenne sur le sol de l’Afrique nous apparaissent plus évidentes. ».
Après la guerre lorsque la domination Française sur les cotes fut établie et reconnue, après que le but premier de faire cesser la course et sécuriser le commerce maritime fut atteint, l’idée d’aller plus loin dans l’occupation va donc apparaitre de plus en plus comme une évidence, tant les retombées économiques d’une colonisation de cette région du monde apparaissent intéressantes.
Alexis de Tocqueville : « En conquérant l’Algérie, nous n’avons pas prétendu, comme les Barbares qui ont envahi l’empire romain, nous mettre en possession de la terre des vaincus. Nous n’avons eu pour but que de nous emparer du gouvernement. La capitulation d’Alger en 1830 a été rédigée d’après ce principe. On nous livrait la ville, et, en retour, nous assurions à tous ses habitants le maintien de la religion et de la propriété. C’est sur le même pied que nous avons traité depuis avec toutes les tribus qui se sont soumises. S’ensuit-il que nous ne puissions nous emparer des terres qui sont nécessaires à la colonisation européenne ? »
Le bombardement d’Alger en 1830
1. Causes politiques
On peut aussi voir dans l’action de l’empire français en Algérie, une façon pour le gouvernement de l’époque de retrouver un peu de grâce auprès de son peuple en ravivant des passions quelques peu oubliées, de croisades et de sainte foi.
On évoque souvent un fait qui peut apparaitre comme anecdotique, mais qui, à en croire certains historiens, a pu fortuitement devenir le catalyseur du déclenchement de l’action Française en Algérie. En 1827, lors d’une entrevue, le dey d’Alger donne un coup d’éventail au consul de France car celui-ci refuse de s’engager sur le remboursement d’un prêt. Cet évènement qui fut au début ignoré par Paris va en quelques mois prendre une importance de plus en plus grande et servir de prétexte à l’intervention Française en Algérie.
Le ministère Polignac, gouvernement ultra constitué par Charles X le 8 août 1829, était en butte à une telle impopularité dans le pays, l’opposition libérale y acquérait une telle audience, que l’affaire d’Alger, traitée quelque peu négligemment jusque-là, s’offrit à lui pour redorer son blason et préparer des élections favorables : le gouvernement « arrêta ses idées sur une expédition militaire qui offrît à la fois de la gloire à l’année, de grands avantages au pays, et qui vint frapper les imaginations par la grandeur et l’étrangeté de son but : la conquête d’Alger remplissait toutes ces conditions. On y trouvait tout le merveilleux des croisades, la nationalité de l’expédition d’Égypte, et l’éclat des victoires de Fernand Cortez.
« Elle délivrait l’Europe de la plus humiliante servitude ; elle servait la cause de la morale et de l’humanité ; elle devait offrir à l’agriculture, au commerce, à l’industrie et à la civilisation, d’immenses moyens de succès, et, à l’ambition, un des plus beaux pays du globe et les richesses d’une ville qui, depuis trois cents ans, enfouissait les trésors de la chrétienté et le fruit des rapines et des brigandages de ses habitants. »
Le 2 mars 1830, lors de la séance d’ouverture de la Chambre, Charles X annonça officiellement sa décision : « Au milieu des graves événements dont l’Europe était occupée, j’ai dû suspendre l’effet de mon juste ressentiment contre une puissance barbaresque ; mais je ne puis laisser plus longtemps impunie l’insulte faite à mon pavillon ; la réparation éclatante que je veux obtenir, en satisfaisant à l’honneur de la France, tournera, avec l’aide du Tout-Puissant, au profit de la chrétienté. »
L’opposition libérale se mobilisa contre une expédition qui permettait au régime de sortir « des voies de la légalité » et de s’engager « sur la route incertaine de l’arbitraire et des ordonnances » à des fins de politique intérieure. Mais rien ne put aller contre la décision qui était prise, un engrenage venait de se lancer qui allait mettre plus d’un siècle à s’arrêter et dont on était bien loin à l’époque d’imaginer les conséquences.
Louis-Auguste-Victor de Bourmont, ministre de la Guerre, obtint donc le commandement de l’expédition, dont il organisa les préparatifs. La flotte, une fois prête, compta 675 bâtiments (103 navires de guerre et 572 bâtiments de commerce). Finalement, 37 000 hommes embarquèrent, du 11 au 18 mai, avec Bourmont pour chef. Le vice-amiral Duperré était responsable de la flotte. L’état-major était dirigé par le général Desprez.
Le 24 mai, les vents favorables permettaient le départ de l’expédition dans un concours d’allégresse : « A midi, la brise se fit belle et bonne [...]. Le départ, si longtemps retardé, devint un grand événement dont tout le monde voulait être témoin : quatre cents voiles sortant à la fois de la belle rade de Toulon, étaient un spectacle qu’on n’avait jamais vu, et que très probablement on ne devait jamais revoir. [...] « A cinq heures, La Provence se mit sous voile, et, à la chute jour, il ne restait plus un seul vaisseau dans ce port, qui, quelques auparavant, contenait toute la marine française. » Alger ! Alger ! » criait-on de toutes parts, comme les Romains criaient » Carthage ! » »
Alger va capituler trois semaines après l’invasion Française en Algérie, le Dey Hussein abdique avec la garantie de conserver sa liberté et ses richesses personnelles.
Sous couvert d’une expédition punitive, l’opération se transforme en guerre de colonisation, les troupes Françaises débarquent sur la plage de Sidi Ferruch à quelques kilomètres d’Alger. Le Sultan d’Istanbul exerce alors sa souveraineté sur l’Algérie, mais dans les faits, l’intérieur du pays est laissé à l’abandon. L’expédition d’Alger avait un enjeu économique, la maitrise du commerce en méditerranée et une justification de politique intérieure : redorer le blason d’un gouvernement impopulaire. On dénonça cette expédition «liberticide», on s’en prit aux hommes qui devaient en assumer le commandement et notamment à Bourmont, ministre de la guerre à qui échut la responsabilité des opérations. C’est dans une large mesure pour parer aux critiques de l’opposition que les services du ministère de la Guerre firent rédiger et imprimer un Aperçu historique, statistique et topographique sur l’État d’Alger, à l’usage de l’armée expéditionnaire d’Afrique, dont il fallait soigner le moral, prévenir les imprudences et satisfaire la curiosité. Un ouvrage de propagande, mais aussi une remarquable source historique qui nous livre un excellent résumé de ce qu’on savait, ou croyait savoir, de l’Algérie, en 1830.
Le guide distinguait nettement les différentes composantes du peuple d’Algérie , notamment les Turcs, « maîtres souverains du pays », qu’on aurait surtout à combattre, des autres éléments musulmans (Arabes, «Maures», Berbères), dont on pourrait gagner la sympathie. Mais ajoutait-il : « En général, les habitants des États d’Alger ont des mœurs fort corrompues ; ils témoignent aux étrangers beaucoup de brutalité et de hauteur, ce qu’il faut attribuer au manque d’éducation et à l’habitude de commander dans leur intérieur à des esclaves de toutes les nations. »
A l’exception de l’Angleterre qui voyait d’un mauvais œil le danger d’expansion française en Méditerranée, les puissances européennes dans leur ensemble donnèrent leur aval à une expédition qui leur promettait de les débarrasser des corsaires barbaresques tout en reprenant le drapeau de la croisade. Car c’est effectivement l’empire français qui prit la décision d’envahir l’Algérie pour faire cesser la piraterie mais l’ensemble des états qui possédaient une flotte et faisaient du commerce en méditerranée étaient victimes de ces actes illégaux. Ainsi le rais Hamidou s’empare en 1802 d’une frégate portugaise de 44 canons avec 282 hommes à bord ! Les tunisiens ne sont pas en reste, en 1798 ils ramènent toute la population de l’ile Saint-Pierre soit un millier d’esclaves. En 1815 ils capturent encore 125 chrétiens à saint-Antioche. Aucun n’avait pris la décision de faire cesser militairement cette situation mais tous se félicitaient des conséquences positives pour leur commerce et leur flotte de l’action de l’empire français. Obtenir la maitrise du commerce en méditerranée serait la récompense des français, avec pour Charles X l’assurance d’une bonne presse et d’une remontée dans l’estime du peuple français.
Mais la prise d’Alger n’eut pas les effets escomptés et ne put éviter le drame qui se jouait à Paris, car déjà la Restauration vacillait. Le nouveau régime de Louis-Philippe, établi en juillet 1830, remplaça Bourmont par Clauzel. Restait à savoir ce qu’on allait faire de la conquête. Bugeaud, son successeur, devait écrire, quelque temps plus tard, à un ami : « La Restauration se targue de nous avoir donné l’Algérie, elle ne nous a donné qu’Alger et elle nous a fait un funeste présent. Je crains qu’il ne soit pour la monarchie de Juillet ce que l’Espagne a été pour l’Empire. Avec une nation qui se paye de grands mots et qui a la velléité des grandes choses avec les petites passions et la parcimonie des épiciers, on ne saura prendre aucun grand parti sur l’Afrique » Terminons par cet extrait des « cahiers du centenaires de l’Algérie » datant de 1930 :
« D’après les estimations de la Chambre de commerce de Marseille, en 1832, l’Alger turc importait pour 6.500.000 Fr. de marchandises européennes. Il les payait apparemment avec les bénéfices de la piraterie, puisqu’on estimait les exportations à 14 ou 15.000 francs. Dans l’Algérie française, en 1924, le total des exportations et importations était de 5 milliards 394 millions; ce total en 1929 atteindra probablement 8 milliards, en francs papier il est vrai. Il faut songer que ces huit milliards de richesse sont une création pure. Ils sont sortis intégralement du coup d’éventail du dey ».
2. Le « bond » colonial.
La France arrive donc en Algérie en 1830 mais les «effets» de la colonisation ne vont pas être instantanés, tant la colonisation-au sens premier du terme, c’est-à-dire avec l’arrivée de colons et l’installation de la France sur le sol Algérien-elle-même ne va pas être immédiate. Les avis sont tout d’abord partagés quant à l’utilité réelle de la présence Française en Algérie, et même en cas d’accord sur le bien-fondé de cette expédition, surviennent des débats houleux concernant la façon d’aborder et de gérer sur le long terme cette situation. Revenons un instant sur la chronologie des évènements de l’époque afin de mieux comprendre ce qui va amener la France à finalement opter pour une conquête «totale». En 1830, alors même qu’il vient de faire envahir l’Algérie, Charles X est déchu et c’est alors Louis-Philippe qui est proclamé Roi de France. Celui-ci n’a d’autre solution que de finir ce qui vient d’être commencé mais ne mets pas en place de « système colonial » particulier visant à faire de l’Algérie une véritable colonie de colons.
En 1848 Louis-Philippe abdique, la seconde République est proclamée qui voit Louis-Napoléon Bonaparte être élu président, ce dernier a son idée au sujet de l’Algérie mais il va attendre son sacre et la proclamation du second empire pour les mettre en application. Nous sommes en 1852 et Napoléon III avance alors sa conception de « royaume arabe » pour l’Algérie. L’idée est simple, il s’agit de faire venir un certain nombre de colons afin de garder la mainmise sur un pays - et surtout son littoral - qui agissait il y a peu de temps en ennemis vis-à-vis de la France et de créer une véritable «barrière» entre colons et populations locales. Voici un extrait des « cahiers du centenaire de l’Algérie » nous expliquant cette politique : « Les colons étaient parqués dans des réserves autour de quelques grandes villes. Tout le reste était le royaume arabe. Les indigènes, gouvernés par les officiers des bureaux arabes, y étaient efficacement séparés de la colonisation, tenus sous cloche, abandonnés à leur propre puissance évolutive. C’était une idée intéressante. Une certaine analogie est évidente avec ce que nous appelons aujourd’hui le protectorat ».
Il apparait clairement la volonté de ne pas aller plus avant dans un processus de colonisation global, Napoléon III cherchant a priori à agir pour les intérêts nationaux en assurant une présence de colons sur le littoral mais sans prendre à son compte la gestion et l’exploitation d’un pays et de ses ressources. En 1870 est proclamée la 3ème République et c’est bien à cette époque que va naitre le véritable empire colonial Français. La colonisation algérienne est déjà bien commencée et il ne reste plus qu’à conquérir tout entier un pays dont la présence Française depuis quarante ans n’a eu que peu d’influence.
http://www.fdesouche.com