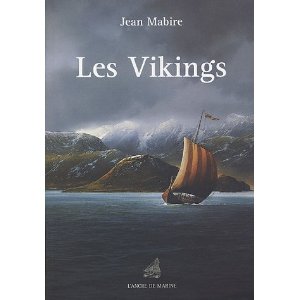Le
8 novembre 1226, à la mort du roi Louis VIII le Lion, son jeune fils
lui succède sous le nom de Louis IX. Il est sacré à Reims le 29 novembre
suivant. Son règne coïncidera avec l'apogée de la France capétienne et
chrétienne et il restera dans la postérité sous le nom de Saint Louis.
Le «siècle de Saint Louis»
Le XIIIe siècle français est souvent qualifié de «siècle de Saint Louis». Né l'année de la bataille de Bouvines
(1214), le roi règne en effet de 1226 à 1270. Dans cette longue
période, il porte le royaume capétien à son maximum de prestige.Chevalier courageux et combatif, souverain habile et sage, mari empressé autant que fidèle, profondément pieux, le roi Louis IX apparaît comme le modèle du chevalier chrétien, d'où sa canonisation quelques années à peine après sa mort.
Le roi met fin à la première guerre contre l'Angleterre ainsi qu'à la croisade contre les Albigeois. Il régularise les relations entre la France et l'Aragon. Il remet enfin à leur place les turbulents féodaux et modernise l'administration.
Sous son règne, Paris devient la ville la plus prestigieuse de la chrétienté occidentale avec son Université et ses monuments (Sainte Chapelle, Notre-Dame). Les foires de Champagne, entre Flandres et Lombardie, stimulent le commerce et la naissance d'une bourgeoisie urbaine active et entreprenante.
Une prise de pouvoir progressive
Par sa mère Blanche de Castille, le nouveau roi est est l'arrière-petit-fils d'Henri II et Aliénor d'Aquitaine.
Il n'a que 12 ans quand il succède à son père et c'est sa pieuse mère
qui prend alors en main les destinées du royaume avec le titre de «baillistre» (régente, d'après le vieux français baillir, synonyme d'administrer).
La baillistre met un terme à la croisade contre les Albigeois en concluant le traité de Meaux
avec le comte de Toulouse en 1229. En 1234, elle soutient une lutte
difficile contre de turbulents vassaux comme le comte de Boulogne, le
duc de Bretagne et le comte Thibaut IV de Champagne.
La coalition se défait et échoue, peut-être en partie à cause de
l'amour passionné que le comte de Champagne voue à la belle reine
Blanche, amour que celle-ci repousse néanmoins sans équivoque.
Enfin, elle marie son fils à Marguerite de Provence le 27 mai 1234 en
la cathédrale de Sens. D'une nature ardente, le roi aimera sa femme
avec passion sans cesser bien entendu de lui être fidèle. Les deux époux
auront onze enfants.
Bien que déclaré majeur en 1236, à un âge déjà bien avancé, 21 ans,
Louis IX laisse les rênes du gouvernement à sa mère jusqu'en 1242, ne
les reprenant que pour combattre une ultime révolte féodale. Après les
victoires de Taillebourg
et Saintes, le roi renouvelle à Lorris un traité de paix avec le comte
de Toulouse. Il prépare également une paix durable avec l'Angleterre.
Celle-ci est signée le 4 décembre 1259 à Paris, mettant fin à la première «guerre de Cent Ans» entre les deux pays.
Dans le même souci d'équilibre et de concessions réciproques, le roi
capétien a signé l'année précédente à Corbeil un traité par lequel il
abandonne toute forme de suzeraineté sur la Catalogne, la Cerdagne et le
Roussillon cependant que le roi Jacques 1er d'Aragon renonce à ses
prétentions sur la Provence et le Languedoc (à l'exception de
Montpellier). Le fils du roi de France, futur Philippe III, épouse par
ailleurs la fille de Jacques, Isabelle d'Aragon.
Fort de sa réputation de souverain juste et équitable, Louis IX est
quelques années plus tard, à Amiens en 1264, choisi comme arbitre dans
un conflit entre le roi Henri III d'Angleterre et ses barons. Cet
arbitrage est connu sous le nom de «mise d'Amiens».
La chrétienté occidentale au XIIIe siècle
Cliquez pour agrandir
 L'Europe
actuelle et une bonne partie de nos moeurs et de nos institutions ont
été forgées au coeur du Moyen Âge, dans une époque assombrie par les
disettes, les maladies et l'insécurité mais éclairée par la foi et la
confiance en l'avenir...
L'Europe
actuelle et une bonne partie de nos moeurs et de nos institutions ont
été forgées au coeur du Moyen Âge, dans une époque assombrie par les
disettes, les maladies et l'insécurité mais éclairée par la foi et la
confiance en l'avenir...
Triomphe du roi chrétien
Libéré de ses soucis de voisinage, le roi inaugure à Paris la Sainte Chapelle.
Ce chef d'oeuvre de l'art gothique est destiné à abriter de saintes
reliques acquises à prix d'or par le souverain. Pour le futur Saint
Louis, l'acquisition des reliques et la construction de la Sainte
Chapelle sont certes affaire de piété. Elles sont aussi le fruit d'une
habile politique visant à faire de Paris une cité comparable, en
prestige et en sainteté, à Rome et Jérusalem.
Cette politique est servie par le dynamisme et le rayonnement de l'Université de Paris où enseigne Saint Thomas d'Aquin
(1225-1274). Contemporain et ami du roi, le dominicain italien tente de
concilier la pensée d'Aristote et la foi chrétienne. En 1253, le
chapelain du roi Robert de Sorbon fonde sur ses deniers une pension pour
accueillir les étudiants et les maîtres en théologie dépourvus de
ressources. Ce Collegium pauperum magistrorum deviendra plus tard... la Sorbonne.
En son royaume, le roi se montre à la hauteur de sa réputation. Il
institue des enquêteurs qui sanctionnent les abus de ses représentants
locaux, baillis et sénéchaux, et met en place une commission financière
chargée de traquer les détournements de fonds (elle deviendra la Cour
des Comptes sous le règne de son petit-fils Philippe le Bel).
Il sévit contre les guerres privées. Les conseillers et juristes de
la cour prennent l'habitude dans les années 1250 de se réunir en «parlement»
(le mot est nouveau), parfois en présence du roi, pour juger des
affaires qui leur sont soumises. Ainsi se développe une justice d'appel
qui prévient et corrige les abus de la justice locale ou seigneuriale.
En 1261, le roi interdit les duels judiciaires. Cette pratique
archaïque sera remise en vigueur à titre exceptionnel par son lointain
successeur Henri II à l'occasion du duel de Jarnac.
Justice royale, arbitraire seigneurial
Louis IX se signale aussi par ses initiatives à l'encontre des juifs.
Il fait brûler en place publique tous les manuscrits hébreux de Paris
(pas moins de 24 charrettes) après qu'un juif converti, Nicolas Donin,
eut assuré en 1242 qu'ils contenaient des injures contre le Christ. En
1254, il bannit les juifs de France (mais, comme souvent au Moyen Âge,
la mesure est rapportée quelques années plus tard en échange d'un
versement d'argent au trésor royal).
En 1269 enfin, il impose aux juifs de porter sur la poitrine une «rouelle»,
c'est-à-dire un rond d'étoffe rouge, pour les distinguer du reste de la
population et prévenir les unions mixtes, appliquant ce faisant une
recommandation du concile de Latran (1215) qui avait demandé de marquer les juifs, à l'image de ce qui se pratiquait déjà dans le monde musulman.
Ces mesures contestables témoignent du désir du pieux souverain de
moraliser son royaume. Dans le même ordre d'idées, il réprime la
prostitution, l'ivrognerie, les jeux de hasard. Il expulse aussi en 1269
les banquiers lombards et les usuriers originaires de Cahors (les cahorsins).
Une réputation de sainteté
La vie de Saint Louis nous est surtout connue par son biographe Jean
de Joinville (1224-1317), sénéchal de Champagne, qui vécut à son service
à partir de la septième croisade (1244). Joinville a ainsi popularisé
l'image du roi rendant la justice sous un chêne, dans son domaine de Vincennes, à l'est de Paris.Dans sa vie privée, le roi se montre d'une austérité à toute épreuve. Il se restreint sur la bonne chère et le vin, porte un cilice (vêtement de crin) à même la peau pour se mortifier, se fait fouetter le vendredi en souvenir de la mort du Christ, soigne et lave lui-même les pauvres...
Jean de Joinville a écrit sa Vie de Saint Louis entre 1305 et 1309 à la demande de la reine Jeanne de Navarre, épouse de Philippe le Bel. Sur la miniature ci-dessus (1330-1440), on le voit remettre son manuscrit à Louis de Navarre, futur Louis X le Hutin.
Le manuscrit, dont un original a été redécouvert au XVIIIe siècle, a fait l'objet de plusieurs rééditions (très remaniées) dès la Renaissance. Il va contribuer au renouveau du culte de Saint Louis sous le règne d'Henri IV. Ce roi appartient à une branche cadette de la dynastie capétienne qui remonte à Robert de Clermont, quatrième fils de Saint Louis. Soucieux de consolider sa légitimité, Henri IV souligne sa filiation avec le saint roi. Ainsi donne-t-il son prénom à son fils aîné, le futur Louis XIII.
Malheureuses croisades
Le roi se consacre par ailleurs à ses rêves de croisade en Terre sainte. Ils ne lui porteront pas chance.
Ayant une première fois fait le voeu de se croiser suite à une
maladie, il s'embarque avec son armée à Aigues-Mortes, en Provence, le
12 juin 1248, après avoir confié le royaume aux bons soins de sa chère
mère. Il atteint le delta du Nil et s'empare de Damiette, puis ill bat
l'armée du sultan, composée de mercenaires appelés mamelouks, devant la citadelle d'el-Mansourah.
Mais son avant-garde s'aventure imprudemment sur la route du Caire en
dépit de ses ordres. Bientôt, toute l'armée est bloquée par la crue du
Nil et menacée par la famine et l'épidémie. Elle tente de battre en
retraite. Le 8 février 1250, le roi de France est fait prisonnier en protégeant son arrière-garde.
Hôte forcé des Égyptiens, Saint Louis impressionne ses geôliers par
sa piété et sa grandeur d'âme. Libéré contre une rançon de 200.000
livres et la restitution de Damiette, il séjourne quatre ans dans les échelles
franques du Levant dont il restaure l'administration et les défenses.
La mort de sa mère le 26 novembre 1252 l'oblige à revenir enfin chez
lui.
Saint Louis est encore à l'origine de la huitième et dernière
expédition. L'expédition, longuement préparée, est contestée par les
proches du roi et le fidèle Joinville lui-même refuse d'y participer !
Comme précédemment, il s'embarque avec son armée à Aigues-Mortes mais se
dirige vers... Tunis. Son objectif est de convertir l'émir local. Mais,
à peine débarquée, l'armée est frappée par une épidémie de typhus. Le
roi lui-même est atteint et meurt pieusement sous les murs de Tunis, emportant avec lui l'idéal religieux de la croisade.
La dépouille du roi est inhumée dans la nécropole royale de Saint-Denis, à l'exception de son coeur, conservé à Monreale, en Sicile, dans le royaume de son frère Charles.
Dès l'année suivante est entamé son procès en canonisation. Celle-ci est prononcée par le pape Boniface VIII le 11 août 1297, sous le règne de son petit-fils Philippe IV le Bel.
La monarchie capétienne est alors à son maximum de prestige et la
France figure comme le royaume le plus puissant et le plus prospère de
la chrétienté.
André Larané. http://www.herodote.net