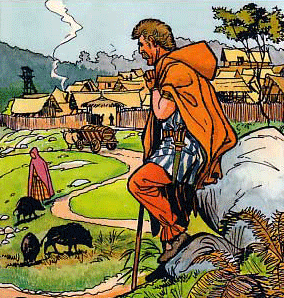Que serait une pensée politique rivée aux seuls échos d'une actualité tonitruante ? Il faut chercher plus loin et voir plus haut que les brutales assertions des manipulateurs de la pensée unique. A l'heure où la démocratie humanitaire se prétend la seule référence morale, unanimement valable pour le monde entier, il n'est certes pas mauvais de mettre son nez dans les ouvrages de quelques penseurs, dont on saura apprécier la différence. Proudhon ne fut pas seulement un militant et un écrivain, ce fut aussi, à sa manière, une sorte de prophète. La chute de l'Union soviétique ne nous à certes pas débarrassé du marxisme, auquel croient encore tant d'intellectuels occidentaux, alors que le rêve confus des Russes devient de mélanger socialisme, nationalisme et panslavisme. Plus que jamais, il importe de connaître celui qui fut le grand rival de Karl Marx et dont la vision n'est pas aussi démodée que voudraient le faire croire ses adversaires libéraux et communistes depuis plus d'un siècle. Dans un monde dominé par un étatisme d'autant plus centralisé et redoutable qu'il devient universel, les idées de Proudhon peuvent surprendre, mais on ne peut ignorer le sens à la fois révolutionnaire et conservateur qu'il donne à un "fédéralisme" qui n'est certes pas une utopie, mais peut-être une véritable vision à la mesure des défis gigantesques que nous connaissons aujourd'hui.
Si le terme même d'enracinement recouvre de solides réalités, le cas de Jean-Joseph Proudhon, reste exemplaire. Il le précisera lui-même : « Je suis né à Besançon, le 15 janvier 1809, de Claude-François Proudhon, tonnelier, brasseur, natif de Chasnans, près de Pontarlier, département du Doubs, et de Catherine Simonin, de Cordiron, paroisse et Burgille-les-Marnay, même département. Mes ancêtres de père et de mère furent tous laboureurs francs, exempts de corvées et de main-mortes, depuis un temps immémorial ».
D'une famille trop pauvre pour poursuivre des études, cet enfant particulièrement doué renonce à l'Université pour devenir ouvrier typographe. De retour de son "Tour de France" traditionnel, il fonde une imprimerie avec deux de ses compagnons.
Après avoir publié des brochures jugées révolutionnaires, il sera élu député en 1848.
Sous le Second Empire, il connaît la prison et l'exil, mais ne renonce jamais à des idées qui lui vaudront une tenace pauvreté et une grande solitude.
Ce n'est certes pas lui qui sera un profiteur de n'importe quel système politique et son socialisme ne sera jamais alimentaire :
« Créer de la richesse, faire de l'argent, s'enrichir, s'entourer de luxe, est devenu partout une maxime de morale et de gouvernement. On est allé jusqu'à prétendre que le moyen de rendre les hommes vertueux, de faire cesser le vice et le crime, était de répandre partout le confort, de créer une richesse triple ou quadruple : à qui spécule sur le papier, les millions ne coûtent rien ».
Aussi son jugement sur la société de son temps - lui qui a connu la monarchie, la république et l'empire - est impitoyable : « On a remarqué que les plus fougueux démocrates sont d'ordinaire les plus prompts à s'accommoder du despotisme, et réciproquement que les courtisans du pouvoir absolu deviennent dans le même cas les plus enragés démagogues ».
Son action n'est pas tant celle d'un conspirateur, comme Blanqui, mais d'un doctrinaire. Certes, ses idées ne sont pas exemptes de contradictions, mais n'en sont que plus vivantes et plus libres.
Contre le totalitarisme, contre la centralisation, contre l'impérialisme, il recherche un équilibre dynamique entre le spiritualisme et le matérialisme, entre la liberté et l'autorité, entre le rêve et l'action, entre le droit et la justice, entre la révolution et la tradition.
Il n'y a pas finalement de "doctrine" proudhonienne, mais une manière proudhonienne d'aborder la vie des hommes et des peuples.
Toute sa trop courte existence - il mourra à Paris le 19 janvier 1865, à cinquante-six ans, après une vie militante et familiale exemplaire - il s'affirme à contre-courant de toutes les idéologies et de toutes les illusions dominantes. Un de ses disciples du XXe siècle, le trop méconnu Alexandre Marc, dira de lui qu'il fut grand frondeur devant l'Eternel scissionnaire opiniâtre, "non-conformiste" farouche.
Aussi est-il difficile, à plus d'un siècle de distance ; de le situer facilement par rapport à une "gauche" et à une "droite", qu'il avait tendance à récuser, mais aussi parfois à con joindre, Libre-penseur dans tous les sens du terme, il s'est voulu finalement une sorte d'aventurier de la pensée, un défricheur et un éveilleur.
Celui qui devait si bien le comprendre et le poursuivre, le grand Péguy, allait, mieux que tout autre, définir le rôle de tels "prophètes" : « Une grande philosophie n'est pas celle qui prononce des jugements définitifs, qui installe une vérité définitive. C'est celle qui introduit une inquiétude qui ouvre un ébranlement ».
Ainsi l'œuvre de Proudhon est, plus qu'un jugement sur la société de son temps, une incitation à agir. En ce sens, ce doctrinaire du travaillisme français est le maître du vieux Sorel et des socialistes prolétariens, qui devaient tant se heurter aux socialistes parlementaires au début de notre siècle. Il a parfaitement précisé le sens de son "enseignement" : « Faire penser son lecteur, voilà, selon moi, ce qui dénote l'écrivain consciencieux ».
La démarche politique et morale de toute sa vie va le conduire de l'anarchie, qu'il professait vers 1840, à l'idée de "fédération", qui sera son grand apport à une nouvelle vision de monde.
Partisan résolu de toutes les diversités - on dirait aujourd'hui : de toutes les identités - il refuse l'uniformité, le nivellement, l'indifférencié. Les familles, les communes, les provinces, les Etats, doivent s'unir ; se "fédérer", mais non disparaître. Il l'affirme sans ambages : « Le système fédératif est à l'opposé de la hiérarchie ou centralisation administrative et gouvernementale par laquelle le distinguent, ex aequo, les démocraties impériales, les monarchies constitutionnelles et les Républiques unitaires ».
On imagine aujourd'hui quel type d'Europe il aurait souhaité et quelle caricature il en aurait refusée.
Certains de ses propos tomberaient sans doute de nos jours sous le coup de la loi. Ceux-ci par exemple : « Qu'importe aux étrangers le despotisme gouvernemental. Ils ne sont pas du pays ; il n 'y entrent que pour l'exploiter, aussi le gouvernement a intérêt à favoriser les étrangers dont la race chasse insensiblement la nôtre. » Ou encore : « La gloire d'un peuple, c'est de faire de grandes choses, en conservant la pureté de son sang, de son individualité, de sa tradition, de son génie ».
Comme le disait admirablement le résistant Alexandre Marc, au lendemain de la dernière guerre : « Notre monde a besoin de Proudhon... comme on a besoin de lumière, d'air pur, d'eau fraîche, de pain franc, de camaraderie, d'amitié virile, d'espérance ».
Jean MABIRE National Hebdo du 15 au 21 avril 1999


 Menés par Clovis, l’un de ces peuples germaniques, les Francs Saliens, occupe le royaume gallo-romain en 486, bat les Wisigoths en 507 et absorbe le royaume des Burgondes, en 534. Il se produit alors un fait linguistique assez rare : contrairement à ce qui s’est passé lors de la colonisation latine, c’est la langue dominée, le latin, qui demeure la langue officielle.
Menés par Clovis, l’un de ces peuples germaniques, les Francs Saliens, occupe le royaume gallo-romain en 486, bat les Wisigoths en 507 et absorbe le royaume des Burgondes, en 534. Il se produit alors un fait linguistique assez rare : contrairement à ce qui s’est passé lors de la colonisation latine, c’est la langue dominée, le latin, qui demeure la langue officielle. [Les Gallo-romains sont un ensemble de peuples qui, en Europe occidentale, ont constitué une civilisation spécifique, à l'issue de la Guerre des Gaules jusqu'à l’avènement des Francs. D’origine ou de civilisation celtique pour la plupart, ils étaient notamment localisés sur le territoire de la Gaule, selon les définitions de leurs voisins romains.]
[Les Gallo-romains sont un ensemble de peuples qui, en Europe occidentale, ont constitué une civilisation spécifique, à l'issue de la Guerre des Gaules jusqu'à l’avènement des Francs. D’origine ou de civilisation celtique pour la plupart, ils étaient notamment localisés sur le territoire de la Gaule, selon les définitions de leurs voisins romains.]