Qui
sont ces Turcs qui, à partir de la fin du XIe siècle, se sont attaqués
d’abord aux provinces byzantines d’Asie Mineure puis, à la fin du XIIIe
siècle, à la partie européenne de l’Empire byzantin avant d’entreprendre
la conquête des Balkans, non sans avoir auparavant encerclé le réduit
byzantin dont le point fort était la capitale de l’empire, Constantinople
qui tomba finalement entre leurs mains en 1453 ? Constantinople n’était
pour eux qu’une étape car, au lendemain de sa conquête, ces mêmes Turcs
lancent attaques sur attaques en direction de l’Europe
centro-danubienne, mettant par deux fois le siège devant Vienne, une
première fois en 1529, une seconde – la dernière – en 1683. Qui sont
donc vraiment ces Turcs ?
Les Turcs ne sont pas des Européens
La
langue qu’ils parlent n’est pas une langue indo-européenne ; c’est une
langue agglutinante qui appartient à la famille des langues altaïques.
Les Turcs sont originaires de Haute Asie tout comme leurs cousins
Mongols. Lorsque les Turcs ont fait leur apparition en Europe, une
Europe alors totalement chrétienne et imprégnée de culture
gréco-romaine, ils l’ont fait en tant que conquérants. D’autres peuples,
quantitativement moins nombreux il est vrai, plus ou moins apparentés
aux Turcs comme les Bulgares, ou cousins lointains comme les Magyars
avaient, les premiers au VIIIe siècle, les seconds à l’extrême fin du
IXe siècle, été tentés par l’aventure européenne, mais bien vite, ces
Bulgares et ces Magyars (Hongrois) se sont intégrés à l’Europe, ont
adopté les structures politiques et sociales de l’Europe d’alors et se
sont convertis au christianisme. Les Turcs en revanche, eux, n’ont
nullement cherché à s’intégrer à l’Europe ; ils ont cherché avant tout à
étendre leur domination sur l’Europe et à s’emparer de ses richesses.
Musulmans, ils ont cherché non pas à « islamiser » les peuples qu’ils
ont soumis – certains d’entre eux se sont ralliés à un islam de surface
comme les Albanais et une partie des Bosniaques, davantage par intérêt
que par conviction – mais à transformer ces peuples en sujets, plus ou
moins durement traités selon les lieux ou selon les époques.
De la conquête des Balkans…
La
conquête de l’Europe par les Turcs a réellement commencé à la fin du
XIV siècle, même si, depuis la fin du XIIIe siècle, il y avait eu des
actions ponctuelles le long des côtes grecques. Profitant de
l’affaiblissement de l’Empire byzantin qui constituait en Europe
orientale la seule force capable de leur résister, les Turcs ottomans, à
partir de l’empire que leur chef Othoman (1288-1366) avait constitué en
Asie Mineure, ont entrepris dans un premier temps le « grignotage » de
l’Empire byzantin. L’état de faiblesse de Byzance était tel que l’un des
empereurs, l’usurpateur Jean VI Cantacuzène, n’hésita pas en 1346 à
donner sa fille en mariage au sultan turc, à lui céder la base de
Gallipoli rien que pour obtenir son aide contre son rival Jean V. Avec
Gallipoli, les Turcs s’installaient pour la première fois sur le sol
européen. À partir de ce point d’appui, ils vont rapidement s’attaquer
aux provinces européennes de l’Empire byzantin et aux États balkaniques
récemment constitués, la Serbie qui avait connu un essor rapide sous
Étienne IX Douchan (1333-1355) – le Charlemagne serbe – et la Bulgarie
qui, après des heures glorieuses à l’époque du « Second Empire bulgare »
se trouvait en pleine décadence. Au nord-est de la Bulgarie, les
provinces danubiennes, la Valachie fondée en 1247 et la Moldavie fondée
en 1352, étaient encore fragiles et insuffisamment organisées pour faire
barrage à des conquérants tels que les Turcs.
Les
premières victimes de l’expansionnisme turc furent les Serbes et les
Bulgares. Le sultan Murad I (1359-1389) enleva d’abord aux Bulgares une
partie de la Thrace et de la Macédoine et établit en 1365 sa capitale à
Andrinople. Puis en 1371, il conquiert sans coup férir la Serbie du Sud.
De là, poussant plus au nord, il occupe Nich et enlève Sofia aux
Bulgares. La Bulgarie se trouva pratiquement aux mains des Turcs. Seules
résistaient encore les principautés rivales du nord de la Serbie. Leur
destin pour plusieurs siècles allait se jouer le 15 juin 1389 – selon le
calendrier orthodoxe, c’est-à-dire le 28 juin d’après le calendrier
latin –, lors de la bataille des Champs des merles – Kosovo Polje
– à mi-distance entre Pristina et Mitrovica. La bataille longtemps
indécise se termine par la victoire des Turcs conduits par le fils de
Murad, Bayazid (Bajazet). Des milliers de soldats serbes y laissèrent
leur vie ; quant aux prisonniers, ils allèrent en grande partie
alimenter les marchés d’esclaves. Le roi serbe Lazare et les nobles de
son entourage furent conduits devant Bayazid qui les fit décapiter.
Après sa victoire, Bayazid dirigea ses armées vers le nord à travers la
Bulgarie déjà soumise, en direction du bas Danube. Le prince de
Valachie, Mircea, malgré l’aide de l’empereur Sigismond, roi de Hongrie,
ne put les arrêter ; il dut accepter de payer tribut aux Turcs, ce qui
lui permit de conserver l’autonomie politique et religieuse de sa
principauté.
Un
peu plus tard, en 1396, inquiet de la menace ottomane, l’empereur
Sigismond prit la tête d’une véritable « croisade » avec des contingents
allemands, hongrois et valaques auxquels s’ajoutaient les 10.000 hommes
de Jean sans Peur, le fils du duc de Bourgogne. L’objectif était de
libérer les Balkans. La croisade s’acheva le 28 septembre 1396 par un
échec cuisant à Nicopolis (Nikopol). L’espoir de libérer les Balkans
avait vécu.
… à celle de la Grèce
Maître
incontesté des Balkans, Bayazid s’attaque dès lors à la Grèce et aux
établissements vénitiens de Méditerranée orientale. En 1395 déjà, il
avait fait une rapide incursion dans le Péloponnèse où il s’empara de
plusieurs forteresses. Deux ans plus tard, les Turcs reparaissaient en
Grèce et occupaient même Athènes pendant quelques mois, tandis que
Bayazid avec le gros de ses troupes tentait en vain de s’emparer de
Constantinople, puis en 1446 se répandirent en Morée. En se retirant,
ils emmenèrent soixante mille captifs qui furent vendus comme esclaves
et obligèrent le despote – le gouverneur byzantin – de cette province à
payer un tribut annuel. L’Empire byzantin dont le territoire se
réduisait comme une peau de chagrin vivait ses dernières heures et se
trouvait bien seul pour résister.
Le
29 mai 1453, le fils de Murad II, Mohamet II, s’empara après un long
siège de Constantinople. Le dernier empereur était mort au milieu de ses
soldats en défendant sa capitale. Pendant trois jours, la ville fut
livrée aux soldats turcs qui pillèrent, violèrent, incendièrent et
massacrèrent impunément. Les églises et les couvents furent profanés et
la basilique Sainte-Sophie, après avoir été dépouillée de ses trésors,
fut transformée en mosquée. Quant aux habitants grecs de la ville, ceux
qui avaient échappé à la mort furent ou bien vendus comme esclaves, ou
bien déportés en Asie Mineure. En quelques semaines, la ville chrétienne
et grecque qu’avait été depuis plus de dix siècles Constantinople fut
transformée en une ville musulmane et turque.
L’Empire
romain d’Orient avait cessé d’exister ; les Turcs étaient maîtres des
Balkans et contrôlaient l’Asie Mineure ainsi que les Détroits, tout
comme ils étaient en train de se rendre maître de la péninsule grecque :
Athènes fut occupée en 1458, Mistra en 1460 et la Morée l’année
suivante. Seules quelques îles de la Méditerranée orientale restèrent
aux mains des princes chrétiens, Rhodes jusqu’en 1522, Chypre jusqu’en
1571 et la Crète tenue par les Vénitiens jusqu’en 1669.
Vers la Bulgarie, la Hongrie, la Bohême et la Pologne
Non
contents d’avoir soumis l’Europe balkanique et la Grèce, et de s’être
assurés le contrôle de la Méditerranée orientale, les Turcs se sont
lancés à partir du milieu du XVe siècle à l’assaut des pays du Moyen
Danube. Face à la menace ottomane, l’Europe chrétienne a réagi
modestement et tardivement. Outre la croisade malheureuse de l’empereur
Sigismond et de Jean sans Peur en 1396, rares furent les autres
tentatives pour contrer les Ottomans malgré les appels incessants de la
Papauté. Certes en 1444, le Hongrois Janos (Jean) Hunyadi,
gouverneur de Transylvanie, tenta de libérer la Bulgarie : son
intervention se solda par un échec devant Varna ; le roi de Hongrie
Vladislas qui avait participé à l’entreprise y trouva la mort ainsi que
le légat de pape, Césarini. Hunyadi, devenu régent de Hongrie en 1446,
ne renonça pas ; après avoir subi un nouvel échec en Serbie cette fois,
il s’efforça de renforcer le système de défense au sud et à l’est de la
Hongrie désormais directement menacée. À la demande du pape Calixte III
représenté sur place par son légat Jean de Capistran, Jean Hunyade mit
sur pied une nouvelle croisade mais, avant même que son armée fût prête,
les Turcs qui avaient maintenant le champ libre depuis la prise de
Constantinople, vinrent mettre le siège devant Belgrade en juillet 1456.
Belgrade était l’une des pièces maîtresses de la défense de la Hongrie.
Malgré des assauts répétés, les Turcs échouèrent. Leur dernier assaut
le 6 août fut un échec total. Les Hongrois contre-attaquèrent et
repoussèrent les Turcs jusqu’aux portes de la Bulgarie. Le danger
ottoman était ainsi écarté mais dans les jours qui suivirent la bataille
de Belgrade, Jean Hunyade et le légat Jean de Capistran succombèrent à
leurs blessures. La victoire de Belgrade, le premier succès chrétien
face aux Turcs depuis bien longtemps, eut un grand retentissement en
Occident. Le pape décida que dorénavant, en souvenir de ce glorieux
événement, on sonnerait chaque jour l’angélus à midi dans toutes les
églises du monde chrétien. Le fils de Janos Hunyadi, Mathias Corvin,
devenu roi de Hongrie en 1458, mena la vie dure aux Turcs. Il leur
reprit la Bosnie en 1463, la Moldavie et la Valachie en 1467, la Serbie
en 1482. Ces succès, hélas, furent sans lendemain. Après la mort de
Mathias en 1490, la menace ottomane reparut et les territoires libérés
par le roi de Hongrie furent réintégrés les uns après les autres dans
l’Empire ottoman. Au début du XVIe siècle, l’avènement de Soliman le
Magnifique (1520-1566) marqua la reprise des offensives turques, à la
fois en Europe centrale et dans tout le Bassin méditerranéen. Les États
directement menacés, la Pologne, la Hongrie et la Bohême, étaient des
puissances secondaires. Les rois Jagellon de Pologne n’osaient rien
faire qui puisse indisposer les Turcs ; leurs cousins Jagellon qui
régnaient en Bohême et en Hongrie, Vladislas II (1490-1516) et Louis II
(1516-1526), malgré leur bonne volonté, n’étaient pas de taille à lutter
efficacement contre les Turcs. Deux grandes puissances en avaient les
moyens, la France et la monarchie des Habsbourg sur laquelle régnait
Charles Quint, sur les « Espagnes » depuis 1516 et sur le Saint Empire
depuis 1519. La France en guerre contre les Habsbourg joua la carte
ottomane sous François Ier et, en 1535, une alliance officielle fut même
conclue avec Soliman le Magnifique. Désormais, les Habsbourg, seuls ou
presque, vont se trouver à l’avant-garde de la défense de la chrétienté
occidentale face aux Ottomans.
Face aux Ottomans : Charles Quint et les Habsbourg
Les
choses ont commencé plutôt mal. Au début de 1526, Soliman le Magnifique
lança ses armées à l’assaut de la Hongrie. Le roi Louis II, malgré les
appels à l’aide, se trouve seul. La victoire des Turcs à Mohacs le 29
août 1526 au cours de laquelle le roi Louis II mourut à la tête de ses
troupes, eut un retentissement considérable. D’autant plus que Soliman
le Magnifique n’en resta pas là ; il se lança dans une expédition
dévastatrice à travers la Hongrie, et occupa pour un temps Buda.
Non
sans réticences, les Diètes de Bohême, de Croatie et de Hongrie
désignèrent, pour succéder à Louis II, son beau-frère Ferdinand de
Habsbourg, le frère de Charles Quint, estimant que celui-ci, grâce au
potentiel de forces que représentait le Saint Empire, était le seul à
pouvoir arrêter les Turcs dans l’immédiat, à les refouler par la suite.
Les Turcs se montrèrent également très menaçants en Méditerranée
occidentale grâce à leurs alliés barbaresques qui, depuis l’Afrique du
Nord, menaçaient les côtes d’Espagne et d’Italie. Charles Quint
s’efforça de les contenir et son fils Philippe II utilisa les talents de
Don Juan d’Autriche pour les refouler. La victoire de Don Juan à
Lépante le 7 octobre 1571 affaiblit pour un temps la puissance navale
ottomane mais cette « victoire de la croix sur le croissant » n’empêcha
pas les Turcs de conserver une position dominante en Méditerranée
orientale jusqu’au XIXe siècle.
Depuis
la plaine hongroise qui fut jusqu’en 1686 leur base avancée en Europe,
les Turcs lancèrent à plusieurs reprises des attaques en direction de
l’Autriche. En 1529, après avoir repris Buda que Ferdinand de Habsbourg
avait libéré deux ans auparavant, ils parurent devant Vienne le 22
septembre. Les assiégés résistèrent et parvinrent le 14 octobre à
repousser l’assaut donné par les Turcs à travers une brèche dans le
Kärntner Tor. Le lendemain, le siège était levé. Par la suite, Ferdinand
conclut une trêve avec le sultan dont il se reconnaissait vassal pour
la « Hongrie royale », c’est-à-dire les régions occidentales et
septentrionales du royaume, le centre du pays restant aux mains des
Turcs. Quant à la Transylvanie, elle devenait une principauté
indépendante de fait, dont les princes, théoriquement vassaux des
Habsbourg, pratiquèrent à l’égard des Turcs une politique faite d’un
savant dosage d’alliance, de neutralité et de soumission, avec le double
objectif d’échapper à l’occupation ottomane et de conserver leur
indépendance par rapport aux Habsbourg. La trêve fut confirmée en 1547 ;
elle assura un demi-siècle de paix précaire en Hongrie. La guerre
reprit en 1591 sans résultat décisif ; le traité de Zsitvatorik qui y
mit fin en 1616 maintint le statu quo territorial mais libéra la
« Hongrie royale » de ses liens de vassalité à l’égard du sultan.
Les relations entre les Turcs et les populations soumises
En
cette fin du XVIe siècle, la puissance ottomane était à son apogée. Les
Turcs, minoritaires dans la population, exerçaient leur domination sur
des millions de chrétiens, orthodoxes pour la plupart, protestants et
catholiques en Hongrie. Pour tenir ces populations considérées a priori
comme hostiles, les autorités ottomanes ont installé dans les villes et
dans les principaux points stratégiques des garnisons turques et parfois
même des colons comme en Bulgarie, afin de mieux surveiller les
populations soumises. La ville chrétienne occupée, ce sont d’abord une
garnison, une administration et également des signes extérieurs
indiquant la présence turque, la ou les mosquées avec le minaret,
symbole de l’islam victorieux, les établissements de bains, les souks,
notamment dans les Balkans.
Comment
sont traitées les populations chrétiennes soumises et qui sont
majoritaires en nombre ? En fait, la situation varie d’un pays à
l’autre, d’une époque à l’autre. Tout dépend du bon vouloir du
gouverneur local, le pacha, tout dépend de la docilité ou de l’esprit de
résistance des populations. Il est évident qu’une première image vient à
l’esprit, celle du sac de Constantinople et du massacre d’une partie de
ses habitants dans les jours qui ont suivi la prise de la ville. Il
s’agit ici bien sûr d’un cas extrême, destiné à frapper les esprits et à
servir d’exemple. La réalité quotidienne est plus nuancée, heureusement
! Il y a d’abord le cas particulier des Albanais qui, malgré un sursaut
de résistance au milieu du XVe siècle à l’initiative de Skanderbeg,
se soumirent assez facilement : une majorité d’entre eux se convertit à
l’islam, d’autres se réfugièrent en Calabre et en Sicile. Dès lors,
l’Albanie fournit au sultan des fonctionnaires, des officiers et de
nombreux soldats. Une partie des Bosniaques a choisi aussi de se
convertir à l’islam en raison parfois des abus de l’Église orthodoxe à
leur égard. Autres peuples relativement privilégiés, les Roumains des
principautés danubiennes, vassaux certes du sultan mais qui conservèrent
leurs princes, et qui purent pratiquer en toute liberté leur religion
orthodoxe. Cette situation relativement favorable a perduré jusqu’à la
fin du XVIIe siècle et a favorisé un essor artistique et culturel
notable avec la construction de nombreuses églises et monastères et la
création d’écoles et d’académies. La situation se détériora à partir de
la fin du XVIIe siècle car l’Empire ottoman était alors sur la défensive
face aux Habsbourg et aux ambitions de la Russie.
Très
différente fut la situation des Bulgares, des Serbes, des Grecs et des
Macédoniens, durement traités et étroitement surveillés par les colons
turcs implantés sur leur territoire. La terre devint la propriété
exclusive du sultan qui en laissait une jouissance toujours révocable
aux paysans indigènes moyennant de lourdes redevances. À ces redevances
en argent ou en valeur s’ajoutait la devchurmé, à laquelle on procédait
en principe chaque année, en réalité plus rarement et en fonction des
besoins ; c’était la « cueillette » des jeunes garçons destinés à entrer
dans le corps des janissaires après avoir été arrachés à leur famille.
Ils formèrent ainsi une troupe d’élite, la garde prétorienne du sultan,
le fer de lance des nouvelles conquêtes mais aussi l’instrument de
nombreux complots. La Hongrie ottomane, celle des plaines centrales, fut
traitée selon ce modèle. Quant à la question religieuse, elle varie
d’un pays à l’autre. Les églises orthodoxes furent souvent le bastion de
la résistance notamment en Serbie et en Bulgarie.
L’État
y contrôlait très sévèrement les évêques et souvent envoyait en Serbie
des évêques grecs jugés plus souples. Mais c’est à l’échelon des
villages que le clergé orthodoxe joua son rôle de gardien des traditions
nationales, ce qui valut souvent aux popes d’être les premiers visés
par les autorités au moindre signe d’agitation. Les élites grecques,
parfois, n’hésitèrent pas à se mettre au service des Turcs.
Le déclin ottoman
Les
premiers signes du déclin de l’Empire ottoman apparaissent en 1664
lorsque les armées de l’empereur Léopold I (1658-1705) triomphent des
Turcs à la bataille de Szent-Gottard. Faute d’argent et à cause des
guerres en cours contre Louis XIV, l’empereur ne put exploiter cette
victoire et dut signer avec le sultan la « paix ignominieuse » de
Vasvar, provoquant ainsi la protestation d’une partie de l’aristocratie
hongroise et des troubles en Hongrie royale qui furent largement
exploités par les agents de Louis XIV. Pour conserver leur position en
Hongrie, les Turcs s’allièrent au chef des insurgés hongrois Imre
(Emeric) Thököly et pour le soutenir, en mars 1683, ils lancèrent une
offensive en direction de Vienne. Une nouvelle fois, Vienne, la « pomme
d’or » dont les Turcs convoitaient les richesses, fut assiégée. À
l’appel du pape Innocent XI, tous les princes du Saint Empire,
catholiques et protestants confondus, le roi de Pologne Jean Sobieski,
mirent sur pied une véritable « armée européenne » que le duc de
Lorraine Charles V conduisit à la victoire, le 12 septembre 1683, sur
les pentes du Kahlenberg devant Vienne. Seul, Louis XIV avait refusé de
participer à cette « croisade », interdisant même aux volontaires
français de s’y joindre. La victoire du Kahlenberg marque le début du
reflux ottoman. Léopold I confia au duc de Lorraine et au prince Eugène
de Savoie le soin de poursuivre les Turcs et de les chasser de Hongrie.
Successivement, Eztergom, Vac, Visegrad furent libérées. Puis le 2
septembre 1686 ce fut au tour de Buda, le « bouclier de l’islam », après
119 ans d’occupation turque. Au cours des années suivantes les
victoires du prince Eugène, notamment celle de Zenta en 1697, permirent
l’expulsion définitive des Turcs du territoire hongrois, ce qui fut
officialisé par les traités de Karlovitz (Karlovici) en 1699 et de
Passarovitz en 1718.
Le réveil agité des Balkans
L’Empire
ottoman était maintenant sur la défensive. À la fin du XVIIIe siècle et
surtout au cours du XIXe siècle, on assiste à un réveil des peuples
balkaniques. Les Grecs, les Serbes, les Roumains, les Bulgares et enfin
les Albanais se constituent en États indépendants face à un Empire
ottoman en pleine décadence. Mais le tracé des frontières entre les
nouveaux États, rendu compliqué par l’enchevêtrement des populations, a
suscité des tensions, des rivalités, voire des guerres souvent
encouragées de l’extérieur par les grandes puissances. On parle
désormais de « poudrière des Balkans ». Les Balkans en effet deviennent
un enjeu majeur dans la lutte d’influence à laquelle se livrent les deux
grandes puissances voisines et rivales, la Russie et
l’Autriche-Hongrie, mais aussi l’Allemagne et le Royaume-Uni. Et ce
n’est pas tout à fait le fruit du hasard si c’est à Sarajevo, au
carrefour du monde chrétien et de l’islam, que va débuter en 1914 la « guerre civile européenne » le dernier cadeau empoisonné offert par les Turcs à l’Europe.
Henri BOGDAN
Professeur émérite d’histoire à l’Université de Marne la Vallée
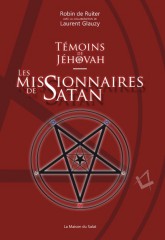 Cet article présente le dernier livre de Laurent Glauzy, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan (
Cet article présente le dernier livre de Laurent Glauzy, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan (