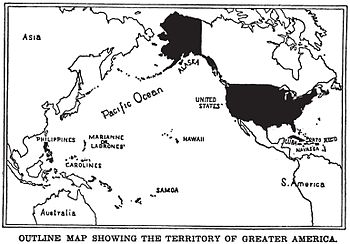La campagne de Syrie et du Liban, par Nabucco
En 1941, La Syrie et le Liban vivent depuis plus de 20 ans sous mandat français. Dés 1917-1918, la province de Syrie (regroupant à l’époque Syrie, Liban, Palestine, Jordanie) a apporté son aide aux alliés contre l’Empire Ottoman dont elle constitue une des plus riches provinces. Cependant, le rêve d’un Grand Orient indépendant est rapidement douché par la Conférence de San Remo et le Traité de Sèvres qui, en 1920, entérinent la dissolution de l’éphémère Royaume Arabe de Syrie et consacrent la présence française.Les troupes françaises du Levant mettront sept ans ans (révolte de 1920-1923 et 1925-1927) pour pacifier le pays. Particulièrement le Nord où subsiste une forte hostilité des Alaouites et des Druzes. A partir de 1927, à défaut de souveraineté, la région se développe et se modernise (électrification, tramway, routes, écoles, agriculture moderne). Un début de libéralisation politique voit timidement le jour. En 1936, la France envisage d’accorder l’indépendance à la Syrie dans un délai de cinq ans. Néanmoins ce projet est définitivement enterré par le Parlement Français en 1938. Pour les puissances coloniales, à l’approche de la Seconde Guerre Mondiale, l’heure est au statu quo frileux, loin des grands bouleversements émancipateurs.
En 1939, nouveau camouflet pour les nationalistes arabes Syriens. Les Français désireux d’obtenir les bonnes grâces de la Turquie, cèdent à l’état kémaliste le sandjak d’Alexandrette, une petite province au Nord-Ouest de la Syrie où vit une minorité turque importante. Il s’agit de ménager la Turquie afin de conserver sa neutralité, voire de s’en faire une alliée contre l’Allemagne avec qui la guerre paraît imminente. Cette perte, considérée comme une annexion par les Syriens est encore, de nos jours, un sujet de querelle entre Turcs et Syriens.
Juin 1940. L’armée Française est défaite en six semaines par la Wehrmacht. Le Parlement Français vote à 88 % les pleins pouvoirs au Maréchal Philippe Pétain. Le 18 juin, un obscur général de brigade à titre temporaire nommé Charles de Gaulle lance un appel à la Résistance depuis la Radio de Londres. En juillet, à Vichy, dans la zone demeurée libre de l’occupant allemand, s’installe le gouvernement de l’État Français. Les forces militaires en métropole sont réduites à 100 000 hommes, sans aviation. La Marine de Guerre est neutralisée dans les ports de Toulon et Bizerte en Tunisie. L’escadre Française qui mouillait dans la rade de Mers el-Kebir en Algérie est bloquée, puis détruite par les Anglais le 3 juillet 1940 (1 300 morts, deux cuirassés, un croiseur et un contre-torpilleur mis hors de combat). Dans ce contexte, l’Armée du Levant (45 000 hommes, 120 canons, 90 chars et 289 appareils) constitue un enjeu stratégique en Méditerranée Orientale.

Troupes de l’Armée du Levant 1941.
Mai 1941. L’Irak, sous mandat britannique s’insurge et fait appel aux forces germano-italiennes pour combattre les Anglais (voir article précédent : Irak : d’une guerre l’autre http://www.egaliteetreconciliation..... Les Allemands négocient avec le gouvernement de Vichy le protocole de Paris (28 mai 1941). En échange d’un hypothétique allègement des conditions d’armistice, les Français accordent des facilités aux Allemands et à leurs alliés italiens en Méditerranée Orientale. Les Allemands et les Italiens sont autorisés à faire escale dans les aérodromes Syriens avant de rejoindre l’Irak en guerre contre les Britanniques (120 appareils de l’Axe transiteront pas la Syrie en mai 1941). Par ailleurs, une partie des armes stockées au Levant est livrée par les Français aux Irakiens. La Turquie autorise le transite de deux convois ferroviaires sur son territoire. Ce matériel obsolète, livré en renâclant, arrivera trop tard pour empêcher l’écrasement de la rébellion Irakienne par les Anglais. Le 12 mai 1941, en représailles, l’aviation britannique bombarde les aérodromes de Syrie.
Juin 1941. La conduite de la guerre en Syrie oppose les Britanniques aux Français Libres du général de Gaulle. Ces derniers veulent pénétrer en Syrie avec une petite force symbolique aux couleurs françaises dans le but de rallier les 45 000 hommes de l’Armée du Levant. L’idée n’est pas saugrenue, d’autant plus que les soldats Français ont été très perturbés par le transit vers l’Irak des appareils de la Luftwaffe et de la Regia Aeronautica italienne via les aérodromes syriens. Un an après le pire désastre de l’histoire de France, les cœurs ne sont pas apaisés. Le désir d’en découdre couve toujours sous la botte allemande. Mais il y a la manière. Les Britanniques en décident autrement. Ils veulent, une entrée en force. Une opération commune sous commandement britannique est décidée fin mai 1941. Désormais, on ne parlera plus de Français, mais de Gaullistes et de Vichystes.
7 juin 1941. Dans la nuit, les Britanniques déclenchent l’opération Exporter. Une force de 20 000 hommes attaque l’Armée Française du Levant forte de presque 40 000 militaires. Les Anglais qui s’attendaient à une randonnée de ’’Scouting for boys’’* sont confrontés à une résistance opiniâtre qui va durer cinq semaines. Les Français demeurés fidèles à ce qui leur semble le seul gouvernement national légitime suivent les ordres de Vichy et ne comprennent pas cet assaut. Du reste, plus aucun appareil allemand ou italien ne transite par la Syrie. Par ailleurs, l’intervention des Forces Françaises Libres de De Gaulle aux côtés des Britanniques apparaît comme un coup de poignard dans le dos.
L’opération Exporter est très académique dans sa conception et s’articule sur quatre axes. A l’extrême nord, les 17ème et 20ème Brigades d’infanterie Indienne sont chargées de cheminer au sud de la voie ferrée turque qui longe la frontière syrienne. Le but, malgré la faiblesse des moyens mis en œuvre, est important : interdire l’approvisionnement des troupes du Levant par la Turquie. Au centre, la 10ème division d’infanterie Indienne doit progresser sur la rive sud de l’Euphrate vers Alep la capitale du Nord. Plus au Sud, la Habforce (Légion Arabe et 4ème brigade de cavalerie Britannique) est chargée de se diriger, en plein désert, vers Palmyre et le terminal pétrolier de Tripoli au Liban. Enfin, à l’extrême Sud, le long de la côte libanaise et vers Damas, ont lieu, les attaques les plus importantes. Elles sont menées par la 7ème division australienne (moins sa 18ème Brigade qui se bat à Tobrouk en Lybie), deux brigades françaises libres (les 1ère et 2ème BFL de la 1ère Division Française Libre) et la 5ème Brigade indienne. La Royal Navy est chargée d’appuyer les troupes avec son artillerie de marine.

Durant une semaine, les attaques Britanniques marquent le pas et se heurtent à une résistance farouche de l’Armée du Levant. L’attaque frontale depuis le Nord de la Palestine est un échec. Il n’existe qu’une seule route côtière dominée par les Monts du Liban qui culmine à 3 000 mètres d’altitude. Un cadeau pour la défense qui fait des ravages parmi les troupes franco-australiennes. En parallèle, la percée vers Damas s’immobilise pour les mêmes raisons (relief escarpé). L’attaque de la Habforce progresse aisément dans le désert pour finir par stagner à l’approche des premiers contreforts des monts de l’anti-Liban, avant la vallée de la Bekaa. Globalement, il s’agit d’un échec pour cette première manche. Le général Wavell doit repenser son plan de bataille et d’abord recevoir des renforts.

Artillerie française de l’armée du Levant pendant les combats.
13 juin 1941. Deux Brigades de la 6ème division d’infanterie Britannique viennent renforcer le front au Sud de Damas. La Royal Air Force est renforcée par des prélèvements sur les forces positionnées en Egypte et en Irak. L’attaque Britannique reprend lentement. Sur le littoral, malgré la prise de Saïda, les progrès des franco-australiens sont très lents. Au Centre, la Habforce assiège la ville de Palmyre. Le 21 juin, Damas en Syrie tombe sous la pression des Britanniques, des Indiens et des Français libres.

Troupes Britanniques après la reddition de Palmyre le 3 juillet 1941.
A partir du 23 juin, la résistance des troupes françaises du Levant commence à donner des signes de faiblesse. A cette date, la Syrie est sous la pression d’un blocus naval et terrestre presque complet. Les unités françaises de l’Armée du Levant doivent se battre sans renfort et subissent une forte attrition. Les troupes du Commonwealth sont désormais plus nombreuses, mieux rafraîchies. Elles dominent la mer et les airs. Le 3 juillet 1941, Palmyre tombe. La 10ème division Indienne qui progresse le long de l’Euphrate s’approche dangereusement du centre de la Syrie, tandis que le 8 juillet les défenses françaises au sud de Beyrouth commencent à lâcher menaçant la capitale du Levant.
12 juillet 1941. Le Général Dentz, gouverneur de la province du Levant, après accord des autorités de Vichy, demande un cessez-le-feu et autorise la négociation d’un armistice. Celui-ci est signé, à Saint-Jean-d’Acre entre les Britanniques et les autorités de la Syrie mandataire le 14 juillet 1941. Les forces alliées ont perdu 4 000 hommes. Les Français de l’Armée du Levant dénombrent 6 000 victimes dont 1 000 tués, 37 000 d’entre eux sont faits prisonniers. Moins de 6 000 décideront de rallier la France Libre, les autres sont désarmés et renvoyés en France en août-septembre 1941.

Le Général Wilson signe la Convention de Saint Jean d’Acre en présence des délégués de Vichy.
Même si le pouvoir virtuel est détenu par les français libres, ceux-doivent compter sur la présence militaire amicale des Britanniques qui favorisent en sous-main les indépendantistes libanais et syriens. Les élections législatives de l’été 1943 portent au pouvoir les nationalistes syriens et libanais. Les gaullistes qui étaient intervenus en juin 1941 à la fois contre les forces de l’Axe, mais aussi les velléités hégémoniques britanniques doivent progressivement passer la main. Fin 1943 et début 1944, le Liban et la Syrie obtiennent leur indépendance. Au printemps 1945, Damas se soulève contre les derniers éléments militaires français qui y tiennent garnison. Un an plus tard, le 17 avril 1946, les dernières troupes françaises quittent le pays.
La campagne de Syrie-Liban s’inscrit dans la lutte entre les Britanniques et les forces de l’Axe germano-italien pour le contrôle de la Méditerranée Orientale et l’accès aux formidables réserves de pétrole du Moyen-Orient. En ce sens, cette bataille est le prolongement de la guerre d’Irak qui se déroula un mois auparavant (mai 1941). Le conflit qui oppose les Français de l’Armée du Levant aux Britanniques alliés aux forces françaises libres, bien que périphérique, revêt une grande importance stratégique pour l’effort de guerre allié.
En juin 1941, les Allemands mènent le siège du port de Tobrouk en Lybie, à quelques pas de la frontière égyptienne. Le 22 juin 1941, la Wehrmacht envahit l’URSS. La plupart des observateurs de l’époque ne donnent que quelques semaines de survie à l’Armée Rouge. Les Britanniques qui ont déchiffré les codes cryptés de la Wehrmacht (machine enigma) sont au courant depuis plusieurs semaines des projets d’Hitler concernant la Russie. A juste titre, ils craignent une poussée combinée de l’Afrika Korps vers le Proche Orient et de l’Ostheer, l’armée allemande en Russie, vers le Caucase et le Moyen-Orient. En ce sens, la présence d’une force de 40 000 français en Syrie et au Liban apparaît comme une menace pour les Britanniques qui se méfient de la neutralité du gouvernement de Vichy.
Par ailleurs, il ne sert à rien aux Britanniques de contrôler les champs pétroliers de Mossoul en Irak si la côte libano-syrienne n’est pas sécurisée. Les terminaux pétroliers des oléoducs se situent tous sur la côte méditerranéenne, l’un à Tripoli au Liban, l’autre à Haïfa en Palestine, à quelques kilomètres de la frontière libanaise. En mai 1941, les Irakiens coupent le pipeline reliant Kirkouk en Irak à Haïfa et redirigent le flux de pétrole vers le Liban vichyste au profit exclusif de l’axe germano-italien. Cette mesure de rétorsion est ressentie comme un casus belli par les Anglais qui décident alors de régler leur compte d’abord aux Irakiens, ensuite aux Français de l’Armée du Levant.
En ce qui concerne les Français, cette campagne est un épisode pénible de leur histoire. D’un côté, fidèle à une vieille tradition bourgeoise de compromission des élites , le gouvernement de Vichy, traîne des pieds, louvoie, ménage la chèvre et le chou, l’anglais et l’Allemand, pour finalement, perdre la chemise et le pantalon au profit de ses faux-amis ou de ses vrais ennemis. Cette vraie-fausse neutralité durera jusqu’en 1944 et l’arrivée des troupes alliées. Pour les gaullistes, le choix de l’alliance avec les Britanniques est net, même s’il n’est pas exempt d’arrière pensées. Les intérêts des Britanniques et de leur empire ne sont pas vraiment les mêmes que ceux des Français et le rapport de force est en défaveur de ces derniers. Dans ces conditions, à plusieurs reprises durant la Seconde Guerre Mondiale, on aura le sentiment d’assister à un marché de dupes.
La campagne de Syrie-Liban ne clôt pas la série des interventions Britanniques. Ceux-ci ont en juin sécurisé leur flanc sud en Syrie. Seule, au Nord-est, l’Iran demeure neutre, même si ses amitiés vont plutôt vers l’Axe par anglophobie. Le dernier acte de ce conflit périphérique se jouera dans ce pays en août et septembre 1941.
* Scouting for Boy : « Éclaireurs » est un ouvrage écrit par Robert Baden-Powell sur les fondements du scoutisme.
http://www.egaliteetreconciliation.fr