Résumé RTL par Éric Zemmour
jeudi 15 mars 2018
mardi 13 mars 2018
lundi 12 mars 2018
dimanche 11 mars 2018
Livres & Histoire • Deux rois sans couronne : Louis XVII et Louis XIX

 Par Anne Bernet
Par Anne Bernet
« Si qua fata aspera rumpas… » comme chantait Virgile. Rien n’est plus désolant que les destins princiers anéantis.
Cousins germains, tour à tour héritiers présomptifs du trône de France, Louis Antoine, duc d’Angoulême, et Louis Charles, duc de Normandie, devaient, en effet, ceindre un jour la couronne, mais ne jamais régner. Autant l’un a suscité, en raison de son destin tragique, une surabondante historiographie, autant l’autre a sombré dans l’oubli. À tort.
Dernier des petits-fils de Louis XV à convoler, le jeune comte d’Artois épouse en 1773, à seize ans, la princesse Marie-Thérèse de Savoie, sœur de la comtesse de Provence. Si la jeune mariée est à peine moins laide que son aînée, de sorte qu’elle ne tardera pas à voir le beau Charles Philippe, pris « d’une indigestion de gâteau de Savoie » se détourner d’elle au profit de nombreuses maîtresses, il ne lui en aura pas moins fait trois enfants en trois ans : deux fils, titrés duc d’Angoulême et duc de Berry, et une fille, Sophie, qui mourra en bas âge.
Angoulême, toujours en second
Lorsque Angoulême naît à Versailles, le 6 août 1775, la stérilité persistante du couple royal et celle du mauvais ménage Provence fait de lui, au grand dam de Marie-Antoinette, le seul prince de la nouvelle génération et un futur roi potentiel. Il le restera jusqu’en 1780 et la naissance du premier dauphin, Louis Joseph. Penché sur le berceau du nouveau-né, Angoulême aurait dit à son père : « Qu’il est donc petit, mon cousin ! » ; à quoi Artois, dépité, aurait répliqué : « Mon fils, un jour viendra où vous le trouverez bien assez grand … » Ce jour ne vint jamais et Angoulême, finalement, retrouva le premier rang dans la succession royale.
Tout, pourtant, s’est ligué, pendant sa vie, afin de réduire ce prince, qui ne manquait pas de qualités ni de vertus, à jouer les seconds rôles sous les regards désapprobateurs, méprisants ou apitoyés de contemporains dont il ne sut pas se faire apprécier. Était-il pour autant aussi nul que la postérité le prétendra sans nuance ? C’est à cette question que tente de répondre, dans une biographie, la première publiée depuis longtemps, François de Coustin. En l’intitulant Louis XIX, l’auteur affiche son intention de rendre son rôle politique à celui qui fut roi de France quelques secondes, le temps, à Rambouillet, de signer, avant son père, le 3 août 1830, sa renonciation à la couronne au profit de son neveu, le petit duc de Bordeaux.
Au lendemain de la prise de la Bastille, à la demande instante du Roi, qui craint pour sa vie, Artois a quitté la France avec sa famille. Louis Antoine a quatorze ans et, avec une maturité précoce, il pressent que cet exil va durer. En effet, il ne reverra la France qu’un quart de siècle plus tard.
Dans l’intervalle, l’emprisonnement de la Famille royale, la mort de Louis XVI, puis celle du petit Louis XVII au Temple auront refait de lui l’espoir de la branche aînée des Bourbons. « Spes », l’espoir, tel est d’ailleurs le nom que, dans sa correspondance codée, lui attribue son oncle Louis XVIII.
Très vite, inquiet des positions politiques et des choix du comte d’Artois, Louis XVIII s’évertue à prendre sous sa tutelle ce neveu qu’il désire former à son futur métier de roi selon ses vues. Comme le souligne Coustin, vivre pris entre un père qu’il aime et auquel il doit obéissance, et un oncle qui est son souverain, incapables d’être d’accord sur rien, sera pour Angoulême cause d’un perpétuel malaise. Son mariage avec sa cousine, Madame Royale, ne fera que rendre sa position plus délicate.
Prêtant à Louis XVI et Marie-Antoinette des intentions qu’ils n’avaient pas, Louis XVIII affirmera, au lendemain de la libération de leur fille, que leur plus cher désir avait toujours été de marier les deux cousins. En fait, en 1789, Louis Antoine était officiellement fiancé à une autre de ses parentes, la princesse Adélaïde d’Orléans. Cette union devenue impossible, lui faire épouser « l’orpheline du Temple » s’avérait, stratégiquement, le meilleur choix. D’abord parce qu’il interdisait aux Autrichiens de concrétiser leur projet de marier Marie-Thérèse à un archiduc et, après avoir aboli la loi salique, d’imposer un souverain Habsbourg à la France, ensuite parce que la gloire douloureuse de la princesse conférerait à son époux une légitimité nouvelle.
12 mars 1814. Louis-Antoine de Bourbon, duc d’Angoulême, entre à Bordeaux après l’abdication de Napoléon.
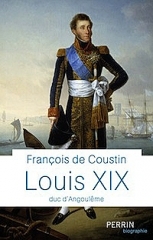 Un prince de qualité
Un prince de qualité
Coustin s’intéresse peu aux sentiments de son héros ; il est vrai qu’en ce domaine, celui-ci fut toujours d’une discrétion exemplaire et qu’au nom de la charité chrétienne, peu avant sa mort, en 1844, il détruisit son journal intime car il y avait porté sur autrui des jugements peu amènes. Il serait donc difficile de percer le secret de cette union politique muée en authentique histoire d’amour, la duchesse d’Angoulême portant, pour son mari, ce surnom révélateur « Gioia mia », ma joie, si, en 1815, Napoléon n’avait eu l’inélégance de publier la correspondance, interceptée, que le prince, dans le Midi, adressait à sa femme à Bordeaux.
Jusqu’à la première Restauration, malgré les nombreuses tentatives d’Angoulême pour servir en première ligne, on aura eu soin de préserver sa vie trop précieuse à la dynastie. Lors des Cent-Jours, les circonstances feront cependant qu’il se retrouvera exposé comme jamais. Coustin souligne l’attitude exemplaire du prince pendant cette campagne malheureuse dans le Midi, qui se soldera, car il aura refusé d’abandonner ses maigres troupes, par son arrestation. On affirmera que Napoléon, vengeur, aurait envisagé de le faire fusiller mais qu’il y renonça, sous la pression de son entourage. Le fait est, en tout cas, que les bonapartistes devaient rendre hommage à l’incontestable courage du prince, qu’il démontrera de nouveau lors de la campagne d’Espagne, par ailleurs si décriée, en 1823.
Peu rancunier, Angoulême sera néanmoins l’un des plus chauds partisans de la politique de réconciliation nationale prônée par Louis XVIII, ce contre les vœux de sa femme et de son père. Charles X le lui fit-il durement payer, comme le pense le biographe, en 1830, en interdisant à ce fils qui ne partageait pas ses vues ultra de régner, serait-ce quelque minutes, pour l’excellente raison que, roi, Louis XIX, aussitôt, eût tenté d’imposer sa ligne politique, fort proche, sans doute, de celle par nécessité, choisie par Louis-Philippe ? Peut-être … Dès lors, ne reste qu’à rêver à ce qui aurait pu être …
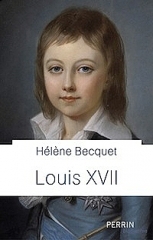 Et Louis XVII ?
Et Louis XVII ?
Charles X et la duchesse d’Angoulême n’étaient pas seuls à déplorer les positions trop libérales du prince. C’est parce que Louis XVIII et Angoulême déçoivent les espérances de royalistes au demeurant d’un dévouement incontestable, que ceux-ci se prennent à espérer une impossible survie de Louis XVII. D’emblée, Hélène Becquet qui, après avoir consacré un essai à Madame Royale en publie un sur son frère Louis XVII, l’assène : Louis XVII ne saurait être, pour un universitaire, objet d’histoire. Comme elle l’a déjà fait pour la fille de Louis XVI, elle ne s’intéresse donc pas à la personne que recouvre le titre, mais à l’image politique qui découle de la naissance et de la fonction.
Dans cette étude, il n’est guère question de l’enfant martyr et beaucoup de ce qu’il incarna. Fils cadet que la mort prématurée de son frère aîné fait dauphin à l’instant où débute la Révolution, puis prince royal, puis fils Capet et « louveteau » issu d’une « race criminelle » vouée à l’extermination, Louis Charles réunit sur sa tête de sept ans toute la haine des uns et toute la ferveur des autres. Qu’en a-t-il compris ? À cette question, l’historienne ne répond pas. Tel n’est pas son propos. Louis XVII peut être terrifié par les événements, arraché à sa mère, maltraité par des éducateurs improvisés et brutaux, transformé sans le comprendre en accusateur de la reine et de Madame Élisabeth, souffrir des mois durant seul dans une chambre murée, et finalement agoniser interminablement de tuberculose presque sans aucun réconfort, puis mourir à dix ans, cela n’est pas son propos. Il n’est à ses yeux qu’un symbole. En quoi il se peut qu’elle se trompe.
Lorsque, en février 1795, Charette, à La Jaunais, accepta une paix que d’aucuns jugèrent déshonorante, ce ne fut pas pour une image que le général du Roi s’exposa aux rumeurs honteuses de trahison, mais pour une personne vivante, un enfant de chair et de sang, qui souffrait et que les Conventionnels avaient promis de lui remettre. La monarchie française est incarnée. C’est sa force. Si la République n’est qu’une idée, le Roi, lui, est une personne.
Louis XIX, François de Coustin, Perrin. 470 p. 25 €.
Louis XVII, Hélène Becquet, Perrin, mai 2017, 304 pages, 20,90 €
Libellés :
Charles X,
Louis XV,
Louis XVI,
Louis XVII,
XVIIIe siècle
samedi 10 mars 2018
Matérialisme, Terreur, relativisme moral… : le côté obscur des Lumières

Le philosophe Bertrand Vergely remet en cause dans un essai iconoclaste, « Obscures Lumières », l’apport des Lumières à la pensée. Non seulement l’humanisme n’est pas, rappelle-t-il, né avec la Révolution, mais d’après lui les Lumières ont institué un impérialisme de la Raison, qui assassine en l’homme ce qu’il a de spirituel.
Qu’oppose-t-on vraiment à l’islam radical aujourd’hui? La morale «Charlie Hebdo», c’est-à-dire le vieux fond anticlérical révolutionnaire revendiquant le «ni Dieu ni maître» de l’anarchisme, sur fond de droit au blasphème! Ce n’est pas ça, la morale laïque. Je suis d’accord pour opposer une morale face à la violence islamiste. Mais quand commence-t-on? Sur la base de quel enseignement, et de quelles valeurs ?
Dans votre livre, vous semblez voir dans les Lumières une nouvelle religion, dont vous dites que, contrairement à l’idée reçue, elle est bien plus obscurantiste que le christianisme qu’elle a remplacé. Manifestement cette religion n’est pas la vôtre…
La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c’est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l’obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l’homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c’est l‘inverse qui s’est produit. Sous prétexte de libérer la société de l’obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l’obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l’homme total contrôlant la nature et l’homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c’est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l’origine d’une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.
Comment expliquez-vous que le siècle des Lumières se soit achevé sous le règne de la Terreur ?
Sous couvert de vouloir lutter contre l’injustice, les penseurs des Lumières ont en réalité voulu créer une humanité entièrement nouvelle. Quand on a comme projet de transformer ce qui fait l’essence de l’humanité, que peut-il se passer? Sur un plan théorique et culturel, on est obligé de se prendre pour Dieu en remplaçant la loi divine par la loi humaine qui devient une nouvelle loi divine. Hobbes dans le Léviathan réécrit le livre de la Genèse en faisant naître l’homme du contrat social et, derrière lui, du Droit humain. Résultat: c’est désormais l’État qui garantit le Droit, devenant en quelque sorte le nouveau Dieu sur terre. Ce qui est l’essence du totalitarisme. Par ailleurs, pratiquement, quand on prétend être la vraie humanité qui va bâtir la nouvelle humanité, on est obligé d’éliminer par la terreur les représentants et les symboles de l’ancienne société et de l’ancienne humanité, l’ancien ne pouvant pas cohabiter avec le nouveau. C’est exactement ce qui s’est passé. Depuis la Révolution Française, tous les régimes révolutionnaires ont été des régimes de terreur dans lesquels on liquidait dans la violence les nobles, les prêtres, les riches, les intellectuels etc … […]
vendredi 9 mars 2018
Secrets d’histoire
Sous la direction de Jean-Christian Petitfils, un collectif d’historiens apporte un éclairage nouveau sur vingt énigmes de l’histoire de France grâce à des documents parfois inédits et à des preuves indiscutables.
Les « Enigmes de l’histoire », filmées en noir et blanc et racontées par André Castelot et Alain Decaux, firent la joie du petit écran à une époque où l’unique chaîne de télévision d’Etat exprimait une exigence culturelle aujourd’hui trop rare. Du mystère de Mayerling – l’archiduc Rodolphe, fils de l’empereur François-Joseph, s’est-il suicidé ou a-t-il été assassiné ? – à l’identité véritable de cette Anna Anderson qui, surgie à Berlin dans les années 1920, prétendait être la grande-duchesse Anastasia, fille de Nicolas II, le grand public s’était initié, aux heures de grande écoute, à quelques célèbres mystères du passé. La formule a été reprise, au cours des années récentes, par des émissions programmées à un horaire tardif, alors que ces énigmes, construites selon la logique des enquêtes policières, ont tout pour passionner.
Sous forme écrite, l’énigme historique est un genre qui a trop souvent nourri une infralittérature aux accents ésotériques ou complotistes. Aussi faut-il se féliciter de la parution d’un volume qui satisfait à la fois la curiosité intellectuelle pour les mystères de l’histoire et les canons de la recherche historique et scientifique. Sous la direction de Jean-Christian Petitfils, historien de la France classique qu’on ne présente plus, les éditions Perrin publient, en coédition avec Le Figaro Histoire, un livre collectif, Les énigmes de l’histoire de France, dont les dix-huit auteurs, outre Petitfils qui signe deux chapitres, se sont partagé vingt sujets. Aucun n’est vraiment neuf, mais tous abordés, ici, en s’appuyant sur des preuves irréfutables et des documents parfois inédits. « N’en déplaise aux détectives amateurs qui se complaisent dans les ronrons de l’histoire et se copient les uns les autres, souligne Petitfils dans son introduction, une des conclusions à tirer de ce livre est que la recherche avance, que les halos légendaires se dissipent, bref que l’on serre toujours plus près la vérité. »
Si l’ouvrage s’organise chronologiquement, Jean-Christian Petitfils en propose lui-même un classement autour de six grands thèmes. Première catégorie, les énigmes concernant des événements ou des personnages de premier plan. Jean-Louis Brunaux, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la civilisation gauloise, pose la question d’Alésia – non pas du site de la bataille, sa localisation à Alise-Sainte-Reine, en Côte d’Or, étant hors de débat – mais pour comprendre comment Vercingétorix et ses 300 000 combattants ont été battus par un adversaire cinq fois moins nombreux, César ayant avec lui 60 000 légionnaires. L’explication est technique, mais la leçon d’histoire est politique puisque Brunaux estime que le chef gaulois vaincu avait remporté une victoire symbolique en rassemblant 300 000 guerriers appartenant à plus de quarante cités, ce qui réserve à Vercingétorix une place au Panthéon du « roman national » désormais honni par certains. Laurent Theis, président honoraire de la Société de l’histoire du protestantisme français, passe en revue les commanditaires possibles du massacre de la Saint-Barthélemy (Catherine de Médicis ? Charles IX ? Le futur Henri III ? Le duc Henri de Guise ?), tandis que Olivier Wieviorka, un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, revient sur les secrets du rendez-vous de Caluire qui, le 21 juin 1943, permit aux Allemands d’arrêter Jean Moulin, ou que Pierre Pellissier, un ancien journaliste du Figaro, explique pourquoi De Gaulle s’est réfugié auprès du général Massu, le 29 mai 1968, alors que le pays sombrait dans l’anarchie.
Deuxième catégorie : les morts mystérieuses. Qui a armé le bras de Ravaillac ? Jean-Christian Petitfils reprend ici l’hypothèse qu’il avait développée dans L’Assassinat d’Henri IV, mystères d’un crime (Perrin, 2009) : le meurtrier n’aurait-il pas été manipulé par des agents de l’archiduc Albert d’Autriche, dans le cadre d’un plan conçu à Bruxelles ? Qui a tué le duc d’Enghien, fusillé dans les fossés de Vincennes en 1804 ? Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, essaie de démêler le vrai du faux, Bonaparte ayant qualifié cette exécution de « crime inutile » avant d’un revendiquer la responsabilité. Le dernier Condé s’est-il réellement pendu à une espagnolette du château de Saint-Leu, en 1830, ou était-ce un crime maquillé en suicide ? Pierre Cornut-Gentille, avocat et historien, fournit la clé de l’énigme qui est à chercher du côté de certaines pratiques inavouables. Et Zola, retrouvé un matin de 1902 asphyxié par des émanations d’oxyde de carbone ? Alain Pagès, professeur émérite à la Sorbonne-Nouvelle, a découvert, au prix d’une véritable enquête, la raison de sa mort.
Dans la troisième catégorie figurent les chapitres consacrés aux trésors enfouis et aux sociétés secrètes. Le médiéviste Alain Demurger, spécialiste des ordres religieux militaires, décrypte les innombrables mythes et fantasmes qui accompagnent l’histoire des Templiers, et de leur introuvable trésor. La Cagoule, mystérieuse organisation anticommuniste des années 1930, avait-elle les moyens et l’intention de perpétrer un coup d’Etat d’extrême droite ? Olivier Dard, professeur à la Sorbonne et spécialiste d’histoire politique, relativise le sérieux des projets des cagoulards. L’abbé Saunière, curé de Rennes-le-Château, dans l’Aude, mort en 1917, était-il le détenteur d’un fabuleux trésor ? Jean-Jacques Bedu, un historien qui a hérité des archives de l’étrange ecclésiastique, fait le point sur une légende qui a été relancée par le Da Vinci Code de Dan Brown.
Les origines mystérieuses de certaines figures fournissent une quatrième catégorie d’énigmes. Spécialiste de l’histoire des femmes sous l’Ancien Régime, Joëlle Chevé s’efforce de comprendre qui était sœur Louise-Marie-Thérèse, une religieuse de couleur, bénédictine au couvent de Moret, près de Fontainebleau, à la fin du règne de Louis XIV, et qui, protégée de Mme de Maintenon, recevait fréquemment la visite de hauts personnages de la Cour. Quant à Napoléon III, s’il était le fils d’Hortense de Beauharnais, était-il celui de Louis Bonaparte, roi de Hollande ? Afin de lever définitivement les doutes émis dès la naissance du second empereur des Français, son biographe, Eric Anceau, professeur à la Sorbonne, s’en remet aux analyses ADN déjà effectuées et dont les résultats mériteraient une contre-expertise, tout en soulignant que « la recherche en paternité de Napoléon III n’a en aucune manière influé sur le cours de l’histoire ».
Cinquième catégorie d’énigmes : les survivances. Jeanne d’Arc a-t-elle vraiment brûlé sur le bûcher ou a-t-elle réapparu sous les traits de Jeanne des Armoises ? Etat-elle la fille d’Isabeau de Bavière ? Jacques Trémolet de Villers, avocat et auteur d’une édition des minutes du procès de Rouen, démonte les légendes qui ont couru sur la Pucelle. Et que valaient les prétentions de Naundorff et de tous les faux Dauphins qui ont prétendu être fils de Louis XVI et Marie-Antoinette ? L’historien Philippe Delorme expose les conclusions sans appel tirées des analyses ADN effectuées en 2000 sur le cœur de l’enfant-roi mort dans la prison du Temple.
Quelques vieux secrets d’Ancien Régime représentent la dernière catégorie d’énigmes rassemblées dans ce volume. Jusqu’où allaient les relations entre Anne d’Autriche et Mazarin ? Directeur du Centre historique des archives du château de Vincennes, Thierry Sarmant étudie – avec pudeur – ce lien fait d’amour et de politique. Qui était le Masque de Fer ? Jean-Christian Petitfils, qui a publié un livre sur le sujet, possède une réponse précise. Que dissimulait l’affaire des Poisons (traitée ici par Claude Quétel) qui jeta une ombre sur le Roi-Soleil, ou l’affaire du Collier de la Reine, qui ternit irrémédiablement la réputation de Marie-Antoinette, alors qu’en l’occurrence elle était innocente, comme le rappelle Hélène Delalex, conservateur du patrimoine au château de Versailles ?
Amateurs de grande histoire ou de petites histoires apprendront beaucoup dans ce livre qui pique l’imagination. A travers ces vingt énigmes se vérifie une grande loi, valable dans le passé comme de nos jours, et qui conservera demain sa pertinence : rien n’est jamais écrit d’avance, car l’imprévu et l’inexplicable peuvent survenir à chaque instant, et la raison pure ne peut tout éclairer, car toute aventure humaine conserve sa part de mystère.
Sous forme écrite, l’énigme historique est un genre qui a trop souvent nourri une infralittérature aux accents ésotériques ou complotistes. Aussi faut-il se féliciter de la parution d’un volume qui satisfait à la fois la curiosité intellectuelle pour les mystères de l’histoire et les canons de la recherche historique et scientifique. Sous la direction de Jean-Christian Petitfils, historien de la France classique qu’on ne présente plus, les éditions Perrin publient, en coédition avec Le Figaro Histoire, un livre collectif, Les énigmes de l’histoire de France, dont les dix-huit auteurs, outre Petitfils qui signe deux chapitres, se sont partagé vingt sujets. Aucun n’est vraiment neuf, mais tous abordés, ici, en s’appuyant sur des preuves irréfutables et des documents parfois inédits. « N’en déplaise aux détectives amateurs qui se complaisent dans les ronrons de l’histoire et se copient les uns les autres, souligne Petitfils dans son introduction, une des conclusions à tirer de ce livre est que la recherche avance, que les halos légendaires se dissipent, bref que l’on serre toujours plus près la vérité. »
Si l’ouvrage s’organise chronologiquement, Jean-Christian Petitfils en propose lui-même un classement autour de six grands thèmes. Première catégorie, les énigmes concernant des événements ou des personnages de premier plan. Jean-Louis Brunaux, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la civilisation gauloise, pose la question d’Alésia – non pas du site de la bataille, sa localisation à Alise-Sainte-Reine, en Côte d’Or, étant hors de débat – mais pour comprendre comment Vercingétorix et ses 300 000 combattants ont été battus par un adversaire cinq fois moins nombreux, César ayant avec lui 60 000 légionnaires. L’explication est technique, mais la leçon d’histoire est politique puisque Brunaux estime que le chef gaulois vaincu avait remporté une victoire symbolique en rassemblant 300 000 guerriers appartenant à plus de quarante cités, ce qui réserve à Vercingétorix une place au Panthéon du « roman national » désormais honni par certains. Laurent Theis, président honoraire de la Société de l’histoire du protestantisme français, passe en revue les commanditaires possibles du massacre de la Saint-Barthélemy (Catherine de Médicis ? Charles IX ? Le futur Henri III ? Le duc Henri de Guise ?), tandis que Olivier Wieviorka, un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, revient sur les secrets du rendez-vous de Caluire qui, le 21 juin 1943, permit aux Allemands d’arrêter Jean Moulin, ou que Pierre Pellissier, un ancien journaliste du Figaro, explique pourquoi De Gaulle s’est réfugié auprès du général Massu, le 29 mai 1968, alors que le pays sombrait dans l’anarchie.
Deuxième catégorie : les morts mystérieuses. Qui a armé le bras de Ravaillac ? Jean-Christian Petitfils reprend ici l’hypothèse qu’il avait développée dans L’Assassinat d’Henri IV, mystères d’un crime (Perrin, 2009) : le meurtrier n’aurait-il pas été manipulé par des agents de l’archiduc Albert d’Autriche, dans le cadre d’un plan conçu à Bruxelles ? Qui a tué le duc d’Enghien, fusillé dans les fossés de Vincennes en 1804 ? Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, essaie de démêler le vrai du faux, Bonaparte ayant qualifié cette exécution de « crime inutile » avant d’un revendiquer la responsabilité. Le dernier Condé s’est-il réellement pendu à une espagnolette du château de Saint-Leu, en 1830, ou était-ce un crime maquillé en suicide ? Pierre Cornut-Gentille, avocat et historien, fournit la clé de l’énigme qui est à chercher du côté de certaines pratiques inavouables. Et Zola, retrouvé un matin de 1902 asphyxié par des émanations d’oxyde de carbone ? Alain Pagès, professeur émérite à la Sorbonne-Nouvelle, a découvert, au prix d’une véritable enquête, la raison de sa mort.
Dans la troisième catégorie figurent les chapitres consacrés aux trésors enfouis et aux sociétés secrètes. Le médiéviste Alain Demurger, spécialiste des ordres religieux militaires, décrypte les innombrables mythes et fantasmes qui accompagnent l’histoire des Templiers, et de leur introuvable trésor. La Cagoule, mystérieuse organisation anticommuniste des années 1930, avait-elle les moyens et l’intention de perpétrer un coup d’Etat d’extrême droite ? Olivier Dard, professeur à la Sorbonne et spécialiste d’histoire politique, relativise le sérieux des projets des cagoulards. L’abbé Saunière, curé de Rennes-le-Château, dans l’Aude, mort en 1917, était-il le détenteur d’un fabuleux trésor ? Jean-Jacques Bedu, un historien qui a hérité des archives de l’étrange ecclésiastique, fait le point sur une légende qui a été relancée par le Da Vinci Code de Dan Brown.
Les origines mystérieuses de certaines figures fournissent une quatrième catégorie d’énigmes. Spécialiste de l’histoire des femmes sous l’Ancien Régime, Joëlle Chevé s’efforce de comprendre qui était sœur Louise-Marie-Thérèse, une religieuse de couleur, bénédictine au couvent de Moret, près de Fontainebleau, à la fin du règne de Louis XIV, et qui, protégée de Mme de Maintenon, recevait fréquemment la visite de hauts personnages de la Cour. Quant à Napoléon III, s’il était le fils d’Hortense de Beauharnais, était-il celui de Louis Bonaparte, roi de Hollande ? Afin de lever définitivement les doutes émis dès la naissance du second empereur des Français, son biographe, Eric Anceau, professeur à la Sorbonne, s’en remet aux analyses ADN déjà effectuées et dont les résultats mériteraient une contre-expertise, tout en soulignant que « la recherche en paternité de Napoléon III n’a en aucune manière influé sur le cours de l’histoire ».
Cinquième catégorie d’énigmes : les survivances. Jeanne d’Arc a-t-elle vraiment brûlé sur le bûcher ou a-t-elle réapparu sous les traits de Jeanne des Armoises ? Etat-elle la fille d’Isabeau de Bavière ? Jacques Trémolet de Villers, avocat et auteur d’une édition des minutes du procès de Rouen, démonte les légendes qui ont couru sur la Pucelle. Et que valaient les prétentions de Naundorff et de tous les faux Dauphins qui ont prétendu être fils de Louis XVI et Marie-Antoinette ? L’historien Philippe Delorme expose les conclusions sans appel tirées des analyses ADN effectuées en 2000 sur le cœur de l’enfant-roi mort dans la prison du Temple.
Quelques vieux secrets d’Ancien Régime représentent la dernière catégorie d’énigmes rassemblées dans ce volume. Jusqu’où allaient les relations entre Anne d’Autriche et Mazarin ? Directeur du Centre historique des archives du château de Vincennes, Thierry Sarmant étudie – avec pudeur – ce lien fait d’amour et de politique. Qui était le Masque de Fer ? Jean-Christian Petitfils, qui a publié un livre sur le sujet, possède une réponse précise. Que dissimulait l’affaire des Poisons (traitée ici par Claude Quétel) qui jeta une ombre sur le Roi-Soleil, ou l’affaire du Collier de la Reine, qui ternit irrémédiablement la réputation de Marie-Antoinette, alors qu’en l’occurrence elle était innocente, comme le rappelle Hélène Delalex, conservateur du patrimoine au château de Versailles ?
Amateurs de grande histoire ou de petites histoires apprendront beaucoup dans ce livre qui pique l’imagination. A travers ces vingt énigmes se vérifie une grande loi, valable dans le passé comme de nos jours, et qui conservera demain sa pertinence : rien n’est jamais écrit d’avance, car l’imprévu et l’inexplicable peuvent survenir à chaque instant, et la raison pure ne peut tout éclairer, car toute aventure humaine conserve sa part de mystère.
Jean Sévillia
Les Enigmes de l’histoire de France, sous la direction de Jean-Christian Petitfils, Perrin / Le Figaro Histoire, 400 pages, 21 euros.
Libellés :
1920,
1930,
Alésia,
Jean Sévillia,
Napoléon III,
Vercingétorix
jeudi 8 mars 2018
mercredi 7 mars 2018
mardi 6 mars 2018
lundi 5 mars 2018
Non, les Gaulois n’étaient pas des barbares

DOSSIER – Une biographie de Vercingétorix et un essai sur les celtes corrigent l’image barbare que Jules César avait donnée de ses adversaires dans «La Guerre des Gaules». Et montrent que la civilisation gauloise s’est développée en osmose avec le monde grec.
Vercingétorix, un guerrier éduqué par les druides
Longtemps, Vercingétorix n’a existé qu’à travers la plume de César qui dans La Guerre des Gaules fait de lui un portrait aussi partiel que partial. Il magnifie les qualités guerrières de son adversaire pour exalter ses propres mérites stratégiques. Aux yeux de César, les Gaulois étaient des Barbares que Rome devait dominer pour instaurer la paix. Cette conception sera remaniée par les historiens nationalistes du XIXe siècle pour qui les Gaulois étaient nos ancêtres et Vercingétorix leur chef flamboyant. Une sorte de «souverainiste» avant l’heure, un militant de l’indépendance nationale dont de Gaulle fera d’ailleurs l’apologie dans ses discours de guerre. Le grand perdant de ces représentations fut Vercingétorix lui-même, dont on ne savait presque rien.
C’est dire l’intérêt de cette biographie de Jean-Louis Brunaux. Les progrès de l’archéologie mais aussi la lecture des auteurs de l’Antiquité permettent de peaufiner l’idée que l’on se fait de ce chef arverne qui, selon Brunaux, fut très près de vaincre César. Le tableau que Brunaux campe de Vercingétorix jeune est captivant. Très grand et majestueux, «l’air terrible», Vercingétorix a vécu plusieurs années dans la proximité de César. Il l’a assisté dans sa lutte contre les Germains d’Arioviste qui avaient pénétré en Gaule… avant de prendre la tête de la révolte contre Rome.
Comment s’est-il imposé? Fils du roi Celtill, il fut formé par les druides, qui constituent une classe sacerdotale dont les conceptions sont proches des pythagoriciens de la Grèce présocratique. Ils croient en la métempsychose et tentent de faire reculer la violence endémique des sociétés gauloises, notamment les sacrifices humains. En Gaule rien d’essentiel ne se décide sans eux. Vercingétorix n’est pas le rustre hirsute de l’image d’Épinal. Les mœurs des Gaulois ont tout de même évolué depuis l’époque où ils mirent Rome à sac et où ils combattaient nus et couverts d’or. Même si la notion moderne de nationalisme ne signifie rien en Gaule, Brunaux montre que Vercingétorix refuse l’acculturation au monde romain. D’une certaine manière, il est un anticolonialiste avant l’heure. «Il arriva trop tard dans un monde en mutation. Tous les nobles et les bourgeois du centre de la Gaule reniaient leurs valeurs ancestrales et aspiraient à vivre à la mode romaine (…). Quelques années plus tôt, il eût gagné son pari, rassembler les hommes et les cités autour d’un même projet politique qu’il définissait comme celui de la liberté commune.»
Nous avons rencontré Jean-Louis Brunaux, archéologue français spécialiste de la civilisation gauloise et auteur de Vercingétorix.
LE FIGARO. – Quelle est la spécificité de cette biographie par rapport à celles qui ont déjà été consacrées au personnage?
Jean-Louis BRUNAUX. – Il s’agit de donner vie aux Gaulois. Or Vercingétorix est le seul qui se prête à ce genre d’exercice. L’époque où il vécut est désormais bien connue à travers l’archéologie. Dans les biographies précédentes il est plus question de la Gaule et de César que du jeune chef arverne. J’ai donc voulu faire une vraie biographie, de la naissance à la mort du personnage.
Comment expliquer que César ait à ce point occulté des pans entiers de la vie de son adversaire?
-La Guerre des Gaules est un ouvrage de propagande. C’est l’œuvre d’un grand littérateur qui réécrit l’histoire. César fait du chef gaulois un adversaire à sa mesure: la victoire est d’autant plus belle que l’ennemi est redoutable. Mais il se garde de dire qu’il entretenait des liens d’amitié et d’hospitalité avec le jeune Arverne. Un tel aveu aurait jeté quelque doute sur la réalité de sa conquête de la Gaule, qui fut moins une œuvre militaire qu’un chef-d’œuvre de diplomatie.
Vous insistez sur la puissance des Arvernes dont Vercingétorix était le chef. Que représentaient-ils dans le monde gaulois?
-Les Arvernes, par leur situation géographique mais aussi par leur rôle dans l’histoire de la Gaule des cinq siècles précédant la conquête, jouent un rôle central. Longtemps ils furent les patrons de la Gaule: ils jouissaient d’un puissant réseau leur permettant de contrôler une grande partie du commerce avec les puissances méditerranéennes. Mais les événements de la deuxième guerre punique, avec le passage d’Hannibal en Gaule, offrirent à leurs concurrents éduens du Morvan la chance de s’allier avec Rome. Les Éduens, déclarés par le Sénat «Frères consanguins des Romains», devinrent le fer de lance de l’entreprise commerciale et impérialiste que Rome menait en Gaule. Les deux grandes puissances du centre – les Éduens, tenants de la romanité, les Arvernes, défenseurs des traditions gauloises – s’affrontèrent alors par l’intermédiaire de leurs peuples clients.
Les druides, auxquels vous accordez beaucoup d’importance, sont-ils spécifiques au monde gaulois?
-Les druides sont consubstantiels à la civilisation gauloise. Philosophes et savants, ils remplacèrent les cultes de type préhistorique par une religion d’État. Ils installèrent une nouvelle spiritualité proche du pythagorisme: l’écriture et l’image proscrites ; l’âme, immortelle, se réincarnant dans une succession de vies. Ils donnèrent des modèles aux institutions politiques, séparant la justice qu’ils exerçaient eux-mêmes du pouvoir régalien et prenant en charge l’éducation de la jeunesse. Les druides ne sont connus qu’en Gaule. Ce qui ne surprend pas: la civilisation gauloise s’est développée en osmose avec le monde grec, par l’intermédiaire de Marseille notamment. Et les druides se sont abreuvés du savoir grec, de la philosophie et des sciences principalement, tout en veillant scrupuleusement à leur indépendance et à leur particularisme.
Les Gaulois contemporains de Vercingétorix sont-ils différents de leurs ancêtres de l’époque de Brennus qui mit Rome à sac?
-Entre les compagnons de Brennus qui prennent Rome vers – 380 et les guerriers de Vercingétorix, les différences sont minimes. Les uns et les autres cultivaient les mêmes traditions guerrières: animés d’une fureur belliqueuse, ils ne craignaient pas de mourir au combat. Cependant, en trois siècles, le monde avait changé. Les Gaulois de Brennus avaient conquis une grande partie de l’Italie et, en association avec Denys, le tyran de Syracuse, ils avaient failli abattre définitivement la cité romaine. Depuis, les Romains s’étaient relevés, avaient repris aux Gaulois toutes leurs terres d’Italie et tout le sud de la Gaule. Cependant, moralement, Rome ne s’était jamais remis de la honte infligée par Brennus, et César, trois siècles et demi plus tard, aura à cœur de laver cet affront.
Loin des stéréotypes, les Celtes étaient des penseurs et des artistes
Depuis longtemps, la Gaule a perdu la parole. Les vainqueurs n’ont pas seulement capturé ses ressources, ils se sont aussi emparés de sa mémoire. Ils ont parlé à sa place.
Ces Celtes, les Grecs les appellent Galates et les Romains Gaulois. Pour eux, ce sont des Barbares. Ils dorment dans la paille, ne mangent que de la viande, ne pensent qu’à la guerre. Leur fureur et leur sauvagerie effraient. Ces stéréotypes sont sans cesse repris dans les textes anciens.
Quand les Gaulois s’emparent de Rome, en 386 av. J.-C., c’est la plus grande humiliation que Rome ait subie sur son sol. En retour, la conquête de César est terriblement meurtrière. Au moins 20 % de morts et de déportés sur une population de 5 à 15 millions d’habitants.
Cette Gaule perdue n’a-t-elle plus rien à dire? Si, nous dit Laurent Olivier, conservateur en chef au Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, même si elle n’est plus qu’une voix infime, qui creuse les silences.
Avec ce voyage au pays des Celtes et leurs «réinventions» successives depuis César, il se livre à une vertigineuse généalogie de la mémoire. C’est comme si on lisait un roman policier ponctué de diversions et de malentendus, de tâtonnements et parfois d’égarements.
Une proximité entre la pensée gauloise et le savoir grec
Au XIXe siècle, lorsqu’on commence à fouiller des tombes, on ne reconnaît pas d’abord les vestiges que les Gaulois avaient laissés, bien qu’on les eût directement sous les yeux. On les attribue à des cultures plus civilisées. Que leur armement fut comparable à celui des Grecs et des Romains, qu’ils portèrent des parures aussi délicates et raffinées, on ne veut pas le croire.
Jusqu’au début des années 1980, on crut même qu’ils vivaient dans des cabanes basses et obscures, au milieu de leurs immondices. On sait aujourd’hui qu’il existe aussi une proximité étroite de la pensée gauloise et du savoir grec – les savants gaulois partageaient sans doute avec les pythagoriciens l’idée que le monde est régi par les nombres.
C’est par la découverte du Nouveau Monde – et celle des «sauvages» des Amériques – que l’on redécouvre les Celtes. On observa notamment des parentés dans le fonctionnement social. Quelque chose de gaulois – d’antérieur à eux, même – survivait chez ces «primitifs».
Les pages consacrées à l’art gaulois, célébré par les surréalistes, sont vivifiantes. C’est en toute conscience que les Celtes auraient choisi la voie de la stylisation, en se distinguant de l’art classique des civilisations méditerranéennes. Plus qu’une technique, l’art gaulois aurait été une façon de penser les formes et le monde. Il aurait survécu au long des siècles, notamment à travers les œuvres gallo-romaines et l’art roman.
On redécouvre aussi l’historien de la IIIe République Camille Jullian. Même si certains de ses points de vue sont surannés, il nous a montré que les Gaulois pensaient et réfléchissaient. Cette réminiscence que l’on perçoit «monter des profondeurs» est une notion que cet historien de la Gaule partage avec Bergson, le philosophe de la mémoire. Ainsi les héritages du passé se transmettent-ils en se transformant.
> Lire l’article dans Le Figaro
« L'héritage, une obsession française depuis la Révolution » ... Vu par Éric Zemmour

BILLET - Les querelles familiales autour de l'héritage de Johnny Hallyday passionnent les médias et les Français. C'est Mirabeau qui a bouleversé les règles en la matière. Un égalitarisme révolutionnaire qui n'a pas eu que des avantages.. [RTL 15.02]. Il en fait surtout ressortir les inconvénients avec humour et pertinence. Les royalistes sociaux du XIXe siècle ne disaient pas autre chose. Et les lecteurs de L'Enquête de la monarchie se souviendront que la liberté de tester était toujours au programme de Maurras et de ses amis royalistes en 1900. C'est bien clair, redisons-le : Zemmour est mieux qu'un réactionnaire, un antimoderne. LFAR
Johnny sera toujours Johnny. Toujours au cœur de l'actualité, toujours objet de scandales, toujours au centre des passions. Même mort, il continue de faire la « une » des journaux et d'enflammer les conversations familiales.
La famille de Johnny est comme toutes les familles : dès qu'il est question d'héritage, c'est la guerre. Surtout entre des enfants qui ne sont pas du même lit. Poisons et délices des familles recomposées.
La famille de Johnny est comme toutes les familles : dès qu'il est question d'héritage, c'est la guerre. Surtout entre des enfants qui ne sont pas du même lit. Poisons et délices des familles recomposées.
Nos contemporains ont beaucoup de mal à comprendre qu'on ose contester à Johnny le droit de faire ses quatre volontés. Dans toutes les séries américaines, le père déshérite tous ceux qui osent lui manquer de respect.
Mais en France, cette pratique est strictement interdite. La règle date de la Révolution. C'est même le dernier texte de loi que le grand Mirabeau lui-même défendit à l'Assemblée quelques jours avant sa mort.
Avant, les nobles avaient deux grands privilèges qu'ils ont perdus : ils ne payaient pas d'impôts, et ils avaient le droit de déshériter à leur guise leurs enfants.
Avec cette querelle autour de l'héritage de Johnny, on se rend compte que les riches ont retrouvé les deux privilèges des aristocrates d'avant : il leur suffit de s'exiler à l'étranger pour ne pas payer d'impôts et retrouver leur pouvoir souverain de choisir leurs héritiers. La Révolution française est bien finie.
vendredi 2 mars 2018
jeudi 1 mars 2018
mercredi 28 février 2018
À la redécouverte des Celtes
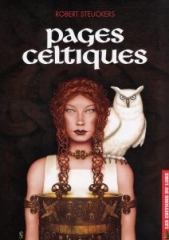 Georges Feltin-Tracol
Georges Feltin-Tracol
Après avoir publié La Révolution conservatrice allemande. Biographies de ses principaux acteurs et textes en 2014 et Généalogie du fascisme français. Dérives autour de Zeev Sternhell en 2017, les Éditions du Lore sortent Pages celtiques de Robert Steuckers (2017, 104 p., 15 €).
Responsable des excellentes revues Orientations et Vouloirdans les années 1980 – 2000, animateur du blogue éponyme ainsi que du site Euro-Synergies, l’une des principales figures de la « Nouvelle Droite » européenne propose une belle compilation d’études consacrées à un sujet méconnu : l’apport du monde celte à notre civilisation continentale.
L’auteur a le mérite de sortir du triangle habituel et quelque peu paresseux Athènes – Rome – Jérusalem pour rappeler que Constantinople, la Germanie, le monde slave et aussi la celtitude participent aux racines spirituelles des peuples européens. Ils doivent beaucoup aux Celtes jamais conquis d’Irlande et d’Écosse, en particulier la conversion à la foi chrétienne par l’intermédiaire du christianisme celtique.
Robert Steuckers revient aussi sur le long et patient combat de libération nationale et populaire des Celtes écossais et irlandais. Il rappelle que le mouvement national irlandais défendait un projet social ambitieux et un dessein pan-celtique. On retrouve d’ailleurs ce pan-celtisme dans la passion légitime qu’éprouve l’auteur pour les patries charnelles.
Ainsi rend-t-il un bel hommage à Olier Mordrel, l’infatigable militant de l’indépendance bretonne, et insiste-t-il sur la belle et fructueuse postérité intellectuelle de l’Allemand Herder. Il est clair que « le nationalisme irlandais est l’exemple même d’un nationalisme de matrice “ herdérienne ” (p. 98) ».
Ce sont au final de magnifiques pages qui font découvrir un patrimoine écarté par la volonté sénile des zélotes d’une Rome paulinienne et augustinienne et par leurs successeurs, les chantres débiles d’une Modernité agonisante.
Bonjour chez vous !
• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n°67, diffusée sur Radio-Libertés, le 23 février 2018.
mardi 27 février 2018
Raviver la flamme par Thierry DUROLLE
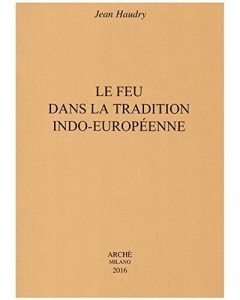 Le feu prend une place centrale dans l’histoire des hommes. Qu’il soit considéré comme un élément ou comme un phénomène importe finalement peu. De tout temps, sa maîtrise relevait d’une question de survie d’où, à n’en pas douter, l’importance de sa place dans la mythologie et dans ce que certains nomment la tradition indo-européenne. L’émérite professeur Jean Haudry, que l’on ne présente plus, a consacré un ouvrage à ce sujet brûlant.
Le feu prend une place centrale dans l’histoire des hommes. Qu’il soit considéré comme un élément ou comme un phénomène importe finalement peu. De tout temps, sa maîtrise relevait d’une question de survie d’où, à n’en pas douter, l’importance de sa place dans la mythologie et dans ce que certains nomment la tradition indo-européenne. L’émérite professeur Jean Haudry, que l’on ne présente plus, a consacré un ouvrage à ce sujet brûlant.
Le Feu dans la tradition indo-européenne est un ouvrage volumineux de plus de cinq cents pages. Le volume risque de rebuter les moins téméraires des lecteurs. Le propos, quant à lui, est universitaire par sa forme, dense et extrêmement riche sur le fond. C’est un ouvrage très complet, futur livre de référence sur la place du feu chez les Indo-Européens.
Ceux-ci sont représentés par six « aires culturelles » : l’Iran avestique, l’Inde, la civilisation gréco-romaine, la civilisation celtique, les cultures nordico-germaniques et slaves. Il en découle une complexe étude sur le feu et ses manifestations ! S’attarder sur son contenu ne paraît pas pas pertinent, ce serait trop long et cela reviendrait à paraphraser le travail de Jean Haudry. Revenons plutôt sur la structure du livre…
La première partie traite principalement de la place du feu dans la tradition indo-européenne, de la place du feu dans leurs sociétés respectives, et de la distinction entre le culte du feu et le feu du culte. Il faut tout de même préciser que l’auteur étudie tous les types de feu, que ceux-ci proviennent de la foudre ou non, qu’ils soient chauds ou « froids », ou encore de ses couleurs (noir, blanc et rouge). Il examine ainsi toutes les mythologies et tous les panthéons indo-européens. Guère étonnant que le deuxième chapitre du livre avoisine la centaine de pages !
Après avoir couvert ce panorama, Jean Haudry étudie, dans la deuxième partie, la notion de feu à travers ses divinités particulières, dont les divinités du foyer Hestia et Vesta. Sa troisième et dernière partie évoque ce que l’auteur appelle les anciens feux divins. C’est l’occasion, par exemple, de recroiser des figures mythologiques bien connues de notre grand panthéon européens telles Dionysos, Janus, Prométhée évidemment, ou encore Heimdall et Loki.
En conclusion, cette remarquable étude sur le feu dans la tradition indo-européenne représente une somme de travail colossale qui force le respect. Certes, l’ouvrage, assez ardu, nécessite toute l’attention du lecteur, mais il en sera récompensé par une mine d’or d’informations passionnantes.
Thierry Durolle
• Jean Haudry, Le Feu dans la tradition indo-européenne, Arché, 2016, 536 p., 43 €.
lundi 26 février 2018
Doctrine sociale de l’Eglise – Rerum Novarum (2)
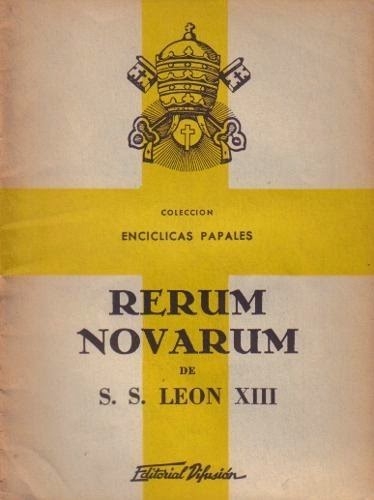
Deuxième vidéo de M. l’abbé Xavier Beauvais au sujet de l’encyclique Rerum Novarum et de la doctrine sociale de l’Eglise catholique.
dimanche 25 février 2018
samedi 24 février 2018
TERRE & PEUPLE Magazine n°74: Jacobinisme liberticide
 Communiqué de "Terre & Peuple-Wallonie"
Communiqué de "Terre & Peuple-Wallonie"
TERRE & PEUPLE Magazine n°74: Jacobinisme liberticide
Le numéro 74 de TERRE & PEUPLE Magazine est centré autour du thème du 'Jacobinisme liberticide'.
Dans son éditorial, Pierre Vial croise ses projecteurs sur les dénis du réel que proclament sans pudeur les saltimbanques obscènes de la comédie politicienne européenne, avec en tête le micro-Macron. Président des riches, il affecte de ne pas voir la pauvreté de neuf millions de ses compatriotes, ou de pouvoir l'imputer à leur paresse. Et de n'apercevoir, dans la crise démographique et le grand remplacement, qu'une hypothèse complotiste, et dans la menace djihadiste et la radicalisation qu'un problème de rééducation de déséquilibrés. Il serait, cela mis à part, l'homme de l'avenir. Quel avenir ?
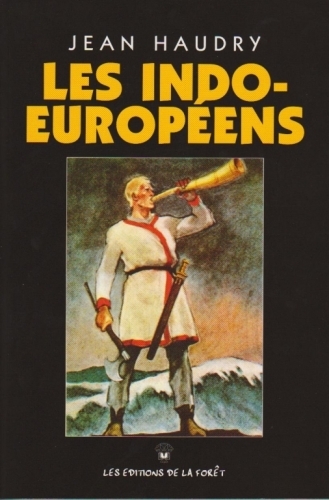 C'est Robert Dragan qui recueille la pensée de Jean Haudry, prélat de la confession indo-européaniste, sur son livre 'La religion des Indo-Européens' et en particulier sur 'Le feu dans la tradition indo-européenne'. Le feu est primordial dans la tradition préhistorique, central dans le foyer qu'il illumine et réchauffe. Il éclaire des métaphores, telle le feu de la parole qualifiante, le feu des eaux, qui désigne l'or. Si, à l'époque classique, il est présenté sous les formes d'une profusion de divinités diverses, d'Hestia-Vesta à Prométhée, en passant par Apollon, Héphaïstos et Artémis, avec leurs correspondants celtiques, germaniques, indiens, slave ou baltes, cette prolifération exprime l'importance de la notion : le feu est omniprésent dans la nature et dans l'homme. L'idée que la fortune est liée au feu apparaît à la fois très ancienne, à en juger sur les correspondances sur lesquelles elle se fonde, et très durable. Pour Héraclite, le feu constitue la substance même de l'univers. Aristote fait remonter cette conception à Pythagore. De fait, pour Philolaos, le « foyer de l'univers, maison de Zeus, principe de cohésion et mesure de la nature » est situé au milieu du monde. Or, comme l'a montré Schuhl, à partir d'un passage du Phèdre, la Nécessité s'identifie à la fois à Hestia « qui siège au centre du monde comme au coeur des cités, sur l'omphalos, au foyer des prytanées » et à l'idée du Bien : « Ce n'est pas un Atlas qui supporte le monde, mais le bien et l'obligation qui supportent toute chose. » Conception proche de celle de l'hymne védique à Mitra, « Mitra (contrat d'amitié) soutient terre et ciel», elle repose sur une homologie traditionnelle entre le respect des obligations, la cohérence du monde qui en dépend et le feu qui est l'élément lié à Mitra.
C'est Robert Dragan qui recueille la pensée de Jean Haudry, prélat de la confession indo-européaniste, sur son livre 'La religion des Indo-Européens' et en particulier sur 'Le feu dans la tradition indo-européenne'. Le feu est primordial dans la tradition préhistorique, central dans le foyer qu'il illumine et réchauffe. Il éclaire des métaphores, telle le feu de la parole qualifiante, le feu des eaux, qui désigne l'or. Si, à l'époque classique, il est présenté sous les formes d'une profusion de divinités diverses, d'Hestia-Vesta à Prométhée, en passant par Apollon, Héphaïstos et Artémis, avec leurs correspondants celtiques, germaniques, indiens, slave ou baltes, cette prolifération exprime l'importance de la notion : le feu est omniprésent dans la nature et dans l'homme. L'idée que la fortune est liée au feu apparaît à la fois très ancienne, à en juger sur les correspondances sur lesquelles elle se fonde, et très durable. Pour Héraclite, le feu constitue la substance même de l'univers. Aristote fait remonter cette conception à Pythagore. De fait, pour Philolaos, le « foyer de l'univers, maison de Zeus, principe de cohésion et mesure de la nature » est situé au milieu du monde. Or, comme l'a montré Schuhl, à partir d'un passage du Phèdre, la Nécessité s'identifie à la fois à Hestia « qui siège au centre du monde comme au coeur des cités, sur l'omphalos, au foyer des prytanées » et à l'idée du Bien : « Ce n'est pas un Atlas qui supporte le monde, mais le bien et l'obligation qui supportent toute chose. » Conception proche de celle de l'hymne védique à Mitra, « Mitra (contrat d'amitié) soutient terre et ciel», elle repose sur une homologie traditionnelle entre le respect des obligations, la cohérence du monde qui en dépend et le feu qui est l'élément lié à Mitra.
Jean-Patrick Arteault dresse avec une grande pénétration un état de l'opinion avant, pendant et après les dernières élections présidentielles. De nombreux Français étant attachés, par peur du changement, à l'euro et à l'Union européenne, il aurait mieux valu n'en point parler, d'autant plus que la souveraineté n'est qu'un moyen pour faire respecter l'identité. Et mener plutôt des actions discrètes, pour restaurer d'abord les souverainetés nationales, sans lesquelles on ne peut appliquer de politiques identitaires. Et faire le choix d'alliances avec des nations européennes souveraines, dont la Russie, pour en faire, à très long terme, naître une synthèse impériale, et non impérialiste. L'incapacité patente de la gauche intellectuelle à renouveler ses idées, le désarroi de ses plumitifs devant la défiance grandissante du public, son asservissement à l'oligarchie libérale, dont elle reprend tous les éléments de langage, tout cela a pu faire croire que la bataille métapolitique était gagnée. Cette victoire ne sera toutefois acquise que lorsque la grande majorité des écrivains et artistes exprimera consciemment (ou encore mieux inconsciemment) notre vision, lorsque la majorité des journalistes valorisera nos idées sans y être contraints. Lorsque la majorité des histrions qui façonnent la culture populaire travailleront spontanément dans notre sensibilité. Lorsqu'une grande majorité des enseignants transmettront nos concepts et valeurs, y ayant adhéré profondément. Lorsque pour une grande majorité de chercheurs notre vision du monde sera devenue le paradigme de leurs travaux. Dès lors, plus que jamais, c'est l'impératif métapolitique qui est à l'ordre du jour, l'investissement politique n'étant qu'une affiche de propagande. En matière électorale, à propos de la 'Ligne Buisson' qui vise à exploiter autant que la veine ouvriériste celle des conservateurs, l'auteur relève pas mal d'ambiguité : des conservateurs, mais de quoi ? D'une forme politique qui, à défaut de fond, permet la survie tant que le capitalisme financier n'a pas détruit les cadres sociaux et culturels ? Quand ce n'est pas un conservatisme réactionnaire de nostalgiques, ou tout simplement de nantis, voire de colbertiens raisonnables qu'inquiètent les partageux. L'ambiguïté de leur conservatisme est encore aggravée pour les catholiques, par leur vocation universaliste, quand ce n'est pas par leur 'anti-fascisme'. On est loin de la fidélité à la tradition culturelle populaire et ses fondamentaux moraux. Jean-Patrick Arteault veut croire à la sincérité de Patrick Buisson quand celui-ci veut joindre aux conservateurs intégraux la couche populaire instinctivement identitaire. Il avertit contre le risque de servir de Harkis à une bourgeoisie apatride. On ne peut blâmer le FN de tenir à distance des éléments compromis dans des structures largements infiltrées d'indicateurs, de provocateurs et de policiers, qui sont utilisés pour lui nuire. Mais bien de négliger les enjeux actuels qui préoccupent la majorité de la population. La dédiabolisation est un échec pour le FN, qui a rallié l'idéologie d'un ennemi que cela ne retiendra pas pour autant de le disqualifier médiatiquement et de l'incapaciter politiquement. Il en va de même de sa pudibonde bouderie à l'égard des catholiques de tradition, trop faibles pour faire la différence, mais assez forts pour qu'on ne puisse les ignorer, même s'il est vrai que certaines références culturelles des traditionnels sont à peu près aussi ouvertes que celles des salafistes. La Nouvelle Droite a bien démontré que l'occidentalisme est la phase terminale de la laïcisation du christianisme. Mais elle a contribué à déchristianiser une frange identitaire, la coupant d'une pratique native du sacré religieux qu'un néo-paganisme intellectualisé ne remplace pas.
Introduisant le dossier central, Pierre Vial qualifie le jacobinisme d'utérus d'où est sorti le système à broyer les peuples et les individus. Pour confisquer les libertés concrètes que ceux-ci s'étaient conquises, il a coupé les têtes au nom de la Liberté. Pour les isoler et anéantir leur conscience identitaire, il a coupé les racines qui rattachent les individus à leur terre et à leurs ancêtres.
Alain Cagnat rappelle que Louis XVI, ayant commis la faiblesse de convoquer les Etats Généraux, a activé les doléances de nombreuses sociétés de pensée, dont le Club Breton. Les députés du tiers état se proclament Assemblée constituante et le club breton Société des amis de la Constitution, qui rédige la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et va s'installer au couvent des Jacobins. Il va connaître un développement rapide, notamment en province, sans cesser de se radicaliser. Allégeant ses conditions d'adhésion, il gonfle ses effectifs, qui basculent bientôt dans l'extrémisme. Peu après, Paris se soulève et ramène de force Louis XVI à Paris. D'abord réservé, Robespierre rallie la ligne dure et, le 29 juillet 1792, propose la destitution du roi et l'élection au suffrage universel d'une Convention. Le 9 août, la Commune insurrectionnelle de Paris est créée et le 17 août siège le premier tribunal révolutionnaire. Le massacre se déchaîne. La monarchie est abolie. Le 21 janvier, le roi est guillotiné. Certaines provinces se rebellent. La France, qui est dans le même temps en guerre avec tous ses voisins, lève 300.000 hommes. La patrie étant en danger, pour sauver la Révolution, un Comité de salut Public de douze députés cumule tous les pouvoirs. Les tribunaux révolutionnaires champignonnent et les têtes roulent, tandis que se consomme le génocide vendéen. Succès au plan international, les alliés se replient derrière le Rhin. Les Jacobins liquident tous leurs adversaires politiques. Robespierre, qui croit triompher, entame la brève période de la Grande Terreur, mais se laisse maladroitement arrêter. Il est décapité deux jours plus tard. Le jacobinisme est bien autre chose que le parisianisme centralisateur, qui a régné en France depuis Philippe le Bel jusque Louis XV. C'est une dictature qui justifie sa violence par la vertu : le peuple souverain est constitué des hommes vertueux. Robespierre est 'Incorruptible'. La loi est le lien social et le délinquant se retranche du peuple. La loi jacobine est infaillible et sa justice est éternelle. L'objectif est une loi naturelle universelle. Celui qui y contrevient est impur, il doit être éliminé. Elue par le peuple, la Convention se considère son image parfaite et elle décide la mort du roi, plutôt que par un referendum dont l'issue aurait été incertaine. Le peuple lui-même peut être corrompu et c'est le cas de la gangrène vendéenne. Justice prompte et inflexible, la Terreur est une émanation de la vertu. Dans les influences à la source du jacobinisme, l'auteur voit l'usure de la piété au XVIIIe siècle, les réticences du clergé à l'égard du progrès scientifique, la contestation de l'autorité papale par les protestants, les philosophes des Lumières. Ceux-ci mettent à mal la Révélation, mais se partagent entre ceux qui osent se déclarer athées et les déistes, dont Voltaire que l'univers embarrasse et qui ne peut « songer que cette horloge existe et n'ait point d'horloger». La conclusion est à Michel Onfray : « De Marine Le Pen à Philippe Poutou en passant par Macron et Mélenchon, Hamon ou Fillon, tous communient dans une même religion jacobine. C'est ce logiciel qu'il faut jeter à la poubelle. »
Le tableau émouvant des Guerres de Vendée que brosse Pierre Morilleau constitue une grande fresque, monumentale jusque dans ses détails, dont il est pratiquement impossible d'extraire la synthèse. Des horreurs abominables des guerres de Vendée (auxquelles n'ont mis fin qu'en janvier 1800 les Paix de Montfaucon et de Candé), on pourrait dire que, quelque fournie qu'en soit l'information que nous en avions réunie, le présent rappel démontre que nous étions encore loin du compte. Il démontre surtout que ces horreurs ont été générées par la roide logique jacobine, comme en témoignent les citations dont l'auteur émaille son texte. Notamment « Les forêts seront abbatues, les récoltes seront coupées pour être portées sur les derrières de l'armée, les bestiaux seront saisis. » - « Soldats de la Liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le réclame, son courage l'accomplira. » - « On emploira tous les moyens pour découvrir les rebelles ; tous seront passés au fil de la baïonnette ; les villages métairies, bois, landes, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. » On ne saurait oublier les Colonnes infernales, ni celles des fuyards dans la Virée de Galerne, ni l'armée des 'puants' rongés de dyssenterie, ni les noyades de masse dans la Loire.
Morilleau constitue une grande fresque, monumentale jusque dans ses détails, dont il est pratiquement impossible d'extraire la synthèse. Des horreurs abominables des guerres de Vendée (auxquelles n'ont mis fin qu'en janvier 1800 les Paix de Montfaucon et de Candé), on pourrait dire que, quelque fournie qu'en soit l'information que nous en avions réunie, le présent rappel démontre que nous étions encore loin du compte. Il démontre surtout que ces horreurs ont été générées par la roide logique jacobine, comme en témoignent les citations dont l'auteur émaille son texte. Notamment « Les forêts seront abbatues, les récoltes seront coupées pour être portées sur les derrières de l'armée, les bestiaux seront saisis. » - « Soldats de la Liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le réclame, son courage l'accomplira. » - « On emploira tous les moyens pour découvrir les rebelles ; tous seront passés au fil de la baïonnette ; les villages métairies, bois, landes, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. » On ne saurait oublier les Colonnes infernales, ni celles des fuyards dans la Virée de Galerne, ni l'armée des 'puants' rongés de dyssenterie, ni les noyades de masse dans la Loire.
 Morilleau constitue une grande fresque, monumentale jusque dans ses détails, dont il est pratiquement impossible d'extraire la synthèse. Des horreurs abominables des guerres de Vendée (auxquelles n'ont mis fin qu'en janvier 1800 les Paix de Montfaucon et de Candé), on pourrait dire que, quelque fournie qu'en soit l'information que nous en avions réunie, le présent rappel démontre que nous étions encore loin du compte. Il démontre surtout que ces horreurs ont été générées par la roide logique jacobine, comme en témoignent les citations dont l'auteur émaille son texte. Notamment « Les forêts seront abbatues, les récoltes seront coupées pour être portées sur les derrières de l'armée, les bestiaux seront saisis. » - « Soldats de la Liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le réclame, son courage l'accomplira. » - « On emploira tous les moyens pour découvrir les rebelles ; tous seront passés au fil de la baïonnette ; les villages métairies, bois, landes, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. » On ne saurait oublier les Colonnes infernales, ni celles des fuyards dans la Virée de Galerne, ni l'armée des 'puants' rongés de dyssenterie, ni les noyades de masse dans la Loire.
Morilleau constitue une grande fresque, monumentale jusque dans ses détails, dont il est pratiquement impossible d'extraire la synthèse. Des horreurs abominables des guerres de Vendée (auxquelles n'ont mis fin qu'en janvier 1800 les Paix de Montfaucon et de Candé), on pourrait dire que, quelque fournie qu'en soit l'information que nous en avions réunie, le présent rappel démontre que nous étions encore loin du compte. Il démontre surtout que ces horreurs ont été générées par la roide logique jacobine, comme en témoignent les citations dont l'auteur émaille son texte. Notamment « Les forêts seront abbatues, les récoltes seront coupées pour être portées sur les derrières de l'armée, les bestiaux seront saisis. » - « Soldats de la Liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le réclame, son courage l'accomplira. » - « On emploira tous les moyens pour découvrir les rebelles ; tous seront passés au fil de la baïonnette ; les villages métairies, bois, landes, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. » On ne saurait oublier les Colonnes infernales, ni celles des fuyards dans la Virée de Galerne, ni l'armée des 'puants' rongés de dyssenterie, ni les noyades de masse dans la Loire.
Robert Dragan rappelle que, dans la Bretagne de 1789 que l'impôt régionalisé favorisait, le petit peuple avait fait corps avec la noblesse contre la centralisation et s'opposait dans la rue à la bourgeoisie que soutenaient les étudiants. Aux Etats-Généraux, les députés de Bretagne formèrent alors un Club breton, qui fédère bientôt nombre de sociétés révolutionnaires, jusqu'à dépasser le millier en 1791. Installant ses assises au couvent des Jacobins, il se rebaptise Société des amis de la Constitution. Quand éclatent les guerres de Vendée, les mêmes opposition villes-campagnes se marquent. Nantes, ville de négociants et d'armateurs, est révolutionnaire. Le coup d'état d'extrême gauche de 1794 balaye les Feuillants et Girondains modérés et régionalistes, les amis de la Constitution le cédant aux amis de la Révolution. Des aventuriers, agissant comme commissaires du Comité révolutionnaires commettent des monstruosités. Les prisons débordant, des camps de concentration, des pontons, des manufactures sont ouverts. La famine et le typhus y règnent. A la guillotine trop lente on substitue des exécutions collectives.
Les Bretons, insulaires délogés de Grande-Bretagne, n'ont jamais su trouver leur centre. Constitués en royaume à la faveur des incursions des Vikings, ils redeviennent bientôt un duché, disputé entre les Plantagenets et les Capétiens, lesquels l'emporteront. L'annexion sera consacrée par le double mariage de la duchesse Anne avec Louis XII et ensuite Charles VIII et par celui de leur fille Claude avec François Ier. Depuis, la France leur promet l'unité et l'indépendance et, en fait, elle les divise. Dès 1781, les persécutions religieuses et les levées de soldats provoquent résistance et révoltes, dont celle de Jean Cottereau, dit Jean Chouan. En 1796, malgré le génocide de la Vendée, on estime à 50.000 le nombre des Chouans. Ils forment des compagnies, avec des capitaines élus, parfois des généraux comme Cadoudal. Les discordes sont fréquentes. Les républicains les qualifient de Brigands, ce qui n'est pas toujours immérité, car le général Rossignol a l'idée de créer des faux Chouans chargés de discréditer les vrais en commettant les pires exactions. Après la chute de Robespierre, des contacts sont pris pour conclure une paix qu'une minorité seulement signe. Les autres proclaméés en état d'arrestation, le conflit reprend. Hoche, qui a succédé à Rossignol, obtient une reddition. Les Chouans, jouant le jeu, gagnent les élections de 1797, qui sont alors confisquées : la République ne survit que par les armes, la forfaiture et la dictature. En 1799, la Loi des otages; qui présume les parents complices, relance l'insurrection. Nantes et Le Mans sont prises et les prisonniers libérés. Mais, en novembre, Bonaparte prend le pouvoir et propose l'amnistie contre la reddition. Certains chefs l'acceptent, d'autres refusent, dont Cadoudal qui bat les armées d'Harty, mais se résigne à signer la paix. Son entrevue avec Bonaparte ayant été un échec, il projette de l'enlever pour le livrer aux Anglais. Trahi, il est arrêté par Fouché et exécuté. En 1830, quand la révolution bourgeoise met Louis-Philippe à la place de Charles X, la bru de celui-ci, la duchesse de Berry, tente de réveiller la chouannerie et est arrêtée. En 1892, l'encyclique de Léon XIII, qui prône le ralliement à la République, désarme le clergé et les monarchistes. A l'imitation des Gallois, les Bretons créent en 1900 le Gorsedd ou assemblée des druides.
 Après la Grande Guerre, une jeune garde identitaire, qui se définit 'na ru na gwen' (ni rouge ni blanc), se constitue autour du journal Breizh Atao. Un parti autonomiste fédéraliste ayant été lancé sans succès, le Parti National Breton, plus radical, est créé en 1931. En 1932, Célestin Laîné dynamite la statue de la Reine Anne (représentée à genoux aux pieds de Charles VIII). Le PNB est dissous et Laîné et Mordrel sont condamnés. En 1939, ils s'opposent à ce que la France apporte une aide à la Pologne. Laîné s'évade et Mordrel et Debauvais (qui défend « un national-socialisme breton ») sont condamnés à mort. Bien que s'évanouisse le rêve d'une indépendance concédée par l'Allemagne victorieuse, Laîné crée les groupes de combat Bagadou Stourm, qui deviendront le Brezen Perrot, après l'assassinat par les communistes de l'Abbé Perrot. Après la guerre, le combat prend une forme culturelle, avec des réussites, comme celle de la musique, et des échecs, comme celui de la langue. L'épuration consacre la domination de la gauche et fera de la Bretagne une terre d'élection du PS.
Après la Grande Guerre, une jeune garde identitaire, qui se définit 'na ru na gwen' (ni rouge ni blanc), se constitue autour du journal Breizh Atao. Un parti autonomiste fédéraliste ayant été lancé sans succès, le Parti National Breton, plus radical, est créé en 1931. En 1932, Célestin Laîné dynamite la statue de la Reine Anne (représentée à genoux aux pieds de Charles VIII). Le PNB est dissous et Laîné et Mordrel sont condamnés. En 1939, ils s'opposent à ce que la France apporte une aide à la Pologne. Laîné s'évade et Mordrel et Debauvais (qui défend « un national-socialisme breton ») sont condamnés à mort. Bien que s'évanouisse le rêve d'une indépendance concédée par l'Allemagne victorieuse, Laîné crée les groupes de combat Bagadou Stourm, qui deviendront le Brezen Perrot, après l'assassinat par les communistes de l'Abbé Perrot. Après la guerre, le combat prend une forme culturelle, avec des réussites, comme celle de la musique, et des échecs, comme celui de la langue. L'épuration consacre la domination de la gauche et fera de la Bretagne une terre d'élection du PS.
Fils de la Catalogne française, notre camarade Llorenç Perrié Albanell a pris part à Gérone (85.000 habitants) à l'ennivrant combat du 1er octobre pour la protection des urnes du referendum. Celles du collège Santa Eulalia étaient protégées par 2.500 personnes, celles de l'école Eiximenis par 2.000. Les Mossos d'Escuadra de la police catalane s'interposent alors entre la foule et la Guardia Civil espagnole. C'est une authentique révolution populaire qui, malgré les provocations policières, reste non-violente. La question que tout le monde se pose est celle de la stratégie de Puigdemont. Alors qu'il avait la main, au lieu de chercher un soutien international au moment où se répandaient les images scandaleuses des violences policières contre des électeurs pacifiques, il attend un dialogue avec Rajoy qui n'en veut pas. Et ce n'est que le 27 octobre que, soutenu par sa coalition et par des centaines de maires, il proclame la République catalane. Mais il ne pose aucun acte d'indépendance : il ne place pas de Mossos aux frontières, il n'imprime aucun papier d'identité de la république, aucune milice citoyenne n'est constituée, aucune constitution provisoire n'est promulguée. Il laisse partir son monde en weekend, sous la légalité espagnole, alors que Rajoy met en application l'article 155 de la Constitution. Et il se prépare à participer, à partir de Bruxelles, aux élections, acceptant de se batre sur le terrain choisi par l'adversaire !
Pour l'Alsacien Robert Spieler, révolutionnaire identitaire s'il en est, il est incroyable que Puigdemont et ses ministres ne se soient pas laissé emprisonner en Espagne : on ne peut faire de révolution qu'avec des révolutionnaires ! Annexée à la France en 1648, l'Alsace a pu conserver son dialecte allemand tant sous la monarchie française que sous l'empire allemand de 1870 à 1918, lorsqu'il existait un parlement alsacien et des députés alsaciens au Reichstag. Les Strabourgeois francophiles célébraient alors chaque 14 juillet devant la statue du général Kléber. En 1918, les troupes françaises furent bien accueillies. Mais 110.000 personnes furent aussitôt expulsées, avec confiscation de leurs biens. Le français fut imposé dans les écoles et le statut concordataire abrogé. La révolte est générale et les autonomistes sont ovationnés. Paris fait marche arrière. Les journaux paraissent alors en allemand, y compris l'Action Française, mais les autonomistes sont persécutés. Les fonctionnaires compromis sont mis à pied et un procès en haute trahison, le 'Procès du complot', est intenté aux chefs de l'opposition. De violentes campagnes de presse fustigent les traîtres à la solde de l'Allemagne. Le PC exige des exécutions. A l'approche de la guerre, les leaders sont emprisonnées et Karl Roos est fusillé pour trahison. Hermann Bickler ne survécut que grâce à la débâcle. Mais le jacobinisme national-socialiste n'avait rien à envier à celui des Français et l'Alsace fut rattachée au Gau Oberrhein. Après la guerre, l'éradication de la langue alsacienne fut féroce.
incroyable que Puigdemont et ses ministres ne se soient pas laissé emprisonner en Espagne : on ne peut faire de révolution qu'avec des révolutionnaires ! Annexée à la France en 1648, l'Alsace a pu conserver son dialecte allemand tant sous la monarchie française que sous l'empire allemand de 1870 à 1918, lorsqu'il existait un parlement alsacien et des députés alsaciens au Reichstag. Les Strabourgeois francophiles célébraient alors chaque 14 juillet devant la statue du général Kléber. En 1918, les troupes françaises furent bien accueillies. Mais 110.000 personnes furent aussitôt expulsées, avec confiscation de leurs biens. Le français fut imposé dans les écoles et le statut concordataire abrogé. La révolte est générale et les autonomistes sont ovationnés. Paris fait marche arrière. Les journaux paraissent alors en allemand, y compris l'Action Française, mais les autonomistes sont persécutés. Les fonctionnaires compromis sont mis à pied et un procès en haute trahison, le 'Procès du complot', est intenté aux chefs de l'opposition. De violentes campagnes de presse fustigent les traîtres à la solde de l'Allemagne. Le PC exige des exécutions. A l'approche de la guerre, les leaders sont emprisonnées et Karl Roos est fusillé pour trahison. Hermann Bickler ne survécut que grâce à la débâcle. Mais le jacobinisme national-socialiste n'avait rien à envier à celui des Français et l'Alsace fut rattachée au Gau Oberrhein. Après la guerre, l'éradication de la langue alsacienne fut féroce.
 incroyable que Puigdemont et ses ministres ne se soient pas laissé emprisonner en Espagne : on ne peut faire de révolution qu'avec des révolutionnaires ! Annexée à la France en 1648, l'Alsace a pu conserver son dialecte allemand tant sous la monarchie française que sous l'empire allemand de 1870 à 1918, lorsqu'il existait un parlement alsacien et des députés alsaciens au Reichstag. Les Strabourgeois francophiles célébraient alors chaque 14 juillet devant la statue du général Kléber. En 1918, les troupes françaises furent bien accueillies. Mais 110.000 personnes furent aussitôt expulsées, avec confiscation de leurs biens. Le français fut imposé dans les écoles et le statut concordataire abrogé. La révolte est générale et les autonomistes sont ovationnés. Paris fait marche arrière. Les journaux paraissent alors en allemand, y compris l'Action Française, mais les autonomistes sont persécutés. Les fonctionnaires compromis sont mis à pied et un procès en haute trahison, le 'Procès du complot', est intenté aux chefs de l'opposition. De violentes campagnes de presse fustigent les traîtres à la solde de l'Allemagne. Le PC exige des exécutions. A l'approche de la guerre, les leaders sont emprisonnées et Karl Roos est fusillé pour trahison. Hermann Bickler ne survécut que grâce à la débâcle. Mais le jacobinisme national-socialiste n'avait rien à envier à celui des Français et l'Alsace fut rattachée au Gau Oberrhein. Après la guerre, l'éradication de la langue alsacienne fut féroce.
incroyable que Puigdemont et ses ministres ne se soient pas laissé emprisonner en Espagne : on ne peut faire de révolution qu'avec des révolutionnaires ! Annexée à la France en 1648, l'Alsace a pu conserver son dialecte allemand tant sous la monarchie française que sous l'empire allemand de 1870 à 1918, lorsqu'il existait un parlement alsacien et des députés alsaciens au Reichstag. Les Strabourgeois francophiles célébraient alors chaque 14 juillet devant la statue du général Kléber. En 1918, les troupes françaises furent bien accueillies. Mais 110.000 personnes furent aussitôt expulsées, avec confiscation de leurs biens. Le français fut imposé dans les écoles et le statut concordataire abrogé. La révolte est générale et les autonomistes sont ovationnés. Paris fait marche arrière. Les journaux paraissent alors en allemand, y compris l'Action Française, mais les autonomistes sont persécutés. Les fonctionnaires compromis sont mis à pied et un procès en haute trahison, le 'Procès du complot', est intenté aux chefs de l'opposition. De violentes campagnes de presse fustigent les traîtres à la solde de l'Allemagne. Le PC exige des exécutions. A l'approche de la guerre, les leaders sont emprisonnées et Karl Roos est fusillé pour trahison. Hermann Bickler ne survécut que grâce à la débâcle. Mais le jacobinisme national-socialiste n'avait rien à envier à celui des Français et l'Alsace fut rattachée au Gau Oberrhein. Après la guerre, l'éradication de la langue alsacienne fut féroce.
Pierre Vial rappelle que la société féodale avait mis en place une mosaïque de sphères d'autonomie, contre-pouvoirs au pouvoir royal, lequel se reconnaissait ainsi des limites. Les libertés et franchises qu'il accordait ont facilité un esprit communautaire qui a débouché sur l'institution communale. Par les avantages obtenus, les villes étaient des pôles d'attraction propices à l'activité économique. L'absolutisme royal s'appliquait plutôt à soumettre l'aristocratie guerrière, brutalement (Richelieu) ou subtilement (Louis XIV). La France comptait un certain nombre de 'pays d'Etats', provinces qui disposaient d'assemblées de représentants des trois ordres (noblesse-clergé-tiers état) qui négociaient les impôts dus au roi avec ses intendants et les répartissaient ensuite entre diocèses et paroisses, en contrôlant la collecte.
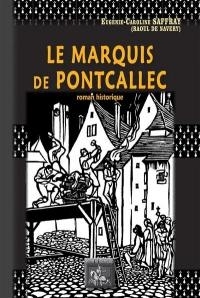 A la mort de Louis XIV, les guerres à répétition ayant mis les finances à sec, les Etats de Bretagne se sont estimés injustement pressurés et le parlement a refusé d'enregistrer l'édit de perception. Le Régent fait alors exiler 73 délégués rebelles et accroît certains droits au mépris du Traité d'union. Le Parlement de Bretagne interdit la levée et vote des remontrances. Une Association patriotique bretonne mobilise plusieurs centaines de personnes et le marquis de Pontcallec réunit une petite troupe armée qui met en fuite les soldats chargés de la collecte. Le Régent répond par une armée de 15.000 hommes. Pontcallec, arrêté et promptement décapité, devient très populaire. Le jacobinisme ne fera que reprendre, avec une violence inouie, l'éradication des identités et libertés des provinces. Il les découpe en départements et, pour uniformiser les pensées, épouse la thèse de l'abbé Grégoire d'universaliser la langue française. Contre ce système à tuer les peuples, des hommes se sont levés. Francis Arzalier (Les régions du déshonneur, 2014) s'en désole: "La Corse, l'Alsace, la Bretagne prétendent exister: on n'en a jamais fini avec les volontés identitaires toujours renouvelées." Les Corses, avec Pascal Paoli, chassèrent les Génois en 1755 et établirent une république démocratique. La brutale conquête française verra dans les résistants des 'brigands' et, quand l'insurrection renaît avec la révolution, la République française ignorera la volonté populaire. Avant la guerre, l'identité corse s'exprimait dans la revue A Muvra, très lue jusque dans les villages. Saisie en 1938 et objet de poursuites, elle cesse de paraître en 1939. En 1946, les procès intentés aux autonomistes se traduisent par de lourdes peines, malgré l'inanité des accusations de collaboration. Les Alsaciens ont connu des sorts similaires, eux dont l'identité se trouve écartelée entre la France et l'Allemagne, ils sont pour la plupart attaché au bilinguisme que la France refuse. C'est le cas de Karl Roos, un médecin, qui fonde le Parti de l'indépendance et qui, accusé d'intelligence avec l'ennemi, sera fusillé en février 1940. Chez les Bretons, Olier Mordrel et Morvan Marchal animent le Parti autonomiste breton, lequel en 1927 invite à son congrès des délégations alsacienne, corse et flamands. Cela déclenche la répression, en particulier contre les Alsaciens: quinze condamnés dont deux viennent d'être élus député. En réaction, le courant séparatiste va s'affirmer d'élection en élection: ce n'est qu'un début, continuons le combat.
A la mort de Louis XIV, les guerres à répétition ayant mis les finances à sec, les Etats de Bretagne se sont estimés injustement pressurés et le parlement a refusé d'enregistrer l'édit de perception. Le Régent fait alors exiler 73 délégués rebelles et accroît certains droits au mépris du Traité d'union. Le Parlement de Bretagne interdit la levée et vote des remontrances. Une Association patriotique bretonne mobilise plusieurs centaines de personnes et le marquis de Pontcallec réunit une petite troupe armée qui met en fuite les soldats chargés de la collecte. Le Régent répond par une armée de 15.000 hommes. Pontcallec, arrêté et promptement décapité, devient très populaire. Le jacobinisme ne fera que reprendre, avec une violence inouie, l'éradication des identités et libertés des provinces. Il les découpe en départements et, pour uniformiser les pensées, épouse la thèse de l'abbé Grégoire d'universaliser la langue française. Contre ce système à tuer les peuples, des hommes se sont levés. Francis Arzalier (Les régions du déshonneur, 2014) s'en désole: "La Corse, l'Alsace, la Bretagne prétendent exister: on n'en a jamais fini avec les volontés identitaires toujours renouvelées." Les Corses, avec Pascal Paoli, chassèrent les Génois en 1755 et établirent une république démocratique. La brutale conquête française verra dans les résistants des 'brigands' et, quand l'insurrection renaît avec la révolution, la République française ignorera la volonté populaire. Avant la guerre, l'identité corse s'exprimait dans la revue A Muvra, très lue jusque dans les villages. Saisie en 1938 et objet de poursuites, elle cesse de paraître en 1939. En 1946, les procès intentés aux autonomistes se traduisent par de lourdes peines, malgré l'inanité des accusations de collaboration. Les Alsaciens ont connu des sorts similaires, eux dont l'identité se trouve écartelée entre la France et l'Allemagne, ils sont pour la plupart attaché au bilinguisme que la France refuse. C'est le cas de Karl Roos, un médecin, qui fonde le Parti de l'indépendance et qui, accusé d'intelligence avec l'ennemi, sera fusillé en février 1940. Chez les Bretons, Olier Mordrel et Morvan Marchal animent le Parti autonomiste breton, lequel en 1927 invite à son congrès des délégations alsacienne, corse et flamands. Cela déclenche la répression, en particulier contre les Alsaciens: quinze condamnés dont deux viennent d'être élus député. En réaction, le courant séparatiste va s'affirmer d'élection en élection: ce n'est qu'un début, continuons le combat.
Inscription à :
Articles (Atom)