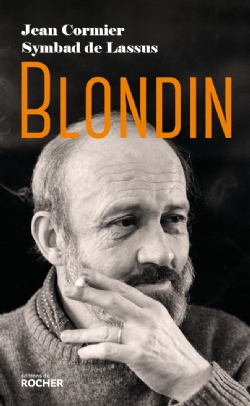À présent que Breton n’est plus, l’on peut se demander ce qu’il est advenu de la quête métaphysique qui a toujours été sous-jacente a toutes les démarches de Breton ? Comme on l’a fait remarquer plus d’une fois, toutes les préoccupations surréalistes de Breton n’ont cesse de converger vers certaines préoccupations initiatiques, alors que pour bien des surréalistes mineurs le surréalisme n’est somme toute guère plus qu’un prolongement d’un dadaïsme en quête de l’insolite, de l’incongru et du plus fol débordement de l’imaginaire, sans le moindre souci de ce “point suprême” si cher a leur maître défunt.
Il est certain que la plupart ont cesse de s’en référer a l’alchimie et aux sciences occultes, et cela pour autant qu’ils s’en soient jamais préoccupés. Si le surréalisme veut poursuivre sa quête sur la lancée qui fut celle d’André Breton, il devrait rechercher à travers les romantiques allemands et les auteurs spirituels de nouvelles ouvertures sur l’immense univers des choses cachées, mais qui ne demandent qu’à être révélées. « À nous, avait déjà écrit Breton, de chercher a apercevoir de plus en plus clairement ce qui se trame à l’insu de l’homme dans les profondeurs de son esprit, quand bien même il commencerait par nous en vouloir de son propre tourbillon. »
Pour explorer les profondeurs de l’esprit humain, André Breton et ses amis s’étaient rallies au freudisme, mais voici que le psychologue suisse Jean Piaget vient d’affirmer que les théories psychanalytiques de Freud relèvent, elles aussi, du domaine des mythes et ne reposent que sur des vues purement subjectives quant au monde de nos volitions et de nos émotions. Selon ce savant, le mystère de l’âme humaine et de ses variables ne pourrait être décrypte que par des analyses endocrinologiques. Sans aller aussi loin, C.G. Jung avait déjà élaboré sa théorie de l’inconscient collectif et du monde des archétypes, tandis que Gaston Bachelard et ses disciples se sont mis en devoir d’explorer tout l’incommensurable domaine de l’imaginaire. Il va de soi que point n’est ici le moment de faire l’inventaire de tout ce que ces récentes recherches ont déjà révélé à notre émerveillement, aussi nous contente-tons-nous de constater que toutes ces disciplines de même que l’existentialisme heideggerien ont déjà apporte maintes lumières sur l’essence de la poésie ainsi que sur les relations de celle-ci avec ce qu’il est convenu d’appeler le monde de l’ineffable.
Mais retournons a Paul Van Ostaijen qui a été en mon adolescence un peu comme mon maître a penser en matière de poésie. Prenant le contrepied des affirmations selon lesquelles la vraie poésie, la poésie qui serait expression de l’ineffable commencerait avec Lautréamont, Rimbaud et les poètes symbolistes, Van Ostaijen proclamait : « Je veux exagérer également pour me faire comprendre : la littérature française commence avec Marie-Jeanne Bouvières de la Mothe-Guyon. Tous les manuels seraient à recomposer d’après une valorisation de cet ordre : oui, celui-là est le plus grand qui retient le plus de transcendance dans son œuvre. Voici que saint Jean de la Croix devient la figure centrale de la littérature espagnole; les Allemands se mettent a relire enfin leur véritable littérature : Mechtild de Magdebourg, Meister Eckehardt, Jacob Böhme, Tauler et Angelus Silesius ».
Paul Van Ostaijen insiste alors sur le fait que nos poètes actuels ne peuvent plus que difficilement se réclamer de la “poésie subconsciemment inspirée” qu’il venait d’évoquer. Et il ajoutait : « Il ne nous reste que la poésie consciemment construite, mais cette construction participera du subconscient par la récupération complète de la matière première. Il ne s’agit donc pas de noter les successions de mots que notre subconscience pousse à la surface, comme si a priori le bon Dieu parlait par notre intermédiaire, mais bien de cet acte conscient qui consiste à rechercher les affinités électives des mots; le son et les rapports sensibles et métaphysiques entre le son et le sens constitueront dans cette recherche les guides les meilleurs ». En somme, selon Van Ostaijen, il s’agit pour le poète d’avoir recours à une véritable “alchimie du verbe” en laquelle le “premier vers qui nous est donné” peut servir de départ à toute une métaphysique du mot où le sens et le son et leur résonance profonde jouent un rôle primordial.
Par ailleurs, Paul Van Ostaijen se posa également la question de savoir s’il est possible de créer volontairement une école mystique”. Et il répondait : « Non certes, mais on peut, sans se proposer cette fin et cependant sans mystification, assez loyalement, si j’ose dire, se servir de ses moyens d’extériorisation ». Et Van Ostaijen poursuivait : « Il ne faut pas oublier que dans notre intention une mystique dans les phénomènes remplace le mysticisme en Dieu et que, d’autre part, ce dernier s’exprime, chez les auteurs mystiques, surtout par un mysticisme réaliste, haussant les phénomènes par les-quels il se manifeste, à une ambiance visionnaire. Il y a une rencontre dans la mysticité des phénomènes qui nous permet, sans employer ce divin, d’user des moyens d’application subjective dans les rapports des phénomènes et des mots comme seuls l’ont fait les mystiques ». Pour conclure, Van Ostaijen ajoutait encore : « Bien que ne participant pas de l’extase, mais bien au contraire relevant toujours de la littérature volontaire – une fois cette différence située – l’émerveillement devant les possibilités de l’expression comme expression centrale, nous fait rejoindre les mystiques. Farce qu’il supprime l’extase, cet émerveillement porte sa fin en soi. C’est donc de cet état d’émerveillement que partiront nos recherches ».
Nous ne serons pas aussi kantien que notre ami Van Ostaijen, et ne retiendrons de ces dernières lignes que le mot “émerveillement”, pour le rapprocher, ne serait-ce qu’un instant, du mot “extase”. Le premier n’est-il pas un peu comme un reflet quelque peu affadi du second ? L’émerveillement n’est-il pas un peu comme l’aspect profane de l’extase, comme une extase au moindre degré ?
Dès lors, dans une approche vraiment profonde, disons métaphysique, du phénomène poétique, ne serait-il point possible de passer de l’émerveillement à l’extase, en se représentant la poésie comme un exercice spirituel à la seule portée de certains êtres d’exception susceptibles de concevoir un mysticisme sans Dieu, un mysticisme dont l’approche du numineux n’aurait point besoin du support de la foi, mais qui trouverait son illumination au plus profond de l’âme de ceux qui l’éprouvent? Et Rimbaud ne parlait-il déjà pas d’un “dérèglement de tous les sens” pour arriver a un véritable état de poésie? Cet état est-il vraiment si éloigné que cela du “mysticisme en Dieu”, ce mysticisme, lorsqu’il aboutit à la fruition, peut également provoquer un dérèglement de tous les sens, au point que des psychologues n’ont pas le site a parler d’hystérie…
Certains théologiens parlent volontiers d’un “mysticisme naturel” auquel ils opposent alors un “mysticisme surnaturel”, alors que d’autres encore, a propos de Nietzsche, ont parle d’un “mysticisme luciférien”. En réalité, peu importent ces subtilités théologiques alors que dans l’un et l’autre mysticisme il doit y a voir avant tout ce que nous pouvons appeler un “état de grâce mystique”, une exaltation intérieure qui peut aussi bien être le partage du croyant que de l’incroyant. Cet état, que d’aucuns qualifient d'”état second”, prend son départ dans une certaine vacuité d’être, cependant que ce que nous avons l’habitude d’appeler l’aime flotte dans les limbes d’une sorte de rêve éveille et que des mots viennent comme des profondeurs à la surface de ce qui, pour un poète, peut devenir un poème. Il y a alors là comme des murmures qui viennent du plus lointain des âges, qui sont comme des archétypes d’une certaine notion ancestrale du sacré et qui conduisent a chanter les vertus de l’indicible “mysterium fascinans”. Peut-être ne s’agit-il après tout que de ce que les surréalistes appellent d’une manière fort approximative et certainement très impropre l’automatisme psychique”. De toute façon, automatisme psychique ou non, tout dépend de la qualité de l’état de pureté et de sérénité ou non de celui par lequel l’indicible vient à se manifester par la bouche de ce tout grand mystère sacré qui s’appelle un poète vraiment inspire.
Marc. Eemans, Antaïos n° 8/9, 1995.
Texte emprunté à : Approches du poétique, éd. Henry Fagne, Bruxelles, pp. 21-36.
Notes :
(1) Que l’on se souvienne que les notions de “sacré” et de “numineux” ont été admirablement définies par Rudolf Otto dans son livre Le sacré (Das Heilige), paru en 1917 et dont la traduction français par André Junat date de septembre 1929. Le savant professeur de l’université de Marbourg y a cerne de près « l’élément non-rationnel dans l’idée du divin et sa relation avec le rationnel ». Depuis lors toute allusion au “sacré” doit nécessairement se référer a cet ouvrage, comme nous l’avons d’ailleurs fait ici.
(2) Dans la monographie que notre ami le Professeur Piet Tommissen a consacrée à la continuité dans l’évolution de la pensée de Marc. Eemans”, celui-ci rappelle l’affirmation de Pierre Drieu la Rochelle selon laquelle celui-ci aurait connu, en l’année 1914, au cours de deux combats a l’arme blanche, une extase dont il prétend qu’elle a été « égale à celle de sainte Thérèse et de n’importe qui s’est élancé à la pointe mystique de la vie ». De son côté Ernst Jünger, un autre combattant de la guerre 1914-18 – et c’est également notre ami Tommissen qui le rappelle – témoigne de même dans ses mémoires de guerre, et cela à plusieurs reprises, du “Rausch”, de l’ivresse mystique qui peut s’emparer du combattant au cours des plus furieuses mêlées.
(3) Sœur Hadewych vécut vraisemblablement au milieu du XIIIe siècle. On ignore tout quant à sa biographie. Il est toutefois a peu près certain qu’elle connaissait le latin ainsi que la poésie de son temps. Elle est l’auteur de visions et de poèmes strophiques ainsi que de quelques lettres, le tout écrit dan un moyen-néerlandais fortement imprégné du dialecte brabançon. Elle se trouve a l’origine de la mystique flamande et, à travers Ruusbroec l’Admirable, à celle de la mystique française et espagnole.
(4) En ce qui concerne le délire de la Pythie, Plutarque, dans son dialogue sur les oracles de la Pythie, précise au chapitre 7 de celui-ci : « Ce n’est pas au dieu qu’apparient la voix, les sons, les expressions et les vers, c’est à la Pythie ; pour lui (le dieu), il se contente de provoquer les visions de cette femme et de produire en son âme lumière qui lui éclaire l’avenir : c’est en cela que consiste l’enthousiasme ».
(5) Rappelons ici l’importance de ce que l’on appelle “la nuit de Gênes” pour le cours ultérieur de l’inspiration poétique de Paul Valéry.
(6) Dans le dialogue intitulé Ion, Platon affirme sans ambage que l’inspiration poétique est comme l’effet d’une véritable possession, et il écrit : « C’est de cette sorte que la Muse fait les inspires (entheoi, exactement dans la main de dieu). C’est par les poètes, ces inspirés que les autres reçoivent l’inspiration: il s’établit ainsi une chaîne ». Plus loin, s’adressant a Ion, il dit encore : « C’est une participation divine (theïa moira) et une possession, comme celles qui font les corybantes, qui ressentent immédiatement cet air qui est celui du dieu par lequel ils sont possédés et qui, sur cet air, improvisent avec abondance gestes et paroles, sans se soucier des autres » (Cf. H. Jeanmarie, Dyonysos, histoire du culte de Bacchus, Payot, 1961, pp. 134-135).
(7) Le poète expressionniste flamand Paul Van Ostaijen naquit à Anvers le 22 février 1896. Il est mort de la tuberculose a Miavoye-Anthee (Prov. de Namur) le 17 mars 1928. Il a résidé durant de nombreuses années, en exil, à Berlin, où il entra en contact intime avec le mouvement expressionniste allemand. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes, de “grotesques” en prose ainsi que de nombreux essais et articles critiques tant dans le domaine littéraire que plastique.
(8) À l’issue de la présente communication, Jean MarKale, l’auteur de maints ouvrages sur le monde et la civilisation celtes, dont Les grands bardes gallois (1956) préfacé par André Breton avec un texte intitule « Braise au trépied de Keridwen », a fait remarquer dans une courte réplique, qu’André Breton était, tout au mains dans les dernières années de sa vie, un lecteur attentif non seulement de la Bible, mais aussi des grands auteurs mystiques. Lorsque nous lui avons demandé par la suite des précisions à ce sujet, Jean Markale s’est toutefois retranché dans un silence prudent.
Bibliographie :
- Ars magna : Marc Eemans, peintre et poète gnostique, Serge Hutin & Friedrich-Markus Huebner, éd. Le soleil dans la tête, Paris, 1959
- Les Trésors de la peinture flamande, M. Eemans, Meddens, 1963
- Anthologie de la mystique des Pays-Bas, préf. et tr. M. Eemans, éd. de la Phalange, 1938
Lien :
Voir aussi sur notre site :