Elle est sans doute la plus grande femme d’État que la France ait jamais connu. Blanche de Castille aura été reine de France suite à son mariage avec Louis VIII, puis régente du royaume lors de la minorité de son fils, Louis IX, le futur Saint Louis. C’est elle qui assurera son éducation politique et religieuse, au point de forger celui qui deviendra le seul roi de France canonisé. La reine-mère protégera également le royaume de l’appétit des grands seigneurs, négociant et gouvernant d’une main de maître, ce qui permettra ni plus ni moins de préserver et perpétuer l’héritage capétien. Retour sur la vie de Blanche de Castille, la plus grande des reines de France.
dimanche 31 octobre 2021
En souvenir de Dominique Venner par Robert Steuckers 2/7
photographie : Louis Monier © - Rue des Archives
Nous ne savions rien des aventures politiques de Venner
Nous ignorions tout bien entendu des aventures politiques de D. Venner quand nous lisions Baltikum : elles s’étaient déroulées en France, pays que nous ne connaissions pas à l’époque, où la télévision n’était pas encore câblée, même si ce pays est voisin, tout proche, et que nous parlions (partiellement) la même langue que lui. Je n’avais jamais été que dans une toute petite ville franc-comtoise, en “traçant” sur la route sans aucun arrêt, parce que mon père, homme toujours pressé, le voulait ainsi et qu’il n’y avait pas moyen de sortir une idée de sa tête (le seul arrêt de midi se résumait à un quart d’heure, dûment minuté, pour avaler deux tartines, un œuf dur et une pomme le long d’un champ).
De la France, hormis Maîche en Franche-Comté et un séjour très bref à Juan-les-Pins (avril 1970) dans un immeuble dont tous les locataires étaient belges, je n’avais vu que quelques coquelicots dans l’un ou l’autre champ le long des routes lorraines ou comtoises et n’avais entendu que le bourdonnement d’abeilles champêtres, à part, c’est vrai, une seule visite à l’Ossuaire de Douaumont et un arrêt de dix minutes devant la “Maison de la Pucelle” à Domrémy. En 1974, aucun de nous, à l’école secondaire, n’avait jamais mis les pieds à Paris.
De l’aventure de l’OAS, nous ne savions rien car elle ne s’était pas ancrée dans les mémoires de nos aînés à Bruxelles et personne n’évoquait jamais cette aventure, lors des veillées familiales ou après la poire et le fromage, ni n’émettait jamais un avis sur l’Algérie : les conversations politiques dont je me souviens portaient sur la marche flamande sur Bruxelles en 1963, sur l’assassinat de Kennedy la même année, sur le déclin de l’Angleterre (à cause des Beatles, disait un oncle), sur le Shah d’Iran (mon père était fasciné par l’Impératrice), sur Franco (et sur la “Valle de los Caidos” et sur l’Alcazar de Tolède qui avait tant marqué mon père, touriste en mai 1962) voire, mais plus rarement, sur le Congo (lors de l’affaire de Stanleyville, car une de mes cousines germaines avait épousé un parachutiste…). Les traces de la guerre d’Algérie, la tragédie des Pieds-Noirs, les aventures politiques du FLN et de l’OAS sont très présentes dans les débats politico-historiques français : je ne m’en apercevrai que très tard, ce qui explique sans doute, pour une bonne part, le porte-à-faux permanent dans lequel je me suis retrouvé face à des interlocuteurs français qui faisaient partie de la même mouvance que D. Venner. Mais ce porte-à-faux, finalement, concerne presque tous mes compatriotes, a fortiori les plus jeunes (maroxellois compris !), qui n’ont jamais entendu parler des événements d’Algérie : combien d’entre eux, à qui les professeurs de français font lire des livres d’Albert Camus, ne comprennent pas que cet auteur était Pied-Noir, a fortiori ce qu’était le fait “pied-noir”, ne perçoivent pas ce que cette identité (brisée) peut signifier dans le cœur de ceux qui l’ont perdue en perdant le sol dont elle avait jailli, ni quelles dimensions affectives elle peut recouvrir dans la sphère politique, même après un demi-siècle.
Attitude altière
Au cours de toutes les années où j’ai côtoyé les protagonistes français du Groupement de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne, c’est-à-dire de 1979 (année de ma première participation à une journée de débats auprès du cercle “Études & Recherches”, présidé à l’époque par Guillaume Faye) à 1992 (date de mon départ définitif), je n’ai vu ni aperçu Dominique Venner, sauf, peut-être, en 1983, lors d’une “Fête de la Communauté” près des Andelys, à la limite de l’Ile-de-France et de la Normandie. Cette fête avait été organisée par le regretté Jean Varenne, le grand spécialiste français de l’Inde et du monde védique, qui avait invité une célèbre danseuse indienne pour clore, avec tout le panache voulu, cette journée particulièrement réussie, bien rythmée, avec un buffet gargantuesque et sans aucun couac. Ce jour-là, un homme engoncé dans une parka kakie (tant il pleuvait), correspondant au signalement de Dominique Venner, est venu se choisir deux ou trois numéros d’ Orientations dans le stand que j’animais, sans mot dire mais en braquant sur ma personne son regard bleu et perçant, avant de tourner les talons, après un bref salut de la tête. Cette attitude altière — besser gesagt diese karge Haltung — est le propre d’un vrai croyant, qui ne se perd pas en vains bavardages. De toutes les façons, je pense qu’on s’était compris, lui le Francilien qui avait des allures sévères et jansénistes (mais l’évêque Jansen était d’Ypres, comme ma grand-mère…), moi le Brabançon, plus baroque, plus proche de la Flandre espagnole de Michel de Ghelderode qui pense souvent qu’il faut lever sa chope de gueuze ou de faro pour saluer, ironiquement, irrespectueusement, les cons du camp adverse car leurs sottises, finalement, nous font bien rire : il faut de tout pour faire une bonne Europe. C’est le sentiment que j’ai eu, après avoir croisé pour la première fois le regard vif et silencieux de Venner, un sentiment dont je ne me suis jamais défait.
La carte d’identité de Venner s’est constituée dans ma tête progressivement : je découvrais ses ouvrages militaires, ses volumes sur les armes de poing ou de chasse, les armes blanches et les armes à feu, et surtout sa Critique positive, rédigée après les aventures politiques post-OAS, etc. Je découvrais aussi son livre Le Blanc soleil des vaincus, sur l’héroïsme des Confédérés lors de la Guerre de Sécession, sentiment que l’on partageait déjà en toute naïveté, enfants, quand on alignait nos soldats Airfix, les gris de la Confédération — nos préférés — et les bleus de l’Union sans oublier les bruns du train d’artillerie (Nordistes et Sudistes confondus), sur la table du salon, quand il pleuvait trop dehors, notamment avec mon camarade d’école primaire, Luc François, devenu fringant officier au regard plus bleu que celui de Venner, alliant prestance scandinave et jovialité toujours franche et baroque, bien de chez nous, puis pilote de Mirage très jeune, et tué à 21 ans, en sortant de sa base, sur une route verglacée de la Famenne, laissant une jeune veuve et une petite fille…
Cependant, Venner n’est devenu une présence constante dans mon existence quotidienne que depuis la fondation des revues Enquête sur l’histoire et la Nouvelle revue d’histoire parce que le rythme parfait, absolument régulier, de leur parution amenait, tous les deux mois, sur mon bureau ou sur ma table de chevet, un éventail d’arguments, de notes bibliographiques précieuses, d’entretiens qui permettait des recherches plus approfondies, des synthèses indispensables, qui ouvrait toujours de nouvelles pistes. Ces revues me permettaient aussi de suivre les arguments de Bernard Lugan, d’Ayméric Chauprade, de François-Georges Dreyfus, de Bernard Lugan, de Philippe Conrad, de Jacques Heers, etc. Chaque revue commençait par un éditorial de Venner, exceptionnellement bien charpenté : son éditeur Pierre-Guillaume de Roux ferait grande œuvre utile en publiant en 2 volumes les éditoriaux d’Enquête sur l’histoire et de la Nouvelle revue d’histoire, de façon à ce que nous puissions disposer de bréviaires utiles pour méditer la portée de cette écriture toute de clarté, pour faire entrer la quintessence du stoïcisme de Venner dans les cerveaux hardis, qui entretiendront la flamme ou qui créeront un futur enfin nettoyé, expurgé, de toute la trivialité actuelle.
À suivre
Un regard territorial sur la biodiversité

Nul ne saurait actuellement contester la prédominance du sujet environnemental. Les enseignements des élections municipales françaises en juin dernier ont mis en exergue le besoin de composer avec l’impératif écologique, qu’il soit vécu, surjoué ou encore exploité. Au premier plan de ces considérations liées à l’environnement figure la biodiversité, souvent utilisée à tort dans une logique purement « marketing » et in fine politicienne.
Comme le précisent Christian Lévêque et Jean-Claude Mounolou dans leur ouvrage Biodiversité – Dynamique biologique et conservation, il conviendrait plutôt d’employer le terme de « biocomplexité » pour désigner « tous les types d’organismes, des microbes aux humains, tous les milieux qui vont des régions polaires aux forêts tempérées et aux zones agricoles, et tous les usages qu’en font les sociétés. Elle est caractérisée par (…) une appréhension du système vivant dans son ensemble et non par morceaux par morceaux. » Loin de nous soumettre à une terminologie déformée, nous emploierons ici par commodité le mot de « biodiversité » pour désigner l’ensemble des rapports qu’entretient l’homme avec la nature et aux mécanismes qui régissent les interactions de tout ordre entre les deux.
Cela n’échappera à personne, il est aujourd’hui inutile de contester la dégradation constante de la biodiversité. Nos décideurs font mine de tirer la sonnette d’alarme, d’engager des plans de « reconquête écologique » et de placer le « vert » au centre des politiques publiques mais des contradictions s’affrontent sans cesse entre leurs intentions et leurs actes. Abandonné depuis novembre 2019 sous la pression de divers acteurs associatifs et politiques, le projet d’Europacity, initialement validé par l’État, en était une parfaite illustration : perte d’espace pour la biodiversité et atteinte à 3,5 hectares de zones humides, disparition du paysage agricole sur 260 ha de terres cultivables, augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, risque de rechargement insuffisant de la nappe souterraine à cause de l’urbanisation, risque d’apparition d’un îlot de chaleur urbain…
Même si certains cas reposent parfois sur des spécificités locales, les acteurs territoriaux auraient tout intérêt à prendre en compte ces quelques paramètres parmi tant d’autres pour tenter d’endiguer le déclin de la biodiversité dans notre pays :
- Remettre la nature au centre de nos terres. Dans une France de plus en plus urbanisée, la végétalisation sur nos territoires est une priorité afin de combler la diminution constante du nombre d’espèces, en particulier les vertébrés. Cette démarche est élémentaire puisque la destruction de centaines d’hectares d’espaces naturels mène logiquement à l’imperméabilisation des sols. Rappelons que la biodiversité se perd et disparaît d’abord par la destruction des sols, et en premier lieu des sols agricoles.
- Mieux combiner énergies renouvelables et biodiversité. Les impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité sont nombreux, tant négativement que positivement. Afin de ne pas écarter la préservation de la biodiversité, en particulier au sein des Parcs Naturels Régionaux (PNR), il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour bien la concilier avec les énergies renouvelables récemment mises en place. La biodiversité doit avoir une place centrale dans la politique énergétique des PNR et on retrouve plusieurs bienfaits à cette combinaison à travers les différentes énergies : fourniture de zones de couverture ou d’habitat et d’alimentation pour certains animaux (énergie solaire), constitution de territoires favorables pour certaines espèces terrestres en raison de la réduction du trafic, de la disponibilité en ressources alimentaires et de la réduction de prédateurs (énergie éolienne terrestre), création de nouveaux habitats ou de nouveaux écosystèmes (énergie hydraulique), fourniture d’habitat, alimentation et autres services écosystémiques de soutien par certaines surfaces recouvertes de plantes énergétiques (bioénergie)…
- Abandonner le bétonnage. Chaque année, le bétonnage induit par le développement de projets d’activités commerciales représenterait dans notre pays plus de 100 millions de tonnes de CO2 émises, soit près de 20 % de toutes les émissions nationales. Ce phénomène détruit entre 50 000 et 100 000 hectares de terres et d’espaces agricoles en France. Les sols artificialisés, c’est-à-dire qui ont perdu leur état naturel, recouvrent 9,3 % du territoire (en métropole) en augmentant de près de 70 % en 30 ans, soit beaucoup plus vite que la population. Entre 2006 et 2014, l’artificialisation s’est faite pour deux tiers à leurs dépens. Cela affecte massivement la biodiversité et tout particulièrement les espèces animales pour qui les cycles sont alors déréglés du fait du nouvel environnement dans lequel elles avaient autrefois l’habitude de prospérer.
- Pérenniser et développer la richesse du patrimoine naturel et plus spécifiquement des milieux forestiers. La préservation de ces espèces est une nécessité absolue quand on remarque que ces dernières ont tendance à diminuer en matière d’effectifs. Les acteurs directs de la biodiversité au quotidien ont ainsi tout intérêt à être directement soutenus, et plus spécialement les agriculteurs qui sont en première ligne. Ce sont eux qu’il faut épauler massivement, notamment dans l’accompagnement des techniques culturales simplifiées et l’abandon de l’usage des produits phytosanitaires, dans le financement de programmes d’aménagements des espaces intermédiaires mais aussi dans les formations et programmes des lycées agricoles.
En quelques mots, favoriser la nature en ville, régénérer les milieux agricoles, exploiter sainement les espaces forestiers, restaurer les milieux aquatiques et humides, entretenir la sauvegarde de la faune et la flore et protéger le patrimoine naturel… C’est finalement répondre à la formule du grand ornithologue français Jean Dorst pour qui « le maintien de la diversité de la nature et des espèces est la première loi de l’écologie » qu’encourager les individus à retisser le lien unissant l’homme et la nature. Ces considérations peuvent paraître abstraites à défaut d’être concrètes, mais elles sont fondamentales dans le processus de compréhension globale des enjeux de biodiversité. Car on le sait trop bien : l’étendue de la pollution, le déclin des espèces vivantes, la dégradation des terres, la détérioration de la santé et tant d’autres encore nous rappellent qu’il n’y a pas d’un côté l’homme et de l’autre la nature.
Rémy Martin
Source : Livr’Arbitres, numéro spécial “La nature comme socle”, septembre 2020
Le champ du partisan
Le monde agricole est dans une spirale infernale : suicides, exode rural, maladies professionnelles liées aux pesticides, précarité extrême… bref un portrait qui n’est point exagéré mais malheureusement on ne peut plus réaliste. Pourtant le paysannat est tout d’abord une fonction anthropologique, celle de l’individu ancré dans sa terre, qui va produire l’ensemble des ressources nécessaires à la survie du groupe, et dont l’activité témoigne d’une approche holistique.
Jean Christophe Lebon dans son dernier ouvrage Pour une Agriculture Rebelle, nous offre un panorama sans concession sur l’évolution de l’agriculture, de ses conséquences sur notre alimentation, véritable poison agro-alimentaire, l’épuisement des sols et ressources. Son opus synthétise à merveille toutes ces questions dont les transformations profondes sont liées aux cinquante dernières années. Lebon nous rappelle que le sort des agriculteurs est entre les mains de l’oligarchie financière (Rockefeller en tête…). Par un travail incessant de lobbying, corruption et traités commerciaux iniques (ALENA, TTP …), l’élite financière a piraté le monde agricole pour le transformer en une industrie où polluants, gaspillages et injustice sociale sont légions. Sursubventionné, l’agriculture des USA impose sa loi et ses normes via tout un ensemble d’organismes internationaux (OMC au premier lieu), mais Lebon rappelle justement que les premières victimes sont les agriculteurs américains eux-mêmes.
Loin d’être uniquement un constat exhaustif et accablant, l’essai de Lebon présente des alternatives aux techniques industrielles où gabegie et rentabilité sont les mètres étalons. Aussi bien sur le plan structurel (aquaponie, agriculture biodynamique) mais aussi pour tout citoyen même urbain qui souhaite décrocher de cette ingénierie mortifère (dynamiser son eau, équilibrer son alimentation, repenser son rapport aux soins, à la maladie…), bref les béotiens désireux d’avoir un aperçu d’ensemble sur ces questions essentielles – et même d’ordre civilisationnel, osons le mot – l’opus de Lebon est plus que salutaire.
Jérôme Régnault
Jean-Christophe Lebon, Pour une Agriculture rebelle, Éditions Retour aux sources, 2020
https://institut-iliade.com/un-regard-territorial-sur-la-biodiversite/
Brève histoire de la laïcité (Alexandre Marie)
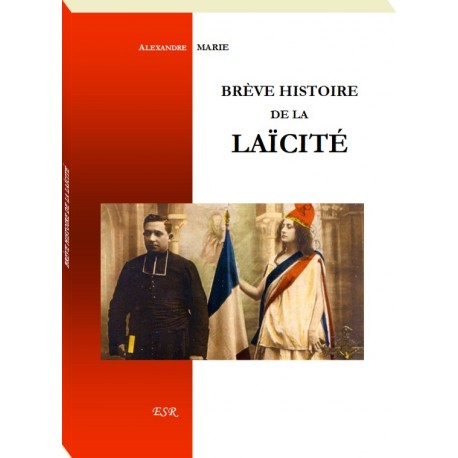
Cette petite plaquette est un outil précieux pour ceux qui mènent le combat pour restaurer une France catholique. Mais sa lecture sera bénéfique à tous ceux qui, plus modestement, veulent en savoir plus sur l’origine de cette notion de laïcité.
Les catholiques libéraux, relayés plus largement par ceux, très nombreux, qui manquent d’une solide formation, font une distinction entre la « laïcité », qu’ils considèrent comme légitime, et le « laïcisme », perçu comme une idéologie hostile à la religion, assimilé à de l’athéisme militant, cherchant à éliminer toute présence religieuse de l’espace public et à réduire la vie religieuse à la seule sphère privée.
Mais cette distinction, rappelle Alexandre Marie, ne saurait en aucun cas être acceptée, car elle identifie à tort la « laïcité » (la fallacieuse et impossible « neutralité » de l’Etat vis-à-vis de la religion, qui n’est en fait rien d’autre que son rejet pur et simple) avec la doctrine catholique de la distinction légitime du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, en accord avec la parole évangélique « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt XXII, 21), qui en aucun cas n’exonère César du devoir qu’il a lui-même aussi de rendre à Dieu ce qui lui revient en justice, à savoir un culte public et la garantie que les institutions et les lois civiles respectent le magistère ecclésial en matière de foi et de morale.
C’est à partir de la Révolution de 1789 que le principe de laïcité fait son apparition. Jusqu’à ce moment, tous les pays européens étaient encore confessionnels et la religion était associée au pouvoir et régissait les conduites sociales. Une chronologie succincte rappelle comment le laïcisme s’est opposé frontalement au catholicisme. Le rôle de la franc-maçonnerie est bien entendu rappelé.
La plaquette se conclut sur la façon dont le pontificat de François contredit tous les enseignements pontificaux antérieurs au Concile Vatican II sur la distinction des pouvoirs spirituel et temporel.
Brève histoire de la laïcité, Alexandre Marie, éditions Saint-Remi, 32 pages, 5 euros
A commander en ligne sur le site de l’éditeur
https://www.medias-presse.info/breve-histoire-de-la-laicite-alexandre-marie/87450/
samedi 30 octobre 2021
En souvenir de Dominique Venner par Robert Steuckers 1/7
photographie : Louis Monier © - Rue des Archives
Il faut que je l’écrive d’emblée : je n’ai guère connu Dominique Venner personnellement. Je suis, plus simplement, un lecteur très attentif de ses écrits, surtout des revues Enquête sur l’histoire et la Nouvelle revue d’histoire, dont les démarches correspondent très nettement à mes propres préoccupations, bien davantage que d’autres revues de la “mouvance”, tout bonnement parce qu’elles exhalent un double parfum de longue mémoire et de géopolitique. Lire les revues que publiait Dominique Venner, c’est acquérir au fil du temps, un sens de la continuité européenne, de notre continuité spécifique, car je me sens peut-être plus “continuitaire” qu’“identitaire”, plus imbriqué dans une continuité que prostré dans une identité figée, mais c’est là un autre débat qui n’implique nullement le rejet des options dites “identitaires” aujourd’hui dans le langage courant, des options “identitaires” qui sont au fond “continuitaires”, puisqu’elles veulent conserver intactes les matrices spirituelles des peuples, de tous les peuples, de manière à pouvoir sans cesse générer ou régénérer les Cités de la Terre. Lire la Nouvelle revue d’histoire, c’est aussi, surtout depuis l’apport régulier d’Ayméric Chauprade, replacer ces continuités historiques dans les cadres d’espaces géographiques précis, dans des lieux quasi immuables qui donnent à l’histoire des constantes, à peine modifiées par les innovations technologiques et balistiques.
J’ai découvert pour la première fois un livre de D. Venner dans une librairie bizarre, qui vendait des livres et tout un bric-à-brac d’objets des plus hétéroclites : elle était située Boulevard Adolphe Max et n’existe plus aujourd’hui. Ce livre de Dominique Venner s’intitulait Baltikum. Nous étions en août 1976 : je revenais d’un bref séjour en Angleterre, d’une escapade rapide à Maîche, j’avais vingt ans et huit bons mois, la chaleur de ce mois des moissons était caniculaire, torride, l’herbe de notre pelouse était rôtie comme en Andalousie, le plus magnifique bouleau de notre jardin mourrait en dépit des efforts déployés pour le sauver coûte que coûte. J’allais rentrer en septembre, le jour où l’on a inauguré le métro de Bruxelles, à l’Institut Marie Haps, sous les conseils avisés du Professeur Jacques Van Roey, l’éminent angliciste de l’UCL. C’est à ce moment important de mon existence, où j’allais me réorienter et trouver ma voie, que j’ai acheté ce livre de Venner. L’aventure des “Corps francs” du Baltikum ouvrait des perspectives historiques nouvelles au lecteur francophone de base, peu frotté aux souvenirs de cette épopée, car les retombées à l’Est de la Première Guerre mondiale étaient quasi inconnues du grand public qui ne lit qu’en français ; l’existence des Pays Baltes et de la communauté germanophone de Courlande et d’ailleurs, fidèle au Tsar, avait été oubliée ; en cette époque de guerre froide, les 3 républiques baltes faisaient partie d’une Union Soviétique perçue comme un bloc homogène, pire, homogénéisé par l’idéologie communiste. Personne n’imaginait que les langues et les traditions populaires des ethnies finno-ougriennes, tatars, caucasiennes, etc. étaient préservées sur le territoire de l’autre superpuissance, finalement plus respectueuse des identités populaires que l’idéologie du “melting pot” américain, du “consumérisme occidental” ou du jacobinisme parisien. La spécificité du “Baltikum” était tombée dans une oubliette de notre mémoire occidentale et ne reviendra, pour ceux qui n’avaient jamais lu le livre de Venner, qu’après 1989, qu’après la chute du Mur de Berlin, quand Estoniens, Lettons et Lituaniens formeront de longues chaînes humaines pour réclamer leur indépendance. Pour l’épopée des Corps francs et des premières armées baltes indépendantes, tout lecteur assidu de la Nouvelle revue d’histoire pourra se rendre au Musée de l’Armée de Bruxelles, où de nombreuses vitrines sont consacrées à ces événements : j’y ai amené un excellent ami, homme à la foi tranquille, homme de devoir et de conviction, le Dr. Rolf Kosieck, puis, quelques années plus tard, un jeune collaborateur de Greg Johnson; ils ont été ravis.
Liberté et rupture disloquante
Outre ces pages d’histoire qui revenaient bien vivantes à nos esprits, grâce à la plume de D. Venner, il y avait aussi, magnifiquement mise en exergue, cette éthique de l’engagement pour la “continuité” (russe, allemande ou classique-européenne) contre les ruptures disloquantes, que les protagonistes de celles-ci posaient évidemment comme “libératrices” sans s’apercevoir tout de suite qu’elles engendraient des tyrannies figeantes, inédites, qui broyaient les âmes et les corps, mêmes ceux de leurs plus féaux serviteurs (cf. les mémoires d’Arthur Koestler et la figure de “Roubachov” dans Le Zéro et l’infini). Il n’y a de liberté que dans les continuités, comme le prouve par ex. le maintien jusqu’à nos jours des institutions helvétiques dans l’esprit du “Serment du Rütli” : quand on veut “faire du passé table rase”, on fait disparaître la liberté dans ce nettoyage aussi atroce que vigoureux, dans ces “purgations” perpétrées sans plus aucune retenue éthique, semant la mort dans des proportions inouïes. Aucune vraie liberté ne peut naître d’une rupture disloquante de type révolutionnaire ou trotskiste-bolchevique, sauf peut-être celle, d’un tout autre signe, qui fera table rase des sordides trivialités qui forment aujourd’hui l’idéologie de l’établissement, celle du révolutionarisme institutionnalisé qui, figé, assoit sans résistance notable son pouvoir technocratique, parce que tous les repères sont brouillés, parce que les cives de nos Cités n’y voient plus clair… Rétrospectivement, après 37 ans, c’est la première leçon que le Prof. Venner m’a enseignée…
Ensuite, toujours rétrospectivement, la liberté dans la continuité a besoin de “katechons”, de forces “katechoniques”, qui peuvent se trouver dans l’âme d’un simple volontaire étudiant, fût-il le plus modeste mais qui, en passant de sa Burschenschaft à son Freikorps, donne son sang et sa vigueur physique pour arrêter l’horreur liberticide qui avance avec le masque de la liberté ou de la “dés-aliénation”, tandis que les “bourgeois” comptent leurs sous ou se livrent à la débauche dans le Berlin qu’a si bien décrit Christopher Isherwood : tous les discours sur la liberté, qui cherchent à vendre une “liberté” qui permet la spéculation ou qui fait miroiter le festivisme, une “liberté” qui serait installée définitivement dans tous les coins et recoins de la planète pour aplatir les âmes, sont bien entendu de retentissantes hypocrisies. La liberté, on ne la déclame pas. La liberté, ce n’est pas une affaire de déclamations. On la prend. On se la donne. On ne se la laisse pas voler. En silence. Maxillaires fermées. Mais on la garde au fond du cœur et on salue silencieusement tous ceux qui font pareil. Comme Cinccinatus, on retourne à sa charrue dès que le danger mortel est passé pour la Cité. Les “Corps francs”, qui fascinaient Venner, étaient une sorte de “katechon” collectif, dont toutes les civilisations en grand péril ont besoin.
À suivre
Pour un réveil européen !

Parce que « l’homme blanc » doit retrouver courage, fierté et confiance dans l’avenir, l’Institut Iliade publie un nouvel ouvrage collectif : « Pour un réveil européen ! »
Vivre, aimer, servir, combattre, transmettre, conscients de notre double vocation d’héritiers et de refondateurs : tel est l’appel au grand réveil des Européens que lancent les auteurs de ce livre, membres ou amis de l’Institut Iliade. Les douze chapitres de l’ouvrage invitent ainsi le lecteur à une réflexion actualisée autour des trois impératifs de la triade homérique définie par Dominique Venner.
Reconnaître la nature comme socle, en respectant les équilibres naturels et en renouant avec la dimension communautaire de nos traditions, pour rebâtir la cité sur le fondement de notre identité.
Rechercher l’excellence comme but, en cultivant l’exigence envers soi-même, en cherchant à se dépasser pour renouer le fil de la continuité avec « ce que nous sommes », sous une forme toujours renouvelée, depuis des millénaires.
Viser la beauté comme horizon, en rompant avec l’utilitarisme bourgeois et en refusant l’extension du domaine de la laideur ; en adoptant une éthique de la tenue et en suivant la voie des « cœurs aventureux », déterminés à ré-enchanter notre monde et à retrouver le sens du sacré.
Le moment est crucial. Sur fond de mouvement Black Lives Matter et de ressentiment « indigéniste » de plus en plus bruyant et agressif, c’est bien la représentation de « l’homme blanc » qui est ciblée, sommée de s’excuser ad vitam aeternam, voire – pour certains extrémistes – de disparaître. La récente polémique visant l’hebdomadaire Valeurs Actuelles, coupable d’avoir rappelé la responsabilité de certains peuples africains dans la vente des esclaves noirs aux négriers européens, atteste de la veulerie et de la dhimitude intellectuelle du monde médiatique et politique français, Rassemblement national compris, ce qui rend d’autant plus nécessaire et urgent le combat des idées dans le champ métapolitique.
Il n’y a aucune fatalité au renoncement, à la lâcheté, au déclin des peuples et des nations d’Europe. À l’horizontalité des besoins, des pulsions et des droits, les auteurs de l’Iliade proposent une alternative, où « nature », « excellence » et « beauté » auraient finalement pour vocation de nourrir l’âme, la sortir de sa torpeur et la tirer vers le haut. Ce qui se dégage de ces contributions, c’est une soif de liberté retrouvée, d’esprit de combat et de communauté, de goût pour l’aventure sans cesse recommencée – celle de tout peuple dans l’histoire.
Cet ouvrage est lancé officiellement en présence des auteurs à l’occasion du VIIe colloque de l’Institut Iliade, samedi 19 septembre à la Maison de la Chimie, Paris. Il sera disponible à la vente à cette occasion puis diffusé par la Nouvelle Librairie et la boutique de l’Iliade : boutique.institut-iliade.com
Points forts :
- Un véritable bréviaire qui servira de livre de chevet aux nouvelles générations d’Européens qui cherchent du sens et des repères par ces temps d’orage ;
- Des chapitres courts et denses, qui vont à l’essentiel et proposent systématiquement des sources et des pistes de lecture pour approfondir les sujets abordés ;
- Un appel à la résistance et à la confiance dans l’avenir : c’est lorsque les lumières s’éteignent, que les torches doivent s’embraser !
Ouvrage présenté par Philippe Conrad et Grégoire Gambier, dirigé par Olivier Eichenlaub. Postface d’Alain de Benoist. Autres contributeurs : Jean-Philippe Antoni, Anne-Laure Blanc, Thibaud Cassel, Paul Eparvier, Guillaume Travers, Jean-François Gautier, Henri Levavasseur, Jean-Yves Le Gallou, Alix Marmin, Rémi Soulié.
Editions de La Nouvelle Librairie, www.lanouvellelibrairie.com, ISBN 978-2-491446-22-2, 192 pages, 16 euros.
Collection Iliade dirigée par Grégoire Gambier. Titres déjà parus (aux éditions Pierre-Guillaume de Roux) :
- Thibaud Cassel, Le Chant des alouettes – Anthologie poétique, préface de Christopher Gérard, 2017.
- Collectif, présenté par Philippe Conrad, Ce que nous sommes – Aux sources de l’identité européenne, 2018.
- Thibault Mercier, Athéna à la borne – Discriminer ou disparaître ?, 2019.
Le cœur rebelle
Dominique Venner, Le cœur rebelle, Belles Lettres, 1994. [rééd. G. de Roux, 2014]
Par celui qui fut, entre autres, le fondateur d’Europe-Action et qui dirige actuellement l’excellente revue Enquête sur l’Histoire. Il s’agit des carnets d’un ancien activiste faisant preuve d’autant de courage que de lucidité : « Notre nationalisme, terme impropre encore une fois, était beaucoup plus qu’une doctrine de la nation ou de la préférence nationale. Il se voulait une vision du monde, une vision de l’homme européen moderne.
Il se démarquait complètement du jacobinisme de l’État-nation. Il était ouvert sur l’Europe perçue comme une communauté de peuples. Il voulait s’enraciner dans les petites patries constitutives d’une "Europe aux cent drapeaux", pour reprendre l’expression de Yann Fouéré. Nous ne rêvions pas seulement d’une Europe de la jeunesse et des peuples, dont la préfiguration poétique était la chevalerie arthurienne. Nous imaginions cette Europe charpentée autour du noyau de l’ancien empire franc, un espace spirituel, politique et économique suffisamment assuré de soi pour ne rien craindre de l’extérieur ».
« Nous étions nécessairement conduits à une réflexion sur les sources de l’identité européenne. Celle-ci était-elle réductible au christianisme ? L’Église (ou les églises) avai(en)t apporté la réponse. Pendant la guerre d’Algérie, à la fin surtout, dans la période cruciale, elle avait choisi son camp, soutenant le plus souvent nos ennemis sans avoir l’air d’y toucher, distillant sournoisement la gangrène du doute et de la culpabilité. Par réaction, nous aspirions à une religion nationale et européenne qui fût l’âme du peuple et non son fourbe démolisseur. L’Église jouait de l’ambiguïté. Aux traditionalistes, elle faisait valoir son empreinte profonde sur l’histoire et la culture européennes. Aux autres, elle rappelait qu’étant universelle, étant la religion de tous les hommes et de chaque homme, elle ne pouvait être la religion spécifique des Européens ».
Cette longue citation est révélatrice tant du fond (Venner vise juste) que du ton de son livre : lucide, implacable, libre. Ses carnets sont donc à lire et à faire lire en tant que petit manuel du "Jeune Européen" d’aujourd’hui.
Patrick Canavan, Nouvelles de Synergies Européennes n°5, 1994.
***
« Demain comme hier, si de nouvelles tables de valeurs doivent être instituées, elles ne le seront pas par des mots, mais avec des actes, par un engagement de l’être même. La vérité du monde ne réside pas dans son “essence” mais dans le travail, la création, la lutte, l’enfantement, dans ces actes dont nous avons oublié qu’ils sont religieux. La seule vérité est de se tenir debout quoi qu’il arrive, de faire face à l’absurdité du monde pour lui donner une forme et un sens, de travailler et de se battre si l’on est un homme, d’aimer si l’on est une femme.
Pendant des années j’avais été constamment placé devant l’obligation de savoir si la fin justifiait les moyens. Il vint un jour où je compris que ma finalité serait aussi ce que mes actes en auraient fait. Raisonnant ainsi, je renonçais nécessairement à la politique. Elle soumet les moyens à des fins qui n’ont pas nécessairement l’excuse d’être désintéressées. J’éprouvais la crainte aussi de verser dans l’habitude et la médiocrité. Il était temps de marcher à mon pas, ce qui comportait d’autres risques. J’ai rompu avec l’agitation du monde par nécessité intérieure, par besoin de préserver ma liberté, par crainte d’altérer ce que je possédais en propre. Mais, il existe plus de traverses qu’on ne l’imagine entre l’action et la contemplation. Tout homme qui entreprend de se donner une forme intérieure suivant sa propre norme est un créateur de monde, un veilleur solitaire posté aux frontières de l’espérance et du temps. »
Dans l’équipe de Staline (Sheila Fitzpatrick)
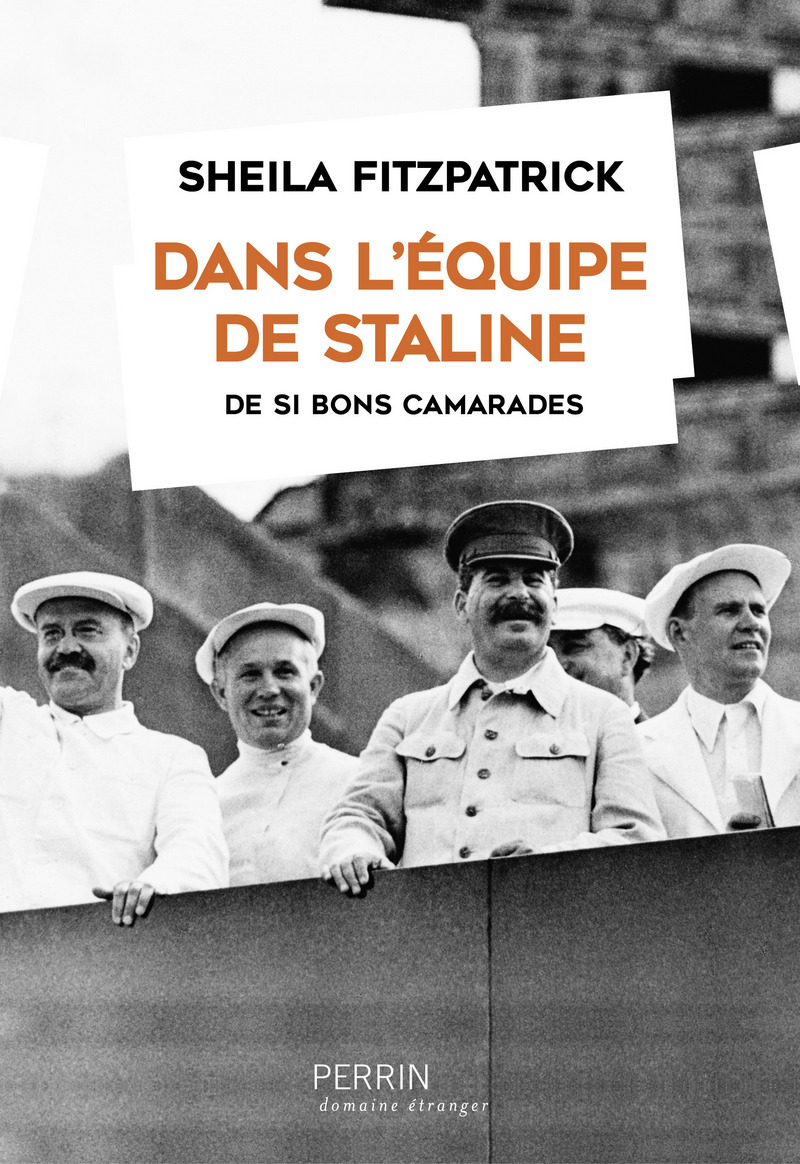
Sheila Fitzpatrick est professeur d’histoire à l’université de Sidney, ancienne présidente de l’Association américaine pour l’avancement des études slaves et coéditrice du Journal of Modern History. Elle est aussi l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur la Russie soviétique.
Quand Staline cherchait à temporiser lors d’une négociation avec des étrangers, il lui arrivait de se retrancher derrière une difficulté : obtenir l’accord de son Politburo. C’était interprété comme un faux prétexte, puisque les diplomates présumaient à juste titre que la décision finale lui appartenait.
Mais cela ne signifie nullement qu’il n’existait pas un Politburo qu’il consultait ou une équipe de collègues avec laquelle il travaillait. Cette équipe – une douzaine de membres en permanence, tous des hommes – prit forme dans les années 1920, combattit après la mort de Lénine contre les équipes de l’Opposition, menées par Léon Trotski et Grigori Zinoviev, et se maintint pendant trois décennies, réussissant à survivre à des épisodes qui la menaçaient directement, comme les grandes purges, la paranoïa des dernières années de Staline et les périls de la transition post-stalinienne. Rester unis en politique pendant trente ans, c’est long, même dans un climat moins délétère que celui de l’Union soviétique sous Staline. L’équipe se dispersera finalement en 1957, quand l’un de ses éléments, Nikita Khroutchev, s’instaura chef suprême et se débarrassa du reste de ses coéquipiers.
Sheila Fitzpatrick décida d’écrire ce livre quand les archives Staline devinrent enfin accessibles, avec notamment de très nombreux échanges de lettres entre Staline et les autres membres de son équipe.
Qui sont réellement ces hommes ? Quelle était leur existence dans l’antichambre de Staline ? Quel fut leur rôle exact ? Quelle a été leur influence ? Ce livre nous en dit beaucoup. On sait maintenant que chez Staline, à un degré inhabituel dans le monde des leaders politiques contemporains, la vie politique et la vie sociale étaient très étroitement liées. Il voyait beaucoup les membres de son équipe, dans les appartements dont ils disposaient au Kremlin ou bien en dehors de Moscou, dans sa datcha personnelle. Ce fut encore plus le cas après le suicide de sa femme en 1932, quand l’équipe et les parents par alliance hérités de ses deux mariages constituaient pratiquement les composantes uniques de sa vie sociale. Il devint plus solitaire encore après les grandes purges, qui virent l’éclatement de sa famille par alliance. Les membres de l’équipe ont laissé des récits mémorables de ces terribles soirées à la datcha auxquelles ils étaient contraints de participer (sans les femmes et les enfants, contrairement aux années trente) et qui constituaient pour eux un véritable fardeau.
Il y avait notamment parmi ces hommes examinés dans ce livre le proche collaborateur Molotov, le coléreux Ordjonikidzé, le pervers sexuel et grand corrompu Beria, le prématurément disparu Kirov, l’apparatchik dodu Malenkov, le chargé des purges Andreïev, le tyranneau Kaganovitch et l’ambitieux Khroutchev.
L’une des révélations surprenantes de ce livre est que le plus gros problème rencontré par les membres du Politburo en matière de politique intérieure semble avoir été le « problème juif ». Leur brusque renoncement à la campagne antisémite lancée dans les dernières années de Staline contraria et déçut une grande partie du public non juif, et le fait que Staline soit mort juste après avoir désigné les médecins juifs comme de possibles espions et de possibles assassins fit penser à beaucoup qu’ils l’avaient tué. Dans les années qui suivirent, la question juive se retrouva mêlée à tout; les principales préoccupations populaires de l’époque concernant le Kremlin consistèrent pour l’essentiel à spéculer pour savoir quel leader était réellement juif, et s’il agissait ou non pour le compte des Juifs.
Au final, il apparaît que Staline pouvait se montrer brutal avec son équipe ou, selon les moments, se comporter vis-à-vis d’elle en camarade. Il pouvait exclure des membres de son équipe et même les faire tuer. Mais il ne se passa jamais de cette équipe.
Dans l’équipe de Staline, Sheila Fitzpatrick, éditions Perrin, 448 pages, 25 euros
A commander en ligne sur le site de l’éditeur
https://www.medias-presse.info/dans-lequipe-de-staline-sheila-fitzpatrick/87514/
vendredi 29 octobre 2021
La France a créé les Etats-Unis (et le Canada aussi)
Ils s’appelaient Jacques Cartier, Jean Cavelier de la Salle, Jean de Brébeuf, Louis-Joseph de Montcalm… Ils ont découvert, exploré, évangélisé, administré et colonisé le continent américain. Sur les 50 états américains et le District de Columbia, le premier pays européen dans le nombre d’états où ils implantèrent le premier peuplement est la France. Six pays européens ont été les premiers blancs à peupler 42 états des actuels Etats-Unis :
– 19 pour la France : Maine, Vermont, Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Minnesota, Wisconsin, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Iowa, Missouri, Kansas, Arkansas, Texas, Louisiane, Mississipi, Alabama et Floride.
– 11 pour la Grande-Bretagne : New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Virginie, Virginie occidentale, Maryland, District of Columbia, Kentucky, Caroline du Nord, Oregon et Washington.
– 6 pour l’Espagne : Californie, Nouveau-Mexique, Arizona, Tennessee, Géorgie et Caroline du Sud.
– 4 pour les Provinces-Unies (actuellement Pays-Bas) : New-York, Delaware, New Jersey et Connecticut.
– 1 pour la Russie : Alaska.
– 1 pour la Suède : Pennsylvanie.
Devenus indépendants de facto en 1776 et de jure en 1783, les Etats-Unis franchirent le Mississipi et furent les premiers à coloniser 8 de leurs futurs états : Nevada, Utah, Idaho, Montana, Colorado, Wyoming, Nebraska et Oklahoma.
Quant à Hawaii, il n’entre pas dans cette catégorie puisqu’il s’agit un état souverain, le renversement de la reine par un coup d’état américain en 1893 amena à l’instauration de la République, l’annexion de l’archipel en 1898 qui devient « territoire des Etats-Unis » et sa promotion au rang d’état en 1959.
Hristo XIEP
https://www.medias-presse.info/la-france-a-cree-les-etats-unis-et-le-canada-aussi/87842/
Taisez ce mot que je ne saurais entendre ici...
En triant quelques journaux des semaines précédentes, je tombe par hasard sur une éphéméride publiée dans Le Parisien du dimanche 5 septembre dernier qui titre « 1793 : le règne de la Terreur », ce qui, évidemment, attire mon attention historienne. Et là, je sursaute : le texte sur cette triste période, fort court, évite un mot, « le » mot, comme s’il constituait un tabou qu’il s’agirait de scrupuleusement respecter ! Je cite en intégral l’éphéméride, et les lecteurs de ce site comprendront sans doute la surprise que j’ai pu éprouver en la lisant moi-même : « Le 5 septembre 1793, l’Assemblée met « la Terreur à l’ordre du jour » !
Rien ne va plus dans l’ancien royaume de France, menacé par la crise économique et une invasion étrangère. Une justice radicale doit permettre de « terroriser » les ennemis de la France. La guillotine va bientôt tourner à plein régime. » Ainsi, comme chacun peut le constater et au-delà de l’utile rappel de cet épisode douloureux de l’histoire de France, le mot « République » est soigneusement évité et remplacé « avantageusement » par la formule, véridique au demeurant si l’on s’en tient à la suite des événements, de « l’ancien royaume de France », puis par le beau et seul nom, et dont il me tient toujours à cœur de défendre l’honneur et le sens, de « France ». Mais de « République », point !! Ce qui ne manque pas de surprendre l’amoureux des faits et de l’histoire vécue comme ressentie que je suis.
Pourquoi cacher le nom du régime qui a mis la Terreur à l’ordre du jour ? Pourquoi ne pas évoquer les pères de la Terreur, en deux noms (ceux qui, pour le commun des Français, incarnent cette période si particulière), Robespierre et Saint-Just ? Pourquoi cette gêne évidente chez le rédacteur de l’éphéméride, ou cette dissimulation consciente, comme si la vérité devait s’arrêter aux portes de la République sans oser, ou sans avoir le droit de les franchir ?
Disons les choses telles qu’elles sont et telles que je les comprends : 1. La Première République, celle qui s’étend de 1792 à 1804, du coup d’Etat des Tuileries au sacre du César Bonaparte en Napoléon 1er, n’est pas la seule République possible, et la Cinquième ne lui est pas exactement comparable, malgré l’homonymie et quelques institutions communes ; 2. La Première République, née dans le sang des gardes suisses et s’achevant dans la dictature impériale, n’est pas réductible aux seuls mois de la Terreur (du début juin 1793 à la fin de juillet 1794), et Marat, Robespierre et Saint-Just, pour idéologues de celle-ci qu’ils soient, ne peuvent prétendre incarner la République à eux-seuls, quoiqu’en pense M. Mélenchon qui, visiblement, ne s’est pas suffisamment penché sur l’histoire sociale de cette période ; 3. Ne pas nommer les choses, comme les « mal nommer », c’est altérer leur sens et celui de l’histoire. Oui, la Terreur, c’est bien la République ; non, ce n’est pas le « tout » de la République, mais cela appartient à son histoire et, plus largement, à l’histoire de France, même si ce triste moment n’est pas à la gloire de la République.
Le mot « République » n’est pas un mot sacré, même si M. Mélenchon le croit ou le voudrait, et n’en déplaise à MM. Darmanin, Blanquer et Bertrand (entre autres…) : les Camelots du Roi lui ont d’ailleurs souvent fait les honneurs de leurs farces et de leurs dénonciations, et ils ne s’en prenaient pas à l’idée, civique, de « Res Publica » ou à celle mise en avant par le jurisconsulte Jean Bodin au XVIe siècle, mais bien à ce régime qui, sous les divers numéros qui les précédaient, ne défendait pas convenablement ni le pays et son intégrité, ni les Français et leur pluralité.
Qu’un auteur d’éphéméride veuille préserver le mot de République de la souillure de la Terreur peut se comprendre, dans une optique de croyance toute républicaine : mais l’histoire est cruelle, et elle n’aime guère qu’on la travestisse ou qu’on la cache. Oui, c’est bien la République, au moins l’idée que s’en faisaient ceux que les manuels d’histoire d’Etat présentaient encore hier comme son incarnation la plus « pure », « incorruptible » même (à l’inverse d’un Danton, plus « intéressé »…), qui a motivé et présidé la Terreur ! Quelques jours après ce 5 septembre 1793, était votée par une Convention survoltée « la loi des suspects », en un 17 septembre que la conscience morale de notre pays ne devrait jamais oublier et qui nous rappelle que la Terreur n’était pas qu’un mot, mais des lois, votées et appliquées, en une terrible spirale idéologique et homicide.
Oui, décidément, l’histoire est cruelle, même pour la République et ses adorateurs… Il importe de ne pas l’oublier, pour éloigner de notre pays comme de notre temps, autant que faire se peut, la cruauté. Et cela quel que soit le nom dont elle se pare…
La Guerre de Succession d'Espagne: une guerre mondiale avant l’heure 2/2
Il est intéressant de noter que cent cinquante ans plus tard, le carlisme fera de ces bastions historiques austrophiles des places fortes au nom de « Dieu, du Roi et des fueros ». Le carlisme bourbonien qui surgit au XIXe siècle reprend maints arguments austracistes du début du XVIIIe siècle. En raison des contentieux dynastiques en son sein à partir de la seconde moitié du XXe siècle où la faction majoritaire carliste se proclame révolutionnaire, socialiste et autogestionnaire au mépris du traditionalisme se relance un courant carloctaviste favorable à l’archiduc Dominique de Habsbourg - Toscane, surtout quand l’actuel prétendant traditionaliste, le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, disparaîtra sans héritier direct.
Hors d’Espagne, le conflit soulève d’autres révoltes. Ainsi les « Malcontents » de Hongrie sont-ils dirigés par un magnat protestant, descendant des princes de Transylvanie, François II Rákóczi. Mais, dès 1704, les Franco-Espagnols s’en désintéressent ! « Louis XIV, qui n’a pas oublié les troubles de la Fronde, se défie des mouvements de rébellion. » Versailles joue tardivement et avec une réticence certaine la carte jacobite. Les Anglais et les Écossais fidèles aux Stuart exilés forment une « diaspora, que l’on estime à 40.000 personnes environ, s’était réfugiée en France, mais aussi en Italie et en Espagne. Ses membres étaient avant tout des militaires, officiers et soldats ». Louis XIV héberge le prétendant jacobite, Jacques III, fils de Jacques II d’Angleterre et d’Écosse, à Saint-Germain-en-Laye. La « Grande Alliance » anti-Bourbon investit peu de son côté dans la «Guerre des Camisards». Ce « mouvement prophétique protestant, actif dans les Cévennes et le Vivarais » conduit par « un jeune garçon boulanger de vingt et un an, Jean Cavalier, prédicant et prophète » sert surtout de diversion militaire. La « petite guerre » (ou guérilla) correspond aux théâtres d’opération hongrois et cévenole. Il faut souligner que « les partisans étaient des troupes régulières, détachées de l’armée, et à qui était confiée une mission précise : reconnaissance, fourrage ou réquisitions ».
Batailles et négociations parallèles
« La Guerre de Succession d’Espagne marque l’aboutissement d’un “ Grand Siècle ” militaire caractérisé par l’augmentation constante de la taille des armées et par l’amélioration de l’organisation du ravitaillement. L’augmentation des moyens des différents États belligérants permettait d’enrôler et d’équiper un nombre supérieur de soldats; les impératifs de l’approvisionnement des hommes et de l’alimentation des chevaux avaient tendance à prendre une part croissante dans le choix des théâtres d’opérations et dans la direction de la guerre. » Clément Oury insiste, d’une part, sur le rôle déterminant de l’intendance et, d’autre part, sur l’importance de la guerre des places avec l’application de la poliorcétique « ou l’art de la conduite d’un siège » Cela implique pendant l’encerclement d’une place forte de maintenir des lignes de communication continues ainsi que des sources variées d’approvisionnement. Cependant, « dans les relations internationales de l’Europe d’Ancien Régime, la négociation et l’action militaire ne sont pas des séquences séparées : elles se déroulent de concert durant toute la durée du conflit ».
La variété des fronts en Europe et au-delà nécessite une concertation permanente entre les responsables des forces anti-Bourbon. Le prétendant Charles III d’Espagne se rend à Windsor saluer la reine Anne d’Angleterre et s’entretient avec les généraux anglais de la campagne à venir de 1704. « Jamais on n’avait vu une telle coopération – et une telle interdépendance – entre les adversaires de la France. » Une autre visite modifie le sort de l’Europe septentrionale. En avril 1707, Marlborough rencontre le roi de Suède Charles XII en pleine « Guerre du Nord ». Le capitaine général anglais « de facto […] diplomate en chef de la Grande Alliance » le persuade de ne pas envahir la Silésie autrichienne « et d’attaquer plutôt Pierre le Grand pour installer un tsar à sa dévotion en Russie – c’est donc sur les bons conseils de Marlborough que le roi de Suède se lança dans la campagne qui allait mener à son épouvantable défaite de Poltava, deux ans plus tard ». À l’été 1702, 14.000 Anglais ont débarqué près de Cadix. C’est « la première fois que les Britanniques réalisaient une opération aussi ambitieuse, si loin de leurs bases et sans le moindre soutien local ».
L’auteur ne cache pas travers et défauts français. Rivalités, divergences d’appréciations et querelles d’ego incessantes ruinent toute coordination effective entre les troupes. Le Royaume de France pâtit d’un mal chronique: le manque d’argent. Mais, « malgré son coût prohibitif, le système financier tint bon. Même accablé par les défaites, le roi de France garde tout au long de la guerre une image suffisamment bonne pour trouver encore des investisseurs. La dette s’était internationalisée », y compris auprès des contempteurs habituels de la monarchie absolue de droit divin. « De nombreux jansénistes exilés en Hollande, comme Pasquier Quesnel, souhaitaient la victoire du parti Bourbon, alors même que le pays qui les accueillait était engagé dans l’autre camp. »
Imprévus militaires et inattendus politiques
Au cours de cette longue et terrible guerre, « les territoires extra-européens deviennent des enjeux stratégiques majeurs, justifiant un effort naval soutenu ». La stratégie prend en compte le domaine naval. Il paraît désormais évident que « pour la marine davantage encore pour l’armée, le rôle de l’argent était essentiel. Les Français, aussi bien que les Anglais et les Hollandais, savaient que de la solidité financière dépendait la puissance navale, qui conditionnait à son tour le commerce, source d’enrichissement pour les particuliers et pour l’État ». Clément Oury avertit que « la guerre dans les Antilles n’était pas moins impitoyable que celle qui se menait dans les plaines de Flandre ». La supériorité navale anglo-hollandaise oblige les navires des Deux-Couronnes à repenser leur tactique. « Les Français pratiquent la course sur toutes les latitudes, des Caraïbes et de l’Amérique du Sud jusqu’à Arkhangelsk. On a calculé que sur l’ensemble du conflit, le butin se monte à 6587 prises, dont 3126 faites à Dunkerque et 886 par Saint-Malo, pour des montants respectifs évalués, au bas mot, à 30 et 15 millions de livres. » « En mai 1712, [le corsaire Cassard] ravagea les îles portugaises du Cap-Vert, avant de décharger son butin à la Martinique. […] En juin, il soumit les îles anglaises de Montserrat et Antigua; en octobre ce fut au tour de la colonie hollandaise de Surinam d’être contrainte à une contribution de 800.000 florins. En janvier 1713, il ravagea l’île hollandaise de Saint-Eustache, puis il tomba sur la colonie hollandaise de Paramaribo le 18 février, et la pilla ainsi que celle de Curaçao. » Quant à la Royale, on lui assigne « une tâche d’escorte pour convoyer l’or des Indes; elle est également incitée à prêter ses vaisseaux pour les opérations de course ».
Vient enfin le « tournant » des années 1710 – 1711 marqué un an auparavant par un vibrant appel de Louis XIV à ses sujets. Lu un dimanche de juin 1709 dans toutes les églises du royaume, le message royal explique les raisons de la poursuite de la guerre et les exigences extravagantes de la Grande Alliance. En 1710, les tories remportent les deux tiers des sièges aux Communes. Ils entament des discussions secrètes avec Versailles. Les pourparlers s’accélèrent après le coup de tonnerre dynastique du 17 avril 1711. Ce jour-là meurt sans héritier l’empereur Joseph. Son frère Charles III d’Espagne obtiendra sous peu la couronne impériale. Il est hors de question pour l’Angleterre et les Provinces-Unies que cette guerre menée contre le bloc dynastique bourbonien entérine la reconstitution de l’Empire de Charles Quint. Il est piquant de rappeler qu’élu empereur, Charles VI n’aura, lui aussi, aucun héritier mâle. Il prendra en 1713 la Pragmatique Sanction qui fera de sa fille aînée Marie-Thérèse son héritière, ce qui entraînera la Guerre de Succession d’Autriche (1740 – 1748). Quel aurait été le sort des territoires hispaniques si l’archiduc était resté Charles III d’Espagne ?
Vers l’ère atlantique…
Finalement, « la Guerre de Succession d’Espagne s’est dénouée sur les champs de bataille du nord de la France, dans les salons d’Utrecht et au palais de Rastatt ». Au mépris des lois fondamentales du royaume de France qui établissent une monarchie successorale (et non héréditaire), ce que proclame dans le vide le Parlement de Paris, Philippe V renonce pour lui et ses descendants tout droit sur la couronne de ses aïeux. Son frère cadet, le duc de Berry, et le duc Philippe d’Orléans abandonnent pour leur part toute revendication sur le trône d’Espagne. Plus d’un siècle plus tard, cela n’empêchera pas le roi des Français Louis-Philippe de convoiter ce trône pour son dernier fils Antoine d’Orléans, duc de Montpensier et époux de Louise-Fernande de Bourbon, sœur cadette d’Isabelle II. Ces renonciations simultanées témoignent de l’avènement thalassocratique anglo-saxon. Entre « deux conceptions de la monarchie : l’une, française, strictement dynastique et de droit divin; l’autre, britannique, inspirée par les principes de la Glorieuse Révolution, dominée par la rationalité politique et les traités internationaux, et garantie par les autres souverains européens », c’est la conception anglaise qui l’emporte à l’aube du « siècle des Lumières ». Il n’est d’ailleurs pas anodin si Paul Hazard situe « la crise de la conscience européenne » entre 1685 et 1715…
Les traités d’Utrecht de 1713 et la Paix de Rastatt du 6 mars 1713 modèlent donc une Europe qui s’affranchit du « Grand Siècle » ludovicien. « Les traités d’Utrecht offrent à la Grande-Bretagne les moyens de la domination maritime et commerciale à laquelle elle aspire. […] Elle se voit récompensée pour ses bons offices par la cession de Gibraltar, de Minorque, du détroit et de la baie d’Hudson, de Terre-Neuve (même si les Français y conservent un droit de pêche), de l’île de Saint-Christophe. » Le bilan pour les Habsbourg demeure mitigé. « Les États héréditaires de la Maison d’Autriche confirmaient leur statut de grande puissance européenne. Dans une perspective téléologique, ces gains jetaient les bases d’un futur “ empire d’Autriche ”. Mais dans la logique dynastique, c’était un désastre. L’idéal de la Maison de Habsbourg, celui d’un empire catholique partagé en deux branches distinctes mais indissociablement liées, avait vécu.»
La victoire des puissances maritimes anglo-hollandaises participe à l’émergence de la Modernité. Ainsi peut-on retenir que « de ce conflit éreintant naît un nouvel agencement des pouvoirs en Europe et, par le biais des empires coloniaux, sur l’ensemble de la planète. Le temps où une famille (Habsbourg au XVIe siècle, Bourbon au XVIIe) jouissait d’une prééminence diplomatique et militaire est désormais révolu. Le siècle des Lumières s’ouvre sur le triomphe de la notion d’équilibre entre les États. La Guerre de Succession d’Espagne marque ainsi un tournant. L’Empire espagnol est démembré; la Maison d’Autriche se recentre sur Italie et sur les Balkans; l’Angleterre affirme sa prééminence sur les mers et sa présence sur le continent, au détriment de la Hollande; les ambitions royales de la Prusse et de la Savoie se confirment; la puissance française demeure redoutable, mais elle revient à des bornes acceptables par ses homologues européens. Si on ajoute que, au même moment, la Russie triomphe de la Suède pendant la Grande Guerre du Nord (1700 – 1721), on constate qu’au début du XVIIIe siècle se dessine une carte de l’Europe où dominent les États qui s’affronteront encore lors de la Première Guerre mondiale ». La Guerre de Sept Ans (1756 – 1763), puis les Guerres de la Révolution et de l’Empire (1792 – 1815) accentueront la mainmise anglo-saxonne pour au moins les deux siècles suivants. Maîtresse du Canada, l’Angleterre commencera un long et patient ethnocide des peuples américains d’ethnie française. Gibraltar et les Malouines resteront des territoires sous occupation britannique. Le récent fiasco de la vente des sous-marins français à l’Australie n’est au fond qu’une très lointaine conséquence de la défaite commune de l’Hispanité et de la Francité sur les champs de bataille de Blenheim (1704) et de Malplaquet (1709).
- Clément Oury, La Guerre de Succession d’Espagne. La fin tragique du Grand Siècle, Tallandier, 2020, 520 p., 25,90 €.
Georges FELTIN-TRACOL
L’Europe centrale face à l’économie mondialisée

Bien que centrale sur le continent, cette Europe oubliée entre l’Occident et le monde russe est, paradoxalement, et depuis un demi-millénaire, devenue une périphérie.
Alors qu’au début du XVIe siècle se mettait en place ce que Carl Schmitt appela plus tard le nomos de la Terre, soit le premier ordre global du monde, la Pologne et la Hongrie, grandes puissances médiévales européennes, sombraient.
Excentrée par rapport aux principales routes commerciales depuis la fin du Moyen Âge, convoitée et dominée à tour de rôle par des puissances étrangères qui ont pu prendre l’ascendant sur la région, l’Europe centrale montre en creux l’importance de l’économie comme outil de puissance politique et donc comme clef de voûte du sort des peuples.
À l’aune des bouleversements récents, en particulier de la fébrilité des États-Unis en perte de vitesse et de l’ascension fulgurante de la Chine, s’ouvre une voie pour l’Europe centrale. Désireux de reprendre leur destin en main, essayant de tirer profit d’une visible redistribution des cartes, les pays d’Europe centrale, tout en n’ayant pas les atouts pour devenir un pôle économique majeur et autonome (peu de ressources énergétiques), cherchent à se développer pour préserver l’existence de leurs peuples et de leurs sociétés.
« Le marchand doit précéder le soldat », disait le chancelier Bismarck. Si précéder ne veut pas dire remplacer, on comprend avec cette citation que la transition industrielle actée à l’aube du siècle, qui allait bouleverser l’échelle relative de la Terre avec les évolutions du transport et de la communication – rétrécissant virtuellement notre monde minuscule – modifierait le modus operandi des luttes de pouvoir. Et changement il y a eu. L’âge de l’atome a introduit un statu quo militaire inédit qui s’est traduit par la Guerre froide.
Cette normalisation des rapports conflictuels, à travers ce qu’Edward Luttwak (un homme d’Europe centrale) qualifie de géo-économie, est devenue le fondement de tout rapport de force.
Le plan Marshall a, sous prétexte humanitaire et pour reconstruire notamment ce que les bombes alliées avaient détruit, servi à asseoir la domination économique des États-Unis sur l’Europe, asservissant ainsi un continent et ouvrant la voie à un enrichissement sans précédent des Étatsuniens. Le règne du dollar a ensuite entériné un mondialisme monopolaire, américanoïde et atlantiste.
La fin de l’histoire annoncée par Francis Fukuyama n’a toutefois pas eu lieu à l’issue de ladite Guerre froide. L’avènement d’internet et de la téléphonie mobile a parachevé la révolution de la communication et, pendant ce temps-là, la Chine s’éveillait. Est-ce le début d’une instabilité dans l’ordre mondial, catalysée par la crise de la Covid-19 ? La guerre commerciale mute-t-elle en guerre monétaire alors que l’Asie se dédollarise et que la zone yuan se construit ? En tout cas, ce qu’on pourrait nommer la « géo-justice » – ici, l’extraterritorialité du droit étatsunien – se met au service de la perpétuation du règne du dollar et affirme le caractère central de l’approche économiste. Et en cas de force majeure, la guerre – asymétrique, contre un concurrent d’abord isolé et résolument plus faible – peut rester une option – on se souvient de la Libye…
Se met donc en place un véritable système à deux soleils qui rappelle par certains aspects la Guerre froide, bien que le parallèle puisse être discuté.
« À Pékin comme à Washington, on voit des alliances entre technocrates d’État – une catégorie qui, en l’occurrence, comprend aussi la direction des organes répressifs – et oligarques (du secteur de la high-tech) – deux oligarchies au demeurant en situation de symbiose avancée –, la différence étant tout au plus que, dans ce mariage, le conjoint dominant en Chine est peut-être le parti-État, et l’oligarchie aux États-Unis », nous explique l’analyste politique hongrois András Kosztur.
La puissance connaît-elle une évolution morphologique qui nous amène à passer du règne des États et des empires à celui, diffus, des réseaux économiques et technologiques ? Cette symbiose des réseaux de la high-tech et du numérique, où les cryptomonnaies se font une place de plus en plus importante en dehors des cadres monétaires traditionnels, remet-elle la notion même de puissance en question ?
Toutes ces interrogations en amènent d’autres et empêchent de trancher a priori le questionnement suivant : sommes-nous de nouveau dans une « guerre froide » ou assise-t-on à un dépassement de la géopolitique en ce que la puissance semble être affaire de réseaux dépassant les intérêts nationaux et régionaux ? Ou bien les structures étatiques fusionnent-elles avec les réseaux d’intérêts, forcément liés géographiquement, humainement, à points d’ancrage, créant ainsi des puissances hybrides ?
Car toute numérique que soit la finance et une partie de l’économie, pour autant les réalités humaines et géographiques restent bien plus stables et concrètes et ne peuvent être éludées. Un des avantages actuels de la Chine sur les États-Unis est sa capacité de production industrielle concrète et physique – ce que possédaient les États-Unis dans leur phase ascendante. Autre exemple, la puissance économique allemande, incontestable, qui s’explique très clairement en considérant son hinterland oriental, aussi appelé Europe centrale.
Du temps de la domination soviétique, les pays du pacte de Varsovie, en particulier la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie, voyaient leurs industries pilotées depuis Moscou, qui avait pris soin de répartir les différents sites de production entre ces pays. En planifiant les échanges et les chaînes logistiques, l’URSS s’assurait ainsi que ses satellites n’étaient aucunement en mesure de prendre le large et d’être industriellement autonome – malgré leur savoir-faire et leur potentiel.
Au moment du changement de régime du début des années 1990, la grande braderie précédant l’intégration au bloc atlantique a laissé les pays d’Europe centrale dans une situation économique peu enviable. La Tchécoslovaquie, pays industrieux et très germanisé culturellement, a la chance d’avoir eu alors des élites qui limitèrent à 50 % l’ouverture aux capitaux étrangers. La Hongrie, elle, n’a pas du tout fixé de seuil et paye aujourd’hui encore le prix de cette politique antinationale. De nos jours, ce changement de régime en Hongrie est toujours surnommé le « changement de gangsters ».
L’Allemagne a été le principal bénéficiaire de cet état de fait. La privatisation massive des moyens de production de la région a permis à Berlin de mener un véritable Blitzkrieg géoéconomique sur ses voisins orientaux. Avec, par exemple, les machines-outils fonctionnelles rachetées au prix du métal mais surtout les usines fermées après rachat, l’Allemagne a généré une position de force lui permettant de négocier une main-d’œuvre peu rémunérée, qualifiée et docile en échange d’investissements et de création d’emploi par le biais de la délocalisation.
L’ancien homme politique hongrois de gauche András Schiffer qualifie même l’entrée dans l’Union européenne (UE) des pays du groupe de Visegrád (ou V4, constitué de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Tchéquie) en 2004 « d’acquisition de marché ». Car c’est bien à travers l’UE que l’industrie allemande accomplit son déploiement de puissance.
L’économiste Thomas Piketty remarque que les capitaux occidentaux « sont graduellement devenus propriétaires d’une part considérable du capital des ex-pays de l’Est : environ un quart si l’on considère l’ensemble du stock de capital (immobilier inclus), et plus de la moitié si l’on se limite à la détention des entreprises (et plus encore pour les grandes entreprises) ».
Et c’est là que réside la force de l’Allemagne. Les fonds de cohésion, appelés souvent et abusivement subventions européennes, accordés aux pays d’Europe centrale pour rattraper leur retard de développement infrastructurel vis-à-vis de l’Europe de l’Ouest, servent en réalité majoritairement les intérêts allemands. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la balance de l’Europe centrale entre les transferts publics entrants et les flux de profits sortants : elle est nettement déficitaire. C’est ce qu’affirme encore Thomas Piketty sur son blog. « Les flux de profits aujourd’hui versés aux propriétaires des entreprises dépassent de loin les transferts européens allant dans l’autre sens. » Les fonds structurels ne sont donc pas un don humanitaire et désintéressé, mais un investissement plus que rentable : « Une bonne partie des hauts revenus issus du capital est-européen est versée à l’étranger ».
L’autre perdante de ce détournement en bande organisée est la classe moyenne occidentale, principale contributrice de ce système, mais pas bénéficiaire. Une certaine élite allemande tire donc profit et des impôts des travailleurs occidentaux et du travail sous-payé des travailleurs d’Europe centrale.
Viktor Orbán, revenu au pouvoir en 2010 et en poste depuis après trois victoires électorales d’affilée et en ayant obtenu autant de fois la majorité constitutionnelle au parlement, mène dans ce cadre une politique économique intéressante. Qualifié de « libéralisme hétérodoxe », l’ordo-libéral Orbán semble faire du sur-mesure pour la Hongrie dont il connaît bien les limites et les contraintes économiques et politiques extérieures.
En 2016, il déclara que, pour son intérêt stratégique, la Hongrie devait réussir à atteindre une majorité de capital hongrois dans quatre secteurs : l’énergie, les médias, la banque et le commerce de détail. Ce souverainisme limité érigé en doctrine par un gouvernement fort et jouissant d’un vaste soutien populaire d’une part, et de bons rapports commerciaux avec Berlin d’autre part – la Hongrie remplit très bien sa part du marché en accédant toujours aux demandes des constructeurs automobiles allemands – porte ses fruits. Une classe d’hommes d’affaires et d’investisseurs hongroise a émergé et la perpétuation de la nation hongroise, avec ses caractéristiques ethnoculturelles propres, a été consolidée. Admettant que la Hongrie ne puisse pas être totalement souveraine, le Premier ministre conservateur essaye au moins d’optimiser les chances de survie de son pays.
Et tout semble indiquer que cela ne s’inscrit pas dans une démarche pessimiste, tout au contraire. Le tumulte actuel dans la mondialisation, provoqué par le décollage de la Chine et accentué par la Covid-19 et les velléités de Grande Réinitialisation, semble au contraire ouvrir une fenêtre de tir pour la Hongrie et, plus largement, l’Europe centrale, pour diminuer sa dépendance à l’égard de l’Ouest, principalement en accueillant des investissements de provenances diverses et alternatives.
Certes, la politique d’ouverture à l’Est n’a pas de grandes conséquences sur les relations commerciales. L’Europe centrale reste moins bien connectée à l’Asie que l’Europe de l’Ouest – et surtout l’Allemagne, dont la moitié du commerce se fait avec la Chine.
Mais le développement d’infrastructures nord-sud pour l’énergie et le transport – sous impulsion étatsunienne – et en même temps l’implication dans la Nouvelle Route de la soie chinoise (OBOR) illustrent la réflexion stratégique des dirigeants d’Europe centrale. Avec OBOR, le Pirée et Constanta seront bientôt reliés aux nœuds économiques et logistiques du V4, tandis que le Y tchèque – canal reliant le Danube, l’Elbe et l’Oder – permettra à terme de court-circuiter les ports de la mer du Nord pour l’acheminement de marchandises asiatiques. La Hongrie étant à la pointe de cette ouverture vers la Chine (campus de l’université chinoise de Fudan à Budapest, nœud de transport ferroviaire eurasiatique dans l’Est de la Hongrie, TGV Budapest-Belgrade avec financement chinois…), ce n’est pas un hasard si elle attire tant les foudres des États-Unis.
Sans ressource énergétique majeure, le V4 n’a pas les moyens de son autonomie pleine et entière. Les tentatives de diversification des approvisionnements en ressources énergétiques montrent sa volonté d’émancipation, mais elle est bridée d’une part par Washington – qui revend son gaz de schiste à prix d’or – et d’autre part par Berlin. C’est là encore un bon exemple de pression économique au service de la puissance géopolitique allemande. Si Berlin va jusqu’au bout de la construction du gazoduc sous-marin Nord Stream 2, dont les travaux avancent à grands pas, ce qui provoque l’ire de Varsovie, cela signifiera que la raison économique l’aura emporté sur les alliances stratégiques en vigueur et cela nous donnera par là même un indice de l’évolution de cette nouvelle « guerre froide ».
Reste aux pays d’Europe centrale à s’insérer dans cette nouvelle mondialisation en se plaçant sur une voie commerciale majeure pour recouvrer une importance économique, donc politique. Ainsi, les sociétés d’Europe centrale demeureront stables et actives, ce qui constitue un atout et vient renforcer leur identité profonde.
Ferenc Almássy
Retrouvez les actes du colloque dans le hors-série de la revue littéraire Livr’Arbitres (10 €).
https://institut-iliade.com/leurope-centrale-face-a-leconomie-mondialisee/




