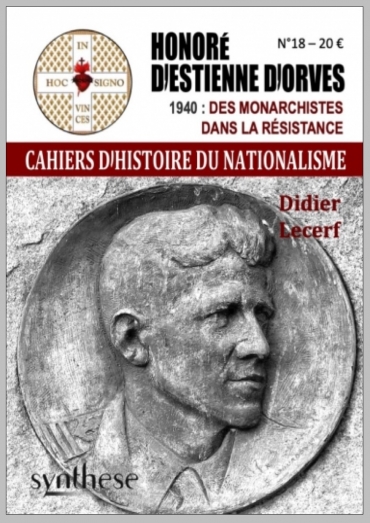Daniel Senor (né en 1971) est issu d'une famille juive d'Utica (État de New York) et a été conseiller du ministère de la défense, conseiller présidentiel et chercheur au Council on Foreign Relations. En 2009, il a cofondé le think tank néocon Foreign Policy Initiative avec Robert Kagan et William Kristol. M. Senor est actuellement rédacteur d'opinion au New York Post, au New York Times, au Wall Street Journal, au Washington Post et à l'ancien magazine néocon The Weekly Standard.
Dan Quayle est né dans l'Indiana en 1947. Il est le petit-fils du riche et influent magnat de la presse Eugene Pulliam. Après avoir étudié les sciences politiques à l'université DePauw et le droit à l'université de l'Indiana, Dan Quayle a siégé à la Chambre des représentants des États-Unis à partir de 1976. De 1989 à 1993, il a été vice-président de Bush père. Le banquier d'affaires Quayle a cofondé le Projet pour le nouveau siècle américain en 1997. Il siège par ailleurs dans divers conseils d'administration de grandes entreprises, est directeur de la banque Aozora au Japon et président de la division Global Investments de la société d'investissement Cerberus Capital Management.
Donald Rumsfeld (1932-2021), né dans l'Illinois, a été pilote naval et instructeur de vol dans la marine américaine de 1954 à 1957. Il a ensuite été employé de deux chambres des représentants (jusqu'en 1960) et banquier d'affaires (jusqu'en 1962), après quoi il est devenu député républicain. En 1969-1972, Rumsfeld est conseiller présidentiel de Nixon. En 1973, il est ambassadeur auprès de l'OTAN à Bruxelles.
Rumsfeld devient chef de cabinet de la Maison Blanche sous le président Ford en 1974. À son instigation, Ford procède à un remaniement en profondeur de son gouvernement en novembre 1975 (ce qui sera surnommé plus tard le « massacre d'Halloween »). Rumsfeld devient secrétaire à la défense. Il met fin au déclin progressif du budget de la défense et renforce les armements nucléaires et conventionnels des États-Unis, sapant ainsi les négociations SALT du ministre des affaires étrangères Kissinger avec l'URSS. Rumsfeld s'est appuyé sur le rapport controversé de l'équipe B de 1976 pour construire des missiles de croisière et un grand nombre de navires de guerre.
Après l'arrivée au pouvoir de l'administration démocrate Carter en 1977, Rumsfeld a brièvement enseigné à l'université de Princeton et à l'université Northwestern de Chicago avant d'occuper des postes à responsabilité dans le monde des affaires. Sous Reagan, il a été conseiller présidentiel pour le contrôle des armements et les armes nucléaires en 1982-1986 et envoyé présidentiel pour le Proche-Orient et le traité sur le droit international de la mer en 1982-1984. Dans l'administration Bush père, Rumsfeld a été conseiller au ministère de la défense de 1990 à 1993. En 1997, il a cofondé le Projet pour le nouveau siècle américain.
Sous la présidence de Bush Jr, Rumsfeld est à nouveau secrétaire à la défense de 2001 à 2006, où il domine la planification des invasions de l'Afghanistan et de l'Irak. Il est tenu pour responsable, tant aux États-Unis qu'au niveau international, de la détention de prisonniers de guerre sans la protection des conventions de Genève, ainsi que des scandales de torture et d'abus qui ont suivi à Abou Ghraib et Guantanamo. En 2009, Rumsfeld a même été qualifié de criminel de guerre par la Commission des droits de l'homme des Nations unies.
Benjamin Wattenberg (1933-2015) est issu d'une famille juive de New York. En 1966-1968, il a travaillé comme assistant et rédacteur de discours pour le président Johnson. En 1970, avec le politologue, spécialiste des élections et conseiller présidentiel Richard Scammon (1915-2001), il a élaboré la stratégie qui a permis aux démocrates de remporter les élections générales de 1970 et au républicain Richard Nixon de redevenir président en 1972. Dans les années 1970, Wattenberg a été conseiller du sénateur démocrate Henry Jackson. Il a également travaillé comme haut fonctionnaire pour les présidents Carter, Reagan et Bush père. Il a également été associé à l'American Enterprise Institute.
Professeur de sciences politiques James Wilson (1931-2012) a enseigné à l'université de Harvard de 1961 à 1987, à l'université de Californie de 1987 à 1997, à l'université Pepperdine de 1998 à 2009, puis au Boston College. Il a également occupé divers postes à la Maison Blanche et a été conseiller de plusieurs présidents américains. Wilson était également affilié à l'American Enterprise Institute.
Paul Wolfowitz, né en 1943 à Brooklyn, New York, est le fils d'immigrants juifs originaires de Pologne. Son père, Jacob Wolfowitz (1910-1981), professeur de statistiques et membre de l'AIPAC, soutenait activement les Juifs soviétiques et Israël. Wolfowitz a d'abord étudié les mathématiques à l'université Cornell dans les années 1960, où il a rencontré le professeur Allan Bloom et a également été membre du groupe étudiant secret Quil and Dragger. Pendant ses études de sciences politiques à l'université de Chicago, il a fait la connaissance des professeurs Leo Strauss et Albert Wohlstetter, ainsi que des étudiants James Wilson et Richard Perle.
En 1970-1972, Wolfowitz a enseigné les sciences politiques à l'université de Yale, où Lewis Libby était l'un de ses étudiants. Par la suite, il a été assistant du sénateur Henry Jackson. En 1976, Wolfowitz fait partie du groupe d'étude anti-URSS controversé Equipe B pour « réexaminer » les analyses de la CIA sur l'URSS. De 1977 à 1980, Wolfowitz est employé par le ministère de la défense. En 1980, il devient professeur de relations internationales à l'université John Hopkins.
Dans l'administration Reagan, Wolfowitz devient employé du Département d'Etat en 1981 sur l'intercession de John Lehman. Il rejette fermement le rapprochement de Reagan avec la Chine, ce qui le met en conflit avec le secrétaire d'État Alexander Haig (1924-2010). En 1982, le New York Times prédit donc le remplacement de Wolfowitz au département d'État. Mais c'est l'inverse qui se produit en 1983 : Haig - qui est également en conflit avec le ministre de la défense Caspar Weinberger (1917-2006), à moitié juif et virulemment anti-URSS - est remplacé par le néoconservateur George Schultz et Wolfowitz est promu assistant de Schultz pour les affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Lewis Libby et Zalmay Khalilzad sont devenus les associés de Wolfowitz. En 1986-1989, Wolfowitz a été ambassadeur en Indonésie.
Au cours de l'administration Bush père, Wolfowitz a été secrétaire adjoint à la défense sous la direction du secrétaire Cheney, avec Libby comme assistant. Ils ont donc été étroitement impliqués dans la guerre contre l'Irak en 1990-91. Wolfowitz regrette vivement que, dans cette guerre, les États-Unis se soient limités à la reconquête du Koweït et n'aient pas poussé jusqu'à Bagdad. Libby et lui continueront à faire pression tout au long des années 1990 pour une attaque « préventive » et unilatérale contre l'Irak.
De 1994 à 2001, Wolfowitz est à nouveau professeur à l'université John Hopkins, où il propage ses opinions néoconservatrices. En 1997, il a cofondé le Project for a New American Century.
Wolfowitz divorce de sa femme Clare Selgin en 1999 et entame une relation avec une employée britannico-libyenne de la Banque mondiale, Shaha Ali Riza (photo), qui lui vaudra des ennuis en 2000 et en 2007 (cfr infra). Pendant la campagne électorale de Bush Jr. en 2000, Wolfowitz faisait partie du groupe consultatif de politique étrangère de Bush, les Vulcains. Lors de l'administration suivante de Bush Jr, Wolfowitz a été nommé à la tête de la CIA, mais cette nomination a échoué parce que son ex-femme, dans une lettre adressée à Bush Jr, a qualifié sa relation avec une ressortissante étrangère de risque pour la sécurité des États-Unis. Il n'est redevenu secrétaire adjoint à la défense qu'entre 2001 et 2005, sous la direction de Rumsfeld.
Wolfowitz a profité des événements du 11 septembre 2001 pour reprendre immédiatement sa rhétorique sur les « armes de destruction massive » et les attaques « préventives » contre les « terroristes ». Dès lors, Rumsfeld et lui ont préconisé d'attaquer l'Irak à chaque fois que l'occasion se présentait. La CIA n'ayant pas donné suite à ses affirmations sur les « armes de destruction massive irakiennes » et le « soutien de l'Irak au terrorisme », elle a créé le groupe d'étude Office of Special Plans (OSP ) au sein du ministère de la défense afin de « trouver » des preuves. Cet OSP a rapidement devancé les agences de renseignement existantes et est devenu la principale source de renseignements du président Bush Jr sur l'Irak, sur la base d'informations souvent douteuses. Cette situation a donné lieu à des accusations selon lesquelles l'administration Bush Jr. créait des renseignements pour amener le parlement à approuver l'invasion de l'Irak.
En 2005, Wolfowitz a été nommé avec succès par le président Bush Jr. au poste de président de la Banque mondiale. Cependant, Wolfowitz s'est rendu impopulaire en procédant à une série de nominations néoconservatrices controversées et en faisant adopter des politiques néoconservatrices au sein de la Banque mondiale. Sa liaison avec Shaha Ali Riza, employée de la Banque mondiale, a également suscité la controverse, les règles internes de la Banque mondiale interdisant les relations entre les cadres et le personnel. En outre, Wolfowitz avait accordé à Riza une promotion assortie d'une augmentation de salaire disproportionnée en 2005. Enfin, en 2007, Wolfowitz a été contraint de démissionner de son poste de président de la Banque mondiale. Il est ensuite devenu chercheur à l'American Enterprise Institute.
Conclusion
Le néoconservatisme est né de l'inimitié virulente des trotskystes juifs qui avaient fui l'Europe de l'Est occupée par l'URSS stalinienne et la Russie. Ils venaient principalement du territoire de l'ancien empire polono-lituanien (Pologne, Ukraine et Lituanie). Ces immigrants juifs se sont principalement installés dans les quartiers new-yorkais de Brooklyn et du Bronx dans les années 1920 et 1930. Aux États-Unis, ils ont formé une communauté très soudée par le biais d'amitiés, de relations professionnelles et de mariages. Certains ont également unifié leurs noms de famille, par exemple « Horenstein » est devenu Howe, « Leibowitz » est devenu « Libby », « Piepes » est devenu « Pipes » et « Rosenthal » est devenu « Decter ». Leurs enfants étudient en masse au City College de New York et forment le groupe trotskiste New York Intellectuals.
Pour lutter contre Staline depuis son exil mexicain, le dirigeant bolchevique en exil Léon Trotski a formé un mouvement communiste rival, la Quatrième Internationale. Détestant le stalinisme, un certain nombre d'intellectuels juifs américains importants de la gauche radicale se sont rassemblés autour de Trotsky dans les années 1930, y compris les jeunes communistes Irving Howe, Irving Kristol et Albert Wohlstetter. Dans les années 1960, ils ont troqué leur trotskisme contre le néoconservatisme.
Ainsi, les principaux idéologues du néoconservatisme sont des marxistes qui se sont réorientés. Les dénominations ont changé, mais les objectifs sont restés les mêmes. En effet, les thèses libérales du néoconservatisme soutiennent tout autant l'universalisme, le matérialisme et l'utopie de l'ingénierie sociale, puisque le marxisme et le libéralisme reposent sur les mêmes fondements philosophiques. Les communistes étaient donc à New York plutôt qu'à Moscou pendant la guerre froide. Le néoconservatisme a également rendu la religion à nouveau utile à l'État.
Le néoconservatisme a été transformé en un véritable mouvement par Irving Kristol et Norman Podhoretz. Ce mouvement néoconservateur peut être décrit comme une famille élargie basée en grande partie sur les réseaux sociaux informels créés par ces deux parrains.
Les néoconservateurs sont des impérialistes démocratiques qui veulent changer la société et le monde. De plus, leur messianisme et leur volonté de répandre la démocratie parlementaire et le capitalisme dans le monde entier sont diamétralement opposés au véritable conservatisme. En effet, les vrais conservateurs n'ont aucune prétention universelle et défendent un non-interventionnisme et un isolationnisme honorables. De plus, les néoconservateurs veulent convertir leur soutien actif à Israël, si nécessaire, en interventions militaires dans des pays qu'ils considèrent comme dangereux pour leurs intérêts et ceux d'Israël.
L'idéal néoconservateur du multiculturalisme implique une immigration massive. Or, les cultures ont des valeurs, des normes et des lois différentes. Ainsi, pour permettre l'interaction sociale, un dénominateur commun est nécessaire. Par conséquent, l'objectif final n'est pas le multiculturalisme mais le monoculturalisme : les néocons veulent donc créer un être humain uniforme et unitaire.
Parmi les néocons, il y a remarquablement beaucoup d'intellectuels. Ils ne constituent donc pas un groupe marginal, mais forment au contraire le cadre intellectuel de la politique étrangère américaine. Cependant, le président Richard Nixon a eu une approche très différente des deux superpuissances que sont la Chine et l'URSS, par rapport à tous les autres présidents américains de l'après-guerre, à l'exception du président John Kennedy (1917-1963), qui a lui aussi cherché à mettre fin à la guerre froide. À la fureur des néoconservateurs, il a noué des relations avec la Chine et a considérablement amélioré les relations avec l'URSS. Aux États-Unis, Nixon a décentralisé le gouvernement, mis en place la sécurité sociale et lutté contre l'inflation, le chômage et la criminalité. Il a également aboli l'étalon-or, tandis que sa politique en matière de salaires et de prix a constitué la plus grande intervention gouvernementale en temps de paix de l'histoire des États-Unis.
Les néocons ont détesté la détente des années 1970 : ils craignaient de perdre leur ennemi préféré, l'URSS. Après la démission de Nixon à la suite du scandale du Watergate, ils ont donc affirmé que la CIA produisait des analyses beaucoup trop optimistes sur l'URSS. Le remaniement gouvernemental de 1975 dont ils ont été les instigateurs a placé George Bush père à la tête de la CIA, après quoi il a mis sur pied l'équipe B, a priori déjà hostile à l'URSS, pour produire une « évaluation alternative » des données de la CIA. Le rapport controversé et totalement erroné de l'équipe B affirmait à tort que la CIA avait tort.
Bien que le secrétaire d'État Henry Kissinger ait rejeté le rapport de l'équipe B, le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld l'a néanmoins diffusé comme une étude « fiable ». Rumsfeld a ainsi sapé les négociations sur la limitation des armements des années suivantes (c'est-à-dire pendant l'administration Carter, de 1977 à 1981). En outre, le rapport de l'équipe B a également servi de base à l'explosion inutile du budget de la défense sous l'administration Reagan.
Lors d'un voyage en Grande-Bretagne en 1978, l'ex-président Nixon a déclaré à propos du scandale du Watergate : « Certains disent que je n'ai pas bien géré la situation et ils ont raison. J'ai tout gâché. Mea culpa. Mais passons à mes réalisations. Vous serez là en l'an 2000 et nous verrons comment je suis considéré à ce moment-là » ...
Avec la chute du mur de Berlin en 1989, le totalitarisme n'a certainement pas été vaincu. Au contraire, il a pris une autre forme - d'apparence conservatrice - et s'est emparé de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Les plaidoyers de néoconservateurs de premier plan comme Norman Podhoretz et William Kristol en faveur du Parti républicain, le rejet des politiques du président Obama et l'infiltration de l'appareil de pouvoir autour du président Trump montrent clairement que les néoconservateurs veulent réintégrer le gouvernement américain. Après tout, leur objectif final reste une attaque contre l'Iran et la domination mondiale des États-Unis. La lutte pour notre liberté sera donc longue !
Références :
ABRAMS (N.), Norman Podhoretz and Commentary Magazine : The Rise and Fall of the Neocons, New York, Continuum, 2010, pp. VII + 367.
BALINT (B.), Running Commentary : The Contentious Magazine That Transformed The Jewish Left Into The Neoconservative Right, New York, Public Affairs, 2010, pp. 304.
BRZEZINSKI (Z.), The Grand Chessboard : American Primacy and its Geostrategic Imperatives, New York, Basic Books, 1997, pp. 240.
DRURY (S.), Leo Strauss and the American Right, Londres, Palgrave Macmillan, 1999, p. 256.
EASTON (N.), Gang of Five, New York, Simon & Schuster, 2002, pp. 464.
GREEN (K.), Jew and Philosopher - The Return to Maimonides in the Jewish Thought of Leo Strauss, Albany, State University of New York Press, 1993, pp. XIV + 278.
HOEVELER (D.), Watch on the right : conservative intellectuals in the Reagan era, Madison, University of Wisconsin Press, 1991, pp. XIII + 333.
JEFFERS (T.), Norman Podhoretz : A Biography, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 418.
MEARSHEIMER (J.) et WALT (S.), The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2007, pp. 496.
SAUNDERS (F.), The Cultural Cold War, New York, New Press, 1999, p. 419.
WALD (A.), The New York Intellectuals : The Rise and Decline of the Anti-Stalinist Left from the 1930s to the 1980s, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1987, pp. 456.
WEDEL (J.), Shadow Elite : How the World's New Power Brokers Undermine Democracy, Government and the Free Market, New York, Basic Books, 2009, pp. 283.
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/07/30/les-racines-trotskistes-du-neoconservatisme.html