jeudi 31 août 2023
Napoléomania – Sortie du nouvel ouvrage de Thierry Lentz

C’est un album juste titré « Napoléon ». Son texte a été confié à Thierry Lentz, le meilleur connaisseur (en France) de la période, le digne successeur de Jean Tulard et dans le même esprit.
L’articulation de l’ouvrage est excellente. Dans l’ordre chronologique, sept tranches de vie :
– L’enfant du XVIIIème siècle.
– Le général politique.
– Le dictateur de Salut public.
– Le successeur de Charlemagne.
– Le Conquérant.
– L’empereur de l’ordre.
– Le vaincu.
La huitième partie est consacrée à la légende napoléonienne avec une part belle faite au cinéma.
Le récit de Lentz, voulu pédagogique, ne néglige pas pour autant l’analyse, la réflexion. Sur cette vie que Napoléon lui-même qualifiait de romanesque il ouvre des pistes très justes que les plus tatillons des spécialistes auront du mal à contester.
Le choix iconographique va du très connu au plus rare. Il est sommairement légendé. Ce qui est tout de même préjudiciable car Napoléon est autant une légende qu’une figure historique. Un seul exemple : la campagne de France en 1814. C’est au peintre « pompier » Meissonier que nous devons son inscription dans la mémoire nationale. Sa toile (musée d’Orsay) est un chef d’œuvre du genre mais il est fictif, recomposé, Il fallait le dire et aussi pour beaucoup d’autres. Cette réserve faite, on courra s’offrir et offrir ce « Napoléon » grand format.
Jean Heurtin
Thierry Lentz est directeur de la Fondation Napoléon et enseigne au Celsa (Paris IV-Sorbonne). Lauréat de l’Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques, prix Paul-Michel Perret, 1993) et Grand Prix de la Fondation Napoléon 1997. Il est également membre de l’Académie Nationale de Metz.
Il a notamment l’auteur de : Dictionnaire Napoléon (Fayard), La France et l’Europe de Napoléon (Fayard), Napoléon, PUF, coll. « Que sais-je ? », Le Sacre de Napoléon, dir., Nouveau Monde Editions, Napoléon et l’Europe, dir., Fayard, Napoléon, l’esclavage et les colonies, Fayard, etc. Il est également secrétaire général du Comité pour l’édition de la Correspondance de Napoléon..
Sur un texte clair et séduisant, retraçant en chapitres thématiques les différents traits de la personne et de l’action de Napoléon, de sa naissance à sa mort, ont été réunies et mises en page de façon superbe une centaine d’illustrations, aussi bien les incontournables que d’autres plus rares. Une place particulière est réservée aux portraits permettant d’offrir en contrepoint du texte une biographie par l’image innovante et spectaculaire. Cette alliance réussie donne toute la mesure du destin le plus extraordinaire de notre histoire, et de celle de l’Europe. Cet ouvrage de prestige est, par sa qualité intellectuelle et artistique, sans équivalent.
* Thierry Lentz, Napoléon, Perrin, 35,00 euros
Photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2015, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine.
https://www.breizh-info.com/2015/11/14/34090/napoleomania/https://www.breizh-info.com/2015/11/14/34090/napoleomania/
Une philippique contre les “assassins de l'histoire”
Un rapport de Luc Nannens
Le débat ouest-allemand récent, baptisé “querelle des historiens”, a fait la une de tous les quotidiens et hebdomadaires de RFA. Il y a d'un côté, ceux qui veulent accentuer encore la culpabilité allemande, ressasser sans cesse les mythèmes culpabilisateurs, les ériger au rang de vérités historiques intangibles. Leur méthode : l'anathème et l'injure. Cet exercice n'a pas plu à quelques historiens célèbres dans le monde entier, porte-paroles de leurs confrères : Ernst Nolte, Andreas Hillgruber et Michael Stürmer. Peu suspects de sympathies à l'endroit du nazisme, ils ont formé le camp adverse des nouveaux inquisiteurs, ceux qui s'auto-proclament “anti-fascistes”. Ils n'ont pas accepté la nouvelle mise au pas, le galvaudage éhonté de leur discipline déjà si malmenée par l'idéologie ambiante, celle de la grande lessive des mémoires. Rolf Kosiek nous a dressé un bilan clair de cette affaire qui annonce une prochaine grande révolte des mémoires contre les escrocs idéologiques, les nouveaux prêtres hurleurs qui veulent domestiquer, asservir et détruire l'indépendance d'esprit et la sérénité européennes, la vieille et pondérée éthique de Thucydide. Son bilan porte le titre de : Rolf Kosiek, Historikerstreit und Geschichtsrevision, Grabert-Verlag, Tübingen, 1987.
La querelle des historiens, écrit Rolf Kosiek, est révélatrice de l'absence de liberté que subissaient les historiens dans les décennies écoulées mais, point positif, elle indique aussi que les choses sont en train de bouger et que les sciences historiques vont enfin pouvoir entrer dans une époque “normalisée” et se dégager des carcans officiels. Les historiens agressés, jadis, entraient automatiquement dans un purgatoire et sombraient dans un oubli catastrophique, résultat de la conspiration du silence. Désormais, ils se rebiffent et font face. Apparaissent dès lors les premières fissures dans l'édifice érigé artificiellement pour les besoins a posteriori de la cause alliée, même si des masses d'archives sont encore inaccessibles et si des rumeurs courent qui disent que les documents entreposés à Londres sont délibérément falsifiés, de façon à ne pas porter ombrage au Royaume-Uni quand ils seront enfin à la disposition des historiens.
L'Allemagne de l'Ouest a connu 5 cas de mise au pas d'historiens actifs dans l'enseignement : l'affaire du Prof. Dr. Peter R. Hofstätter en 1963, l'affaire Stielau (qui contestait l'authenticité du Journal d'Anne Frank) en 1959, l'affaire Walendy en 1965, l'affaire Diwald en 1978 (deux pages jugées litigieuses dans un livre de 764 pages, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires !), l'affaire Stäglich où l'accusé s'est vu non seulement condamné mais dépouillé de son titre de docteur en droit en vertu d'une loi imposée sous Hitler en 1939 ! Si toutes ces affaires concernaient des mises en doute directes de la façon dont l'idéologie dominante présente les rapports tragiques entre Allemands et Juifs pendant la parenthèse hitlérienne, la querelle actuelle ne se base pas du tout sur des arguments relatifs à cette douloureuse question.
D'où Kosiek distingue deux types de révisionnisme historique : le révisionnisme proprement dit, vivace dans la sphère anglo-saxonne et porté par des célébrités comme B.H. Liddell-Hart, P.H. Nicoll, C.C. Transill, H.E. Barnes, qui, tous, nient la culpabilité exclusive de l'Allemagne dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nier l'exclusivité de la culpabilité, ce n'est pas nier toute culpabilité mais cette nuance, qu'acceptera tout esprit doté de bon sens, est déjà sacrilège pour les néo-inquisiteurs. Ensuite, un révisionnisme plus marginal, et surtout plus spécialisé, qui n'aborde que les questions propres aux rapports germano-juifs.
Une volonté populaire diffuse de retour à l'histoire et de réappropriation d'identité
Une sourde hostilité couvait depuis une bonne décennie contre l'arrogance inquisitoriale : en 1976, le Président de la RFA, Walter Scheel, avait déclaré en public, devant un congrès d'historiens, que l'Allemagne de l'Ouest ne pouvait nullement devenir un pays purgé de toute histoire. En 1977, les historiens hessois protestèrent vivement contre le projet du Ministère de leur Land [région] visant à supprimer purement et simplement la matière histoire dans les Gymnasium [lycées]. L'exposition consacrée aux Staufer à Stuttgart en 1977 permet à plusieurs hommes politiques en vue de réitérer leur volonté de sauver l'histoire des griffes de ceux qui veulent systématiquement l'éradiquer. À partir de 1980, on assiste à une véritable offensive de retour à l'histoire et à une volonté très nette de se reconstituer une identité qui avait été provisoirement occultée ; l'exposition sur la Prusse à Berlin en 1981 a montré que les milieux de gauche, eux aussi, souhaitaient renouer avec l'histoire de leur pays (cf. Alain de Benoist, Gérard Nances & Robert Steuckers, « Idée prussienne, destin allemand », in Nouvelle École n°37, 1982).
Les historiens, bénéficiant de cet engouement populaire pour l'identité nationale, vont s'enhardir et amorcer un processus d'émancipation. Helmut Rumpf, juriste et politologue de notoriété internationale, disciple de Carl Schmitt, rappelle, dans un article de la prestigieuse revue Der Staat (Berlin) un ouvrage capital de 1961, assassiné par la conspiration du silence : Der erzwungene Krieg (La guerre forcée) de l'Américain David L. Hoggan. Ce livre, épais de 936 pages, démontrait la culpabilité britannique, notamment celle de Lord Halifax, sur base de documents polonais, jamais étudiés à l'Ouest (sur Hoggan, cf. Orientations n°6).
La légende de l'incendie du Reichstag par les nazis fut, dans la foulée, réfutée par l'historien Fritz Tobias, membre de la SPD ; Tobias avait entamé son enquête dès 1959 mais les inquisiteurs avaient jugé que sa thèse était « inopportune sur le plan de la pédagogie populaire » (!?). Il fallut attendre 1986 pour qu'elle soit admise, sans pour autant être diffusée. L'historien suisse-alémanique Wolfgang Hänel put démontrer que les affirmations de Hermann Rauschning, consignées dans le fameux Hitler m'a dit, sont absolument fausses pour la simple raison que l'auteur n'a jamais rencontré Hitler plus de 4 fois et, en ces occasions, n'était pas seul. Le Prof. Alfred Schickel, directeur de l'Institut d'Histoire Contemporaine d'Ingolstadt, put prouver que les officiers polonais prisonniers en Allemagne organisaient des “universités de camp”. Ce fait, incompatible avec l'image qu'on s'est fait des relations germano-polonaises, fut d'abord nié par les historiens officiels, jusqu'au jour où plusieurs officiers polonais sont venus personnellement témoigner, preuves à l'appui !
Nolte contre Habermas : la “querelle des historiens” commence !
C'est avec un tel arrière-plan qu'a commencé la “querelle des historiens” proprement dite, en 1986. Ernst Nolte, célèbre sur le plan international pour ses études sur l'origine des fascismes, a déclenché la polémique en écrivant, en substance, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), le 6 juin 1986, que “l'asiatisme” national-socialiste, exprimé par la terreur policière, les camps et les massacres, n'est pas unique ni originelle mais a été précédée par “l'asiatisme” bolchévique. L'approche de Nolte était dans la droite ligne de ses options libérales : il ne niait pas les massacres et les crimes nationaux-socialistes mais refusait, par souci éthique, de justifier les massacres subis par ses compatriotes par les massacres qu'ils auraient commis ou non. Cette volonté de relativiser les faits, de les restituer à leur juste mesure et de les dépouiller de tous adstrats passionnels, constitue une démarche scientifique et objective, telle que tout historien sérieux se doit de poser. Les professionnels du culpabilisme ont réagi immédiatement, d'abord par des lettres de lecteurs à la FAZ, reprochant à Nolte de minimiser, par comparaison avec la terreur stalinienne, les actes du régime nazi. Wolfgang Schuller, professeur d'histoire à Constance, fut le premier à prendre parti pour Nolte, en écrivant : « Si l'on n'est plus autorisé qu'à écrire des choses négatives (à l'endroit de l'histoire allemande de ce siècle, ndlr), si plus aucun lien causal, plus aucune causalité ne peut plus être évoqués, alors nous avons une sorte d'historiographie courtisane inversée ».
J. Habermas, qui n'en rate pas une, saisira l'occasion pour se donner de la publicité, en mitonnant un article farci de vitupérations et de fulminations hautes en couleur, en traînant Nolte dans la boue, avec 3 autres de ses collègues, Andreas Hillgruber, Klaus Hildebrand et Michael Stürmer. Pariant sur l'ignorance des masses, sachant que les médias conformistes lui donneront une publicité imméritée, Habermas recourt sans vergogne à l'injure, au tronquage des citations et au langage propagandiste, sans pour autant éviter les contradictions : ainsi, il reproche à Stürmer de fabriquer une « philosophie otanesque » (Natophilosophie), assortie de « tamtam géopoliticien », propre à une « idéologie du milieu » (Ideologie der Mitte) qui met en danger les liens de l'Allemagne avec l'Ouest, matrice des sacro-saintes “Lumières” ! La réponse moqueuse des agressés n'a pas tardé : se posant comme leur avocat, Günter Zehm se gausse du philosophe-sociologue libéral-gauchiste en faisant appel à ses propres théories ; en effet, Habermas, voulant ancrer sa démarche dans l'héritage rationaliste, hégélien et marxiste, a toujours opté pour les faits objectifs contre les travestissements métaphysiques, les engouements romantiques, les mythes mobilisateurs de type sorélo-fasciste ou völkisch-hitlérien ; dans la querelle des historiens, toutes ses belles intentions, il les jette par-dessus bord, comme des ordures de cuisine par-dessus le bastingage d'un paquebot transatlantique : contre les faits mis en exergue par les historiens, le grand prêtre de la sociologie francfortiste évoque, trémolos feints dans la voix, la « malédiction éternelle » qui pèse sur le peuple allemand (et qu'il s'agit de ne pas égratigner) et la « faute incomparable » que les générations post-hitlériennes, faites de bons gros touristes roses et gourmands, doivent continuer à traîner comme un boulet de forçat.
L'hystérie habermassienne contre la science historique
Ces gamineries hystériques n'ont pourtant été que le hors-d'œuvre, les zakouskis du maître-queue Habermas. Rudolf Augstein, rédac'chef du Spiegel, prend le relais avec le gros sel : Hillgruber, selon le brave homme, nierait Auschwitz et serait “un nazi constitutionnel”. Janßen et Sontheimer, autres para-habermassiens, écrivent, sans rire et avec quelques circonlocutions, que les résultats de toute enquête historique doivent correspondre à des critères de « pédagogie populaire » et renforcer la « conscience Aufklärung ». Tout autre résultat est malvenu et doit donc être tu, occulté, dénoncé. Le nazisme est unique, singulier et au-dessus de toute comparaison, avancent Kocka, Bracher et Winkler, impavides devant le ridicule, puisque toute science historique est par définition comparative, comme le sait tout étudiant de première année.
Winkler, qui avait bâti jadis quelques belles théories sur la particularité allemande par rapport à l'Ouest, estime brusquement que le nazisme ne peut être comparé avec l'URSS stalinienne ou le Cambodge de Pol Pot, terres asiatiques, mais exclusivement avec l'Ouest et ses normes puisque l'Allemagne est un morceau d'Occident. Après ces raisonnements spécieux : coucou ! Qui réapparaît donc comme un diablotin d'une boîte ? Habermas ! L'homme prend des poses de Iavhé biblique et en imite le courroux : la faute des Allemands se transmettra de générations en générations ad infinitum (cf. Die Zeit, 7-XI-86). On ne voit plus où est l'histoire. On voit au contraire comment se modernisent les anathèmes théologiques.
Ces excès ont eu pour résultat de mobiliser une phalange d'historiens agacés parmi lesquels Joachim Fest, qui, en défendant Nolte, s'insurge contre les simplismes ânonnés à propos du national-socialisme par les adeptes des Lumières qui, derrière un discours rationaliste-utopique sur la liberté, asseyent sans scrupules leur propre mandarinat. Thomas Nipperdey attaque directement la méthode de Habermas : le passé y est dénoncé, puis, au nom du principe tout-puissant de l'émancipation, politisé et moralisé, mieux, hyper-moralisé ; de cette manière seulement, la voie est libre pour le monopole futur des utopies, des “constructions” artificielles, détachées de toute continuité historique.
Un passé moralisé détruit ipso facto l'histoire réelle, pour installer des schémas désincarnés dans lesquels les peuples ne retrouvent pas leurs aspirations. C'est pourquoi il faut historiciser le national-socialisme, afin de ne pas renoncer au réel et de ne pas confisquer aux Allemands le droit de construire une démocratie conforme aux rythmes de leur histoire. Pour le bien de la science, on ne peut interdire aux chercheurs de s'interroger et de solliciter témoignages et documents. Nolte renchérit : il faut éviter que ne s'installe une situation où le passé national-socialiste est érigé en un mythe négatif, indicateur du mal absolu, qui empêche toute révision pertinente et s'avère ennemi de la science.
Hildebrand rejette les arguments passionnels de Habermas en démontrant que les thèses que ce dernier incrimine ne sont nullement neuves mais ont déjà été débattues en Allemagne et à l'étranger depuis longtemps. L'assassinat des Juifs, écrit-il dans Die Welt (22-XI-86), est sans doute “singulier” dans une perspective universelle mais demeure néanmoins inscrit dans une chaîne d'événements tout aussi tragiques de notre siècle ; cet événement “génocidaire” a eu des précédents et des imitations : le génocide des Arméniens, la liquidation de millions de paysans propriétaires russes, les koulaks, l'élimination et les déportations de peuples entiers sous le joug de Staline, les exterminations du “communisme paléolithique” cambodgien.
Procéder à une comparaison entre ces horreurs historiques est légitime pour l'historien, dont la tâche est d'en dégager les constantes et d'en comprendre les motivations, aussi répréhensibles soient-elles sur le plan moral. Spécialiste des crimes perpétrés contre les Allemands au cours des expulsions de 1945-46, l'historien américain Alfred de Zayas, en prenant position dans Die Welt (13-XII-86), explique que le processus de “démythologisation” du nazisme est en cours aux États-Unis et en Angleterre depuis longtemps et exhorte les Allemands à s'intéresser à ces travaux en dépit des hurlements du mandarinat établi ; selon de Zayas, la thèse de “l'unicité” de la faute nazie est inepte et les Allemands ne doivent pas se laisser hypnotiser ou paralyser par Auschwitz, car, pendant la seconde guerre mondiale, il n'y a pas eu de “monopole de la souffrance”.
Les 5 questions-clefs du débat
Au-delà de la polémique, Kosiek dégage les principaux points de discorde entre les historiens :
- 1) La démarche de révision est-elle ou non la norme de la scientificité historique ?
- 2) Le IIIe Reich revêt-il un caractère d'unicité ?
- 3) L'époque du IIIe Reich doit-elle être historicisée, c'est-à-dire doit-elle être soumise aux mêmes critères d'investigation historiques que n'importe quelle autre segment de l'histoire ?
- 4) Le problème du calcul du nombre de victimes doit-il être abordé ?
- 5) Convient-il ou ne convient-il pas d'étendre la notion de “faute collective” aux générations post-hitlériennes et, si oui, jusqu'à quelle génération ?
Au-delà de ces 5 questions d'ordre éthique et philosophique, qui ne sont pas du ressort direct de l'historien mais concernent immédiatement sa liberté de travail, l'histoire contemporaine, si elle veut quitter certaines impasses, doit aborder des terrains laissés jusqu'ici en jachère, terrains inexplorés à cause de la terreur intellectuelle exercée par le mandarinat. Seules des réponses allant dans un sens résolument non-habermassien aux 5 questions ci-dessus, permettront aux historiens d'aborder des domaines inexplorés (ou explorés seulement dans une marginalité éditoriale non médiatisée), comme, par ex., les exterminations staliniennes et leurs incidences sur l'histoire de l'Europe orientale, la question de savoir si la guerre déclenchée par Hitler contre l'URSS a été préventive ou non, les problèmes de l'expulsion des Allemands de Silésie, de Poméranie, de Prusse orientale et du Territoire des Sudètes.
Une demande générale se fait jour qui comprend l'étude historique et scientifique de ces événements, un débat public, franc et ouvert, sur ces questions. Y répondre clairement, sans a priori idéologique, avec sérénité, signifierait que l'histoire n'est pas une science morte. Ne pas y répondre, persister dans l'occultation de pans entiers de l'histoire européenne, signifierait au contraire que l'histoire est morte, et avec elle la liberté, et que se sont réalisées les pires appréhensions d'Orwell concernant la manipulation du passé dans des buts de manipulation politique. Un habermassien sincère, soucieux de transparence, de dialogue et de publicité, hostile aux mécanismes mis en scène par l'imagination romanesque d'Orwell dans 1984, devra nécessairement prendre la parti des Nolte, Hildebrand, Stürmer, etc., malgré les dérapages, divagations et éructations récentes de son maître-à-penser.
Dix conclusions
Quelles conclusions tirer de tout cela ? Pour Kosiek, il convient de dégager 10 leçons de cet événement :
- 1) Pour la première fois, toute une brochette d'historiens établis réclame une révision des schémas historiques et un abandon franc des simplismes en vogue.
- 2) Le scandale déclenché par Habermas a montré l'inanité intellectuelle des dits schémas et induit bon nombre d'historiens à relire les livres oubliés de certains "révisionnistes" anglo-saxons, dont Hoggan. Une modification ad hoc des manuels scolaires devrait suivre...
- 3) Le scandale doit nécessairement déboucher sur une liberté de recherche et il doit être accordé aux historiens le plein droit au débat pour toutes questions. Les peines prévues par le code pénal pour ceux qui enfreindraient le prêt-à-penser doivent être abrogées, au nom de la liberté de recherche.
- 4) Le processus d'historicisation du national-socialisme est enclenché, volens nolens. La chape de moralisme stérilisant s'effrite pour faire place à une histoire objective.
- 5) Le délicat problème du calcul arithmétique des victimes fait une entrée discrète sur la scène universitaire.
- 6) Des domaines délaissés de l'histoire (cf. supra) vont enfin être abordés et des angles d'approche négligés, comme la géopolitique, sont en passe d'être réhabilités.
- 7) Grâce à la querelle des historiens, les camps se sont formés et les clivages clarifiés. Le refus des méthodes anti-scientifiques s'est étoffé.
- 8) Le débat s'est déroulé dans les grands journaux, ce qui a permis à de larges strates de la population de prendre acte des enjeux.
- 9) Les historiens attaqués sauvagement par les inquisiteurs n'ont rien à voir avec la mouvance dite “néo-nazie” et n'appartiennent même pas à un secteur ou l'autre du clan nationaliste ou conservateur. Preuve que les inquisiteurs ne respectent aucune nuance et n'hésitent pas à utiliser la stratégie inféconde de l'amalgame.
- 10) Ces historiens modérés, auxquels aucune insulte et bassesse n'ont été épargnées, devront désormais faire montre de solidarité à l'égard de collègues moins en vue et en proie aux attaques des nervis inquisitoriaux habituels ; ils ne pourront plus honnêtement se satisfaire de la politique de l'autruche.
Luc Nannens, Orientations n°10, 1988.
Littérature complémentaire :
- Hans-Christof Kraus, « Wissenschaft gegen Vergangenheitsbewältigung : Eine Bilanz des Historikerstreits », in Criticón n°99, 1987.
- Criticón n°104, consacré à la "querelle des historiens". Textes de H.-Chr. Kraus, Dietrich Aigner, Alfred de Zayas et Armin Mohler (où le célèbre explorateur de la Konservative Revolution démontre que Nolte, avant les incidents de l'automne 1986, avait "cimenté" quelques simplismes et fétiches historiques).
« Ma blessure de guerre invisible » de Sylvain Favière

Sylvain Favière
Sylvain Favière, simple infirmier militaire en Afghanistan en 2008, raconte son expérience. Il nous livre tout sur cette partie de sa vie. L’Afghanistan, ce n’est pas que 6 mois mais plusieurs mois de préparation loin de sa famille. Sylvain nous raconte ses rencontres avec les habitants afghans, leurs habitudes, leurs coutumes totalement différentes des nôtres. Il tisse des liens même s’il doit apprendre à se méfier car même des enfants se font exploser. La vie est parfois précaire mais chaque militaire apprend à être solidaire de l’autre.
Sylvain devient un combattant aguerri tandis qu’il apprend à ses camarades à faire une perfusion au cas où, lui-même est touché. Au téléphone, il échange de simples banalités avec sa femme et lui cache tout ce qu’il vit pour ne pas l’effrayer plus. Son quotidien c’est la fatigue, la peur, l’angoisse, la peur de mourir. Le 18 juin, il se trouve dans un convoi motorisé. Un IED (engin explosif improvisé qui peut être déclenché à distance) explose sous un des véhicules dans lequel il aurait dû se trouver. Il y aura des victimes et il ne pourra pas intervenir. Il évoque aussi la colère surtout après la fameuse embuscade d’Uzbin. Il avoue avoir eû envie d’aller tuer un taliban pour se venger de la mort de ses frères d’armes.
Quand il rentre chez lui, il découvre qu’il a changé. D’abord, il se sent en décalage par rapport à sa famille. Il a raté des événements et ne comprend pas tout. Surtout il rencontre de l’incompréhension et un désintérêt. Il a besoin de parler mais personne ne l’écoute. Alors il s’isole et mène une vie monotone. C’est alors qu’apparaissent les premiers signes d’irritabilité. Il y a cette tentation d’adapter la vie militaire à la maison après avoir vécu 24h/24 avec des règles strictes. Il se met en colère mais peut se calmer tout aussi vite. S’ajoute à cela une hypersensibilité. La moindre chose peut l’émouvoir au point de pleurer. Surtout il rêve de l’Afghanistan. Il se voit frapper par une balle en plein gilet pare-balles avant de se réveiller. Pour ne pas tomber dans l’alcool et la drogue, il se met à travailler de manière intensive. Il fait lui-même le constat : il a changé. Il fait vivre un enfer à sa famille. Sa femme lui demande de se reprendre. Il reconnait qu’il est malade et décide de consulter un médecin. Aujourd’hui il se déclare ni malade ni guéri. C’est un autre homme qui est revenu d’Afghanistan avec une blessure indélébile. Il a vécu l’écriture de ce livre comme une thérapie. Il espère sensibiliser l’opinion publique à cette maladie qu’est le stress post traumatique aujourd’hui reconnu comme blessure de guerre mais aussi aider ses camarades qui en souffriraient car il y a un long chemin avant de reconnaitre cette maladie invisible.
Le livre est sorti en janvier 2013. Témoignage simple, édifiant et émouvant, il nous fait découvrir un nouvel aspect de la guerre en Afghanistan. Il ne s’épanche pas sur ce qu’il a vécu mais entend témoigner pour les autres. Cependant il revient souvent sur ce manque de reconnaissance de la population et des médias vis-à-vis de l’armée française en Afghanistan. Il est revenu à la vie civile mais il ne regrette rien de ces moments passés à l’armée.
Vous êtes militaires, femmes de militaires ou vous avez un proche militaire, ce livre s’adresse à vous !
Le livre est disponible aux éditions Esprit Com’ : http://www.esprit-com.net/
Le prix est de 12 euros
La totalité des droits d’auteurs est reversé à la CABAT (Cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre)
https://www.medias-presse.info/ma-blessure-de-guerre-invisible-de-sylvain-faviere/791/
mercredi 30 août 2023
Rome face aux barbares, par Umberto Roberto
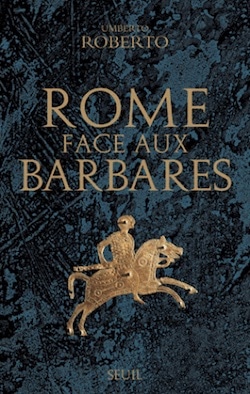
Les Editions du Seuil publient le 10 septembre prochain le nouvel ouvrage d’Umberto Roberto intitulé « Rome Face aux Barbares ». Cet historien, est professeur émérite depuis 2008 et titulaire de la chaire de sémiotique et directeur de l’École supérieure des sciences humaines de Bologne.
Dans les derniers siècles de l’empire romain d’Occident, Rome fut à plusieurs reprises saccagée par les barbares. Le plus célèbre de ces événements reste le sac de l’Urbs en 410 par les Goths d’Alaric mais il y en eut d’autres : par des Vandales venus de Carthage, par les barbares du général Ricimer et du chef ostrogoth Totila qui faillit bien raser la Ville. Fondé sur une relecture serrée des sources et sur les dernières trouvailles de l’archéologie, ce livre retrace cette succession d’assauts et les moyens mis en oeuvre par les Romains pour y faire face et en réparer les blessures.
Il brosse un vivant tableau des dernières décennies de la Rome impériale, des batailles, trahisons et retournements d’alliance, tandis que grandit l’influence de l’Eglise chrétienne et qu’à l’arrière-plan s’effondrent les provinces de l’Empire partagées entre les royaumes barbares. De ces assauts, la Ville conserva longtemps la mémoire traumatique, qui se réveilla encore quand les armées impériales de Charles Quint l’assiégèrent une nouvelle fois en 1527.
Se démarquant à la fois du cliché de la “décadence” romaine et des lectures qui gomment la violence des événements, Umberto Roberto signe là un ouvrage captivant. Un prologue consacré au sac de Brennus en 386 av. J.-C., avec le célèbre épisode des Oies du Capitole, et un dernier chapitre, qui retrace le sac de 1527, encadrent le récit principal.
Rédigé comme une fresque chronologique et narrative, l’ouvrage se lit de façon très rapide et captivante. A noter qu’outre les 290 pages du livre en lui même, de nombreuses notes explicatives sont rédigées en fin de livre ainsi qu’une bibliographie particulièrement fournie. Le lecteur découvrira également avec plaisir un petit carnet photo au centre du livre, illustrant des pans de l’histoire romaine.
Ce livre – à la superbe couverture – retrace l’histoire d’un Empire et d’une cité en proie aux attaques nombreuses, violentes, sanglantes. Un Empire qui finira par s’écrouler, rongé de l’intérieur, non sans avoir duré grâce à une volonté de fer.
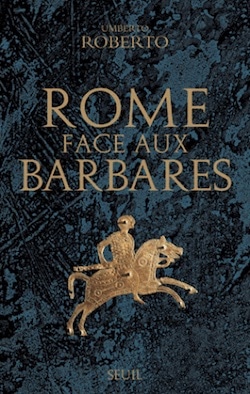
Rome face aux Barbares – Umberto Roberto – Le Seuil – 24€
Photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2015, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine
https://www.breizh-info.com/2015/09/12/30945/rome-face-aux-barbares-par-umberto-roberto/
Lire et discuter Clausewitz. Penser la guerre

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.
Certains observateurs ont pu penser, avec la fin de la guerre froide et de l’Union soviétique en 1991, que la guerre cesserait d’être un problème majeur, du moins pour l’Europe. Certes, des conflits subsisteraient (on le verra : Mali, Syrie, Afghanistan…), mais loin de chez nous, et de faibles conséquences pour nous. C’était le rêve d’un monde apaisé. Du moins pour les pays ayant la chance d’avoir des dirigeants issus du « cercle de la raison ». C’est-à-dire des libéraux partisans de la poursuite et de l’accélération de la mondialisation. En avant vers un monde de plus en plus uniforme et de plus en plus lisse, malgré quelques accros inévitables. Telle était la perspective.
On peut se demander si l’erreur n’était pas totale. En d’autres termes, est-ce que la guerre froide n’était pas précisément ce qui empêchait les guerres chaudes ? La guerre d’Ukraine déclenchée en 2022 montre que l’Europe n’est pas préservée des guerres. Du reste, nous avons vite oublié les guerres de Yougoslavie et les bombardements de l’OTAN sur la Serbie, une action assimilée trop rapidement à une simple correction administrée à un pays complaisant envers des nationalistes « d’un autre âge ». On connaît la formule qui est clamée par la caste dirigeante, face à tous les rebelles à un nouvel ordre mondial à la fois géopolitique et moral : « Nous ne sommes plus au Moyen Âge ! » Ce qui veut dire : « Vous avez tort de croire à l’existence de constantes anthropologiques. »
Et pourtant. Chassez le réel, il revient au galop. Voilà donc que la guerre revient, en Ukraine, et que ses conséquences économiques – au détriment de l’Europe – nous rendent cette réalité plus sensible que jamais. Mais depuis 2015 (attentats Charlie Hebdo, Bataclan, puis Nice, etc.), voilà que la guerre a pris des formes nouvelles, extra-étatiques. C’est la guerre des partisans, c’est le terrorisme, c’est aussi la guerre informationnelle, technologique, industrielle. Ce sont des guerres pas toujours déclarées mais néanmoins bien réelles. Un camp veut en affaiblir un autre et le mettre à genoux. Par tous les moyens, même légaux, la production de lois, par exemple dans le domaine international, étant aussi une forme de guerre. Exemple : la guerre, ou au moins les sanctions, contre un pays « non démocratique », non « LGBT friendly », etc.
Nous redécouvrons une constante de l’histoire des peuples et des civilisations : le monde est conflictuel. Comment avons-nous pu l’oublier ? Comment nos gouvernants peuvent-ils encore rester aveugles à cette évidence ? Comment les entretiens de Macron sur la politique étrangère (par exemple sur le site Le grand continent) peuvent-ils être aussi désolants par leur insignifiance et ses actes aussi consternants ou contre-productifs ? À moins que les discours à la fois lénifiants et inquiétants soient encore un moyen de mener une guerre contre les peuples pour leur cacher qu’il y a bien un projet oligarchique de gouvernance mondiale – projet parfaitement assumé et conforme à une idéologie que l’on peut contester, mais dont la cohérence est réelle d’un point de vue universaliste – et qu’il n’y a pas qu’une seule politique internationale possible.
La « Formule » de Clausewitz
Le spectre de la guerre plane donc sur les Européens. Un foyer de guerre peut toujours s’étendre. Une guerre localisée n’est jamais assurée de le rester. C’est le moment de réfléchir à nouveau à ce que Clausewitz nous a dit de la guerre. Il faut tout d’abord ne pas se méprendre sur le projet de Clausewitz (1780-1831). Il ne fournit pas une « doctrine pour gagner les guerres ». Pas même celles de son temps. Clausewitz fournit une série de leçons d’observations. Ce n’est pas la même chose. Des leçons pour comprendre des situations diverses. Son objectif est de nous montrer ce qui caractérise un conflit guerrier par rapport à d’autres phénomènes socio-historiques. Qu’est-ce que la guerre a de spécifique dans les activités humaines ? Comment connaître la guerre et qu’y a-t-il à connaître dans la guerre ? Il s’agit donc, par-delà la diversité des guerres, de déterminer ce qu’il y a de commun à toutes les guerres. C’est une entreprise aussi capitale que de chercher à connaître quelle est l’essence de l’économique, ou l’essence du politique.
Une grande partie des discussions tournent autour de ce que Raymond Aron a appelé la « Formule » de Clausewitz : « La guerre est une simple continuation de la politique par d’autres moyens. » Considérée comme trop brutale par certains politologues, ceux-ci ont proposé soit de l’inverser, soit de la corriger. Au risque de lui enlever toute sa force. Ou de verser dans la pirouette. Et si la question n’était pas d’invalider cette formule, mais de bien la lire, et d’en comprendre toute la force explicative ? La guerre, expression de la politique ? Bien sûr, mais de quelle politique ? La guerre selon Clausewitz est à la fois un outil du politique et une forme du politique. Une continuation de la politique par d’autres moyens. Un outil et une nouvelle tunique. Du reste, doit-on comprendre la Formule : « par d’autres moyens [que les moyens politiques] » ? Ou « par d’autres moyens [que les moyens de la paix] » ? De là une question : tous les moyens non directement politiques de faire évoluer un rapport de forces relèvent-ils de la guerre ? Même question pour tous les moyens non directement pacifiques, c’est-à-dire fondés sur une contrainte (financière, morale, etc.), sur la technologie, la mobilisation des masses, la propagande, l’intoxication, la déstabilisation… On voit que la simple définition que donne Clausewitz ouvre déjà à la possibilité de diverses interprétations.
Dès lors, la guerre est-elle le seul affrontement entre deux armées ou est-elle l’ensemble des moyens, diplomatiques, idéologiques, moraux, économiques, destinés à faire plier l’adversaire ? Ainsi, la guerre peut être – version restreinte – la seule confrontation des armées, ou bien – version large – l’ensemble des moyens, militaires ou autres, visant à soumettre l’adversaire à notre volonté et à modifier un rapport de forces en notre faveur. La guerre peut donc être définie selon deux interprétations, l’une restreinte, l’autre élargie. La guerre, c’est : a) seulement quand les armes parlent ; ou bien b) quand l’ensemble des leviers sont mobilisés pour exercer une violence sur l’adversaire et le faire plier, sans que les armées entrent forcément en action. La guerre suppose comme préalable, dans les deux définitions, conflit d’intérêt entre deux puissances, et conscience de ce conflit, au moins par l’un des deux camps, et sentiment d’hostilité même s’il est inégalement partagé. C’est dire que la guerre relève du politique en tant que mode de gestion des conflits.
La guerre comme mode des relations publiques
L’une des difficultés dans la lecture de Clausewitz est justement ceci : bien qu’étant « à la fois stratège et penseur du politique » (Éric Weil), il ne définit pas toujours de manière identique le politique. C’est « l’intelligence de l’État personnifié » (De la guerre, livre I, chap. 1), nous dit Clausewitz. C’est encore ce qui représente « tous les intérêts de la communauté entière » (livre VIII, chap. 6). Ces deux définitions ne s’opposent pas. Comprendre où sont les intérêts pour les défendre : les deux propositions de Clausewitz se complètent. Reformulons cela en termes modernes : le politique, c’est la recherche de l’intérêt de l’État en tant qu’il représente la nation. La guerre est-elle, dès lors, uniquement la résultante du politique comme analyse rationnelle des intérêts de la nation ? Non. C’est la réponse que nous suggère Clausewitz. Il écrit : « La guerre n’est rien d’autre que la continuation des relations publiques, avec l’appoint d’autres moyens » (De la guerre, livre VIII, chap. 6). Cela veut dire que la guerre a toujours une dimension politique, mais ne résulte pas toujours d’un choix politique d’un sujet de l’histoire. La guerre échappe en partie à la dialectique sujet-libre choix-acte (dialectique de Descartes). Elle est une interaction. Elle est un mode des relations publiques. C’est bien pour cela que lorsque l’on étudie l’enchaînement qui mène à une guerre, on ne peut que rarement attribuer l’entière responsabilité d’un conflit à un seul camp. On observe ainsi qu’il y a guerre lorsque les deux protagonistes la veulent. Si un des deux ne fait qu’accepter la guerre (sans quoi, c’est pour lui la capitulation), il y aussi guerre. Mais peut-il y avoir guerre quand aucun des protagonistes ne la veut ? C’est l’hypothèse d’un enchaînement fatal non voulu. Or, Clausewitz envisage les deux cas de figure, la guerre prévue et assumée ; et la guerre qui nous échappe en partie.
Un exemple du Clausewitz rationnel est celui de la « Formule », déjà cité plus haut. Le Clausewitz rationnel est aussi celui qui dit : « L’intention politique est la fin, tandis que la guerre est le moyen, et l’on ne peut concevoir le moyen indépendamment de la fin. » Mais l’irrationnel pointe quand Clausewitz écrit : « Ne commençons pas par une définition de la guerre lourde et pédante ; bornons-nous à son essence, au duel. La guerre n’est rien d’autre qu’un duel à une plus vaste échelle. » En un sens, c’est une deuxième « Formule », autre que « la guerre, continuation de la politique par d’autres moyens ». Deuxième « Formule » qui nous éloigne du rationnel. Chacun sait, en effet, que les duels sont souvent une question d’honneur. Bien plus qu’une question d’intérêt ou de rationalité. Et quand le duel est porté à l’échelle de groupes organisés – en allant du duellum au bellum –, il reste une interaction et une relation. Avec sa part d’irrationnel. « Je ne suis pas mon propre maître, car il [l’adversaire] me dicte sa loi comme le lui dicte la mienne », écrit Clausewitz. Comme le dit Freud de son côté, « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ».
La guerre n’est pas un accident
Ainsi, la guerre est-elle une volonté appliquée à « un objet qui vit et réagit ». Clausewitz résume : « La guerre est une forme des rapports humains. » La preuve du caractère relationnel de la guerre est qu’il faut être deux à recourir à la violence. Si l’un des camps attaqué répond à la violence par la non-violence – comme le Danemark face à l’Allemagne en 1940 –, il n’y a pas guerre (il y a néanmoins occupation du pays et sujétion de celui-ci. Il y a donc défaite de la nation et risque de disparition politique de celle-ci). On peut parfois éviter la guerre, mais si un pays vous désigne comme son ennemi, vous êtes son ennemi, que cela vous plaise ou non. Nous voyons ainsi que Clausewitz pense la rationalité, et espère la rationalité. Mais il envisage la possibilité de l’irrationalité. En fonction des citations, on passera de l’accent mis sur un registre à l’accent mis sur l’autre. Le rationnel précède l’irrationnel pour Clausewitz. Mais il ne le supprime pas.
Nous avons vu plus haut que l’on peut se demander parfois s’il n’y a pas guerre sans qu’elle soit vraiment voulue par les protagonistes. Il faut préciser les choses. La guerre résulte toujours de décisions, celles de l’attaquant, celle de l’attaqué, qui décide (ou pas, nous l’avons vu avec le Danemark de 1940) de se défendre. L’idée de la guerre comme simple enchaînement a ses limites. Dans Les Responsables de la Deuxième Guerre mondiale, Paul Rassinier explique que rien ne prouve que Hitler voulait la guerre en Europe en 1939, car il pensait pouvoir récupérer le couloir de Dantzig sans guerre, contrôler le pétrole roumain sans guerre, voire faire s’effondrer l’Union soviétique sans guerre, etc. Outre que cette thèse apparait très fragile compte tenu de la croyance affichée par Hitler dans les vertus « virilisantes » de la guerre (forme de « concurrence libre et non faussée » entre les peuples), il est bien évident que l’on ne peut arguer de son désir de paix en partant de l’hypothèse que tout le monde se pliera, en capitulant, à ses exigences. Toutefois, le caractère relationnel de la guerre dont parle Clausewitz dans le chapitre 6 du livre VIII De la guerre laisse penser que l’accident – nous voulons dire la guerre comme accident – n’est pas forcément impossible. La relation prend le pas sur les sujets de la relation. Sur la base d’un malentendu, tout peut se dérégler. Mais cela n’empêche pas qu’il y a dans le déclenchement d’une guerre des responsabilités parfaitement identifiables, même si les responsables ont parfois agi ou décidé dans le brouillard d’hypothèses contradictoires ou imprécises. Prenons l’exemple de l’Allemagne impériale en 1914 : on a dit à bon droit que Guillaume II ne voulait pas la guerre. Peut-être. Réalité « psychologique ». Mais l’essentiel est qu’il a quand même décidé de céder aux pressions du grand état-major général, notamment en acceptant d’envahir la Belgique, pourtant disposant d’un statut de neutralité internationale.
Résumons : des accidents peuvent infléchir des décisions, mais une guerre n’intervient pas par accident. Autre exemple, plus brûlant. Imaginons que Poutine ait pensé que suite au déclenchement de l’« Opération spéciale », le gouvernement ukrainien serait immédiatement renversé et négocierait avec la Russie dans un sens favorable aux projets de Poutine, à supposer qu’ils aient été très clairs dans son esprit. Il n’y aurait pas eu de guerre. Certes. Mais ce n’était qu’une hypothèse et de fait, elle ne s’est pas vérifiée : le gouvernement de Zelensky, pour x ou y raisons, ne s’est pas effondré. Poutine a donc pris le risque d’une guerre. Il en est donc responsable. En revanche, il n’en est pas le seul responsable, car il est bel et bien exact que les populations prorusses du Donbass étaient bombardées depuis 2014, et que les accords de Minsk (2014) n’ont pas été appliqués. Derechef. Il y a une part d’accident dans la guerre, mais la guerre n’est pas un accident.
La notion de guerre totale
La définition par Clausewitz de la guerre comme « continuation des relations politiques » est éclairante non seulement par elle-même, par ce qu’elle dit de la nature dialogique de la guerre, mais par ce qu’elle montre de la conception du politique par Clausewitz. Le politique, c’est le commerce entre les États et les nations. Le commerce n’est évidemment pas que le simple commerce des marchandises et de l’argent. C’est aussi le commerce des idées. Le politique, ce sont les relations entre les nations telles que déterminées par les intentions de chacun et par les interactions réciproques. En ce qui concerne la politique dite « intérieure », c’est la même chose, sauf qu’il s’agit des relations entre des groupes sociaux. La guerre est donc bien pour Clausewitz la continuation du politique par d’autres moyens (que les moyens pacifiques). Mais justement, en tant que continuation du politique, elle ne le fait pas disparaître, non plus que les autres moyens du politique. La guerre n’absorbe pas tout le politique. « Nous disons que ces nouveaux moyens s’y ajoutent [aux moyens pacifiques] pour affirmer du même coup que la guerre elle-même ne fait pas cesser ces relations politiques, qu’elle ne les transforme pas en quelque chose de tout à fait différent, mais que celles-ci continuent à exister dans leur essence, quels que soient les moyens dont elles se servent. » C’est pourquoi la guerre n’exclut pas de mener en parallèle des négociations. « On livre bataille au lieu d’envoyer des notes mais on continue d’envoyer des notes ou l’équivalent de notes alors même que l’on livre bataille », écrit Raymond Aron (Penser la guerre, Clausewitz, tome 1, Gallimard, 1989, p. 180). La notion de guerre totale (Erich Ludendorff, 1916) exprime justement cette idée que la guerre, c’est plus que la violence armée. C’est la mobilisation de tout, y compris des imaginaires (idéalisation de soi, diabolisation de l’ennemi). C’est la mobilisation de tout le peuple, y compris les vieillards et les enfants. Si l’Allemagne nazie augmente le montant des retraites de ses citoyens en 1944, ce n’est pas parce qu’elle sous-estime la priorité du militaire, c’est parce qu’elle pense que l’arrière doit tenir pour que le front ne s’effondre pas. Mobilisation de tout et de tous : c’est pourquoi la stratégie n’est pas un concept étroitement militaire, mais est la conduite de tous les aspects économiques, démographiques, politiques, technologiques qui peuvent conduite à la victoire, comme l’explique le général André Beaufre (Introduction à la stratégie, Pluriel-Fayard, 2012). La guerre inclut la violence armée et son usage, mais va au-delà et inclut des moyens pacifiques. La paix comme la guerre relèvent des relations politiques. Ces relations sont des rapports de force mais aussi des rapports asymétriques entre vues du monde. Quand Napoléon dit en 1813 à Metternich qu’il ne peut pas revenir battu en France, contrairement aux souverains légitimes qui peuvent revenir vaincus dans leur pays sans perdre leur trône, c’est une vérité subjective qui devient une vérité objective. Dans la mesure où Napoléon dit lui-même qu’il sera trop affaibli devant les Français s’il accepte d’être vaincu, les Alliés (alors les ennemis de la France) ne veulent pas traiter avec un dirigeant affaibli qui ne garantirait pas la durée de la paix aux conditions obtenues par eux. L’argument de Napoléon se retourne contre lui. Nous le voyons : la dimension rationnelle de la guerre et du politique, qui relève du calcul, se croise toujours avec une dimension irrationnelle, qui relève des subjectivités. Mais pour qu’il y ait guerre, et non stasis (guerre civile, discorde violente) ou terrorisme, il faut qu’il existe des groupes organisés, des nations ou des fédérations de nations, mais non pas des tribus éphémères. En ce sens, la postmodernité qui s’installe amène des conflits qui ne seront pas – et sans doute de moins en moins – des guerres au sens traditionnel, et qui n’en seront pas moins très violents, et échapperont à un mode de règlement classique par des négociations. Une perspective de chaos accru.

CITATIO : entretien avec Fabrice Lesade

Rattaché à l’Institut ILIADE, CITATIO est un portail de citations lancé à l’été 2020. Outil particulièrement précieux dans le travail de reconquête européenne et de défense de notre civilisation, il permet aux visiteurs, qu’ils soient auditeurs ou simples sympathisants, de retrouver les meilleurs extraits d’auteurs, ainsi que leurs références précises. Entretien avec Fabrice Lesade, co-fondateur de l’Institut Iliade.
CITATIO apparaît comme un portail de citations d’auteurs très divers. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé sa création ? Ce qui justifie son existence ?
CITATIO est venu d’une réflexion commune avec des amis lecteurs qui ont, comme moi, toujours eu le réflexe, l’habitude de lire avec un stylo ; sous-entendu de marquer les passages intéressants et les extraits qui « nous parlent », de les retranscrire dans des cahiers ou de les compiler dans un fichier. Il est à noter d’ailleurs, nous l’avons appris plus tard, que c’était une recommandation fondamentale de Dominique Venner.
Ainsi, que pouvions-nous faire de toutes ces citations extraites de nos lectures ?
Il nous a paru évident, après la création de l’Institut Iliade, qu’il fallait en faire profiter le plus grand nombre. Alors, en novembre 2019, nous avons constitué un petit groupe de travail et quelques mois après, à l’été 2020, CITATIO voyait le jour avec 1.500 citations qui venaient de nos propres cahiers ou fichiers.
Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le site ? Qui l’alimente et à qui est-il destiné ?
CITATIO fonctionne comme tous les autres sites du même genre. Vous pouvez y trouver des citations de plusieurs manières : en utilisant le nom d’un auteur que vous recherchez tout particulièrement, ou en cherchant un thème à l’aide de mots clés qui vous sélectionneront les citations ad hoc. Nous avons d’ailleurs déjà regroupé certaines citations par thème pour accélérer vos recherches. Nous y référençons également les livres dont nous avons extrait les citations.
Aujourd’hui, nous approchons les 2.400 citations en ligne. Vous me direz que c’est peu en comparaison des deux ou trois autres sites plus connus et plus anciens (comme Evene par exemple). Mais nous sommes récemment arrivés dans la compétition, sachant que nous ne cherchons pas la première place en nombre de citations, mais que nous privilégions la qualité. Il faut en effet préciser que toutes les citations sont parfaitement sourcées, ce qui nous distingue clairement des autres sites. Seules des citations lues par nos contributeurs dans les livres (parfois des revues ou des discours), dont la source est identifiée et référencée sous chaque citation, sont « autorisées » à être publiées sur notre site. Nous sommes assez intransigeants sur ce point. Si un contributeur nous communique des citations sans source, celles-ci n’ont aucune chance d’y figurer… Ce qui fait évidemment beaucoup de déçus chez nos amis et contributeurs. Mais c’est la dure loi de notre exigence.
Toutefois, cela porte ses fruits, car il est maintenant fréquent, à l’occasion d’une recherche sur Internet, que CITATIO apparaisse dans les trois premiers sites proposés, quand ce n’est pas le premier. La qualité de nos sources, le choix de nos auteurs qui sont absents des autres sites, puis la qualité du travail de notre administrateur sur les liens hypertextes qui sont renseignés dans chacune de nos citations et nos entrées sont à l’origine de ces bons résultats.
CITATIO est officiellement affilié à l’Institut Iliade. Pouvez-vous expliquer dans quelle mesure ce site participe à la reconquête européenne et à la défense de notre civilisation ?
CITATIO est un outil et à ce titre il peut modestement participer à cette reconquête. La recension de citations bien choisies permet de trouver, en un seul endroit, la matière nécessaire pour illustrer un travail universitaire, un article de presse ou un livre. Une citation particulièrement pertinente peut amener un visiteur à aller lire le livre dont elle est extraite pour aller plus loin.
Le fait que nous soyons affiliés à l’Institut Iliade nous permet en outre d’accroître notre réseau de contributeurs, notamment avec l’implication des auditeurs des cycles de formation de l’Institut. Ces derniers sont tenus de fournir des citations extraites de leurs lectures et peuvent ainsi, dans la même philosophie de départ, participer à ce travail de reconquête en faisant profiter les autres de leurs lectures. Ces auditeurs ainsi que le nombre croissant de nos amis qui suivent l’Institut Iliade utilisent régulièrement le site pour leurs propres réflexions et leurs travaux.
Propos recueillis par Sixtine Chatelus de la promotion Jean Raspail
https://institut-iliade.com/citatio-entretien-avec-fabrice-lesade/
mardi 29 août 2023
Herbert Marcuse, philosophe néo-marxiste de mai 68

En 1979 mourrait Herbert Marcuse, le penseur utopiste de la Nouvelle Gauche soixante-huitarde. Werner Olles, ancien agitateur des barricades allemandes à la fin des années 60, fait le point vingt ans après cette date et rappelle l’engouement de sa génération pour Éros et civilisation et L’Homme unidimensionnel.
***
Marcuse nous disait : « Je pense qu’il existe pour les minorités opprimées et dominées un droit naturel à la résistance, à utiliser des moyens extra-légaux dès que les moyens légaux s’avèrent insuffisants. La loi et l’ordre sont toujours et partout la loi et l’ordre de ceux que protègent les hiérarchies établies. Il me paraît insensé d’en appeler à l’autorité absolue de cette loi et de cet ordre face à ceux qui souffrent sous cette loi et cet ordre et les combattent, non pas pour en tirer des avantages personnels ou pour assouvir une vengeance personnelle, mais tout simplement parce qu’ils veulent être des hommes. Il n’y a pas d’autre juge au-dessus d’eux sauf les autorités établies, la police et leur propre conscience. Lorsqu’ils font usage de la violence, ils n’amorcent pas un nouvel enchaînement d’actes violents, mais brisent les institutions établies. Comme on pourra les frapper, ils connaissent les risques qu’ils prennent, et quand ils ont la volonté de se révolter, aucun tiers n’est en droit de leur prêcher la modération, encore moins les éducateurs et les intellectuels ».
Ces quelques phrases sur la « tolérance répressive », tirées de sa Critique de la tolérance pure ont eu un impact considérable et durable sur le mouvement étudiant de 1968. Dès mai 1966, Herbert Marcuse, professeur de philosophie sociale à l’Université de Californie à San Diego, avait prononcé la conférence principale lors d’un congrès sur la guerre du Vietnam tenu à l’Université de Francfort à l’invitation du SDS (le mouvement des étudiants gauchistes allemands de l’époque). Devant 2.200 personnes, Marcuse constatait que « toutes les dimensions de l’existence humaine, qu’elles soient privées ou publiques étaient livrées aux forces sociales dominantes » et que le système ne connaissait plus aucun « facteurs extérieurs » :
« La politique intérieure, dont la continuation est la politique extérieure, mobilise et contrôle l’intériorité de l’homme, sa structure pulsionnelle, sa pensée et ses sentiments ; elle contrôle la spontanéité elle-même et, corollaire de cette nature globale et totale du système, l’opposition n’est plus d’abord politique, idéologique, socialiste (…). Ce qui domine, c’est le refus spontané de la jeunesse d’opposition de participer, de jouer le jeu, c’est son dégoût pour le style de vie de la “société du superflu” (…). Seule cette négation pourra s’articuler, seul cet élément négatif sera la base de la solidarité et non pas son but : il est la négation de la négativité totale qui compénètre la “société du superflu” ».
Dutschke défendait l’attitude de l’intellectuel
En juillet 1967, Marcuse, devant 3.000 personnes entassées dans les auditoires bourrés de la Freie Universität de Berlin-Ouest, prononçait sa série de conférences en quatre volets, « La fin de l’Utopie ». Sans cesse interrompu par les applaudissements des étudiants, le penseur dissident du néo-marxisme explicitait une fois de plus ses positions sur le « problème de la violence dans l’opposition ». Lors de la troisième soirée, une discussion a eu lieu sous la direction du philosophe et théologien Jacob Taubes : y participaient plusieurs membres du SDS, dont Hans-Jürgen Krahl, Rudi Dutschke, Peter Furth et Wolfgang Lefèvre, ainsi que les professeur d’université sociaux-démocrates Richard Löwenthal et Alexander Schwan. Ils engagèrent tous un débat avec Marcuse sur le thème : « Morale et politique dans la société d’abondance ». Lors de la quatrième soirée, Marcuse, Dutschke, Peter Gäng, Bahman Nirumand et Klaus Meschkat ont discuté du « Vietnam : le tiers-monde et l’opposition dans les métropoles ». Ce fut surtout Marcuse qui tenta de donner une explication de cette question en parlant du rôle que pouvaient jouer les intellectuels dans le processus d’éclosion et de consolidation des mouvements de libération dans les métropoles. Pour Marcuse, le rôle des intellectuels consiste à éclairer les masses en révolte en « reliant la théorie et la pratique politique ». Il proclama également la constitution « d’une anti-politique dirigée contre la politique dominante ».
Mais un an plus tard, toujours dans le grand auditoire de l’Université Libre de Berlin, il essuie le refus concentré des étudiants, lorsqu’il prononce sa conférence sur « l’histoire, la transcendance et la mutation sociale » ; il dit clairement aux activistes de la Nouvelle Gauche qu’il ne songe nullement à donner sans détour des conseils pour organiser la révolution ni a y participer. Plus tard, Rudi Dutschke a dit qu’il comprenait l’attitude de Marcuse à l’époque. Il l’a défendu âprement face aux critiques acerbes des étudiants les plus radicaux qui voulaient infléchir le processus révolutionnaire dans une seule dimension, celle, exagérée, de la guerre civile.
Herbert Marcuse, mélange génial de Marx, Freud et Isaïe, penseur éclectique, subjectiviste et néo-marxiste, figure du père dans la révolution culturelle de 68, est né le 19 juillet 1898 dans une famille de la grande bourgeoisie juive de Berlin. Devenu membre de la SPD sociale-démocrate, il appartenait aux courants vitalistes des jeunes socialistes, proche du mouvement de jeunesse. Après l’assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, il quitte la SPD et adhère à l’USPD (les socialistes indépendants plus radicaux et révolutionnaires). En 1918, il est membre d’un conseil de soldat à Berlin-Reinickendorf. Ensuite, il s’en va étudier à Berlin et à Fribourg, où il passe son doctorat en rédigeant une thèse sur Schiller. À Fribourg, il a été pendant un certain temps l’assistant de Heidegger. Mais les éléments nettement conservateurs de la pensée de Marcuse ne lui viennent pas directement de Heidegger mais d’une lecture très attentive de Hans Freyer, dont l’ouvrage Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (Théorie du temps présent) a fortement imprégné les thèses exposées plus tard dans L’Homme unidimensionnel. Pedro Domo démontre dans Herrschaft und Geschichte : Zur Gesellschaftstheorie Freyers und Marcuses (Domination et histoire : À propos de la théorie de la société chez Freyer et Marcuse) que l’influence de Freyer s’est exercée sur Marcuse tout au long de sa vie. Même affirmation chez un autre analyste, Wolfgang Trautmann (in : Gegenwart und Zukunft der Industriegesellschaft : Ein Vergleich der soziologischen Theorien Hans Freyers und Herbert Marcuses ; Présent et avenir de la société industrielle : Comparaison des théories sociologiques de Hans Freyer et de Herbert Marcuse). À cette influence de Freyer dans la composante conservatrice de Marcuse, il faut ajouter le véritable culte qu’il vouait à Schiller, héritage de la vénération que lui vouait le mouvement de jeunesse socialiste au tournant du siècle. Ce culte de Schiller a très vraisemblablement entraîné le mépris quasi féodal de Marcuse pour les sciences, la technique et la démocratie. Kolakowski l’a d’ailleurs décrit comme « le prophète d’un anarchisme romantique sous une forme hyper-irrationnelle ».
En effet, Marcuse propageait un « socialisme des oisifs ». Dans leur recherche d’un sujet révolutionnaire après la fin du marxisme et du progrès, les intellectuels de la classe moyenne aisée et les franges politisées du Lumpenproletariat ont fini par rencontrer cet idéologue de l’obscurantisme, qui constituait une symbiose entre Marx et Freud. En bout de piste, cela a donné l’utopie de la Nouvelle Gauche. Marcuse interprétait toutefois Marx à l’aide de critères pré-marxistes ; il voyait en lui un sociologue et non un économiste scientifique. Ensuite, il voyait en Freud un « adepte sceptique des Lumières ». Ce mélange a produit finalement cette idéologie de 68, caractérisée par le non sérieux relatif de la vie de l’éternel étudiant.
Cohn-Bendit a diffamé Marcuse en l’accusant d’être un agent de la CIA
Herbert Marcuse a quitté l’Allemagne sous la République de Weimar, en 1932, quand les nationaux-socialistes n’avaient pas encore pris le pouvoir. Il émigre aux États-Unis. Il y devint conseiller en guerre psychologique à l’Office of Strategic Services (OSS), une organisation militaire qui a préfiguré la CIA. C’est de cette époque que datent les études que l’on appelle “analyse de l’ennemi”. Le passé de Marcuse à l’OSS a induit Daniel Cohn-Bendit, un jour, à diffamer Marcuse, qu’il a accusé à Rome d’être un agent de la CIA, ce qui est objectivement faux.
Plus tard, Marcuse a enseigné la philosophie à l’Université d’État en Californie à San Diego. En ce temps-là, il vivait à La Jolla en Californie. À l’âge de 81 ans, le 29 juillet 1979, il meurt à Starnberg en Allemagne, à la suite d’une thrombose. Aujourd’hui, notre intention ne saurait être de récupérer et de redécouvrir Marcuse dans un sens “conservateur-révolutionnaire”. La pensée de ce néo-marxiste a été beaucoup trop influencée par la mystification de la révolution mondiale, même s’il ne plaçait plus aucun espoir dans la classe ouvrière, mais, au contraire, dans les groupes marginalisés de la société, refusant toujours davantage le système.
Ensuite, autre volet de la pensée de Marcuse : il concevait la « société technologique » de plus en plus comme un moyen d’asservir le prolétariat ; celui-ci était de toute façon lié au système capitaliste de la satisfaction et de l’élargissement des besoins. Dans un tel contexte, la position du prolétariat est purement défensive. L’économie, pour Marcuse, est toujours une économie politique qui ne produit jamais une « économie psychologique ». L’économie dominante gère les besoins que réclame le système, jusqu’aux pulsions les plus élémentaires.
Puisque le capitalisme a absorbé le « potentiel révolutionnaire » et que l’ère révolutionnaire du prolétariat est définitivement passée, n’explique pas pourquoi la « théorie critique » et la « praxis politique » n’ont pas coïncidé partout. Pourtant Marcuse voyait dans l’indépendance nationale un facteur positif. Il soutenait la guérilla nationale-communiste au Vietnam, corollaire de sa définition des États-Unis comme « héritiers historiques du fascisme ». Aucun immigrant n’avait formulé auparavant une critique aussi acerbe contre la politique américaine. Mais Marcuse n’avalisait pas pour autant la politique soviétique, qui convergeait de plus en plus avec celle des États-Unis. Il la qualifia un jour de « honteuse », ce qui lui a valu la haine tenace des gauches fidèles à Moscou. Il était cependant assez réaliste pour reconnaître que la Nouvelle Gauche n’allait jamais devenir un mouvement de masse. Raison pour laquelle il a limité sa thématique aux perspectives pluri-dimensionnelles de la théorie dialectique, visant la suppression de la « société d’abondance », le prise de conscience psychologique et sensitive de la répression dans les métropoles occidentales et de l’oppression flagrante et impérialiste des peuples du tiers-monde.
Par ailleurs, Marcuse prônait l’instauration d’un « pré-censure », qu’il nommait avec euphémisme un « idéal platonicien », et une dictature provisoire de la gauche, qu’il baptisait « éducation » (Erziehung), et qui devait préparer l’avènement d’une « société humaine ». Dans l’existence qui attendait les hommes au sein de cette « société humaine », le rois-philosophes d’inspiration platonicienne devaient veiller sans discontinuité à ce qu’il n’y ait plus jamais de guerre, de cruauté, d’agressivité, de stupidité, de brutalité et de racisme. Dès que cette hydre à têtes multiples se manifestait, les rois-philosophes devaient intervenir et sévir. Ainsi, l’utopie deviendrait possible, elle serait une société véritablement libre. Cette vision marcusienne contredit toutefois à terme son idéal libertaire d’inspiration nietzschéenne, héritée du mouvement de jeunesse. La “pré-censure” et “l’éducation” indiquent une contradiction majeure dans cette pensée subversive de gauche.
Max Horkheimer a reproché à Marcuse de se retrancher derrière le concept « d’homme nouveau ». Horkheimer s’insurgeait avec véhémence contre la domination du principe de plaisir et contre l’idée naïve qu’une société de masse puisse vivre sans aucune contrainte. De la pensée de Marcuse, il restera donc cette dénonciation de la rationalité technologique comme expression de l’arbitraire, tendant vers le totalitarisme. Sa thèse disant que « la technologie livre la grande rationalisation pour la non-liberté de l’homme » est restée actuelle et réelle. Elle exprime clairement les sentiments d’un philosophe qui a vécu et pensé la crise de l’existence humaine comme une crise de la philosophie. Restent également sa critique de la « société unidimensionnelle », de la liberté illusoire (qui risque de chavirer dans « le déluge de scepticisme »). Unidimensionnalité et liberté illusoire ont conduit à des quiproquos philosophiques terribles dont souffrent encore nos sociétés de masses modernes.
Le “grand refus” de Marcuse
Le “grand refus” de Marcuse n’offrait toutefois pas de contre-modèle concret à l’unidimensionnalité du capitalisme tardif. Il n’a pas été capable de générer une conception de la vie, un “oïkos” alternatif, susceptible d’offrir à l’individu un éventail de possibilités afin d’échapper ou de résister à « la destruction totale et incessante des besoins de l’homme dans la conscience même de l’homme » (Hans-Jürgen Krahl). Telle a bien été la plus grande faiblesse de cet éclectique qui n’a pas pu se corriger, même dans la lutte collective pour l’émancipation menée par la Nouvelle Gauche (pour laquelle Marcuse a toujours témoigné sa sympathie). La raison de cet enlisement provient de ce que les contradictions quotidiennes du système capitaliste tardif ne se reflètent plus dans la conscience des masses. La subtilité des rapports de domination finit par conditionner la psychologie même des hommes.
Ainsi, la répression assortie de l’accord tacite entre le facteur subjectif et le maintien tel quel de la réalité de classe, dans un système de pouvoir très complexe, anonyme et technocratique, a conduit à l’échec du mouvement de 68.
Werner Olles, Nouvelles de Synergies Européennes n°41, 1999.
(texte issu de Junge Freiheit n°31-32/1999)
Christopher Gérard : « Paideia : la transmission comme acte révolutionnaire »

Ce qui distingue une grande civilisation, n’est-ce pas, entre autres qualités, son aptitude à transmettre l’héritage ancestral, sa capacité d’assurer la continuité de dessein qui la fait survivre aux aléas de l’histoire ?
En Europe, cette aptitude porte un nom, et un nom grec : paideia.
Notre civilisation semble être la seule, et la première dans l'histoire, à nier ses propres valeurs et, en malsaine logique, à refuser de les transmettre. Ce refus conscient de transmettre, ce refus justifié par toute une faune d’idéologues et de pédocrates, ce refus n'est jamais qu'un suicide différé, un suicide sans noblesse ; il illustre à lui seul notre présente décadence, celle d’une société « sans feu ni lieu », celle d’une civilisation « de la digestion et du fumier » – pour citer un écrivain cher à mon cœur, le Normand Jules Barbey d’Aurevilly. Il illustre en réalité l’oubli de notre paideia plurimillénaire.
Cette funeste pulsion, cette ruse de la Mort aux noires prunelles, qui consiste, par haine de soi (généralement grimée en amour de l’autre), à ne pas transmettre, il nous incombe de la combattre sans merci, car telle est la mission qu’impose le rapide destin, une mission d’ordre métaphysique – notre guerre sainte, si j’ose dire : maintenir et restaurer la paideia.
Le premier éducateur de notre civilisation, notre grand ancêtre, c’est le divin Homère, dont Platon disait à juste titre qu’il avait éduqué la Grèce.
Dans le chant VI de l’Iliade, Homère décrit le dialogue entre deux adversaires qui s’affrontent en duel dans la plaine de Troie, le Troyen Glaucos et l’Achéen Diomède. Glaucos rappelle sa généalogie ainsi que les consignes données par son père lors de son départ pour la guerre : « Toujours être le meilleur, surpasser tous les autres, ne pas déshonorer la race de tes aïeux ». Il y a trente siècles donc, pour un Hellène digne de ce nom, les trois devoirs de l’homme noble sont : excellence, prééminence, fidélité aux ancêtres. Rien n’a changé et cette devise demeurer celle de tous les Bons Européens qu’évoquait Nietzsche.
Exceller pour continuer à surpasser les autres – n’est-ce pas le défi qui, une fois de plus dans notre longue histoire, nous est lancé par le cruel destin ? Quant aux ancêtres, comment pourrions-nous oublier l’aïeul qui a tenu bon sur l’Yser, la Marne ou dans la boue des Flandres ? Impensable amnésie, assimilable à un crime.
Dans le passage de l’Iliade que j’ai évoqué, Homère utilise, pour la première consigne, le verbe aristeuein : être l’aristos, le meilleur (superlatif); faire preuve de cette qualité suprême qu’est l’excellence, aretè en grec. Longtemps, le terme aretè a été traduit par « vertu », vocable quelque peu connoté en raison de son acception moralisatrice. L’italien virtu rend bien mieux le sens premier d’aretè : l’excellence, qu’un poète grec de l’époque classique définit de la sorte : « le pied, la main, l’esprit sûrs, façonnés sans nul défaut ». Retenons cette image de façonner l’esprit et le corps tel que le ferait un potier avec de l’argile.
Cette aretè, cette virtu à la fois physique et morale, qui concerne l’âme, le corps et le caractère, fonde la paideia hellénique, idéal né à l’époque homérique, transmis, avec ses éclipses et ses métamorphoses, jusqu’à nos jours, depuis l’Athènes classique, en passant par l’empire romain, par Byzance, par nos monastères jusqu’aux collèges et aux lycées d’aujourd’hui.
Qu’est-ce donc que cette paideia, terme difficilement traduisible, car « éducation » en réduirait le sens ? Il faudrait ajouter « culture, civilisation, tradition, littérature », ou encore « modelage du caractère humain selon un idéal » pour citer la définition du grand humaniste Werner Jaeger, professeur aux universités de Berlin puis de Harvard, qui avait consacré trente ans de sa vie à étudier la transmission de l’hellénisme. Son maître livre, Paideia, est un classique de la pensée aristocratique et un monument de l’humanisme européen. Avec le Français Henri-Irénée Marrou, lui aussi immense érudit, auteur d’une monumentale Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, nous avons là deux ouvrages de référence sur le thème de la transmission.
Dans son maître-livre, Jaeger rappelle que toutes les renaissances en Europe se sont fondées sur un retour à la paideia antique : renaissance carolingienne, Renaissance italienne, classicisme français, idéalisme allemand - chaque fois, quand il s’est agi en Europe de surmonter l’obscurantisme et la sclérose, chaque fois qu’il a fallu assurer un nouveau départ, les Européens ont recouru à la culture mère – la paideia grecque en tant qu’idéal de modelage, de façonnement du caractère et de la sensibilité, de parachèvement de la nature.
La paideia implique de modeler sa propre statue, de se créer soi-même et de devenir pleinement homme par l’imitation d’un modèle idéal obéissant à des lois universelles. Comme le disait Jaeger, la paideia « donne le sens de l’harmonie et de la totalité », car elle repose sur la vision d’un monde gouverné par un principe d’unité transcendante, le Logos d’Apollon, régissant de manière harmonieuse et l’âme humaine, et la cité et l’univers tout entier.
La Paideia classique comme principe éducatif et comme idéal de communauté civilisationnelle consiste donc en une discipline progressive qui transforme l’enfant, l’adolescent et même l’adulte sur les plans physique et moral ; elle est un élan créateur et directeur qui s’oppose à la pulsion morbide consistant à refuser de préserver ses traditions. Elle est, comme disait Platon, « le bien le plus précieux » que nous ayons reçu de nos ancêtres et que nous devons, contre vents et marées, transmettre à nos descendants. Platon oppose d’ailleurs paideia, la culture en tant que savoir désintéressé, à technè, le savoir utilitaire. On voit ainsi que l’homme européen, né en Grèce (comme le nom de notre civilisation), s’interroge depuis l’origine sur l’art de transmettre sous peine de disparaître.
Notre paideia se fonde sur deux valeurs essentielles qui distinguent l’Europe des autres civilisations : la première est cet insatiable désir de liberté, aux antipodes de l’oubli de soi, de cette soumission orientale qui force à se prosterner.
Déjà, à l’époque homérique, les guerriers groupés autour de leurs princes débattent de la stratégie à adopter. Typiquement grec, et devenu européen, est ce besoin irrépressible de se déterminer soi-même, de se former son propre jugement, de régler sa vie selon ses propres valeurs. Nous sommes loin de la soumission à un Dieu jaloux qui espionnerait les âmes et brimerait les corps. Nous sommes loin de l’obéissance abjecte aux dogmes, économiques (la Croissance) ou religieux (le Salut), qui toujours stérilisent la pensée en la paralysant.
La seconde valeur est la prise de conscience du caractère irremplaçable de la personne humaine. « L’homme est la mesure de toute chose » proclame Platon dans le Protagoras ; « Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est point de plus grande que l’homme » s’exclame Sophocle dans son Antigone. La paideia grecque exalte cette conception de l’homme comme trésor à chérir, ce que les Romains, successeurs des Grecs, ont appelé humanitas, et nous, Modernes, héritiers des Grecs et des Romains, humanisme.
La paideia, c’est donc l’humanisme classique ─ le fondement de l’identité européenne, que l’école, la famille, la cité doivent transmettre, j’ai envie de dire, « sous peine de mort ». Cet humanisme, savoir désintéressé par excellence mais qui par un étrange paradoxe façonne les élites d’Europe depuis 25 siècles, se traduit avant tout par l’amour de la création, par le respect devant l’œuvre des devanciers, et par donc l’humilité qui va de pair. Loin, bien loin, de cette manie de la table rase, de ce mépris du passé qui infectent notre modernité finissante.
Certes, le mot humanisme a été galvaudé et souvent vidé de son sens, mais il n’empêche que cette attitude anthropocentrique, née en Grèce au sein de la chevalerie homérique et métamorphosée par les philosophes classiques, demeure l’une des plus belles créations du monde gréco-romain. Nul ne confondra cette paideia avec l’individualisme post-moderne, celui du zombie « sans feu ni lieu », qui n’est jamais ni aristos ni fidèle, ce zombie qui ne se reconnaît plus ni liens ni obligations ─ uniquement des droits, avec aigreur réclamés.
Nous parlons bien d’humanisme en tant que mise en forme d’une personne, de formation de l’âme, du corps et de l’esprit, de développement en chacun de toutes les possibilités de sa nature, de promotion acharnée de ce que l’enfant, l’adolescent, l’adulte possèdent d’irremplaçable. Il s’agit bien de discipliner le jugement et l’impulsion, de pousser l’enfant à accomplir son devoir sans négligence et de faire de lui un citoyen libre. L'humanisme ne se réduit en rien à une banale et souvent peu sincère forme de philanthropie, mais bien comme un idéal de liberté de l'homme par la connaissance de son héritage plurimillénaire, comme une solidarité effective entre les siècles, les générations, les communautés. En somme, l’héritage est un lien qui rend libre.
Le renier, accepter l’oubli constitueraient des sacrilèges, l’impiété absolue. Impensable posture pour tout homme noble, quelle que soit d’ailleurs sa race ou sa classe.
Cet humanisme, cette paideia sont d’essence élitaire, ne le cachons pas, car cela n’a rien de honteux. Le propre d’une élite digne de ce nom est précisément de se sentir responsable de la sauvegarde de ses traditions, qu’elle livre aux générations futures.
Nous parlons bien d’une aristocratie du mérite et de l’effort qui, seule, fonde l’authentique noblesse, laquelle, pour citer Jaeger, « n’est jamais pur privilège, elle correspond à un certain danger que l’on accepte ». Pour désigner l’homme accompli, l’équivalent du gentilhomme français ou du gentleman anglais, les Grecs disaient kalos kagathos, « beau et bon à la fois », l’homme accompli, excellent et fidèle à son héritage, alliant noblesse d’âme, vigueur physique et beauté intérieure. Le Romain Pline disait des Grecs qu’ils étaient homines maxime homines : des hommes totalement hommes, pour qui le dépassement de soi était la loi.
Pour les Anciens, l’homme « au pied, à la main et à l’esprit façonnés sans nul défaut » que chantait le poète Simonide, est avant tout raisonnable, car conscient d’être un animal politique (Aristote) obéissant à des lois qui règlent la vie de sa cité. Raison, loi, cité sont donc des mots clefs de la paideia, qui, par le biais de contraintes dont le rôle est de brider les passions dans ce qu’elles ont de destructeur, doit former les hommes à vivre en société. Théorisée entre autres par Platon et Aristote, la paideia consiste à réguler les appétits, à s’exercer à la frugalité, à former des âmes loyales. Idéal aristocratique ? Certes, mais cet idéal, pensé il y a plus de 25 siècles, traverse toute notre histoire, souvent de manière souterraine. Qui dira l’effet de la lecture d’Homère sur un jeune garçon ? Le courage d’Hector, la ruse d’Ulysse, la fidélité du vieux chien Argos ? Qui dira l’émotion ressentie à la lecture de la mort volontaire de Socrate, au sublime sacrifice d’Antigone ? Et l’on voudrait nous priver de ces trésors au nom de l’amnésie programmée de nos contemporains, de la dissolution de la personne dans une masse informe et grisâtre, de la chute dans un présent totalitaire, de la soumission au règne de la marchandise ou à la dictature spirituelle du livre unique.
Derrière les slogans modernistes et égalitaires ─ donc démagogiques ─ se cache une idéologie sournoise de la table rase, qui déstructure l'individu et l'enferme dans une hébétude, un narcissisme morbides, pour le livrer pieds et poings liés aux mercantis et aux fanatiques.
En cette phase toute provisoire d’inversion des valeurs, plutôt que de se contenter de verser dans un pessimisme démobilisateur ou dans une déprimante déploration, les hommes libres ont pour mission de maintenir la paideia ─ acte révolutionnaire et devoir moral.
Christopher Gérard ─ Source : Archaion