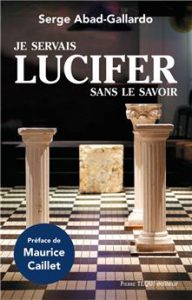Renaud Camus publie un essai monumental dans lequel il retrace l’histoire du « remplacisme global », cette idéologie qui dépossède l’homme de tout ce qui le constitue, à commencer par son essence. Par Olivier Maulin
Dans les bras de sa Mère, entouré d’Augustin, de Marc et de Jean-Baptiste, l’Enfant Jésus tend la main droite en direction de Catherine d’Alexandrie agenouillée devant lui. Posé par terre, devant la sainte, au premier plan du tableau : un moyeu, celui d’une roue de l’effroyable machine à laquelle elle sera livrée au martyre. C’est ce tableau du Tintoret, La Vierge et l’Enfant avec sainte Catherine, saint Augustin, saint Marc et saint Jean-Baptiste (vers 1550) que Renaud Camus a choisi de faire figurer sur la couverture de son nouveau livre, et plus exactement un détail de ce tableau : le fameux moyeu.
Curieusement, l’objet est au centre de la toile, comme si c’était lui la divinité. Pourtant, personne ne semble le remarquer, personne ne le regarde : il est là et il n’est pas là. Il est au centre de tout mais on ne le voit pas. C’est un petit rouage insignifiant mais c’est lui qui fait tourner la machine et cette machine, en l’occurrence, servira à broyer Sainte Catherine, à broyer l’Homme. Il fallait un Renaud Camus pour nous montrer ce moyeu : « La fonction sociale et politique d’un écrivain est de se porter systématiquement aux angles morts d’une société, à ce qu’elle ne veut ni voir ni lire ni entendre, à ce que toute son organisation vise à ne pas comprendre et à ne pas reconnaître », écrit-il dans La Dépossession, un formidable monument de plus de 800 pages qu’il publie aujourd’hui. Un livre d’une profondeur, d’une hauteur de vue et d’une intelligence inouïes, que l’ensemble des médias a choisi d’ignorer superbement, mais cela n’étonnera personne, et surtout pas le premier concerné.
Depuis qu’il a inventé et popularisé le terme de « Grand Remplacement », Renaud Camus a été repoussé dans les marges honteuses de la vie culturelle. Il est le « maudit » par excellence, celui que l’on ne peut inviter sur un plateau de télévision sans créer le scandale, quoiqu’il dise, et même s’il parle d’art ou de littérature ; il est celui qu’il est interdit de citer, celui que l’on harcèle sur les réseaux sociaux, à qui on coupe ses comptes un à un, celui que l’on peut diffamer impunément, l’homo sacer des Romains que la Cité ne protège plus. L’absurdité de sa situation saute pourtant aux yeux : le changement de peuple et de civilisation causé par la submersion migratoire que la France connaît depuis des décennies, changement de peuple et de civilisation qu’il constate et déplore, est aujourd’hui, et de plus en plus, constaté par d’autres que lui, qui s’en réjouissent, le nommant Grande Expérience (Yascha Mounk) ou Créolisation (Jean-Luc Mélenchon), et n’en sont, eux, nullement inquiétés. Ce n’est donc pas le constat qu’on lui reproche, mais de ne pas l’accepter, de vouloir que la France reste la France, de vouloir que la civilisation française reste la civilisation française, et cette position qui lui aurait valu la reconnaissance des générations précédentes lui vaut l’opprobre de la nôtre, en tout cas de ses élites.
Dans un livre précédent, l’écrivain avait montré combien l’acceptation passive de ce « génocide par substitution », selon l’expression d’Aimé Césaire, était liée à l’écroulement de la Culture, au remplacement, là encore, de la grande culture par le divertissement culturel produit par « l’industrie de l’hébétude » : c’est ce qu’il appelle le « Petit Remplacement », sans lequel le Grand ne pourrait avoir lieu. « Un peuple qui connaît ses classiques ne se laisse pas mener sans regimber dans les poubelles de l’histoire », nous disait-il en son château de Plieux lorsque nous le rencontrâmes fin 2019.
Il nous parlait déjà, alors, du « remplacisme global », qu’il appelait sa pierre de rosette, et qu’il définissait comme l’idéologie organisant « le remplacement de tout, matériaux, arts, peuples, individus, espèce humaine, par son double plus simple, moins coûteux et plus interchangeable ». Il y voyait le geste moderne par excellence, le triomphe d’une conception de l’homme dépossédé de son essence, réduit à n’être qu’un produit, un petit rouage de la machine identique aux autres, et donc remplaçable. Il y voyait surtout la matrice des totalitarismes concentrationnaires.
Nul complot là-dedans, bien sûr, en dépit du bavardage de ceux qui n’ont jamais lu Renaud Camus mais lui prêtent des tas d’opinion, sinon l’œuvre « de mécanismes hautement interdépendants, où les enchaînements s’opèrent pour ainsi dire tout seuls […] sans qu’il soit nécessaire de supposer à leur source ou dans leur fonctionnement de volonté humaine tout à fait délibérée ». Ce sont ces mécanismes et ces enchainements qui forment aujourd’hui le cœur de son nouveau livre. Autrement dit, c’est ni plus ni moins l’histoire de ce remplacisme global qu’il nous propose, ou celle de la Dépossession, ce qui revient au même, car l’idée d’un homme remplaçable conduit inéluctablement à le déposséder de toutes ses appartenances et à en faire une « matière humaine indifférenciée », un homme sans attaches, sans racines, sans race, sans culture, bientôt sans sexe : l’homme interchangeable.
Ceux qui l’ont lu le savent : Renaud Camus est un écrivain obsessionnel. Il tourne autour de son sujet, y revient, s’en éloigne, le prend par un autre bout. Il digresse, saute du coq à l’âne, sort par la porte, revient par la fenêtre, fait feu de tout bois. Son livre est tour à tour un ouvrage de philosophie (avec Heidegger et la question du temps planant tout du long), un essai historique, un journal intime, un plaidoyer pro domo, un journal de l’actualité, un recueil d’aphorismes, un traité d’histoire de l’art et de littérature, un long poème enfin, hanté par le fantôme d’une civilisation qu’il chérit plus que tout.
« Tout commence à la mort de Dieu -en 1882, je crois, au mois d’août, il me semble, en Thuringe, dans le Gai Savoir ; et plus précisément dans cette section du Gai Savoir intitulée, comme par hasard, « L’insensé » », attaque-t-il. Cette « mort de Dieu » annoncée par Nietzsche va ouvrir la voie à la science qui va bientôt s’instituer en instance suprême de la vérité, au point de dépouiller l’homme de son expérience sensible, de son propre regard sur le réel.
S’il n’a rien contre la science et les progrès qu’elle a incontestablement apportés à la société, l’écrivain refuse sa prétention à décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l’est pas. Ainsi des races, dont elle a repris la définition biologisante des racistes du XIXe siècle pour décréter que sous cet aspect-là, biologisant, elles n’existaient pas, comme si les races pouvaient être réduites à la génétique. Pour Camus, mais aussi pour les poètes, les philosophes et les écrivains du passé, et jusqu’à Pompidou qui en parlait encore à son aise, « la race est avant tout une affaire de destin longuement partagé, de territoires longuement habités ensemble, d’héritage, de traditions communes amoureusement transmises, de religions tour à tour adoptées ou répudiées, de coutumes, de reconnaissance réciproque ».
Avoir décrété que les races n’existaient pas constitue l’une des graves dépossessions de l’homme, qui ouvrirait bientôt la voie aux autres et permettrait un jour à un président de la république de décréter que la culture française, elle non plus, n’existe pas. Or, si les races, les peuples et les cultures n’existent pas, on peut bien sûr remplacer des individus par des autres, n’importe où, n’importe quand : est-ce un hasard si le dogme de l’inexistence des races coïncide avec le regroupement familial et le début de la submersion migratoire ?
On est là au cœur de la vision « littéraire » du monde de Renaud Camus et de son dialogue de sourds avec les démographes, lesquels ne savent opposer que des chiffres à une expérience. Ce n’est pas tant que ces chiffres soient trafiqués (ils le sont bien sûr, notamment quand ils exposent qu’il y a moins d’étrangers en France aujourd’hui que dans les années 1930, en prenant soin de laisser de côté les naturalisés : à ce titre, le Grand Remplacement aura pris fin quand il n’y aura plus un seul étranger en France, ironise Renaud Camus), c’est qu’ils entendent se substituer à notre regard pour imposer une vérité que nos yeux démentent. Nos ancêtres avaient-ils besoin que les démographes leur expliquent qu’ils étaient frappés par la Grande Peste ? Les résistants de 1940 réclamaient-ils des graphiques sur la présence allemande département par département avant de gagner les maquis ?
On ne réussira pas mieux ici que d’esquisser maladroitement la richesse d’un tel livre. Sur la vérité, le « nettoyage » des concepts, l’horreur du temps et de l’ancienneté cultivée par les sociétés remplacistes, la culture, les classes sociales, l’antiracisme ou la technique, Renaud Camus emporte l’adhésion du lecteur de bonne foi. Mais c’est sur son travail d’historien que l’on souhaite insister pour finir. Camus retrace en effet l’histoire du taylorisme et du fordisme, ainsi que leurs liens avec le nazisme et le communisme, lesquels sont édifiants. Le « management scientifique » et la chaîne de montage des usines Ford seront ainsi repris tel que par les deux totalitarismes, non sans quelques accommodements, ce qui est parfaitement documenté par les historiens anglo-saxons qu’il suit, mais assez peu connu dans notre pays.
C’est bien là, dans cette Amérique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, avec la standardisation des produits et l’invention décisive du travail à la chaîne transformant l’homme en matricule, que l’auteur voit la mise en place de l’idéologie totalitaire du « remplacisme global », celle qui a ouvert la voie à la déshumanisation des camps et à l’horreur de l’extermination des Juifs, et qui gère désormais le « parc humain » sans autre considération que celle des besoins de l’économie, comme si ces humains étaient de simples produits.
Et la solution ? réclameront certains lecteurs. Camus n’en donne pas, à moins qu’elle ne soit, elle aussi, dans le tableau du Tintoret. La machine à roue qui persécutera Saint Catherine, symbolisé par notre moyeu, sera brisée par Dieu au moment du supplice.
Olivier Maulin
Source : valeursactuelles.com/clubvaleurs/
La Dépossession. Ou du remplacisme global, Renaud Camus, La Nouvelle Librairie éditions, 846 pages, 33,5 €.
La dépossession du regard par la science
« Du Grand Remplacement je ne puis donner de preuves, et je n’ai jamais eu la moindre intention de le faire, car ce serait entrer moi-même dans l’univers que je dénonce, celui du remplacisme global, et, pour l’homme, celui de la dépossession. Ce serait admettre que les chiffres seuls, les nombres, la preuve, la « science », sont l’instance unique et indubitable de la vérité […] Autant la preuve et tout son appareil ont toute leur légitimité dans les champs qui leur sont « naturellement » soumis, autant ils sont une imposition déplacée et suspecte s’agissant du destin manifeste des nations et des civilisations. Le citoyen qui consent ridiculement à s’y soumettre au milieu des cataclysmes reconnaît par là qu’il est incapable de juger en son nom propre de ce qui lui arrive en tant que citoyen et de ce qui arrive à son peuple, à sa race, à son espèce. A aucun moment de l’histoire l’homme n’a eu besoin de la science pour dire : c’est la Grande Peste, c’est le Grand Schisme, ce sont les guerres de Religion, c’est la Fronde, c’est la Révolution française, c’est l’Année terrible, c’est la Grande Guerre, c’est la Grande Dépression, c’est l’Occupation allemande, c’est la décolonisation ».
https://institut-iliade.com/la-depossession-renaud-camus/