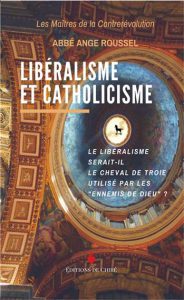Pour Maurras, qui n’est pas né royaliste, comme il aime à le rappeler, notamment dans la préface à ses souvenirs intitulés Au Signe de Flore, le recours à la monarchie comme nécessité institutionnelle pour préserver à la fois l’indépendance de l’État au-dessus des factions et la souveraineté du pays par rapport à l’étranger — le Roi empereur en son royaume — ne saurait évidemment courir le reproche de reproduire ce qui précisément est le défaut principal de la République, à savoir le choix toujours incertain de celui qui tient lieu de souverain. S’il y a nécessité d’un souverain, qui est, comme le nom latin l’indique, superanus, tout au-dessus au plan humain, reconnaissant lui-même une transcendance, alors ce souverain doit échapper à la compétition. Le Roi n’a donc pas à être choisi. Il est parce qu’il est là, à sa place, désigné par la triple légitimité historique, familiale ou dynastique et nationale. Légitimité historique en tant qu’il appartient à la lignée de ces quarante rois qui n’ont cessé de servir le pays tout simplement en faisant le pays en 1000 ans, familiale ou dynastique, en étant qu’il est celui que les règles désignent, nationale, en tant qu’il appartient à une lignée toujours restée française.
Pour Maurras il ne convient pas de confondre les moyens avec la fin. Comme il l’écrit lui-même dans un article de 1941 de L’AF (L’Action Française, 4 juillet 1941) :
« Ce que l’on est convenu d’appeler la loi salique a été faite pour une fin, par un moyen. La fin était d’éloigner de la couronne de France toute tête étrangère. Le moyen était d’assurer la succession de mâle en mâle par ordre de primogéniture. D’où il résultait que les mâles qui étaient allés régner à l’étranger, étant devenus étrangers s’excluaient naturellement de toute la série.
Comment peut-on dans ces conditions rêver de légitimité française au profit de princes espagnols ou italiens ? Le droit national leur est refusé par définition. C’est la question préalable que rien ne dispense de poser chaque fois que l’on essaie d’introduire un débat sur ce sujet où doit seul compter l’esprit des lois, leur sens national, leur défense essentielle contre ce qui n’est pas national. »
On aura compris que pour Maurras, qui définit la monarchie comme le nationalisme intégral, des trois légitimités, c’est la légitimité nationale qui prédomine :
« Personne n’a porté plus haut que nous l’estime et l’admiration pour la politique bourbonienne conduite en Espagne et en Italie, qui tendait à faire un lac français de cette Méditerranée dont la Révolution et l’Empire ont fait un lac anglais. Il serait ridicule d’admettre qu’un ricochet final de cette haute politique eût pour effet d’atteindre ou de meurtrir, de Parme ou de Madrid, le principe de la succession à Paris ! »
Et de rappeler encore dans L’Action Française du 29 mars 1926, à propos de la mort du duc d’Orléans :
« [La doctrine monarchique]dispose de tout à l’avance, dans un ordre que les siècles n’ont pas altéré. L’antique loi salique, l’arrêt nationaliste du quatorzième siècle se retrouvent tels quels dans la Constitution de 1791, qui maintenait encore, au fort de la Révolution, un principe de cohérence, de continuité et d’autorité : « La royauté », dit-elle, « est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance… »
La loi salique considérée comme un « arrêt nationaliste » au sens juridique du mot « arrêt » : tel est le fond de la pensée de Maurras. Aussi récuse-t-il tout juridisme, c’est-à-dire l’autojustification du droit, celui-ci pouvant devenir le lieu privilégié des arguments sophistiques :
« Tenons-nous à la grande vérité de l’Histoire politique. Elle est écrite en caractères aveuglants. Le comte de Chambord n’en doutait pas lorsqu’après avoir reçu les jeunes fils du duc d’Orléans, il écrivit que « la Maison de France » était « réconciliée » ou lorsqu’il ordonna de recevoir « Paris » comme un dauphin de France. Dépositaire de la tradition de sa race, il savait en quel rang les premiers princes du sang venaient les Orléans, immédiatement après les Bourbons, tant sous l’ancien régime qu’à la Restauration : il ne se reconnaissait pas le droit d’y rien changer.
En 1883, devant le cercueil de ce noble prince, les fils aînés des plus vieilles familles françaises, conduites par des hommes comme La Tour du Pin ou de Mun, se rallièrent au principe de cet ordre toujours vivant. Si le bon sens et la raison parlaient moins haut, la tradition suffirait donc à en décider. »
Celui qu’on présente donc à tort comme un positiviste, alors qu’il n’a cherché chez Auguste Comte qu’une méthodologie et nullement une religion, convient donc que l’argumentation juridique doit reposer, pour rester dans son ordre, sur sa finalité. Le droit ne se justifie pas par lui-même : il a un objet, sous peine de se contredire ou de justifier un objet vidé de son contenu. Cet objet c’est l’indépendance de la patrie, plus précieux des biens au temporel. Et même si les trois dimensions de la perception du fait politique sont ici en accord à ses yeux, toutefois, la tradition est au-dessus du bon sens et de la raison dans ce qu’ils pourraient avoir de déconnecté de la transmission nationale.
Qu’entendre en effet par tradition, qu’on sait de plus critique chez Maurras ? Précisément la vie même de la nation passant de génération en génération, sa perpétuation à travers les siècles qu’il convient de préserver à travers celle de la famille royale, même en suspension de trône.
Comment dès lors justifier le règne de Louis-Philippe ? Le lieutenant-général du royaume en devenant Roi des Français n’a-t-il pas de ce fait brisé cette tradition au sens où nous venons de la définir ? Maurras pose lui-même l’objection :
« Si la légitimité du duc de Bordeaux est sûre, l’usurpation de Louis-Philippe ne l’est pas. Si, comme je le crois (et rien n’est plus sûr), Henri V était le roi légitime, comme celui qui régnerait à sa place n’était-il pas usurpateur ? »
Il y assurément un péché originel de la monarchie louis-philipparde : en ayant « l’immense malheur de ne « pouvoir » rallier à lui tous les bons éléments du pays : clergé, grande et petite noblesse, familles fidèles de toutes conditions et de tous métiers, ce qui faisait peut-être le plus solide du composé français (…) sa « politique de résistance » dut s’appuyer sur le conservatisme souvent aveugle et avide de classes ou l’intérêt commercial et financier prévalait avec dureté, et sa « politique de mouvementé était sans cesse menacée des entraînements le plus dangereux par les partis révolutionnaires. Neuf fois sur dix, Louis-Philippe dut gouverner contre son parti. », le terme de parti indiquant bien, du reste, que Louis-Philippe avait été l’homme d’une faction.
Et pourtant, Maurras refuse de voir en Louis-Philippe un usurpateur comme l’a été Napoléon Ier :
« Le droit dynastique était incontestablement avec le Duc de Bordeaux, les forces légitimistes françaises lui appartenaient à coup sûr. Cela veut-il dire que Louis-Philippe ait été un usurpateur ? C’est ce que j’ai déclaré plus que douteux à mon sens. Car, nommé Lieutenant-général du royaume par le vieux roi Charles X ? Louis-Philippe conçut tout aussitôt sa tâche comme celle d’un Régent, et l’on a le malheur d’ignorer une démarche que trop peu d’historiens mentionnent, dont trop peu avouent l’importance : on ne sait pas qu’il demanda au roi de France en fuite de bien vouloir lui confier la personne du jeune Henri V, (…) que le vieux roi inclinait à accepter l’offre d’un Prince qu’il estimait, qu’il y eut une opposition radicale, absolue et décisive de la part de la mère du jeune roi, et que Madame la Duchesse de Berry l’emporta de toute la fougue de sa jeunesse, de sa volonté et de sa passion. »
Aussi est-ce cette sincérité de la démarche de Louis-Philippe, en quelque sorte Roi des Français malgré lui et à défaut du Roi de France en exil puis de son petit-fils, qui, aux yeux de Maurras, fait échapper Louis-Philippe au qualificatif d’usurpateur.
« (…) Comment pas se dire que la démarche du lieutenant-général était sincère, que Charles X avait raison de la tenir pour telle, et que si elle eût réussi, l’histoire aurait eu à admirer, au XIXe siècle, une régence aussi belle, aussi vertueuse, forte et fidèle, que la régence du XVIIIe siècle avait peu mérité ces qualifications.
Le règne fut illégitime. Mais il ne fut pas usurpé, puisque le souverain légitime était en fuite que la révolution, maîtresse de Paris, devait être matée, matée à tout prix, comme la France sauvée, sauvée à tout prix. »
Intéressante distinction que celle entre illégitimité et usurpation. Illégitime au sens strict du droit, Louis-Philippe l’était en tant que roi des Français, et non pas en tant que lieutenant-général ou que régent. Usurpateur, il ne l’a jamais été du fait qu’il conçut son règne avant tout précisément comme une régence, ce que la réconciliation de 1883 entre les deux branches prouve historiquement à ses yeux. Là encore, la finalité gouverne les moyens :
« Puisque le souverain légitime était en fuite que la révolution, maîtresse de Paris, devait être matée, matée à tout prix, comme la France sauvée, sauvée à tout prix ».
Si la loi salique fut évidemment bafouée de 1830 à 1848, il n’en reste pas moins que celle-ci a été mise entre parenthèses par nécessité historique à partir du moment où l’abdication de Charles X et l’impossibilité où était le dauphin légitime, à savoir Henri V, son petit-fils, d’accéder au trône, il restait à assurer « à tout prix » la survie de la nation, qui est l’objet même d’une loi salique qui n’aurait sinon plus aucun sens. On a rappelé que la tradition chez Maurras est critique. Celle de la loi salique a été passée au crible de l’urgence nationale, qui commandait à Louis-Philippe d’être là et d’y rester. Il n’en reste pas moins que, comme Maurras le précise dans sa Politique du 29 septembre 1920, où Maurras informe ses lecteurs que le duc d’Orléans, « Philippe VII », a donné « l’ordre de faire célébrer à Paris, dans la paroisse des rois de France, le centenaire de la naissance du duc de Bordeaux », Maurras tient à rappeler que :
« Le gouvernement de Juillet, qui eût pu faire une si belle Régence, était déjà une erreur. Le second Empire et la seconde République étaient d’autres erreurs plus fortes. La troisième République en était une nouvelle. Nous avons payé et nous payons encore tout cela. »
Et de rappeler le programme salvateur du comte de Chambord, tel qu’il apparaissait notamment dans la lettre de Henri V au général de Saint-Priest :
« Un pouvoir fondé sur l’hérédité monarchique, respecté dans son principe et dans son action, sans faiblesse comme sans arbitraire ; le gouvernement représentatif dans sa puissante vitalité ; les dépenses publiques sérieusement contrôlées ; le règne des lois, le libre accès de chacun aux emplois et aux honneurs, la liberté religieuse et la liberté civile conservée et hors d’atteinte ; la propriété foncière rendue à la liberté et à l’indépendance par la diminution des charges qui pèsent sur elle ; l’agriculture, le commerce et l’industrie constamment encouragés, et au-dessus de tout cela une grande chose : l’honnêteté, qui n’est pas moins une obligation dans la vie publique que dans la vie privée. L’honnêteté qui fait la valeur morale des États comme des particuliers. »
Pour Maurras, l’échec du comte de Chambord à monter sur le trône et à rétablir la monarchie à la fois traditionnelle, moderne et populaire — ces trois éléments se complétant à ses yeux — prouve bien que les qualités qui font le politicien républicain ne sont pas celles qui font le grand roi.
Aussi l’important à ses yeux est-il l’absence de solution de continuité : les Orléans ont recueilli un héritage que l’exilé de Frohsdorf avait maintenu intact. Il va jusqu’à parler de « fusion », comme pour bien insister sur la permanence, la transmission intégrale — un terme maurrassien que nous employons à dessein — de la tradition monarchique de la branche aînée, éteinte, à la branche cadette.
« On ne dira jamais avec quelle piété exacte, scrupuleuse, le comte de Paris a su recueillir à la mort du comte de Chambord cette tradition de la monarchie légitime, de sa raison, de son droit et de sa doctrine. Les témoins et les confidents de ce règne en exil, si appliqué et si laborieux, admirèrent surtout combien la sociologie du comte de Paris, si haute et si sagace, tendit de plus en plus à vérifier les voies de son auguste prédécesseur. La fusion qui s’accomplissait de la sorte était la vraie ; celle des idées, celle de l’esprit. L’esprit qui avait construit la France, les idées capables de la relever. »
Et de s’écrier, dans son article de L’AF sur la mort de Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon, le 29 juin 1910 :
« À moi, Nemours ! À moi d’Aumale ! À moi Joinville !
Certes, c’eût été beau, ce cri dans notre ville…
Aux vieux vers de Musset (Alfred de Musset, Le Treize Juillet, pour la mort du duc Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans, en 1842), répondaient le regard enthousiaste du comte de Chambord à la vue de cette gerbe de jeunes princes, la plus belle et la plus brillante d’Europe, et qui eût assuré à la vie nationale de jeunes chefs résolus, audacieux et sages, menant tous nos progrès dans l’ordre de leur Roi ! »
Et d’évoquer dans un article du 4 avril 1926 où il revient sur la mort du duc d’Orléans :
« Ces fusionnistes ardents, dignes des « politiques » auxquels Henri IV a dû sa couronne, qui, pendant un quart de siècle, travaillèrent à réconcilier Bourbon et Orléans et qui virent enfin l’effort couronné. La question du drapeau soulevée plus tard reste un malentendu d’origine parlementaire. « Je n’ai pas été compris », disait le comte de Chambord au marquis de la Tour du Pin, qui l’a raconté. »
Du reste, c’est précisément à la mort de « Philippe VIII » que Maurras tient à insister sur les différents aspects de cette fusion. Il faut savoir que le duc d’Orléans était le cadet d’un an de Maurras, qui trouvait dans ce prétendant un homme de son exacte génération : lorsqu’ils se rencontrent pour la première fois en 1902 à Gênes, ils ont respectivement 34 et 33 ans : ce sont donc deux hommes jeunes et pleins d’énergie pour la lutte à mener, d’autant que les événements ont déjà montré, en dépit de l’exil qui frappe les aînés de la famille de France, l’intérêt du duc d’Orléans pour la chose publique. Avant même son engagement dans l’affaire Dreyfus pour défendre l’armée, n’a-t-il pas fait quatre mois de prison et mérité le surnom populaire de Prince Gamelle pour avoir voulu faire son service militaire comme tout jeune Français en dépit de la loi d’exil ? C’était en 1890. Il est intéressant de noter que Maurras n’est pas encore monarchiste, il pense à l’époque que la monarchie est terminée — il la qualifie même de « cadavre » dans une lettre à l’abbé Penon, à l’occasion du Ralliement — mais cette provocation, conforme aux yeux du jeune Maurras à la légitimité historique du jeune Prince, suscite alors son admiration. Cette légitimité historique, aux yeux de Maurras, le duc d’Orléans la conformera encore lorsqu’au début de la guerre, en août 1914, le Prince demande à servir dans l’armée française : après avoir essuyé le refus de Viviani, il essuie également celui des souverains belges et anglais, à la demande secrète de la république française, ce qui fait écrire à Maurras que l’Union sacrée est en un seul sens. Aussi se consacra-t-il au soin des blessés.
Bref, en dépit de quelques brouilles au début de la naissance du quotidien L’Action Française entre la jeune équipe et celle, plus vénérable, qui entourait le duc d’Orléans, c’est une véritable amitié politique et intellectuelle qui unissait Maurras au prince. L’historienne spécialiste de la famille d’Orléans qu’est Dominique Paoli ajoute dans son article « Les Princes de Maurras » paru dans le Cahier de l’Herne consacré à Maurras : « Au fil des années et de leur correspondance, on voit chez le Prince s’ajouter l’affection à l’admiration ». Du reste, c’est la formule du duc d’Orléans, « Tout ce qui est national est nôtre », formule de janvier 1900, que reprend le journal, formule qui non seulement résume le « nationalisme intégral » qu’est la monarchie aux yeux de Maurras mais encore justifie cette finalité historique que Maurras assigne à la loi salique.
Or sur quoi insiste Maurras dans l’article qu’il écrit dans L’AF du 29 mars 1926 sur la mort du duc d’Orléans ?
« Nous ne nous lassons pas de le répéter, Henri V, comte de Chambord, avait restitué les principes sans lesquels rien n’eût pu renaître. Philippe VII, comte de Paris, adaptant ses principes aux nécessités administratives et sociales du jour, les avait ainsi dégagés de tout archaïsme. Mais le duc d’Orléans, mais Philippe VIII, mais « Philippe », comme nous disions, fort des idées, fort des doctrines de ses prédécesseurs, s’était engagé, pour sa part, bien au-delà : il était dans le vif des actions et des réactions nationales le plus confuses. (…) De 1894 à 1926 on peut dire qu’une partie de la haute société parisienne s’est ralliée à la République, mais on peut dire aussi que, dans le même laps de temps, une partie considérable du gros peuple et de la petite bourgeoisie, autrefois républicaine, a viré de bord et mis le cap sur la monarchie. (…) sa politique n’a pas varié d’un iota (…) avant tout traditionaliste et légitimiste. (…) »
Aussi commettrait-on une grave erreur en voyant dans la fidélité de Maurras aux Bourbon-Orléans une quelconque preuve d’orléanisme, dans ce que ce concept peut avoir d’idéologique. On l’a vu lorsqu’il regrette que le « parti » de Louis-Philippe ait si souvent mis des bâtons dans les roues du roi des Français. On le voit encore non seulement dans sa célébration de la politique sociale du comte de Chambord, telle qu’elle apparaît dans la Lettre de celui-ci Sur les ouvriers du 20 avril 1865, mais également dans l’article qu’il consacre dans la Revue d’Action Française, le 2 février 1901, à la mort du duc Albert de Broglie (né en 1821), chef orléaniste bien connu de la IIIe République, descendant lui-même d’une dynastie orléaniste qui a traversé tout le XIXe siècle. Or dans cet article, Maurras, précisément, « exécute le principe consubstantiel de l’Orléanisme : l’alliance de la Couronne et de la Révolution »[1]
À suivre…
Axel Tisserand
Professeur agrégé de lettres classiques,
Docteur de l’École pratique des hautes études en sciences religieuses
[1] Introduction au texte sur http://maurras.net/textes/96.html
Publication originale : Axel Tisserand, « Maurras, L’Action Française et les Princes », dans Collectif, Actes de la XXe session du Centre d’Études Historiques (11 au 14 juillet 2013) : Les Bourbons et le XXe siècle, CEH, Neuves-Maisons, 2014, p. 251-268.
Consulter les autres articles de l’ouvrage :
► Préface, par Monseigneur le Duc d’Anjou (p. 5-6).
► Avant-propos, par Jean-Christian Pinot (p. 7-8).
► « Naples et Rome, obstacles à l’unité politique de l’Italie », par Yves-Marie Bercé (p. 13-26).
► « Le roi Juan Carlos et les Bourbons d’Espagne », par Jordi Cana (p. 27-35).
► « Deux décennies de commémorations capétiennes : 1987, 1989, 1993, 2004, etc. », par Jacques Charles-Gaffiot (p. 37-49).
► « L’abrogation de la loi d’exil dans les débats parlementaires en 1950 », par Laurent Chéron (p. 51-67)
► « De Gaulle et les Capétiens », par Paul-Marie Coûteaux (p. 69-97) :
► « De Chateaubriand à Cattaui : Bourbons oubliés, Bourbons retrouvés », par Daniel de Montplaisir (p. 99-108).
► « Les relations Église-État en Espagne de 1814 à nos jours », par Guillaume de Thieulloy (p. 109-124) :
► « Autour du livre Zita, portrait intime d’une impératrice », par l’abbé Cyrille Debris (p. 125-136) :
► « La mission Sixte : la tentative de paix de l’Empereur Charles Ier », par le Pr. Tamara Griesser-Pecar (p. 137-157) :
► « Les stratégies matrimoniales », par le Pr. Philippe Lavaux (p. 159-170) :
► « Les Bourbons dans les Carnets du cardinal Baudrillart », par le père Augustin Pic (p. 171-188).
► « Un Roi pour le XXIe siècle », par Philippe Pichot-Bravard (p. 189-196).
► « Le Prince Sixte : la nationalité des descendants de Philippe V et la succession de France », par Jean-Christian Pinot (p. 197-206).
► « Les entrevues de 1931 entre Jacques Ier et Alphonse XIII ainsi que tout ce qui s’en suivit », par le baron Hervé Pinoteau (p. 207-218).
► « Le carlisme : fin et suite », par le Dr Jean-Yves Pons (p. 219-230).
► « Le Prince Xavier de Bourbon-Parme, du premier conflit mondial à Dachau, de la France à l’Espagne », par le Dr Jean-Yves Pons (p. 231-238).
► « Les Bourbons à Versailles au XXe siècle », par Vivien Richard (p. 239-250).
► « Maurras, L’Action Française et les Princes », par Axel Tisserand (p. 251-268) :
- Partie 1 : Le fusionnisme maurrassien
- Partie 2 : Les trois devoirs des royalistes
https://www.vexilla-galliae.fr/civilisation/histoire/maurras-laction-francaise-et-les-princes-par-axel-tisserand-partie-1-le-fusionnisme/