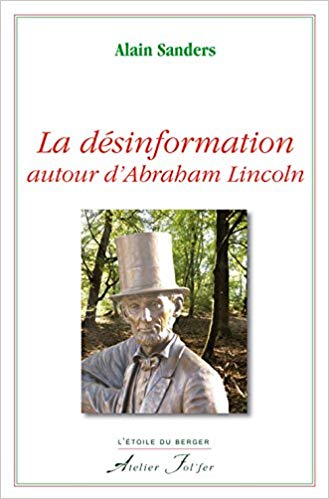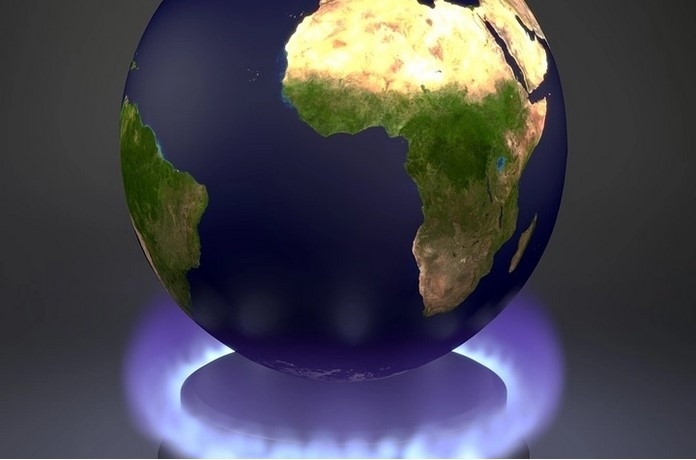Ce texte a été publié dans le numéro 68 de la revue Liberté politique, pour le dossier consacré à l’Ecole. Ce numéro est actuellement en vente sur le site de Liberté politique.
Les écoles, les familles, les mouvements de jeunesse, l’Église elle-même parlent volontiers d’une éducation chrétienne, c’est-à-dire une formation intégrale de la personne, dans tous ses aspects, à la lumière de l’Évangile, devant contribuer à préparer des hommes et des femmes libres, disciples joyeux de Jésus Christ. Mais de pédagogie il est moins souvent question, quoiqu’on évoque volontiers la pédagogie de Dieu dans la manière dont le Créateur amène peu à peu son peuple à la Révélation complète, au long de l’Histoire sainte. Ce point est essentiel ; on parle bien de manière de faire.
En effet, la pédagogie, terme polysémique, peut être à la fois comprise comme synonyme de l’éducation, donc enseignement complet, et comme manière d’instruire, en somme comme méthode. Le dictionnaire de l’Académie française, dans sa neuvième édition, la définit, pour l’instruction et l’éducation des enfants comme « l’ensemble de procédés employés pour les instruire et les former en fonction de certaines fins morales et sociales ». Mais aussi, en deuxième sens possible, voisin, comme une « discipline théorique visant à définir des méthodes d’enseignement, à déterminer de nouvelles pratiques éducatives ». La pédagogie, lorsqu’elle est distinguée de l’éducation, est donc avant tout une manière de faire et d’être qui s’inscrit dans une démarche éducative dont elle est une part.
Ce premier point établi on peut plus aisément se demander s’il y a une pédagogie chrétienne. Le chrétien se revendiquant disciple de Jésus Christ, il est raisonnable de considérer le Verbe de Dieu comme le socle de la pédagogie. C’est à son exemple et son imitation que le pédagogue chrétien peut le plus raisonnablement agir.
La pédagogie de Jésus-Christ
Comment Jésus-Christ enseignait-il sa Parole ? Comment préparait-il ses interlocuteurs à cette chose extraordinaire qu’est, par lui, la rédemption de l’humanité ?
Suivons-le dans sa position enseignante, au long de l’Évangile de saint Marc, qui servira de texte témoin. La première manière dont il enseigne est celle d’un homme qui a autorité. Il enseigne en maître légitime, qui a un dépôt de science à offrir aux hommes.
Au chapitre premier de cet Évangile, des versets 21 à 28, nous pouvons lire :
Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.
Comme nous le voyons, Jésus-Christ enseigne dans un lieu d’étude et de prière, la synagogue, et en maître, au grand étonnement de tous. Sa puissance souveraine s’étend aux démons qu’il peut chasser d’un simple commandement. Cette force augmente encore l’autorité dont il est revêtu dans son enseignement. En tant que maître de la parole, sa renommée est grande puisqu’elle couvre toute la Galilée. En somme, le maître a une posture adéquate, il est légitime, et son enseignement est reconnu.
Cette autorité se retrouve à plusieurs reprises. On peut lire, au chapitre deuxième, verset 13 : « Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les enseignait », ou encore au chapitre sixième, verset 2 : « Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : “D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?” »
Cette position du maître est essentielle. Jésus-Christ enseigne à chaque instant en homme qui sait, et sa parole, toujours à propos, ne souffre pas de répartie, elle est magistrale. Pourtant, ce n’est pas un maître distant ou hautain. Au contraire, à la différence des pharisiens, c’est un maître qui fait si grand cas de la valeur de la parole à transmettre qu’il va vers tous, les publicains et les prostituées autant que les scribes et les pharisiens.
En outre, si cette parole est dite d’en-haut, elle demeure recevable dans sa forme, par ses auditeurs. Le fond de son enseignement parut souvent scandaleux aux Hébreux de son temps, mais la parabole dont il faisait un usage si fréquent leur était coutumière. En somme, il savait parler le langage de tous les hommes et être accessible, loin des cultes à mystères, nombreux alors dans le bassin méditerranéen.
Accessible sans perdre de sa hauteur, Jésus-Christ était également disponible pour répondre à toutes les questions, quelles qu’elles fussent, timides ou audacieuses, naïves ou vicieuses, de ses disciples comme des pharisiens. Il savait prendre le temps pour enseigner. Au chapitre quatre, par exemple, intervient la parabole du semeur, et comme les apôtres ne comprennent pas le sens de ce récit, il leur en donne un commentaire, des versets 10 à 20 :
Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les Douze l’interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C’est à vous qu’est donné le mystère du royaume de Dieu ; mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète : Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas ; ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas ; sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la Parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée : quand ils l’entendent, Satan vient aussitôt et enlève la Parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux : ceux-là, quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie ; mais ils n’ont pas en eux de racine, ce sont les gens d’un moment ; que vienne la détresse ou la persécution à cause de la Parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d’autres qui ont reçu la semence dans les ronces : ceux-ci entendent la Parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : ceux-là entendent la Parole, ils l’accueillent, et ils portent du fruit : trente, soixante, cent, pour un. »
L’incompréhension des apôtres se répète au chapitre sept. Jésus-Christ s’agace un instant de la lenteur d’esprit de ceux qu’il a choisis pour ses disciples, au verset 18, leur disant : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? », car le maître sait admonester lorsqu’il le faut, et on connaît la palette de l’injure christique, entre « race de vipère » et « sépulcres blanchis », mais aussi ses colères, comme l’expulsion des marchands du temple à grands coups de fouet.
Dans ce chapitre sept, cependant, s’il perd patience, il explique de nouveau sa pensée et leur fait comprendre que ce n’est pas ce qui entre dans la bouche de l’homme qui est impur, mais les paroles venimeuses ou fausses qui en sortent.
Jésus-Christ répond aux questions sans jamais se dérober, jusque dans les instants les plus tragiques, où un silence le sauverait, comme face au prêtre Caïphe ; il lui arrive également d’en poser, pour susciter la réflexion chez ses disciples. C’est pourquoi on peut véritablement dire que son enseignement, d’abord magistral, se mue peu à peu en dialogue, au fur et à mesure que les disciples croissent en connaissance. C’est pourquoi il leur demande, au chapitre 8, des versets 27 à 29 :
Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »
Un maître enseignant
Toute occasion est bonne pour enseigner. C’est pourquoi au chapitre 9, Jésus-Christ, demandant à ses apôtres de quoi ils discutaient seuls en route, et ceux-ci lui ayant avoué qu’ils s’interrogeaient pour savoir lequel était le premier d’entre eux, au lieu de les morigéner pour cet orgueil imbécile, leur explique que nul ne peut être le premier, s’il ne s’est fait avant le serviteur de tous.
En somme, il ne se départit jamais de sa place de maître enseignant, lorsqu’il est en présence de ceux qu’il doit instruire préférentiellement, c’est-à-dire ses disciples.
Enfin, Jésus-Christ est un maître doux au naturel, comme il a pu le montrer au chapitre cinq en guérissant la femme hémorroïsse, lui enseignant que c’est sa foi qui l’a sauvée : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Les trois autres Évangiles et de nombreux passages de saint Marc, encore, confirment cette manière d’enseigner de Jésus-Christ, que l’on pourrait résumer par une centralité du maître qui annonce avec autorité un savoir connu de lui, qui ne se départit jamais de sa fonction enseignante devant ses disciples, mais qui reste toujours accessible, répondant aux questions, les posant pour susciter la réflexion, ne se dérobant pas, admonestant parfois, étant doux et sans préjugés toujours.
Une pédagogie qui n’aurait pas de finalité serait creuse. Le Seigneur veut révéler le sens de son passage sur terre, faire comprendre la portée de son sacrifice et parfaire la Révélation en vue de l’avènement du Royaume de Dieu, afin d’y préparer les hommes par leur conversion qui ne peut passer que par lui, se réaliser en lui. C’est pourquoi, le savoir qu’il transmet aux disciples a une visée pratique. Une fois formés, ils sont envoyés en mission. Déjà, dans l’évangile de saint Marc, il les envoya deux par deux annoncer sa parole. Mais c’est au seizième et dernier chapitre qu’il leur commanda :
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. »
En somme, ayant reçu son enseignement de manière complète puisque ayant entendu ses paroles de son vivant et cru en sa résurrection, les apôtres sont désormais des disciples accomplis, aptes à aller leur chemin, à leur tour, pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi on peut bien dire que cette pédagogie, c’est à dire cette manière de faire, s’intégrait au service d’une éducation intégrale faisant croître des hommes debout.
I- La pédagogie de l’Enseignement catholique
Cette pédagogie est-elle présente dans l’éducation chrétienne actuelle en France ?
La pédagogie dans les documents officiels de l’Enseignement catholique
L’école est le lieu d’épanouissement par excellence de la pédagogie. L’institution scolaire chrétienne la plus notable, en France, est l’Enseignement catholique, qui regroupe les écoles privées catholiques sous contrat d’association avec l’État et scolarise 2 000 000 d’élèves environ.
Quelle est la place accordée à la pédagogie dans l’esprit même de cette structure, et celle-ci est-elle chrétienne ?
Si nous nous référons au Statut officiel de l’enseignement catholique, publié en 2013, le terme de pédagogie revient dans treize articles. À l’article 39, la pédagogie s’inscrit dans l’attention aux faibles et aux pauvres, et doit rechercher l’inventivité pour leur répondre. À l’article 48, nous apprenons que les parents doivent être tenus informés des méthodes pédagogiques des établissements scolaires, ce qui nous permet de noter que les méthodes pédagogiques peuvent varier d’un établissement à l’autre. À l’article 74, nous arrivons au cœur du problème. La pédagogie, pour l’enseignement catholique, est ainsi définie :
La mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ. Elle déploie solidairement une attention : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? », un appel toujours personnel : « Viens… », une confiance en chacun : « Va… », une promesse d’accompagnement : « Je serai avec vous… »
Cette affirmation est renforcée à l’article 86, disposant que la formation des professeurs, dans la pédagogie, la relation éducative et la didactique doivent accorder les dimensions académiques et la conception chrétienne de l’homme. Cet article a toute son importance, car il tient compte d’une particularité de l’enseignement privé sous contrat avec l’État, dans lequel l’employeur du professeur est l’État, qui lui verse un salaire et a signé un contrat de travail avec lui. En conséquence, le professeur doit suivre les recommandations professionnelles de l’État. Mais l’enseignement catholique souhaite que l’application de celles-ci n’écarte pas l’approche chrétienne de l’homme, ce que l’on peut retenir comme un appel à appliquer la pédagogie du Christ.
L’article 112, lui, prévoit que nul, dans les personnels, ne soit écarté de la conception et de la mise en pratique de la pédagogie de l’établissement scolaire. Ce qui est confirmé à l’article 123 où le conseil d’établissement est réputé capable de formuler avis sur le projet pédagogique.
L’article 145 confère la responsabilité pédagogique de l’établissement à son directeur, sous les encouragements de l’autorité de tutelle de l’école, qui peut être diocésaine ou congréganiste, d’après l’article 182. Laquelle tutelle veille à l’enracinement chrétien de cette pédagogie d’après l’article 183. Le prêtre référent de l’établissement, lui-même, doit être tenu au courant et informé sur la pédagogie en cours, d’après l’article 224, notamment du fait que chaque école a son identité, ses spécificités et sa capacité d’innovation dans ce domaine, comme le rappelle l’article 240.
Cet édifice est chapeauté par le secrétaire général de l’Enseignement catholique, qui veille, article 361, à l’animation du réseau des écoles, dans leur dimension pédagogique.
Faiblesses
Il ressort de ces articles que la pédagogie, dans sa conception chrétienne, est tout à fait centrale et que l’Enseignement catholique entend en rester le pilote. Pourtant, quelques faiblesses se remarquent immédiatement.
D’une part, la pédagogie chrétienne n’est jamais clairement définie. Dans l’article 74 qui présente le plus directement cette notion de « pédagogie du Christ », on y retrouve l’attention de Jésus-Christ à tous, la confiance qui ne se lasse jamais et cette présence du pédagogue auprès de ses élèves, confirmée dans les autres articles. Mais la figure du maître est la grande absente.
Ce manque est gravement dommageable. En effet, l’étude rapide de l’Évangile de saint Marc a montré que tout partait de cette place du maître. Son autorité le rend légitime pour délivrer un contenu d’enseignement, mais aussi pour prêter toute son attention à chacun. Sans le maître au départ, le pédagogue s’appuie sur une légitimité bancale.
Cette absence est aisément compréhensible. Elle se retrouve dans la plupart des ouvrages pédagogiques actuels, à ce point centrés sur l’élève qu’ils en oublient que l’enseignement repose au préalable sur une parole ou un écrit hors de l’être du maître vers ses élèves. Ce n’est que si ce point est assuré que l’attention autour du petit ou du faible peut s’exercer, que les méthodes de mise en activité des élèves peuvent s’épanouir.
D’ailleurs, cette place du maître, qui tend à être effacée dans les recommandations pédagogiques actuelles au sein de l’Éducation nationale, revient au galop, comme le naturel. Le maître reste une figure aimée des élèves, qui attendent que l’instruction vienne de lui, alors que leurs professeurs tentent de s’effacer depuis les petites classes. Mais rien n’y fait, l’élève veut toujours un maître. Mieux encore ! Si les pédagogies recommandées par les inspecteurs de l’Éducation nationale, dans la plupart des matières, sont bien de faire naître le savoir des élèves par leurs recherches documentaires propres, sous la coordination la plus accompagnante possible de l’enseignant, dans la pratique, en classes de 3e et de terminale, lorsqu’approchent le brevet et le baccalauréat, le cours magistral dicté en catastrophe retrouve tous ses droits, et après avoir camouflé le maître, l’urgence conduit à l’hypertrophie magistrale, également dommageable car autant excessive.
De deux choses l’une ; soit le maître est devenu une figure inutile, et les élèves devraient pouvoir apprendre largement par eux-mêmes, accompagnés par un enseignant, du début à la fin de leur scolarité. Mais dans ce cas pourquoi avoir recours au maître comme à la solution la plus efficace et aisée en cas d’urgence ? Soit le maître a encore toute sa place, et il faut la lui rendre pour éviter les excès d’un cours ennuyeux, intégralement dicté en magistral, lorsqu’il n’est plus possible de faire autrement.
Les deux excès présentés ici ne sont absolument pas chrétiens. La pédagogie du Christ module à merveille la position du maître et l’accompagnement dans la croissance du disciple. Il conviendrait que cela soit mieux mis en valeur par les textes de l’Enseignement catholique.
En effet, si nous nous penchons dans d’autres publications de l’Enseignement catholique, nous y retrouvons un grand souci de la pédagogie, mais sans qu’elle ne soit clairement définie.
Par exemple, le document Un souffle nouveau pour le collège, publié en 2015 à l’occasion de la réforme actuellement en cours, s’appuie sur une anthropologie réaliste, invitant à prendre l’élève tel qu’il est, dans toutes ses dimensions, corps et âme, avec son vécu, pour le mener à une réussite éducative avant tout. Nous sommes dans une démarche de bienveillance, si souvent mise en avant par l’école catholique. Évidemment, la pédagogie, c’est-à-dire la manière de transmettre, est centrale pour réussir ce pari de la réussite d’un élève selon ses talents. On retrouve dans le texte les termes de « pédagogie innovante », « innovations pédagogiques », « nouvelles pédagogies », « diversité pédagogique », « pédagogie du projet », « pédagogie du choix », « pédagogie différenciée », « équipes pédagogiques », « journées pédagogiques », « projets pédagogiques. »
Ces termes recouvrent, en réalité, une grande pluralité de situations. Les « innovations pédagogiques » sont des manières expérimentales d’enseigner, comme par exemple la classe inversée, dont le principe est, durant quelques séances, d’inciter les élèves à réaliser un travail de recherche en amont, afin de préparer eux-mêmes le contenu du cours, sous la coordination de leur enseignant. La « pédagogie du projet » ou du « choix » est l’attention portée à l’orientation de l’élève dans sa connaissances des voies possibles, selon ses capacités. Ici on dépasse le cadre du cours pour entrer dans celui de l’établissement en général. « Pédagogie différenciée » fait appel à un enseignement par groupes, au sein de la même classe, en fonction des niveaux d’élèves, afin de permettre au professeur d’adapter son cours, mais aussi aux élèves de travailler en plus grande autonomie par équipes homogènes. Les trois derniers termes, eux, font appel à des structures institutionnelles, à savoir les groupes d’enseignants et d’encadrants, le temps qu’ils consacrent à réfléchir à leur pratique professionnelle et le projet commun qui les anime dans l’établissement.
La pédagogie recouvre un vaste champ, mais le terme de pédagogie chrétienne est absent. L’éclairage chrétien, s’il est sous-entendu peut-être, n’est jamais explicite. Enfin, le grand absent reste le maître, encore une fois, dans une pratique avant tout centrée sur l’élève acteur, oubliant ou minimisant à l’extrême l’élève récepteur.
L’ambition de ce document est de participer, dans le collège de demain, à « former des personnes libres, responsables, sachant vivre avec les autres ». C’est l’ambition de l’Enseignement catholique, mais aussi de l’enseignement public, quoiqu’il l’affirme avec moins de force dans ses textes officiels. Comment faire si le maître est l’absent ?
Le mur du « comment faire » ?
Plus nous avançons dans notre lecture de ce texte, plus nous nous heurtons à ce mur du comment faire ?
En effet, ce document majeur invite au renouvellement des pratiques pédagogiques devant les mutations des comportements et des références des adolescents. Il invite à contribuer au « développement intégral de la personne », dans lequel s’intègre bien sûr la pastorale. Il invite à repenser le rapport des professeurs et des élèves à l’erreur, pour en faire, non pas un échec mais un point de départ pour apprendre de nouveau. Tant de choses vraies, mais qui souffrent d’un manque de définition strict de la pédagogie chrétienne.
Ce manque est d’autant plus criant au moment où la réforme du collège va augmenter la liberté d’action des équipes enseignantes et de direction dans leurs choix éducatifs, au sein des établissements, et où il faudra, pour l’école catholique, profiter à plein de ces nouvelles libertés.
Les autres documents disponibles sur le site Internet du secrétariat général de l’Enseignement catholique, et qui constituent une très précieuse base de données pour l’exercice du métier d’enseignant ou d’encadrant, nous laissent autant sur notre faim. Le hors-série de Enseignement catholique, Actualités, de 2013, sur le thème « Avons-nous besoin de l’enseignement catholique ? », question qui avait suscité alors un débat national dans les établissements, parle de « défi pédagogique », « pédagogie de la réussite », « pédagogie de la confiance », « innovations pédagogiques », « combat pédagogique », « projet pédagogique individualisé », mais ne définit jamais la pédagogie et ne parle pas de sa spécificité chrétienne.
Pourtant on ne peut pas accuser ces documents de manquer de concret. Les témoignages abondent, comme dans le hors-série de 2011 « Des États-généraux pour l’animation », qui mentionne l’utilisation de la pédagogie du scoutisme au collège-lycée La Maison française, ou de la formation commune des professeurs de l’enseignement général, technologique et professionnel dans le diocèse de Caen.
À l’usage des professeurs et personnels encadrants, le hors-série de 2006 « Changer de regard » donne des exemples de pratique dans l’organisation du cours ou l’usage de la discipline, mais encore et toujours, la particularité chrétienne de la pédagogie n’est pas définie et si le souci de l’élève est central, le maître est absent. De la même manière, le numéro de Enseignement catholique, Actualités d’août 2009 donne des pistes concrètes en pédagogie, comme l’octroi de plus larges responsabilités aux élèves dans l’échange des savoirs, l’engagement au sein de la vie des écoles, le tutorat des plus jeunes ou des plus faibles, ou encore la responsabilisation des élèves dans leur orientation. Mais toujours, le maître est oublié et la pédagogie chrétienne n’est pas définie. À vrai dire, même si toutes ces recommandations puisent leur eau à la source de l’Évangile, on peut même penser qu’il n’est point besoin d’être chrétien pour les mettre en œuvre. Alors qu’est devenu, ici, le caractère propre de l’école catholique ?
Pour conclure sur cette rapide exploration, mentionnons deux outils majeurs mis à disposition des professeurs, le document hors-série d’août 2007 Être professeur dans l’enseignement catholique, et sa suite de 2009, Pour travailler en équipe le document « Être professeur dans l’enseignement catholique ». Ces deux livrets, fort utiles pour la formation, sont résolument chrétiens. Le professeur qui les utilise en conscience ne peut pas ne pas être touché par eux, dans sa pratique professionnelle. Ils insistent sur la spécificité de l’enseignement catholique, le cadre légal dans lequel peut évoluer le professeur et comment utiliser au mieux sa liberté. Le document de 2009, notamment, reprend chaque passage de celui de 2007 avec des textes de l’Écriture sainte devant aider à mieux les comprendre dans un angle chrétien. À propos de ces extraits, d’ailleurs, on remarque que nulle part il n’est fait allusion à l’enseignement avec autorité de Jésus-Christ.
On peut donc dire que dans sa documentation officielle l’enseignement catholique, à côté d’une éducation chrétienne bien définie et balisée, propose une pédagogie plus incomplète et tâtonnante quant à sa spécificité et sa conformation à l’exemple de Jésus-Christ. Disons que tout y est sauf la figure essentielle du maître, dont tout part. Pour que Jésus soit appelé ami par des disciples devenus adultes dans la foi, il faut d’abord que Jésus leur maître leur ait donné les enseignements nécessaires à la croissance. De la même manière, pour qu’un jour élèves et professeurs soient sur le même pied d’égalité, il faut d’abord que ceux-ci l’aient eu pour maître enseignant contribuant à leur croissance intellectuelle, physique, morale et spirituelle.
Dans la pratique professionnelle, qu’en est-il de cette pédagogie ?
II- La pression de l’Éducation nationale sur la pratique pédagogique dans l’Enseignement catholique
Un élève aura beau se trouver dans un établissement catholique où la vie sacramentelle et de prière est rayonnante, où les propositions pastorales sont multipliées et toutes alléchantes, il n’en restera pas moins vrai que la presque totalité de son temps dans les murs se sera déroulé dans une salle de classe, face à un professeur duquel il reçoit les enseignements.
C’est donc du professeur qu’il faut partir pour mieux percevoir la pédagogie dans l’enseignement catholique.
L’enseignant, dans une école catholique privée liée à l’État par un contrat d’association, est salarié par l’État. Il a signé avec lui un contrat de travail, c’est donc son employeur. Ainsi, tout professeur recruté par un chef d’établissement de l’enseignement catholique est, en fait, un agent de l’État, ce qui situe d’emblée le professeur dans une situation double, à la fois travaillant dans et pour une école catholique et dépendant d’un État qui ne l’est pas.
En tant qu’agent public de droit privé, il est soumis aux mêmes règles que ses collègues de l’enseignement public en matière de liberté pédagogique. Quelles sont-elles ?
Le Code de l’éducation dispose, depuis 2005, que :
La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
Quelles sont les dispositions de ce fameux L. 421- 5 ? Il permet l’institution dans les établissements d’un comité établissant les orientations pédagogiques, en général réunies dans le projet éducatif au sein des établissements catholiques. Le champ d’action de ce conseil est assez restreint. D’après le R 421-41-3, le conseil pédagogique peut coordonner les enseignements, les organiser par groupes de compétences, mettre en place des dispositifs de soutien aux élèves, coordonner la notation et l’évaluation dans l’établissement, accompagner l’orientation des élèves, veiller aux échanges linguistiques et culturels, établir des propositions pour l’organisation de l’accompagnement personnalisé, enfin, réaliser des propositions d’expérimentation pédagogique et participer à la rédaction du projet pédagogique.
En somme, ce conseil organise le volet pédagogique de la vie de l’établissement, mais son autorité s’arrête devant les portes des salles de classe. En conclusion, la plus grande partie du travail et de la semaine des élèves lui échappe. On devine comment cette barrière peut entraver l’instauration d’une pédagogie chrétienne dans le concret de l’enseignement.
Liberté sous instructions
En effet, pour revenir à l’article définissant la liberté pédagogique, notons tout de suite les limites qui reposent sur elle et entravent donc l’enseignant. Il est libre, à condition de respecter les programmes et les instructions du ministre, dans le cadre du projet d’école (nous avons vu que celui-ci s’arrête devant les portes des salles de classe) et sous le contrôle des membres des corps d’inspection.
Les programmes et instructions sont contenus dans le Bulletin officiel de l’Éducation nationale et leur précision est très variable d’une matière à l’autre pour l’enseignement secondaire. Par exemple, en philosophie en classe de terminale, il n’y a que quelques orientations générales sur les thèmes à aborder, les grandes notions à connaître et les auteurs à avoir lu au moins partiellement. Au contraire, en histoire-géographie, pour chaque thème, il est précisé la manière dont il doit être abordé, jusqu’aux exemples jugés incontournables, de telle sorte que le professeur devra, normalement, toujours commencer par l’étude d’un cas particulier avant de passer à la synthèse générale.
Au-delà du Bulletin officiel, les inspecteurs de l’Éducation nationale distillent, par académie, leurs recommandations, par des lettres circulaires et des instructions orales durant des inspections ou des journées de formation. Dans la plupart des matières, notamment en histoire-géographie et en langues vivantes, il est recommandé de faire sortir le savoir des élèves eux-mêmes, par l’étude des documents mis à leur disposition, le professeur devant naviguer d’un groupe à l’autre, pour veiller à la bonne mise en activité, orienter la recherche, donner la bonne parole méthodologique, mais surtout ne pas apporter de contenu magistral, celui-ci faisant l’objet d’une brève synthèse établie dans un deuxième temps à partir des conclusions des élèves, orientées par le professeur.
On conçoit bien que cette méthode, pour réussir, nécessite des élèves curieux et réceptifs, disciplinés et respectueux, un professeur infatigable et d’une rare compétence, toujours souple et adaptable, dans un contexte horaire largement supérieur à la simple heure de cours. En somme, il faut des sur-hommes dans un monde idéal. Faute de cela, l’édifice est souvent boiteux, donne des résultats satisfaisants au prix d’efforts herculéens et de programmes jamais terminés, avec toujours en fin d’année un retour complet au cours dicté ou pris en notes de manière magistrale pour boucler les thèmes essentiels.
Outre les défauts propres à cette pédagogie, on remarque que la figure chrétienne du maître est tout à fait absente de cette mise en pratique des contenus d’enseignement. S’il n’y a pas là de pédagogie résolument chrétienne, il ne saurait y avoir d’éducation parfaitement chrétienne non plus. L’attention au plus faible, la disponibilité à tous, le questionnement sont des éléments essentiels, mais il leur manque le fondamental.
Or, ici, la logique du contrat d’association prive les enseignants catholiques de la liberté de réaliser une pédagogie pleinement et complètement chrétienne. Seuls le Bulletin officiel et les inspecteurs peuvent franchir la porte de la classe avec le professeur, et si les inspections sont rares dans les faits, le poids moral de l’inspecteur engendre une loyauté étonnante des professeurs de l’Enseignement catholique envers l’Éducation nationale, dans le domaine de leurs matières. Ils obéissent en matière de pédagogie, sans pour autant être dupes, sachant prendre leurs libertés lorsque nécessité fait loi. C’est tout le paradoxe de cette étrange situation où celui qui garde le moins de prise sur les événements internes à la classe demeure le chef d’établissement, qui a pourtant la responsabilité générale de l’école.
Être ou ne pas être un bon professeur
L’encadrement de la pédagogie par le ministère va plus loin encore, puisqu’en dépit de la liberté accordée au conseil pédagogique, le Code de l’éducation encadre également l’organisation de la scolarité en cycles et la logique générale de l’évaluation en école primaire, dans son article L311-1. De même, les connaissances, mais aussi les compétences à acquérir sont définies dans chaque matière et pour chaque cycle de la scolarité par les programmes officiels, d’après l’article L331-3.
L’État va jusqu’à contrôler la manière dont l’école organise son emploi du temps général et la répartition de ses heures, de sorte qu’il peut encadrer la place prise par l’enseignement religieux, ainsi qu’en dispose l’article R442-36 :
L’organisation des services d’enseignement, dans les classes sous contrat d’association, fait l’objet d’un tableau de service soumis aux autorités académiques.
L’instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l’emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de la matinée ou de l’après-midi.
Les autres heures d’activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.
Enfin, les compétences attendues de tout enseignant, chiffrées au nombre de dix par le ministère, figurent au Bulletin officiel. Elles sont impératives et visent essentiellement à faire un bon fonctionnaire, loyal. Reconnaissons que certaines de ces recommandations, sur la posture d’autorité, l’usage d’un langage correct et respectueux, l’entretien d’une solide culture générale, sont de simple bon sens et ne font pas polémique. Ce qui est plus inquiétant est la mainmise totale de l’État sur ce qu’il convient d’être et de ne pas être pour un faire figure de bon professeur.
Une telle emprise laisse songeur, et l’on comprend à quel point il est difficile, pour l’enseignement catholique, de faire véritablement valoir une pédagogie chrétienne fondée sur l’imitation de Jésus-Christ, dans ses salles de classe.
III- Comment libérer la pédagogie de l’Enseignement catholique ?
L’enseignement catholique se trouve dans une situation paradoxale, puisqu’il est responsable de ses élèves, de ses locaux, de ses enseignements, mais ne dispose pas de ses professeurs. En outre, faute d’un nombre suffisant de chrétiens convaincus en France, le recrutement de professeurs et d’encadrants chrétiens est nettement en-dessous des besoins réels. Il n’est pas rare de ne trouver qu’un ou deux enseignants chrétiens convaincus dans une école catholique. Au mieux on trouvera, dans les situations les plus favorables, 20 ou 30 % de professeurs et d’encadrants chrétiens dans les établissements les plus protégés sur ce plan.
Cette pénurie se retrouve à l’échelon supérieur parmi les professeurs formateurs, qui animent les réseaux de réflexion pédagogique de l’enseignement catholique, où nombre d’enseignants soit ne sont pas chrétiens, soit sont en délicatesse avec l’Église pour un motif ou un autre, souvent matrimonial.
Ouvert à tous et soucieux de le rester, l’Enseignement catholique se trouve cependant dans la position où les chrétiens y sont ultra-minoritaires au cœur même de la structure. En outre, parmi les 211 900 adultes qui travaillent au sein de cet Enseignement, 135 000 sont des enseignants et dépendent à ce titre de l’État, qui est leur employeur et définit leurs objectifs et méthodes par le Bulletin officiel.
Il y a pourtant des moyens de sortir, par le haut, de cette situation délicate, pour peu que l’enseignement catholique le veuille et ancre d’avantage en Jésus-Christ sa pratique pédagogique. (Notons qu’il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’ancrage en Jésus-Christ déjà présent et actif dans l’Enseignement catholique, mais de chercher à voir comment faire mieux et plus, notamment en réinvestissant les salles de classe.)
Privilégier le recrutement de professeurs chrétiens est un vœu pieu. Les chefs d’établissement et directeurs diocésains font déjà leur possible à ce sujet, avec des ressources humaines peu importantes et l’obligation, avant tout, de pourvoir tous les postes et de recruter des enseignants compétents dans leur matière pour donner aux élèves la meilleure instruction possible.
Le pouvoir des chefs d’établissement
En revanche, il est possible d’agir à l’échelon supérieur, en affinant le recrutement des professeurs formateurs. Ici, il conviendrait de rompre avec une des pratiques phares de l’Enseignement catholique, celle de la cooptation, pour rendre plus de pouvoir de choix aux chefs d’établissements, aux directeurs diocésains et aux évêques, quitte à passer par-dessus la tête des instituts de formation, afin, dans un second temps, de leur procurer des formateurs plus en phase avec le caractère propre de l’institution. Certes, cela froisserait, à n’en pas douter, bien des susceptibilités. Mais peut-on agir autrement ? Sur un volume de formateurs plus réduit, il est possible de repérer et de recruter des enseignants chrétiens et compétents, aptes à former les futurs professeurs ou les professeurs au long de leur carrière, en accord avec la mission éducative et l’approche pédagogique de l’Enseignement catholique.
Depuis que les professeurs stagiaires de l’enseignement catholique ne passent plus par les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) mais par les Instituts supérieurs de formation de l’Enseignement catholique (ISFEC), structures propres à cet enseignement, cette démarche permettrait de mettre un premier pas dans les salles de classe.
En outre, le contrat d’association lui-même donne une certaine souplesse, dans la pratique, à la gestion du corps enseignant. Il est tout à fait possible, pour un établissement sous contrat, de panacher ses classes avec des parties hors contrat. Il est permis de recruter des professeurs hors contrat et de leur confier des cours ou des classes parfaitement détachés de l’État. Il est même possible, sous condition que ce deuxième emploi ne crée pas un revenu régulier supérieur au tiers du traitement octroyé par l’Éducation nationale, de confier des cours ou classes hors contrat à un professeur effectuant par ailleurs des heures sous contrat.
Cette souplesse permettrait de recruter des enseignants parfaitement libres, ou de faire intervenir des personnels issus de congrégations, pour introduire, au sein des équipes enseignantes, ce zeste de liberté et d’indépendance propre à faire évoluer positivement le reste du corps professoral sous contrat. Ainsi le permet l’article L442-5, dont voici un extrait :
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
Ce deuxième point pose la question des ressources financières pour salarier ces professeurs sur des fonds propres. Mais d’ores et déjà si les établissements en capacité de le faire agissaient de la sorte, cela créerait pour tout l’Enseignement catholique une dynamique positive. Le point du recrutement de professeurs religieux est plus délicat, compte tenu du très faible nombre de religieux, religieuses et prêtres actuellement disponibles en France. Cependant, si dans ce faible nombre, là encore, se dégageaient, venus de France ou de l’étranger, des personnels compétents détachés de leurs congrégations, même en petit nombre dans les établissements, cela augmenterait encore cette configuration de la pédagogie à la suite du Christ, sans rompre pour autant ce fil si précieux du contrat d’association. La nouvelle évangélisation ne doit-elle pas commencer ici, dans les écoles catholiques ? Quel homme est légitime pour évangéliser au loin, lorsqu’il n’a même pas essayé de le faire au milieu des enfants qui lui étaient confiés ?
Précieux contrat d’association ? Oui, il l’est, même s’il a créé une situation enfermante pour l’Enseignement catholique. En effet, sans ce contrat et les apports financiers qu’il conditionne, jamais l’école catholique ne pourrait scolariser 2 000 000 d’élèves en France. A contrario, jamais l’État ne pourrait se charger de ces élèves supplémentaires si l’école libre venait à disparaître ou diminuer considérablement. C’est donc un équilibre où chacun a besoin de l’autre et où, compte-tenu de cette nécessité du maintien du statu quo du contrat, avec un peu d’audace, l’Enseignement catholique peut s’emparer de bien des libertés, dans le cadre même du contrat.
Après tout, ce système du panachage entre le contrat et le hors contrat se fait déjà dans les établissements les plus privilégiés pour des options de langue ou des classes préparatoires aux grandes écoles, alors pourquoi pas pour des matières fondamentales ? C’est une liberté à prendre pour que l’enseignement catholique puisse faire rayonner le caractère propre de sa pédagogie dans toutes les dimensions de ses établissements.
En guise d’envoi, conservons bien à l’esprit que l’Enseignement catholique est une institution d’Église, en France, dont les établissements sont sous la tutelle des diocèses ou des congrégations religieuses. Or, pour qu’il y ait volonté d’instaurer ou restaurer une pédagogie chrétienne à la suite du Christ, encore faudra-t-il une volonté ecclésiale sereine et sans crainte.
Gabriel Privat