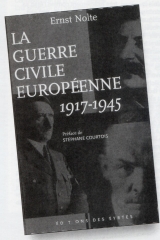 En publiant La guerre civile européenne, où il expose sa théorie du « nœud causal » entre communisme et nazisme, Ernst Nolte avait lancé voici une douzaine d'années la « querelle des historiens » en Allemagne et en Europe. Cet ouvrage essentiel vient enfin d'être traduit en français. Compte-rendu et entretien avec l'auteur.
En publiant La guerre civile européenne, où il expose sa théorie du « nœud causal » entre communisme et nazisme, Ernst Nolte avait lancé voici une douzaine d'années la « querelle des historiens » en Allemagne et en Europe. Cet ouvrage essentiel vient enfin d'être traduit en français. Compte-rendu et entretien avec l'auteur.
Les fins de siècle se prêtent aux bilans historiques, aux longues rétrospectives, à la tentation des grandes synthèses où l'historien essaie de donner un sens à la période qui déjà se dérobe. Lorsque le siècle considéré est aussi le sien, même l'étude apparemment la plus distanciée et savante recèle toujours une part autobiographique.
La fin du XXe siècle n'a pas échappé à la règle, avec en particulier trois gros livres, tous écrits par des historiens arrivés à l'automne ou au soir de leur vie. Si l'on s'en tient à l'ordre de parution de l'édition originale de chaque ouvrage, il y eut tout d'abord le livre du philosophe et historien allemand Ernst Nolte (né en 1923), Der europäische Burgërkrieg 1917-1945, paru en 1987 et qualifié par son auteur de « version longue » d'un retentissant article, « Le passé qui ne veut pas passer », publié le 6 juin 1986 par le plus prestigieux des quotidiens allemands, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Certains se souvenaient du nom de Nolte à cause de la lointaine traduction, à la fin des années soixante, de deux livres de lui consacrés aux fascismes. Mais des thèses soutenues dans Der europäische Burgërkrieg, on n'eut en France, à l'exception des germanistes et des historiens spécialistes de la période, qu'une connaissance très indirecte, par reflet, au travers de l'ouvrage collectif Devant l'histoire (Cerf, 1988), qui se faisait avant tout l'écho de la fameuse « querelle des historiens » allemands. Traduit et publié treize ans après sa parution, La guerre civile européenne est désormais disponible grâce au courage d'une jeune maison d'édition fondée et animée par Pierre-Guillaume de Roux, fils de l'écrivain et éditeur prématurément disparu. Sous-titré « National-socialisme et bolchevisme », il porte donc sur la période charnière du siècle écoulé, puisqu'il est évident que « la relation dialectique entre communisme et fascisme est au centre des tragédies du siècle » (1 ).
gros livres, tous écrits par des historiens arrivés à l'automne ou au soir de leur vie. Si l'on s'en tient à l'ordre de parution de l'édition originale de chaque ouvrage, il y eut tout d'abord le livre du philosophe et historien allemand Ernst Nolte (né en 1923), Der europäische Burgërkrieg 1917-1945, paru en 1987 et qualifié par son auteur de « version longue » d'un retentissant article, « Le passé qui ne veut pas passer », publié le 6 juin 1986 par le plus prestigieux des quotidiens allemands, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Certains se souvenaient du nom de Nolte à cause de la lointaine traduction, à la fin des années soixante, de deux livres de lui consacrés aux fascismes. Mais des thèses soutenues dans Der europäische Burgërkrieg, on n'eut en France, à l'exception des germanistes et des historiens spécialistes de la période, qu'une connaissance très indirecte, par reflet, au travers de l'ouvrage collectif Devant l'histoire (Cerf, 1988), qui se faisait avant tout l'écho de la fameuse « querelle des historiens » allemands. Traduit et publié treize ans après sa parution, La guerre civile européenne est désormais disponible grâce au courage d'une jeune maison d'édition fondée et animée par Pierre-Guillaume de Roux, fils de l'écrivain et éditeur prématurément disparu. Sous-titré « National-socialisme et bolchevisme », il porte donc sur la période charnière du siècle écoulé, puisqu'il est évident que « la relation dialectique entre communisme et fascisme est au centre des tragédies du siècle » (1 ).
Le deuxième livre, paru en 1994 mais traduit et publié il y a quelques mois seulement, est le plus ambitieux par le nombre des domaines traités (économique, politique, social, artistique, etc.) et par la période étudiée, l'intégralité du « court vingtième siècle », comme dit fort justement l'auteur, qui le fait commencer en 1914 et s'achever en 1991. Vieux marxiste-léniniste impénitent beaucoup plus que marxiste au sens propre, Eric Hobsbawm, né en 1917 ne pouvait manquer de relever, au début de sa tentative d'histoire globale de l'« âge des extrêmes », que « ce n'est pas un hasard si l'histoire du court vingtième siècle [...] coïncide pratiquement avec la durée de vie de l'État né de la révolution d'Octobre » (2). Le troisième livre présentant lui aussi une vaste rétrospective sur l'ensemble du XXe siècle est bien sûr Le passé d'une illusion, paru en 1995, de François Furet (1927-1997). S'inspirant par endroits d'une lecture attentive des livres de Nolte sur le fascisme (plus que de La guerre civile européenne, Furet lisant mal l'allemand), le testament de l'historien français, qui a pour sous-titre « Essai sur l'idée communiste au XXe siècle », tourne autour du constat suivant : en ce qui concerne les deux grandes religions séculières, communisme et fascisme, « ce qui les unit aggrave ce qui les oppose » (3).
Les idéologies, rationalisations des émotions premières
Ceci renvoie d'emblée au cœur même du livre de Nolte, qui a pour ambition avouée de conférer à la théorie « structurelle » du totalitarisme, défendue par Hannah Arendt notamment, « la dimension historico-génétique qui lui manque » (p. 40). En effet, Nolte ne se livre pas à une histoire comparée des idées : il ne dit rien sur l'œuvre de Lénine, rien sur la « Révolution conservatrice », pas grand-chose sur les idées agitées au sein de la SS; quant à Rosenberg, il l'intéresse bien plus comme témoin oculaire de la révolution bolchevique dans le monde balte que comme théoricien. Son propos est de retracer l'élaboration de deux idéologies de combat au contact des conditions réelles du moment, conditions qu'il décrit et analyse d'une manière qui n'est pas toujours très éloignée de l'analyse marxiste. Ce n'est pas le cas, en revanche, de son interprétation des idéologies : on a souvent l'impression qu'à ses yeux, elles sont des rationalisations a posteriori de passions et émotions premières/primaires, au sens technique et non polémique du terme. Pareto n'est jamais cité, mais il est difficile de ne pas penser à lui quand on lit cette définition : « L'expérience vécue et les émotions fondamentales, de là procèdent les idéologies. Ces dernières ne sont pas le fruit de l'imagination de tel ou tel penseur - c'est en elles, au contraire, que se décantent et s'articulent les vécus et les émotions qui, pour un grand nombre d'hommes, ont un caractère déterminant et qui sont en soi prédisposées à donner forme à des idées » (p. 417).
Dans cette optique, Nolte restitue à la révolution d'Octobre toute sa force de nouveauté et d'étrangeté, tout ce par quoi elle effraya à juste titre tant de contemporains. Il se sert pour cela de très nombreux témoignages datant des années 1917-1930, d'où il ressort que la volonté exterminatrice proclamée du bolchevisme à l'égard d'une classe aux contours passablement élastiques - la « bourgeoisie » - avait été clairement perçue comme un danger énorme, non pas seulement à l'extrême droite, non pas seulement dans les milieux conservateurs anticommunistes, mais aussi bien chez les sociaux-démocrates. C'est l'un des premiers mérites du livre de Nolte que de rafraîchir une mémoire devenue déficiente depuis 1945 au moins pour cause d'antifascisme officiel. On a aujourd'hui du mal à s'imaginer ce que représentèrent pour les contemporains l'instauration, en 1917 d'un État de guerre civile en Russie et, en 1919, avec la IIIe Internationale communiste, la fondation d'un parti de guerre civile mondiale appelant expressément à la destruction des États existants et à la création d'une société sans classes.
En inaugurant « un processus qui a conduit à l'abolition de toute distance entre le discours et les actes », comme écrit Stéphane Courtois dans sa préface (p. 9), Lénine et ses camarades mettaient en place sans le savoir les conditions du « nœud causal » - concept central chez Nolte - qui devait relier plus tard le Goulag à Auschwitz. La « brutalisation » de la société européenne (4) engendrée par la Première Guerre mondiale va produire, selon Nolte, une « exacerbation » de la passion de l'égalité en Russie et, dans la proche Allemagne, une « contre-exacerbation » de l'idée nationale, devenue prioritaire. Furet lui-même ne dit pas autre chose quand il écrit que « la porte de sortie internationaliste de la guerre est occupée depuis 1917 par les militants bolcheviques. On le voit en 1918. Aussitôt le dernier coup de canon tiré, défendre la nation contre la révolution communiste est devenu plus pressant que lui réapprendre à vivre dans un ordre international où elle est affaiblie. La priorité du bolchevisme crée la priorité de l'antibolchevisme » (5).
Mais si l'on entend bien saisir la logique du « nœud causal », le rappel de quelques données historiques est indispensable. Il y a d'abord l'extraordinaire prestige dont jouit, non pas tant l'Allemagne, patrie de Marx et d'Engels, que son glorieux, puissant et ancien mouvement ouvrier, aux yeux des bolcheviks russes (lors de la fondation du KPD, le parti communiste allemand les 30 décembre 1918 et 1er janvier 1919, Karl Radek, haut dirigeant bolchevik, prononce un discours dans lequel il qualifie le mouvement ouvrier allemand de « frère aîné » du mouvement ouvrier russe). Il y a ensuite leur conviction d'avoir été les acteurs d'une révolution « anormale » du point de vue marxiste (elle a éclaté dans un pays arriéré et féodal, sans véritable classe ouvrière constituée), mais qui doit bientôt trouver un formidable appui dans une « inévitable » révolution allemande, puisque toutes les conditions paraissent réunies. L'importance capitale attribuée à l'Allemagne par les premiers bolcheviks et leurs successeurs dans l'expansion du mouvement communiste mondial est d'ailleurs confirmée par un détail significatif : Hobsbawm rappelle - en cette matière, on peut lui faire confiance qu'« entre les deux guerres, c'est l'allemand, non le russe, qui resta la langue officielle de l'Internationale » (6). Du côté du camp opposé, l'importance des témoignages oculaires devient absolument évidente quand on sait qu'il y avait à Berlin, dans les années qui suivirent la révolution d'Octobre, pas moins de 300 000 émigrés russes. Autant d'éléments qui différencièrent radicalement la perception de la révolution d'Octobre en Allemagne et, par exemple, en France, même si l'on fait abstraction de la « tradition » héritée de 89.
Le bolchevisme comme idéologie de la guerre totale
Avec Lénine et les bolcheviks, c'est une lecture autoritaire et « conspirative », sinon conspirationniste, de Marx qui l'emporte. Le politique prédomine désormais sur le social la révolution a été faite par un groupe d'activistes professionnels et l'on accuse désormais, non plus tant le système capitaliste que les capitalistes, puis, dans le cadre de la logique du bouc émissaire, les « bourgeois ». Ayant vu ses rangs grossir considérablement au nom du refus de la guerre, le parti bolchevique est alors fatalement conduit à s'éloigner de l'esprit de Marx, qui était passé de la critique des « Juifs » (voir son écrit de jeunesse La question juive) à la critique du système capitaliste. Le parti bolchevique connaît plutôt une évolution en sens contraire, ainsi que l'explique Nolte : « Si ce parti persistait à ne pas rendre responsables du crime originel qu'était la guerre les attributs d'un système ou une phase historique bien définie, mais à accuser, avec l'intention exterminatrice allant de pair, des instigateurs humains qualifiés de criminels, il devait paradoxalement devenir un parti de guerre d'une nature particulière au cas où il ne parviendrait pas à s'imposer vite, totalement et partout » (p. 103).
Ce fut bientôt le cas du KPD, où les défenseurs de la ligne autoritaire l'emportèrent sur les héritiers du spartakisme. Mais à la différence de la Russie, l'Allemagne de Weimar était une société moderne et industrialisée, économiquement intégrée à l'Occident. Les « bourgeois » y représentaient déjà la majorité de la population. Constamment pris pour cible par la propagande communiste, obsédés par l'image, largement répandue depuis 1917 et l'aventure du Baltikum, du « bolchevik au poignard entre les dents », ils auraient donc, selon Nolte, ré-agi au sens strict, Hitler se chargeant d'« exacerber » cette réaction. Dans son avant-propos à l'édition française, Nolte confirme son premier diagnostic de 1987 : « Je continue [...] à tenir pour vraisemblable qu'il existe un "nœud causal" - même s'il ne s'agit certainement pas d'une causalité unique et absolue - entre les expériences initiales, transmises en grande partie par des témoins oculaires comme Alfred Rosenberg et Max von Scheubner-Richter, et les actes ultérieurs » (p. 24). Ancien vice-consul d'Allemagne à Erzeroum (Turquie orientale), revenu à Riga en 1918, Scheubner-Richter, témoin du sort réservé par les Turcs aux Arméniens puis des massacres perpétrés par les bolcheviks, fonde à Munich, dès 1921 une agence de presse pour informer sur ce qui se passe à l'Est. En juin de la même année, il organise à Bad Reichenhall le premier congrès des émigrés monarchistes russes. Tué à Munich lors du putsch manqué du 8 novembre 1923, cet homme aurait joué, selon Nolte, de concert avec Rosenberg et l'écrivain antisémite Dietrich Eckart, un rôle décisif dans la formation initiale des idées de Hitler.
Nolte résume ainsi ce qu'il veut dire lorsqu'il parle du côté essentiellement « réactif » du national-socialisme : « Le présent ouvrage procède de l'hypothèse que le rapport de Hitler au communisme, marqué par la crainte et la haine, a effectivement été au centre de ses pulsions et de son idéologie. Il aurait simplement mis en forme, de manière particulièrement forte, ce que de nombreux contemporains, allemands ou non, ressentaient » (p. 39), et ce en se livrant à une exacerbation sous la forme d'une « interprétation antisémite de l'expérience anticommuniste vécue » (p. 40).
L'idéologie hitlérienne étant interprétée comme une « contre-passion exacerbée », le « nœud causal » bolchevisme/national-socialisme peut dès lors se décliner au travers d'expressions comme « repoussoir et modèle », « original et copie », « défi et réponse » et, dans le domaine des mesures de répression puis d'extermination, comme « correspondance » et « surcorrespondance ». Le premier exemple de « sur-correspondance » nationale-socialiste aux méthodes bolcheviques est vu dans la « nuit des longs couteaux » (30 juin 1934), purge au sein des partisans qui ne peut même pas se prévaloir, comme au temps de Lénine, d'une situation de guerre civile aiguë et qui frappe aussi les proches des opposants (on liquide Kurt von Schleicher, mais aussi sa femme, de même que, dix ans plus tard, ordre sera donné de liquider tous les membres de la famille du comte von Stauffenberg, artisan de l'attentat manqué du 20 juillet 1944).
Le national-socialisme adopte les méthodes bolcheviques
Dans un premier temps néanmoins, l'« époque du combat » (de la fondation du NSDAP à la prise du pouvoir, le 30 janvier 1933), l'adoption des méthodes bolcheviques fut relativement lente et il fallut attendre paradoxe - qui n'est qu'apparent - la guerre germano-soviétique sur le front de l'Est pour voir l'« échange des caractéristiques » entre les deux États à parti unique s'accentuer notablement. Dans cette perspective, la mansuétude de la République de Weimar à l'égard du NSDAP et son attitude souvent bien plus hostile au KPD s'expliquent aisément selon Nolte : il suffit de se référer aux objectifs déclarés des deux factions. L'une visait un bouleversement complet de la société allemande, l'autre la libération des entraves du traité de Versailles et l'instauration d'une Volksgemeinschaft harmonieuse et unie. Même s'« il est devenu presque impossible, depuis 1945, d'imaginer le national-socialisme de 1920 ou 1930 comme une promesse » (7), la réalité de sa capacité à incarner le sursaut national au début des années trente ne saurait, pour Nolte, être niée. L'anachronisme, ici plus qu'ailleurs encore, bloque toute compréhension du phénomène- des deux partis extrémistes allemands, « l'un exigeait qu'une petite minorité qui n'était pleinement assimilée que depuis la seconde moitié du XIXe siècle, se voie à nouveau retirer son statut de citoyenneté l'autre réclamait l'anéantissement social de la bourgeoisie tout entière. [...] Il était inévitable que, pour les contemporains, le parti communiste apparût comme le plus extrémiste » (p. 237).
Certes, Hitler ne saurait être comparé, comme idéologue, à Lénine. Mais il est bel et bien idéologue si l'on accepte le sens que Nolte donne à l'« idéologie » : mise en forme à valeur mobilisatrice et « explicative » (pour ceux qui y adhèrent) de quelques émotions et expériences vécues fondamentales. C'est bien l'idéologie, entendue en ce sens, qui explique de nombreux choix et erreurs de Hitler : la conviction que les Anglais, peuple racialement « supérieur » et racialement apparenté aux Allemands, sont leurs alliés naturels et comprendront que ceux-ci veuillent se tailler à l'Est l'espace vital dont ils ont besoin, prélude à un empire continental qui serait le pendant de l'empire maritime du Royaume-Uni; l'idée profondément enracinée, héritée du darwinisme social, que les empires coloniaux conquis par plusieurs nations occidentales s'expliquent d'abord par une supériorité raciale (d'où le refus, pendant la guerre, d'appeler au soulèvement armé des Palestiniens contre le mandat britannique ou de soutenir efficacement le leader indépendantiste indien Subhas Chandra Bose) l'incroyable mépris des peuples slaves, qui contraste tellement avec l'« orientation à l'Est » des « nationaux-socialistes de gauche » et des nationaux-bolcheviks, et qui coûtera si cher (8) le nationalisme pangermaniste, qui fait pencher pour la Realpolitik, au détriment du' soutien à d'autres nationalistes, dont Hitler, au fond, se méfie : il joue Franco contre la Phalange, Antonescu contre la Garde de Fer, Horthy contre les Croix Fléchées.
Nolte, à cause peut-être du sens très particulier qu'il confère au mot « idéologie », n'évite pas toujours flottements et contradictions. C'est par exemple le cas lorsque, se référant au fameux discours de Hitler du 30 janvier 1939 contenant la menace d'une « destruction de la race juive en Europe », il affirme qu'on peut déduire de ce discours que Hitler « professait [...] une théorie visant au salut du monde, une théorie s'adressant par principe à tous les hommes et correspondant exactement à la doctrine marxiste en dépit de sa signification opposée » (p. 326). Il est impossible de suivre ici Nolte, qui opère de toute évidence un glissement injustifié de l'« idéologue » au « théoricien », qualificatif qui ne saurait s'appliquer à Hitler. Ceci heurte d'ailleurs la thèse centrale de Nolte lui-même sur Hitler, chez qui la pulsion fondamentale aurait été un nationalisme anticommuniste exacerbé par l'antisémitisme. Un même flottement sur la question de savoir si, chez Hitler, c'est l'anticommunisme ou l'antisémitisme qui est premier, s'observe chez Nolte. Dans La guerre civile européenne, l'historien allemand soutient, à l'inverse de nombreuses thèses reçues, que l'antisémitisme est second. Mais dans sa correspondance avec François Furet, il rappelle s'être penché dès les années soixante sur le mentor de Hitler, Dietrich Eckart, auteur d'une brochure intitulée Le bolchevisme de Moïse à Lénine. Dialogue entre Adolf Hitler et moi-même, et ajoute : « Autant que je sache, je fus le premier qui ait cru pouvoir établir que certaines déclarations faites précocement par Hitler [...] contenaient une claire anticipation de l'extermination des Juifs » (9).
Ces réserves en appellent d'autres. En 1995, Furet avait très bien résumé les mérites et limites de l'idée du « nœud causal » « Cette approche [...] a l'avantage d'épouser de plus près le mouvement des événements. Elle présente le risque d'en offrir une interprétation trop simple, à travers une causalité linéaire selon laquelle l'avant explique l'après » (10). Il écrivit par ailleurs à son correspondant : « Je pense qu'acharné à souligner le caractère réactif du fascisme, vous en sous-estimez la nouveauté », qui « a consisté à émanciper la droite européenne des impasses inséparables de l'idée contre-révolutionnaire » (11). Parce qu'il sous-estime le caractère de nouveauté des fascismes, Nolte néglige le fait que leurs composants culturels préexistent à 1914, donc au bolchevisme : il est révélateur que le nom de Zeev Sternhell, qui s'est précisément beaucoup intéressé aux lointaines origines intellectuelles du fascisme, n'apparaisse même pas dans l'index d'un livre qui compte plus de 600 pages serrées ! De même, on saisit mal l'absence, dans un ouvrage de cette densité et de cette qualité, de considérations un tant soit peu développées sur la tradition culturelle antidémocratique allemande. Là aussi, des références que l'on s'attendait à trouver, quitte à les voir fortement discutées (plusieurs essais de Mosse ou bien le livre de Fritz Stern) (12), font complètement défaut. Pourtant, comme le disait Furet à Nolte à propos de l'Allemagne d'avant 1914 et de la vie culturelle sous Weimar : « En matière de pensée antilibérale, je ne pense pas qu'on puisse trouver un répertoire plus riche, et plus radical » (13).
Le combat de la « vie » contre la « transcendance »
Enfin, quand Nolte tente d'apercevoir le fond philosophique ultime de la « solution finale de la question juive » dans une opposition entre la « vie » et ce qu'il appelle la « transcendance » (à savoir l'abstraction ou intellectualisation de l'universalisme démocratique, dont les Juifs seraient les représentants par excellence), il semble négliger ce que le national-socialisme avait d'intrinsèquement mortifère. Dire, comme il le fait, que la « solution finale » fut, bien plus qu'une extermination simplement biologique, « un choix [...] contre le progrès, opéré sur la base de réalités progressistes [l'appartenance de l'Allemagne à l'Occident moderne], tandis que le bolchevisme était un choix pour le progrès, mais étroitement lié à des réalités retardataires » (p. 558), c'est encore une autre façon de décliner le « nœud causal », mais cela n'explique pas pourquoi le national-socialisme fut ce mélange si déroutant de traditionalisme réactionnaire (en matière culturelle notamment, du moins après 1936) et d'une ultra-modernité technologique qui renforça en Allemagne les « réalités progressistes ».
Il est logique de se demander pourquoi Nolte a appliqué de façon aussi systématique sa thèse du « nœud causal ». Une première réponse, classique, prend appui sur la détestable « culture du soupçon ». Tel est le cas de Hobsbawm qui, après avoir vanté les mérites des premiers bolcheviks cette « armée nécessairement impitoyable et disciplinée de l'émancipation humaine » (14) a le culot d'écrire : « Les apologistes du fascisme ont probablement raison de soutenir que Lénine a engendré Mussolini et Hitler. En revanche, il est absolument illégitime de disculper la barbarie fasciste en prétendant, comme certains historiens allemands ont été tout prêts de le faire dans les années 1980 [Nolte, 1987], qu'elle s'est inspirée, en les imitant, des supposées barbaries [sic] de la Révolution russe » (15). Une deuxième réponse consiste à dire, tout simplement, qu'il est fréquent qu'un scientifique, ayant découvert une « clé » explicative de certains phénomènes, soit tenté de s'imaginer qu'elle ouvre toutes les serrures.
Quoi qu'il en soit, au moment où un Hobsbawm se permet encore des euphémismes insupportables sur « le caractère implacable et brutal de la politique stalinienne de collectivisation et de répression de masse » (17), sans jamais nommer les choses par leur nom, il serait scandaleux que le livre de Nolte fasse l'objet d'un procès en sorcellerie pour « négationnisme ». On lit ainsi dans l'« Epilogue » de son livre : « Himmler et Hitler, en rendant les Juifs responsables d'un processus qui les avait affolés, donnèrent une dimension nouvelle au concept d'extermination original des bolcheviks et, remplaçant le présupposé social par un présupposé biologique, dépassèrent, par l'horreur de leur forfait, les idéologues innés » (p. 594, n. 28).
Ouvrage admirablement construit, disponible dans une bonne traduction, La guerre civile européenne est un livre aussi important, sous l'angle historiographique, que Le passé d'une illusion et le Livre noir du communisme. Un livre d'hygiène mentale à lire et à faire lire absolument.
Bertrand Laget Éléments N° 98 Mai 2000
✑ Ernst Nolte, La guerre civile européenne 1917-1945, éditions des Syrtes, 665 p., 218 F.
✑ À lire également sur le sujet : Alain de Benoist, Communisme et nazisme, Labyrinthe, 160 p., 120 F. En vente dans nos pages centrales.
1) F. Furet, « Sur l'illusion communiste », in le Débat, 89, mars-avril 1996.
2) E.J. Hobsbawm, L'âge des extrêmes. Histoire du court vingtième siècle 1914-1991 Complexe/Le Monde diplomatique, Bruxelles-Paris 2000, p. 86.
3) F. Furet, Le passé d'une illusion, LCF, 1996, p. 261
4) Sur ce thème, cf. George L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Hachette, 1999.
5) F. Furet, Le passé d'une illusion, op. cit., p. 45.
6) E.J. Hobsbawm, op. cit., p. 105.
7) F. Furet, Le passé d'une illusion, op. cit., p. 15.
8) Furet écrit fort justement : « Guerre idéologique, la guerre nazie en Russie paye le prix de l'idéologie » (Le passé d'une illusion, op. cit., p. 558).
9) F. Furet et E. Nolte, « Sur le fascisme, le communisme et l'histoire du XX' siècle », in Commentaire, 80, p. 799. Publiée en ouvrage (Fascisme et communisme, Commentaire/Pion, 1998), la correspondance Furet-Nolte a apparemment recueilli un succès certain puisqu'elle vient d'être rééditée dans une collection de poche (Hachette, 2000).
10) F. Furet, Le passé d'une illusion, op. cit., p. 269.
11) F. Furet et E. Nolte, « Sur le fascisme, le communisme et l'histoire du XXe siècle », art. cit., p. 812.
12) Cf. F. Stern, Politique et désespoir. Les ressentiments contre la modernité dans l'Allemagne d'avant Hitler, Armand Colin, 1990.
13) F. Furet et E. Nolte, art. cit., p. 812.
14) E.J. Hobsbawm, op. cit., p. 107 15.
15) lbid.,p. 172.
16) F. Furet, Le passé d'une illusion, op. cit., p. 272, n.2.
17 E.J. Hobsbawm, op. cit., p. 137
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire