Il existe dans la tradition française un fort courant songeur, surnaturaliste, mystique et prophétique qui, loin de soustraire à notre entendement quelque clarté que ce soit en éprouve les véritables puissances d’embrasement et de transfiguration. Comment ne pas entendre l’œuvre de Racine comme l’épanouissement d’un Songe mélodieux et terrible ? Comment ne pas reconnaître dans les pensées de Pascal la persistante présence des abysses ? S’il est une constante dans la littérature française, elle est bien dans la coïncidence de la métaphysique et de la poésie, dans l’accord de la Doctrine et du Chant et dans l’audace à requérir contre la banalité des apparences le jugement d’une « expérience-limite » où la claire raison, en s’éprouvant à ce qui la fonde et la menace, ouvre à la pensée l’empire des illuminations et des correspondances.
Gérard de Nerval fut, comme Baudelaire et Balzac, un fervent lecteur des Soirées de Saint-Pétersbourg. Il y trouva l’idée, traditionnelle par excellence, d’une antériorité lumineuse et inspiratrice, qui réduit à l’état de vantardise pure la prétention civilisatrice des modernes: « C’est une idée très-frappante, écrit Gérard de Nerval, que celle de Joseph de Maistre qui suppose que les sauvages ne sont nullement des hommes primitifs, mais, au contraire, les derniers représentants d’une civilisation dégradée et abolie ». En amont du temps, en quelques contrées hors d’atteinte mais présentes dans l’âme des poètes, il y eut donc une sapience plus haute. Certes, cette sapience semble éteinte, sa doctrine est généralement oubliée, et toutes les « valeurs » modernes se fondent sur cet oubli, mais elle n’est pas, pour autant, annulée. De tout ce qui fut, il demeure quelque chose. La sagesse s’est éloignée, mais ses traces demeurent en nous, non dans notre entendement diurne mais dans nos rêves, une fois franchies « les portes de cornes et d’ivoire qui nous séparent du monde invisible » – et gardent l’empreinte des Symboles oubliés ou bafoués.
La vie et l’œuvre de Gérard de Nerval consisteront à retrouver, par des voies périlleuses, dans les profondeurs du rêve, l’empreinte du sceau invisible des Symboles. Dans Le carnet de Dolbreuse, Nerval écrit: « Les songes avertissent l’homme parce qu’alors la conscience prend une vision indépendante ». L’œuvre du poète consiste à se rendre attentif à ces avertissements. Ce qui demeure en nous des Symboles d’un Age d’Or oublié nous avertit des désastres et des reconquêtes futures en nous révélant que l’espace-temps qui nous emprisonne n’est qu’une illusion. « Pour en revenir à la nuit et aux songes, écrit Joseph de Maistre, nous voyons que les plus grands génies de l’antiquité, sans distinction, ne doutaient nullement de l’importance des songes, et qu’ils venaient même s’endormir dans les temps pour y recevoir des oracles. Job n’a-t-il pas dit que Dieu se sert des songes pour avertir l’homme ? »
Tel est donc le paradoxe admirable: les songes nous avertissent, ils nous éveillent. La plongée dans le monde invisible éveille les images, et ces images sont vraies. Pour Gérard de Nerval, le rêve éveille à cette vérité que le somnambulisme ordinaire recouvre de ses écorces de cendre. A la veille machinale des travaux utiles et des distractions planifiées, dont le caractère hypnotique n’échappe qu’à ceux qui le subissent, Nerval oppose l’insurrection des songes où vivent les assemblées des déesses et des dieux. Son audace ultime sera de porter la Veille du Songe avertisseur au cœur même de la vie éveillée au risque d’être frappé par foudre d’Apollon. Lorsque le monde ressemble à un faux-sommeil machinal, lorsque la raison partagée ignore la vérité, comment encore oser donner une voix aux augustes et vertigineuses vérités de la Doctrine et du Chant ?
Sans doute l’intelligence moderne n’est-elle si désastreuse que par son impuissance à accorder l’image et la vérité. Pour le moderne, l’imagination est bien « maîtresse de fausseté ». Aux Symboles se sont substituées les fantasmagories. Les songes mentent car ils sont édictés, non par le monde intermédiaire entre le sensible et l’intelligible dont nous parle Henry Corbin, le mundus imaginalis, mais par rumeur confuse des subjectivités agrégées. Cependant le souvenir lancine, et la nostalgie ardente, d’une imagination vraie, telle qu’elle se déploya, par exemple, dans L’Odyssée ou La Divine comédie.
Ce souvenir, qui présume l’antériorité d’une sapience lumineuse, d’une anamnésis possible, rassemble en lui les forces conjointes de l’Intellect et de l’impression. Les signes avertisseurs des rêves et les signes que nous adresse le monde sensible sous les atours du « hasard objectif », ou, pour mieux dire, des « synchronicités », lorsqu’ils opèrent ensemble, peuvent aussi bien éclairer que foudroyer. « Le monde est un ensemble de choses invisibles manifestées visiblement ». Si le songe est bien l’avertissement de l’invisible dans le visible, alors l’oniromancie, saisie par le génie du poète, peut d’avérer être une rigoureuse méthode d’induction. Les Soirées de Saint-Pétersbourg ne disent rien d’autre: « Certains philosophes se sont avisés dans ce siècle de parler de causes. Mais quand voudra-t-on comprendre qu’il ne peut y avoir de causes dans l’ordre matériel et qu’elles doivent toutes être recherchées dans un autre cercle ? Il n’y a que les hommes religieux qui puissent et veulent en sortir; les autres ne croient qu’en la matière et se courroucent même lorsqu’on leur parle d’un autre ordre de chose. »
Or cet « autre cercle », plus vaste que les mondes, est aussi, par la prodigieuse magnanimité de la providence divine, contenue dans nos âmes. Le mystère des hauteurs se tient dans les profondeurs, le point de focalisation extrême détient l’ampleur hors d’atteinte, toute la splendeur du monde est dite dans le iota de la lumière incréée. La sagesse humaine, lorsqu’elle s’affranchit des fausses sciences, nous dit Jacob Böhme, « outrepasse la sagesse des Anges ».
Le péril contre lequel nous mettent en garde Joseph de Maistre et Gérard de Nerval est de confondre cette possibilité magnifique avec le prométhéisme des modernes. Rien ne s’accomplit avec bonheur sans le diapason d’une humilité, que l’on peut dire pythagoricienne ou chrétienne. « La musique creuse le ciel » disait Baudelaire qui savait entendre comme naguère l’on savait prier. L’œuvre de Joseph de Maistre déplait fort aux modernes car elle ne laisse presque aucune carrière à l’outrecuidance. Le moderne veut bien prétendre aux gnoses souveraines, mais il ne veut rien abandonner aux prérogatives de son « moi », il veut bien s’approcher des « ésotérismes », des « réalités cachées », surtout lorsqu’elles sont exotiques, – mais la simple et humble prière lui est étrangère, hostile, incompréhensible. « Si la crainte de mal prier, écrit Joseph de Maistre, peut empêcher de prier, que penser de ceux qui ne savent pas prier, qui se souviennent à peine d’avoir prié et ne croient pas même à l’efficacité de la prière ? »
Qu’est-ce qu’une prière ? Les heures où lentement s’écoulent les entretiens du Comte, du Sénateur et du Chevalier sont des prières de l’intelligence. Si l’âme et le cœur entrent en prière sous l’afflux des sentiments généreux et des pressentiments magnanimes, est-ce à dire que l’intelligence ne saurait prier ? Il existe une prière de l’Intellect, qui est pure théorie, c’est-à-dire contemplation. Mais cette prière, en nos temps de fausses raisons outrecuidantes, est aussi la plus rare et la plus difficile. Une prière de l’Intellect serait ainsi une prière de délivrance. La raison doit s’affranchir des raisons et des déraisons et devenir pure oraison; elle doit se délivrer non seulement de la rationalité linéaire mais de la temporalité même où s’inscrit cette linéarité. Il faut infiniment prier pour cette libre gloire de la pensée.
« L’homme est assujetti au temps et néanmoins, il est, par nature, étranger au temps ». La considération maistrienne ouvre des perspectives infinies. Elle fonde la légitimité du prophétisme, non moins que la pertinence de la négation du hasard. Ainsi, la providence divine, loin d’être une énigme impénétrable, serait inscrite, au titre de sapience originelle, dans la nature même de l’homme, « étranger au temps ».
Cette perspective métaphysique modifie, et rectifie, les notions fondamentales de l’humanisme moderne, si éloigné de l’humanitas des Anciens. Si la nature de l’homme est d’être « étranger au temps », toute explication de l’humain par des théories évolutionnistes est infirmée. La prière de l’Intellect témoigne de la possibilité d’une vision surplombante. « L’esprit prophétique, écrit Joseph de Maistre, est naturel à l’homme et ne cessera de s’agiter dans le monde. L’homme en essayant à toutes les époques et dans tous les lieux de pénétrer dans l’avenir, déclare qu’il n’est pas fait pour le temps, car le temps est quelque chose de forcé qui ne demande qu’à finir... »
« Le temps est quelque chose de forcé ». On peut ajouter qu’il en est de même de l’espace. La juste et humble prière de l’Intellect touche sans efforts aux réalités, si troublantes pour des raisons profanes, que sont la prédiction et l’ubiquité. En témoignent les Prédictions et les Bilocations de Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit. L’espace et le temps sont « forcés », ils sont illusoires. En franchir les limites artificieuses, ce n’est point transgresser l’ordre de notre nature mais retrouver par la simple légèreté de la prière un état d’être non forcé, ni soumis. Outrepasser les conditions de l’espace et du temps, ce n’est point conquérir quelque pouvoir d’exception mais répondre à l’attente même de l’univers. « L’univers, écrit Joseph de Maistre, est en attente. Comment mépriserions-nous cette grande persuasion, et de quel droit condamnerions-nous les hommes qui, avertis par des signes divins, se livrent à de saintes recherches ? » La prière répond à l’attente de l’univers, et cette réponse résonne en notre cœur, dont l’humilité essentielle est de se confondre avec le cœur de l’univers.
« Toute la science changera de face; l’Esprit longtemps détrôné et oublié, reprendra sa place. Il sera démontré que les traditions antiques sont toutes vraies, que le paganisme entier n’est qu’un système de vérités corrompues et déplacées. » Déplacées, en l’occurrence, par le temps lui-même, – d’où l’importance d’une clef de voûte, d’un Hors-du-Temps, fine pointe de la spéculation divinatrice. « Tout annonce je ne sais quelle grande unité vers laquelle nous marchons à grand pas ». Mais ces pas n’y conduiront que s’ils sont autant d’étapes d’un déchiffrement des signes et des intersignes.
L’armorial initiatique des Chimères de Gérard de Nerval marque, lui aussi, le pas de la recouvrance du limpide secret des songes et des raisons, du Chant et de la Doctrine. Ces sonnets sont des creusets versicolores où le récit autobiographique s’inscrit. Cette inscription fait office, en même temps, de mystère et de précepte. La nuit reconquise, la nuit aimée, la nuit éperdue tient en elle le principe d’un ordre ensoleillé, d’une souveraine raison d’être.
Il est temps d’en finir avec ce dualisme de pacotille qui ne se lasse point d’opposer une raison diurne à une irrationalité nocturne, un « classicisme » prétendument raisonnable et un « romantisme » qui serait tout embarbouillé d’obscurantisme. La forte prégnance mystique de Racine et des œuvres dites du Grand Siècle tient en son exactitude rhétorique une perspective à perte de vue, de même que le romantisme roman, celui de Novalis, dans ses plus libres effusions, rétablit la légitimité d’une norme métaphysique qui s’avère être, désormais, l’ultime sauvegarde de l’homme différencié. La vertu augurale et inaugurale de l’œuvre de Joseph de Maistre tient à cette double appartenance. Ce que l’on nomme le classicisme s’exaltera dans les Soirées de Saint-Pétersbourg jusqu’à donner à Baudelaire et à Nerval les ressources et les puissances nécessaires à s’affranchir des épigones du classicisme.
Œuvre par excellence frontalière, non seulement par sa chronologie mais par sa vocation (l’appel auquel elle répond non moins que celui qu’elle lance !), l’œuvre de Joseph de Maistre illustre la permanente possibilité de penser hors des entraves édictées. Toute pensée exigeante, pour peu qu’elle envisage de ne point servir les idéologies mais les Idées, doit ainsi faire son deuil des facilités conjointes de l’alternative et du compromis. La divine providence que les Soirées déchiffrent, par le dialogue et non par l’exposé systématique, s’exerce sur nous par la quête où elle nous précipite. Elle avive nos curiosités, nous entraînant à une approche encyclopédique, et peut-être faudra-t-il quelque jour admettre que les points de convergences de l’Encyclopédie de Diderot et de l’Encyclopédie de Novalis sont autant à considérer que leurs divergences, de même que l’allure, voltairienne quelquefois, de Joseph de Maistre devrait peut-être interdire de réduire Voltaire au seul usage qu’en font des « voltairiens » qui ne l’ont guère lu.
La providence, et c’est le propre de sa nature divine, s’inscrit à la fois dans la raison et dans un mystère plus haut que le raison. Rien de tout cela n’est compréhensible sans la notion de hiérarchie. Qu’il y eût un mystère plus haut que la raison, cela, certes, n’ôte rien à la raison ; et que ce mystère fût déchiffrable par la raison, et que cette raison s’éployât en oraison, cela ne diminue en rien la souveraineté du mystère.
La grande détresse des modernes sera d’avoir perdu à la fois la raison et le mystère par l’exacerbation simultanée d’un rationalisme outrecuidant et des superstitions du « démos ». Sans l’appel du mystère, la raison s’effondre. Nous autres modernes vivons dans cette raison ruinée, dans les décombres de cet en-deçà de la raison que hantent les superstitions et les barbaries. Contrairement à ce que feignirent de croire certains intellectuels, la destruction des normes grammaticales et métaphysiques, loin de donner lieu à l’épanouissement de la sirène Diversité fut au contraire extrêmement uniformisatrice. Les gravats sont toujours plus uniformes que les édifices et la confusion, pour séduisante qu’elle apparaisse aux yeux de certains, présage immanquablement la planification. Comme l’écrivait Dominique de Roux, « nous en sommes là ».
Les différenciations individuelles elles-mêmes s’estompent dans la subjectivité de masse : la preuve en est qu’il suffit d’une phrase pour distinguer les uns des autres, pour reconnaître en leur unificence irréductible, les écrivains de belle race et de grande tradition, alors que nos adeptes du subjectivisme se ressemblent tous. Tel est l’apparent paradoxe : la norme grammaticale et métaphysique est l’éminente gardienne de la diversité humaine, alors que la confusion, la subversion, sont les non moins évidentes propagatrices de l’uniformité. La divine providence nous laisse toutes les chances de comprendre ou de ne pas comprendre, et sa mise-en-demeure, loin de nous planifier, nous hausse vers l’extrême singularité. Cette aventure-là, certes, n’est pas du goût de tout le monde car ce elle exige de nous, – outre l’épreuve de la solitude, – s’apparente à quelque dédaigneux dédain pour le « moi », cette idole bourgeoise, laquelle, comme l’automobile, si chère à nos classes moyennes, n’est jamais qu’un objet de série. Le « moi », la subjectivité du moderne, où il se figure être délivré des normes, n’est jamais que le véhicule de sa banalité.
« Tout se tient, tout s’accroche, tout se marie, écrit Joseph de Maistre, lors même que l’ensemble échappe à nos faibles yeux c’est une consolation de savoir que cet ensemble existe et de lui rendre hommage dans l’auguste brouillard où il se cache. »
Que serait une raison qui se refuserait à s’affronter au brouillard, une raison qui se déclarerait au-suffisante, sinon la pire des folies ? A l’inverse, il est des divagations fécondes en hypothèses surgissantes dont le cheminement, pour déroutant qu’il paraisse, réconcilie entre eux, et quand bien leurs auteurs en furent parfois égarés, les pouvoirs de l’Esprit. Fut-elle si irrémédiablement folle, la folie de Nerval, en son siècle bourgeois où se précisaient déjà les méthodiques folies qui allaient conduire aux totalitarismes modernes, si autistiquement déductifs ? Pour retrouver nos raisons d’être, il fallut qu’un homme doué des grâces du pur parler du Valois s’aventure en des contrées crépusculaires. Nous lui en sommes infiniment redevables, comme nous le sommes à Joseph de Maistre, d’avoir restauré, pour nous, le « flambeau de l’Analogie ».
L’Analogie et la hiérarchie, celle-là étant le mode opératoire de celle-ci, sont au cœur de la pensée maistrienne, bien proche à cet égard de la métaphysique des gradations du Colloque entre Monos et Una d’Edgar Poe. Cette métaphysique graduée, ou graduelle, au vrai sens initiatique, témoignera des correspondances et de ce monde qu’il faut bien voir comme un « temple de symboles », sous peine ne rien percevoir du grain et de la ductilité du monde sensible.
L’idée à la fois architecturale et musicale d’une Analogie fondatrice, – l’architecture, de par le mouvement de celui qui la découvre, se faisant musique, et la musique reconstruisant dans l’entendement une architecture, – nous sauvera peut-être des déterminismes inférieurs où prétendent nous enfermer ces « rationalistes » dont l’engagement n’a d’autre fin que la destruction pure et simple de la raison. Quiconque croit, par exemple en la légitimité exclusive du « démos » à gouverner toute chose, y compris ce qui échappe, de fait, à ses prérogatives, doit faire son deuil de la raison qui, par nature, est hostile « au sommeil de la brute et à la convulsion du fauve ». A Joseph de Maistre écrivant : « Il n’y a rien de pire que la foule », Gérard de Nerval renchérit : « Fatale époque d’aveuglement, de doutes et de haines mortelles, où la Providence n’intervient plus par les éclairs du génie, mais par les forces déchaînées des éléments et des passions ». Et ceci encore : « C’est un triste appel celui qui se fait, au nombre d’une part, et de l’autre à la force : au courage sans raisonnement, à la foule sans moralité ». Point d’envol qui d’emblée on s’englue dans l’Opinion. Aux esprits ouraniens, en revanche, à ceux qui manifestent leur préférence pour l’esprit de l’air, et contre le démon calibanesque, la chance est offerte de gravir l’échelle du vent, – qui nomme cette hiérarchie que nous évoquions, qui n’a, en soi, rien d’administratif, ni même de militaire.
Que les esprits vétilleux cherchent encore à démêler le tien du mien, à répartir ce qui appartient au christianisme et ce qui appartient au paganisme, il n’importe. Nous savons par l’Aurélia de Gérard de Nerval que les dieux antiques dorment à peine derrière les plus fines apparences du Songe et du Réel, et par Joseph de Maistre, prédécesseur capital de René Guénon, qu’il est une tradition antérieure à tous les dogmes. Une identique menace pèse désormais sur toutes les formes de l’esprit, et cette menace s’accroît de tout ce qu’elle divise en prévision de son règne sans nuance. « La génération présente, écrit Joseph de Maistre, est témoin de l’un des plus grands spectacles qui jamais ait occupé l’œil humain : c’est le combat à outrance du christianisme et du philosophisme. La lice est ouverte, les deux ennemis sont aux prises, et l’univers regarde. » Le « philosophisme », en l’occurrence, c’est l’ « isme » qui ne se soucie plus ni de l’amour ni de la sagesse, – tout entier livré au despotisme de ses bonnes intentions meurtrières.
Gérard de Nerval lui répondra, dans Quintus Aucler, par cette question : « S’il était vrai, selon l’expression d’un philosophe moderne que la religion chrétienne n’eût guère plus d’un siècle à vivre encore, – ne faudrait-il pas s’attacher avec larmes et prières au pieds de ce Christ détaché de l’arbre mystique, à la robe immaculée de cette Vierge mère, expression suprême de l’alliance antique du ciel et de la terre, – dernier baiser de l’esprit divin qui pleure et qui s’envole ? »
Luc-Olivier d’Algange
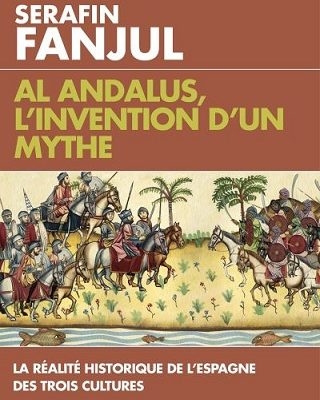 Faut-il répondre aux attaques insidieuses, aux violences verbales, aux débordements de haine des historiens polémistes qui contestent l’existence du mythe d’al-Andalus? Pour ma part, j’ai toujours préféré le silence réprobateur à la polémique partisane estimant que celle-ci ne mène à rien et qu’elle est une perte de temps. Mais une fois n’est pas coutume et je me sens aujourd’hui le devoir d’éclairer le lecteur qui se laisserait abuser de bonne foi par le discours captieux et malveillant de quelques spécialistes ou prétendus tels.
Faut-il répondre aux attaques insidieuses, aux violences verbales, aux débordements de haine des historiens polémistes qui contestent l’existence du mythe d’al-Andalus? Pour ma part, j’ai toujours préféré le silence réprobateur à la polémique partisane estimant que celle-ci ne mène à rien et qu’elle est une perte de temps. Mais une fois n’est pas coutume et je me sens aujourd’hui le devoir d’éclairer le lecteur qui se laisserait abuser de bonne foi par le discours captieux et malveillant de quelques spécialistes ou prétendus tels.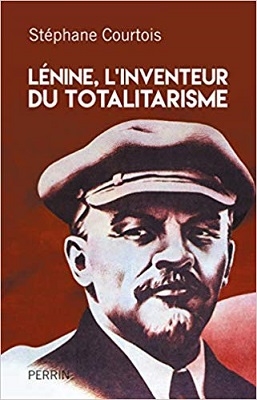 Stéphane Courtois, Lénine, l’inventeur du totalitarisme, Perrin, 2017, 500 p.
Stéphane Courtois, Lénine, l’inventeur du totalitarisme, Perrin, 2017, 500 p. Ayons aujourd'hui, d'abord, une pensée pour rendre hommage aux soldats français tombés en Afrique pour la défense de l'Europe. Elle nous renvoie hélas aux centaines de milliers de nos grands-parents sacrifiés entre 1914 et 1918, dans un conflit européen, sans que nos dirigeants aient su empêcher par leurs décisions de 1919 que les combats reprennent en 1939.
Ayons aujourd'hui, d'abord, une pensée pour rendre hommage aux soldats français tombés en Afrique pour la défense de l'Europe. Elle nous renvoie hélas aux centaines de milliers de nos grands-parents sacrifiés entre 1914 et 1918, dans un conflit européen, sans que nos dirigeants aient su empêcher par leurs décisions de 1919 que les combats reprennent en 1939. Tout a été dit au long des débats de 1919 à la Chambre des députés...
Tout a été dit au long des débats de 1919 à la Chambre des députés... L’Enquête sur la Loi du 3 janvier est un livre choc.
L’Enquête sur la Loi du 3 janvier est un livre choc.