
Entretien avec le colonel Michel Goya, propos recueillis par Philippe Mesnard
« Jamais une organisation française, comptant plusieurs millions d’individus, ne s’est aussi radicalement et rapidement transformée que l’armée française pendant la première guerre mondiale.»
Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en préparant votre livre ?
La faiblesse américaine, le décalage entre l’historiographie américaine et la réalité du terrain. Si le conflit avait duré, l’armée américaine, en 1919, aurait été la plus puissante – et on peut d’ailleurs se demander si signer l’armistice en novembre 18 était pertinent. Mais les Américains n’interviennent véritablement qu’en septembre 1918, sans d’ailleurs être remarquables, comme la bataille de l’Argonne en témoigne. Ils en tireront beaucoup d’enseignements, d’ailleurs, sur l’organisation, l’équipement… Les Américains sont le seul pays à avoir eu plus de morts par accident et par maladie qu’au combat. L’autre surprise, c’est l’état de déliquescence de l’armée allemande, alors que l’historiographie reprend l’argument politique d’une armée invaincue, rentre en bon ordre, trahie par l’arrière : le fameux « coup de poignard dans le dos ». Ni Ludendorff ni Hindenburg ne seront là pour signer l’armistice, ce n’est pas l’armée qui capitule. Mais c’est faux. L’état-major allemand le sait bien qui s’est discrètement retiré de la conduite du pays dans les dernières semaines et a remis en avant, pour négocier la paix, un pouvoir civil très falot jusque-là. Dans les faits, les Allemands ne se battent plus, en novembre 1918. La Belgique est peuplée de centaines de milliers de déserteurs allemands qui ne résistent plus – au point, une fois encore, que certains combattants ne comprennent pas que les opérations ne soient pas allées jusqu’en Lorraine, au Rhin . Choses qu’on fera pendant la Seconde Guerre mondiale : pas d’armistice puis de longs pourparlers de paix. Et ce sont les maréchaux allemands qui viendront signer la capitulation. En 1918, sans aucun doute, l’armée allemande avait été vaincue sur le terrain, en France et en Belgique.
Cent ans après l’armistice du 11 novembre 2018, les Français ne retiendraient de la Grande Guerre que la souffrance, l’horreur… Les trois premières années, pour ainsi dire, faites de défaites et de désillusions. Un voile sinistre recouvre désormais la guerre de 14-18.
Sur “l’objet guerre” lui-même, il y a une dépolitisation, alors que la guerre est un acte politique : il y a des morts mais ce n’est ni une épidémie, ni une catastrophe naturelle. Des entités politiques s’affrontent par les armes, et il n’y avait aucune ambiguïté dans l’esprit des gens de l’époque : les soldats savaient qu’ils devaient défendre leur pays contre l’invasion allemande, et que cela nécessitait des efforts et des risques. Les tranchées n’étaient pas un méchant hasard qui les contraignait à vivre une vie de souffrances. Quand on regarde l’historiographie telle qu’elle a évolué, on voit que le 11 novembre n’est plus la célébration de la victoire, mais seulement celle de la fin des souffrances, comme si la seconde ne dérivait pas de la première… Et il faut pointer un autre phénomène : cette victoire est d’abord une victoire française. Ce sont les Français qui, durant la guerre et jusqu’à la fin, ont supporté le principal effort. L’historiographie efface peu à peu cette contribution française à la victoire finale. On peut le comprendre chez les historiens britanniques, qui n’ont aucun scrupule à survaloriser le rôle de leurs forces armées, c’est plus surprenant chez les Français : à les lire, on a l’impression que, passées l’offensive Nivelle et les mutineries, l’armée française n’existe plus. J’ai voulu montrer à quel point la France avait eu un rôle capital dans la victoire, et à quel point cette victoire n’était pas seulement due aux efforts et aux sacrifices des combattants mais aussi à l’intelligence : jamais une organisation française, comptant plusieurs millions d’individus, ne s’est aussi radicalement et rapidement transformée que l’armée française pendant la première guerre mondiale. L’armée de 1918 a plus à voir avec l’armée d’aujourd’hui qu’avec celle de 1914.
Vous soulignez dans votre livre deux évolutions : technique, avec tous les nouveaux matériels inventés en fonction des nouveaux impératifs du combat (inventés et améliorés en permanence) ; stratégique, avec une doctrine qui évolue sans cesse : on conceptualise la troisième dimension, par exemple, et c’est la stratégie qui sert de moteur à la technologie.
Comme dans toute bonne stratégie, il y a une rencontre entre la doctrine et les moyens. À la fin de 1917, la première armée de renfort des Français, ce ne sont pas les Américains mais les machines. Au deuxième semestre 1917, l’industrie française produit autant que dans toutes les années précédentes. L’arsenal des démocraties, c’est la France : c’est elle qui équipe les Balkans, les Américains – au détriment des Français : Patton a des troupes et des chars français sous ses ordres. Alors même que les Allemands ont envahi plusieurs régions industrielles françaises. De nouvelles unités de combat sont créées : 80.000 camions (autant que toutes les armées du monde réunies) transportent des troupes, très vite, sur n’importe quel point du front, et, à partir de mai 1918, des chars légers, l’aéronautique est puissante (en ratios, une division française d’infanterie est appuyée par quarante avions, là où les Allemands ne peuvent en aligner que vingt), trente-sept régiments sont équipés en canons de 75 tirés par des camions et non plus par des chevaux – alors qu’en 1914, la logistique était quasi-napoléonienne. La doctrine Pétain, qui renonce au mythe de la grande offensive décisive, exige qu’on puisse multiplier les “coups”, les batailles, donc exige une grande mobilité rapide : à la fin de la guerre, on est capable d’imaginer et de réaliser en deux-trois semaines une opération nécessitant de déplacer plusieurs dizaines de milliers d’hommes ; c’est un miracle de management. Les Britanniques sont bons aussi, mais leur corps expéditionnaire ne représente que 40% des forces françaises ; les Américains aussi, mais ils n’auront de véritable impact sur la conduite de la guerre qu’au deuxième semestre 1918.
C’est le paysage français lui-même qui change : les chemins de terre où vont les charrettes sont remplacés par des routes goudronnées à deux voies. Même les populations civiles ont gagné la guerre : elles se sont adaptées.
Les Français ont eu le taux de mobilisation le plus élevé de toutes les nations combattantes mais on parle assez peu du million de travailleurs étrangers qui sont venus renforcer l’appareil industriel. Tout le réseau ferré est modifié, on crée des routes, avec des nœuds de communication, pour fluidifier tous les mouvements au plus près du front. Là aussi, tout se fait sur un pied inédit et même inimaginable en 1914, au point que l’organisation de la France pendant la Première Guerre mondiale (et celle de l’Allemagne dans une moindre mesure) servira de modèle aux économies planifiées d’après-guerre, comme celle de l’URSS : l’État a fait la preuve qu’il était capable d’organiser la production à très grande échelle.
Votre livre débute en 1917, au moment où les choses basculent : le commandement prend conscience qu’il faut changer de méthodes. Foch devient généralissime, les Anglais – et les autres généraux français – ayant enfin accepté l’idée d’un commandement unique.
Au-delà des rivalités nationales et des rivalités de personnes, le commandement est réorganisé, les fronts sont dissociés et le gouvernement choisit Nivelle comme commandant des armées – choix technique pertinent, car c’est lui le vrai vainqueur de Verdun, mais surtout choix politique, car c’est le plus jeune des généraux, le plus “contrôlable”. Ce sera désastreux, avec la boucherie du Chemin des Dames, qui déclenchera les mutineries. Pétain s’impose alors comme le meilleur des généraux du moment, celui qui a le mieux compris la nouvelle nature du conflit. C’est lui qui va réorganiser l’armée, imposer une doctrine et créer l’instrument de la victoire. Fin 1917, alors que les Allemands bénéficient du retrait de la Russie et sont donc capables de jeter de nouvelles forces sur le front français, Foch remet sur la table la question du commandement général des armées. Il suffit d’une percée allemande sur les positions britanniques pour convaincre tout le monde de cette nécessité. Entre un Foch agressif et un Pétain placide, l’armée française devient encore plus efficace.
Vous décrivez la manière dont l’amirauté allemande pousse à la guerre sous-marine à outrance en mésestimant les risques d’entrée en guerre des États-Unis. On a l’impression que les états-majors sont perpétuellement surpris par les conséquences de leurs décisions, leurs effets secondaires, à cause de l’ampleur du phénomène « guerre totale » : mécanique, nombreuse, étendue comme aucune guerre ne l’a jamais été ?
Les Allemands surestiment en effet leurs forces et les effets de leurs actions, et sous-estiment les réactions de leurs ennemis. L’Allemagne aura manqué d’une véritable conduite stratégique de la guerre, alors que les Alliés réussissent mieux à coordonner les instruments de puissance. Les Allemands laissent les Britanniques débarquer en France sans que leur marine intervienne, ou envahissent la Belgique sans se poser la question des conséquences diplomatiques (croyant que la guerre se gagnera en quelques semaines). L’ambassade allemande va jusqu’à organiser des sabotages sur le sol même des États-Unis ! ou propose une alliance au Mexique s’il désire déclarer la guerre à leur voisin… A la fin de la guerre, quand Ludendorff gère, dans les faits, le pays, il consacre toutes les ressources à l’effort de guerre, allant jusqu’à réquisitionner tous les chevaux, ce qui ruinera ce qui reste d’agriculture allemande… Toute la conduite de la guerre est une série de paris perdus.
Ce qui amène la victoire française, c’est la volonté de gagner, au point de se réinventer de fond en comble, du matériel au moral. En 1919, l’armée française est victorieuse et est devenue le gendarme de l’Europe. Vingt ans plus tard, c’est une armée qui n’a plus envie de gagner, et vous dites que la campagne de France aurait pu être gagnée si le désir de victoire avait été aussi vif qu’en 1918.
Gamelin, en 1940, a l’âge de Foch en 1918 : on ne réécrit pas l’histoire mais un Foch en 40 n’aurait sans doute pas donné la même chose… Surtout, l’outil militaire s’est rigidifié, a perdu de son inventivité. Le gouvernement a d’autres priorités que ses armées suréquipées, il gèle la production. Les compétences techniques se perdent, notamment en aéronautique. Et la doctrine a évolué : la France est un vainqueur qui a peur du vaincu, au potentiel humain et industriel bien plus fort. Ceux qui préconisent la normalisation des rapports avec l’Allemagne, comme les Anglo-Saxons, gagnent contre ceux qui préconisent une vigilance sans faille, les Français, et préconisent donc d’occuper et de démilitariser l’Allemagne et de garder une armée française très mobile. La détente prévaut, la stratégie devient défensive, la durée du service se réduit (sans qu’on puisse, donc, former des techniciens), l’armée ne se soucie plus que d’établir des lignes et non plus d’aller porter rapidement la guerre chez l’ennemi. Au moment de l’arrivée au pouvoir d’Hitler, le gouvernement français réduit considérablement les budgets militaires. On se réveillera en 1937, trop tard.
Le colonel Michel Goya, enseignant et auteur français, est spécialiste de l’histoire militaire et de l’analyse des conflits. Il vient de publier :
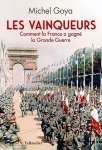 Les Vainqueurs – Comment la France a gagné la Grande Guerre. Tallandier, 2018, 320 pages, 21,50€.
Les Vainqueurs – Comment la France a gagné la Grande Guerre. Tallandier, 2018, 320 pages, 21,50€.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire